
Paola Tabet – La construction sociale de l’inégalité des sexes. Des outils et des corps
Paola Tabet, La construction sociale de l’inégalité des sexes. Des outils et des corps, Paris, L’Harmattan, 1998
« Les mains, les outils, les armes », paru une première fois en langue française dans L’Homme (principale revue française d’anthropologie) en 1979[1] au sein d’un numéro thématique intitulé « Les catégories de sexe en anthropologie sociale », et « Fertilité naturelle, reproduction forcée », paru une première fois dans L’Arraisonnement des femmes en 1985[2] aux éditions de l’EHESS, sont deux textes de l’anthropologue italienne Paola Tabet, professeure d’anthropologie à l’Université de Calabre et également auteure en langue française de La grande arnaque. Sexualité des femmes et échange économico-sexuel[3]. Ils ont tous deux été réédités en un volume intitulé La construction sociale de l’inégalité des sexes. Des outils et des corps en 1998, et ce dans l’excellente collection « Bibliothèque du féminisme » des éditions L’Harmattan.
Il s’agit de deux textes importants de l’anthropologie féministe matérialiste. L’un, « Les mains, les outils, les armes », parce qu’il revisite l’inégalité sociale de genre et la division genrée du travail, objets centraux de l’anthropologie, sous l’angle « matérialiste » de la répartition (inégalitaire) des outils. L’autre, « Fertilité naturelle, reproduction forcée », parce qu’il considère de manière novatrice la reproduction non comme un donné naturel, mais comme une production socialement organisée.
Je me contenterais ici de faire une synthèse des deux articles de Paola Tabet, sans chercher à en faire une actualisation (aujourd’hui, on parlerait de division genrée du travail et non de division sexuelle du travail, de genre et non de sexe, etc.) et sans critiquer son utilisation non-spécifique du concept de travail. J’invite cependant mes lectrices et mes lecteurs à lire cette synthèse en l’actualisant de leur côté.
« Les mains, les outils, les armes »
Paola Tabet commence son article en disant qu’il n’y a pas eu jusqu’ici [1979] d’étude systématique satisfaisante d’un aspect central de la division sexuelle du travail : la répartition des outils en fonction du sexe et leur impact en termes de division (inégale) du travail et de domination masculine. Pour elle, il y a eu principalement en anthropologie jusqu’ici une lecture de la division sexuelle du travail comme complémentarité naturelle des sexes s’entre-aidant. Elle cite, comme exemples, les travaux de Godelier (qui en parle en termes de « destin »[4]), de Leacock (qu’elle critique en considérant qu’il n’y a pu avoir d’accentuation des inégalités hommes-femmes suite à la colonisation qu’en raison du terreau inégalitaire de ces sociétés) ou encore de Leroi-Gourhan. Elle remarque qu’à chaque fois, « complémentarité » est non seulement synonyme d’une division équilibrée, d’une répartition d’activités d’importance égale, mais également elle est postulée comme d’origine naturelle. Tabet effectue ensuite une critique de Murdock et Provost[5], montrant notamment qu’ils attribuent aux femmes des avantages « naturels » moindres dans l’exercice de tâches physiques difficiles, d’où un soi-disant monopole masculin « naturel » de ces activités, alors qu’en réalité les femmes en effectuent un grand nombre (portage de l’eau et du bois, désherbage, etc.). Elle rappelle également que les activités des femmes sont définies sur une base négative, par leur exclusion de tâches réservées aux hommes. Contre cette lecture complémentariste et « naturalisante » de la division sexuelle du travail, qu’on retrouve selon elle y compris chez les anthropologues reconnaissant l’importance qu’a le monopole masculin sur la chasse, la guerre et les armes dans l’inégalité hommes-femmes, Paola Tabet fait référence (comme Gayle Rubin dans The Traffic in Women[6]) aux travaux de Lévi-Strauss, qui a fait de la division sexuelle du travail « un moyen d’instituer un état de dépendance réciproque entre les sexes[7] », et de Maxine Molyneux, pour qui elle doit « être conceptualisée comme une construction sociale » et que postuler son caractère naturel « dissimule l’existence d’importants mécanismes socialement déterminés qui s’articulent avec la « biologie » »[8]. Paola Tabet s’inscrit dans cette vision « constructiviste », anti-naturaliste de la division sexuelle du travail, qu’elle considère comme « division socio-sexuée du travail » à l’instar de Nicole-Claude Matthieu[9]. Même au sein des sociétés « égalitaires », pour elle, la division du travail est inégalitaire, constituant un rapport d’exploitation (elle parle de « rapports de classe entre les deux sexes », une analogie qu’on retrouve également chez Christine Delphy[10]) plutôt que de coopération, ce qui se manifesterait dans une répartition asymétrique des tâches basée sur une exclusion des femmes de certaines tâches et leur assignation à d’autres tâches. Elle fait également référence aux travaux de Rubin[11] autour de l’assignation d’une gender identity socialement construite aux hommes et aux femmes. Son hypothèse principale est qu’il y a un sous-outillage des femmes et un monopole masculin des outils « avancés », ce qu’elle va tenter de démontrer.
Critiquant l’évolutionnisme technologique « androcentrique » de Leroi-Gourhan, Paola Tabet montre au contraire qu’un des deux sexes s’est réservé historiquement un dépassement possible de ses capacités physiques grâce à des outils toujours plus avancés, tandis que l’autre sexe s’est vu limité à son propre corps et aux outils rudimentaires. Pour elle, cela fait écho au statut même d’ « outil » des femmes comme travailleuses, comme reproductrices et comme fournisseuses de services sexuels, exploitation qu’elle qualifie d’ « appropriation matérielle » (qu’elle préfère au concept de « sexage » de Colette Guillaumin). Elle précise néanmoins, à titre de précaution méthodologique, que cette conceptualisation est différemment pertinente en fonction des sociétés, lesquelles doivent donc faire l’objet d’enquêtes de terrain spécifiques.
Paola Tabet entend questionner « l’évidence » de la répartition des outils entre sexes, lesquels seraient « adaptés » à leurs activités distinctes. Outre que cela avalise l’idée que les femmes ne feraient qu’un travail élémentaire et n’auraient donc besoin que d’un outillage simple, l’anthropologue italienne propose un renversement de perspective : les tâches assignées aux femmes seraient déterminées en raison de leur outillage simple, et c’est dans l’accaparement masculin des moyens techniques de production qu’il faut chercher les constantes de la division sexuelle du travail et un des déterminants centraux « du rapport de classe entre hommes et femmes ». Pour cela, Tabet se propose de montrer au travers d’une enquête systémique non seulement un moindre équipement des femmes, mais également une répartition socio-sexuée des tâches en fonction de la complexité de l’outillage (faible pour les femmes, forte pour les hommes). Elle se propose également de montrer qu’il existe une limitation sociale de l’emploi et du contrôle des outils par les femmes, limitation déterminant l’exclusion des femmes de certaines activités, et que cela permet aux hommes de s’assurer un contrôle des moyens techniques de production et en même temps des femmes elles-mêmes. L’anthropologue italienne pense que cela permettrait d’expliquer certaines données statistiques au sujet de la division sexuelle du travail[12] : l’absence d’activité exclusivement féminines et le caractère « résiduel » de ces activités (uniquement lorsqu’elles peuvent être accomplies sans ou avec peu d’outillage, celles-ci revenant aux hommes en cas d’introduction de nouvelles techniques).
Pour ce qui est de la collecte, les femmes en sont globalement responsables en raison d’un outillage rudimentaire (ce qui n’enlève rien à leur savoir et à leur contribution alimentaire, précise Tabet), en-dehors d’une exception où il y a un quasi-monopole masculin, la récolte du contenu des troncs d’arbres, qu’on coupe justement à l’aide d’une hache. Les femmes, en Australie, doivent généralement se contenter de bâtons à fouir (objet « pénible et peu efficace » selon Leroi-Gourhan) et de couteaux grossiers, alors que les hommes sont munis de couteaux améliorés, de haches, de boucliers, de lances, de boomerangs et de propulseurs. Dans une tribu aborigène, selon un anthropologue que cite Tabet, « plus complexe est la technologie, plus la participation des hommes y est importante, et plus les processus technologiques sont simples, plus les femmes participent »[13]. Les hommes !Kung du désert du Kalahari, eux, excluent les femmes de la chasse, et leur réservent des journées de cueillette épuisantes (avec un parcours moyen entre 3 et 30 kilomètres, transportant sur leur dos des enfants pesant jusqu’à 12 kilos et des végétaux entre 7 et 15 kilos), s’accaparant l’ensemble des activités nécessitant des outils complexes et des savoirs « avancés » (feu, travail des matières premières, fabrication et utilisation des armes). Tabet nuance donc le tableau « égalitaire » qu’on a généralement dressé de cette société. Pour ce qui est des Yamana (Terre de feu, Argentine), les femmes utilisent des outils primaires dans l’optique du ramassage des fruits de mer et ne cessent de travailler, contrairement aux hommes qui disposent d’outils plus avancés et de temps libre. De manière générale, note Tabet, les femmes dépendent des hommes même pour fabriquer ces outils primaires, ceux-ci ayant un monopole du savoir-faire de fabrication.
La chasse est, elle, une activité principalement masculine, mais Tabet s’intéresse au cas où les femmes participent à cette activité pour en dégager des constantes en termes d’outils et de limites. Sauf exception, les hommes fabriquent et utilisent des armes perforantes (arcs, harpons, etc.), les femmes ne disposant elles que d’ustensiles ménagers (couteaux, massues). Les femmes peuvent disposer d’armes perforantes dans de rares sociétés (Inuit, Ojibwa), mais uniquement dans des périodes de non-conjugalité (en résonance avec les mythes autour des amazones et des vierges chasseresses). Les femmes, le plus souvent, se contentent d’un rôle de rabatteuses et de pagayeuses, activités extrêmement physiques mais ne leur valant aucun droit à du temps de repos, et décisives mais ne leur valant aucune considération. Lorsqu’elles chassent elles-mêmes, elles doivent se contenter de cailloux, de bâtons, de petites massues, d’arcs munis de flèches à pointe globuleuse, de chiens ou encore de pièges en fibres végétales. Les hommes peuvent également chasser avec ces armes, observe Tabet, mais les femmes ne peuvent jamais utiliser des armes « masculines » : ce n’est donc pas la chasse qui est interdite aux femmes, mais bien l’accès à des armes performantes (ce qu’explique Alain Testart, de manière non-matérialiste, par « l’idéologie du sang »[14]).
Pour ce qui est de la pêche, les femmes disposent de davantage d’outils à leur disposition, et souvent il s’agit d’outils fabriqués à partir de matériaux qu’elles travaillent. Elles ne peuvent cependant contrôler l’ensemble du processus technique en raison du contrôle masculin du savoir-faire de fabrication des embarcations, souvent indispensables. Surtout, les femmes sont exclues de la pêche à perforation balistique (harpons, flèches) exclusivement masculine, se contentant de la pêche menée à l’aide de parois immobilisantes (filets, pièges) et de perforations non-balistiques (croches, hameçons). L’anthropologue italienne explique qu’il s’agit là d’un aspect de l’interdit général des armes performantes imposé aux femmes, et qu’ici comme ailleurs cela entraîne une moindre productivité des pêches féminines (c’est donc contre-productif au niveau des ressources alimentaires d’une société donnée). La pêche masculine, elle, est moins fréquente, rapporte moins de ressources alimentaires (malgré une supériorité technique), mais est plus prestigieuse. Une autre exclusion se dessine lorsqu’on considère l’activité de pêche comme un complexe technique, selon Tabet. Les femmes sont en effet exclues de la pêche éloignée du rivage de par leur exclusion des embarcations développées (en-dehors donc des canots d’écorce et des pirogues basiques) dont l’utilisation se masculinise plus elles sont complexes. Les hommes disposent ainsi d’un monopole des armes et des embarcations complexes, et donc d’un contrôle (relatif) des activités de pêche. Tabet prend l’exemple de Tikopia (îles Salomon) et de Buka (île de Nouvelle-Guinée) pour démontrer qu’au final, les femmes sont souvent contraintes de pêcher à main nue.
L’agriculture, enfin, n’est pas en reste en termes d’exclusion des femmes de certains outils. Les femmes sont généralement exclues de l’usage de la charrue[15] et doivent se contenter de la houe, moins performante. Dans certaines sociétés, les femmes prennent même en charge l’ensemble de l’activité agricole en compagnie d’esclaves razziés, les hommes étant libérés des activités agricoles. Encore une fois, l’invention de nouveaux outils plus efficaces (charrue) conduit à une masculinisation de l’activité[16] (en l’occurrence, du labour). Au sein des sociétés sans charrue, généralement, les femmes n’ont que des bâtons à fouir et des houes, employés habituellement dans l’activité de cueillette, tandis que les hommes disposent d’outils (haches, coupe-coupe, etc.) généralement utilisés au sein des chasses masculines. Elle remarque également que les outils employés pour les travaux de défrichage et de construction de palissades, travaux réservés quasi-exclusivement aux hommes, sont en même temps des outils et des armes, et permettent aussi de fabriquer des outils, d’où l’exclusion des femmes de ces activités. Tabet met alors en parallèle l’agriculture avec la pêche, avec une double interdiction faite aux femmes d’employer des outils-armes et des instruments de productions (charrue dans un cas, embarcation dans l’autre) : il s’agit ainsi d’interdire aux femmes une meilleure productivité ou un plus grand prestige, tout en assurant aux hommes un contrôle du cycle productif et une subordination des femmes malgré le fait qu’elles assurent une majorité des travaux. Tabet poursuit en montrant que si les hommes sont aussi dépendants des activités des femmes que celles-ci des activités des hommes, les hommes ont l’avantage stratégique de savoir effectuer les tâches des femmes tandis que celles-ci ne peuvent pas effectuer celles des hommes. S’il ne faudrait pas exagérer l’importance des outils dans le contrôle masculin des femmes, force est de constater que la possession exclusive des outils en fer par les aînés est un moyen de contrôle central des femmes et des cadets chez les Gouro de Côte-d’Ivoire[17], par exemple. L’introduction d’outils en fer et en acier chez les Baruya a d’ailleurs eu l’effet d’accroître le temps libre des hommes et au contraire d’augmenter le temps de travail des femmes, exclues de l’utilisation de ces nouveaux outils[18]. Le défrichage est un autre exemple intéressant, poursuit Tabet : les femmes y contribuent par du débroussaillage à l’aide de leurs mains ou d’outils rudimentaires, par le transport et l’amoncellement du produit des coupes des hommes, et enfin par le nettoyage du champ après qu’il ait été brûlé, activités épuisantes, absolument nécessaires mais non valorisées socialement ; mais les hommes se réservent la coupe des arbres (hautement prestigieuse) au travers du monopole des haches, plus efficaces, symboles de virilité et marques de prestige. De manière générale, lorsque l’agriculture est pratiquée par les deux sexes, ce sont les opérations rébarbatives, exténuantes et ininterrompues qui sont assignées aux femmes.
Tabet poursuit sa démonstration au sujet de l’artisanat. Encore une fois, les femmes sont sous-équipées, et une masculinisation de l’activité se produit lors d’améliorations techniques. Ainsi, le broyage des céréales, labeur épuisant, est réservé aux femmes lorsqu’il s’effectue à l’aide d’outils rudimentaires (mortier, pilon, meule, petit moulin manuel) ou aux femmes et aux esclaves lorsqu’on utilise des meules manœuvrées par plus d’une personne, tandis que le moulin à eau ou à vent est l’objet d’un monopole masculin. La poterie sans tour, de même, est de manière écrasante une activité de femmes, contrairement à la poterie avec tour qui est souvent une activité masculine. Pour ce qui est du tissage, même monopole des hommes des métiers à pédales, même cantonnement des femmes aux métiers horizontaux ou verticaux (moins performants).
Tabet conclue alors en affirmant qu’au sein des sociétés pré-étatiques, le monopole masculin des armes-outils est au fondement de la domination masculine et de l’assujettissement des femmes, et ce non seulement parce qu’elles donnent aux hommes un monopole des instruments de coercition physique, mais aussi parce que les armes-outils sont des instruments bénéficiant prioritairement des avancées technologiques, lesquelles débouchent au fil du temps sur une supériorité des outils masculins face aux outils féminins. D’autre part, la mécanisation accentue le pouvoir des hommes, puisqu’on passe d’une situation où les hommes contrôlent surtout les savoir-faire de fabrication à un monopole complet des hommes sur les instruments de production devenus mécaniques. Pour autant, les femmes ne sont pas exclues de la production mécanique, mais elles sont encore davantage subordonnées, utilisées comme force motrice ou assistantes dans le procès de production mécanique, à côté de leurs activités traditionnelles où elles continuent de travailler avec des outils rudimentaires ayant un faible rendement. Les femmes sont donc limitées à leur corps, on leur refuse l’accroissement de leur puissance d’agir aux moyens de techniques avancées. Au final, l’explication de la division sexuelle du travail fondée sur « l’avantage masculin dans la force physique […] ne semble guère adéquate »[19], et celle fondée sur un sous-équipement des femmes davantage corroborée empiriquement. Et ce sous-équipement socialement construit va jusqu’à une dépendance des femmes vis-à-vis des hommes pour la fabrication des outils rudimentaires dont elles se servent : dépossédées des armes et des outils complexes, elles sont également dépossédées des techniques de fabrication d’outils, assurant un contrôle complet des hommes sur leurs activités. Ainsi Tabet termine-t-elle en expliquant que l’impossibilité pour les femmes de se fabriquer des outils et des armes, le monopole masculin sur les moyens de coercition violente et le sous-équipement des femmes ont certainement été des conditions sine qua non de l’appropriation du travail et de la sexualité des femmes. Et il est vrai que le monopole masculin des savoir-faire complexes, des outils complexes et des armes est sans doute un élément décisif de la domination masculine si on se place d’un point de vue matérialiste.
Certes, ce texte n’est guère irréprochable. L’avancée technologique ne se traduit pas forcément par une masculinisation de l’activité, notamment en Occident avec l’introduction de l’électroménager. Il faudrait donc préciser que c’est uniquement lorsque l’avancée technologique se fait dans un secteur de production socialement valorisé que cette masculinisation se produit. Mais surtout, le monopole masculin des armes reste encore largement d’actualité.
« Fertilité naturelle, reproduction forcée »
Dans cet article, Tabet s’attaque aux arguments naturalistes, y compris en anthropologie, expliquant l’inégalité femmes-hommes par des contraintes biologiques liées à leur rôle reproductif. Elle critique une vision de la procréation comme un fait purement extra-social, ne devenant social qu’a posteriori aux moyens de rituels. Outre que cela viole l’axiome fondateur des sciences sociales selon lequel un fait social doit être expliqué par un fait social, cela aboutit à une naturalisation de la domination masculine et des rapports de reproduction. L’anthropologie italienne propose une rupture épistémologique avec ce naturalisme, en rappelant que depuis l’imposition du coït hétérosexuel jusqu’au sevrage de l’enfant, tout est fait social. Depuis, Touraille a poursuivi remarquablement cette déconstruction de la procréation comme « désir naturel » et donc obligatoire (avec des réserves toutefois sur sa reprise acritique des thèses de Richard Dawkins).
Tabet s’attaque d’abord à une distinction entre « fécondité naturelle », définie usuellement comme celle d’une femme n’employant ni contraceptif ni abortif dans l’optique d’une limitation et/ou d’un espace du nombre de naissances, et « fécondité dirigée », définie généralement comme là où il y a une intervention sociale pour limiter le nombre des naissances. Tabet souligne un paradoxe : la limitation des grossesses est considérée comme un fait social, mais pas le fait qu’il y en ait. Pour elle, il s’agit d’un raisonnement idéologique, qu’on retrouve y compris chez Godelier lorsqu’il distingue d’une part les femmes et « leurs grossesses périodiques[20] » (comme s’il s’agissait d’un phénomène naturel, analogue aux saisons) et d’autre part les transactions entre hommes autour de la reproduction comme moyen d’alliance. Le social interviendrait donc a posteriori d’une fécondité débordante spontanée des femmes, naturalisée notamment par une Françoise Héritier, et seule l’intervention sociale (souvent masculine) viendrait y mettre de l’ordre et du sens. On est ici face à un risque perpétuel en sciences sociales, celui de vouloir fonder un fait social ultimement sur un « roc » naturel. Mais n’y aurait-il pas, s’interroge Tabet, un lien à faire entre cette fertilité si « naturelle », si « féminine », et cette intervention si sociale et si masculine ?
En effet, de la capacité de procréer est automatiquement inféré le fait de procréer, comme si les femmes étaient des poules pondeuses. Pourtant, il y a un monde entre la production de gamètes et la production d’enfants, et ce monde c’est celui de l’organisation sociale (et matérielle) de la sexualité et de la reproduction, nous explique l’anthropologue italienne. Tabet dénonce qu’en anthropologie comme en démographie, les rapports de sexe aient été écartés de l’étude de la procréation, et notamment la fréquence du coït, pourtant décisive. Même l’anthropologie proche du féminisme ne s’est pas intéressée aux conditions sociales de la sexualité et de la reproduction. Pour combler ce manque, Tabet se propose d’analyser les mécanismes d’organisation sociale de la reproduction à toutes ses étapes, grâce auxquels on passe d’une simple capacité biologique à une reproduction imposée. Et ce, en partant du postulat épistémologique que la reproduction humaine a un caractère social, en accord avec l’axiome fondamental des sciences sociales. Il s’agira notamment de déterminer, dans une veine matérialiste, s’il s’agit d’un travail, et si l’on peut appliquer à la reproduction les concepts de travail aliéné, d’exploitation ou encore d’appropriation-expropriation du produit.
Paola Tabet commence par une étude de l’organisation sociale de l’exposition au risque de grossesse. Si, en suivant Adorno et Horkheimer, « l’exagération » révèle une condition générale, alors l’utilisation des femmes comme bétail de reproduction au sein des plantations étasuniennes ou des Lebensborn n’est peut-être qu’un cas-limite d’une situation beaucoup plus générale. Tabet, après avoir critiqué un manque d’intérêt des sciences sociales au sujet de l’organisation sociale de l’exposition des femmes au risque de grossesse, rappelle quelques données biologiques : l’espèce humaine est relativement peu fertile, donc il faut de nombreux coïts pour produire une grossesse ; contrairement aux autres mammifères, suite à la perte de l’œstrus, il n’y a pas de synchronicité organique des périodes de fertilité et des périodes de désir sexuel ; il n’y a pas de signe particulier aux périodes de fertilité importante.
Tout cela rend nécessaire, dans une société visant à une production maximale d’enfants, une exposition socialement organisée des femmes à un coït régulier. Pour l’anthropologue, cette exposition (souvent contrainte, d’où la notion désormais juridiquement acceptée de « viol conjugal ») est assurée généralement aux moyens du mariage : les données démographiques confirment d’ailleurs un plus grand nombre d’enfants par femme du côté des femmes mariées. Pour remédier aux périodes de divorce et de veuvage (donc de non-production d’enfants), certaines sociétés (comme les Diola d’Afrique de l’Ouest) obligent périodiquement les femmes à se choisir un mari temporaire. Les femmes sont ainsi réduites à des machines reproductrices : à Manus (Océanie)[21], la femme « vertueuse » est celle qui n’a jamais ses règles, perpétuellement en période de grossesse ou d’allaitement. Tabet critique toute forme de naturalisation du mariage comme lieu naturel, symétrique, égalitaire de réalisation des pulsions sexuelles[22]. Et cela, parce que cela serait oublier l’existence de la domination masculine et du rapport de force (de classe ?) inégal entre hommes et femmes, parce que cela occulterait la construction sociale de la sexualité, et parce que cela assumerait que les pulsions sexuelles ne conduisent qu’au coït hétérosexuel (oubliant l’ensemble des relations sexuelles sans coït et/ou non-hétérosexuelles). Cette naturalisation du mariage est battue en brèche du fait que dans de nombreuses sociétés, il est imposé de force à un ou deux des partenaires.
Le mariage cependant n’est pas seul dans l’organisation sociale d’une régularité du coït hétérosexuel : il y a également l’inculcation du coït comme norme sexuelle et la contrainte au « devoir conjugal ». Cela ne veut pas dire, pour Tabet, que les femmes n’ont pas de désir sexuel ou n’en auraient pas – sinon sous contrainte – pour les hommes, mais plutôt que les désirs sexuels sont exclusivement canalisés (de manière contrainte) vers un seul type de sexualité. La sexualité est, au sein des sociétés de domination masculine, un rapport politique (de classe ?) inégalitaire entre hommes et femmes, et peut-être même « une institution sociale de violence »[23]. Les femmes sont également fréquemment réduites à leur sexe, notamment chez les Hausa de l’Ader (Niger), et cette réduction est organisée matériellement, aux moyens d’une appropriation du produit de leur travail et d’un accès inégal aux moyens de production, aux outils, aux ressources, etc. Pour Tabet, il faut sortir de l’idée que le coït suivi d’une éjaculation est quelque chose de purement « naturel » et non social, alors même qu’il faudrait analyser son imposition comme seule forme de sexualité normale. Il existe en effet une éducation au coït, au travers notamment de rites d’initiation[24], mais également de menaces (jusqu’au meurtre, parfois accompli) et même de viols individuels ou collectifs (rituels ou non) normalisés[25], y compris par les ethnologues en faisant un récit détaillé[26]. Le viol individuel ou collectif est même conçu dans de nombreuses sociétés comme un moyen de dressage sexuel des jeunes filles[27]. Toute cette entreprise de dressage violent a pour but, selon l’anthropologue, de faire des femmes des corps-outils sexuels et de reproduction. Au sein des sociétés n’utilisant pas ces moyens de dressage préalables, le « devoir conjugal » (c’est-à-dire le droit de viol conjugal) va néanmoins de mise, et pour qu’il soit accompli de nombreuses formes de violence (pénétration forcée, coups entraînant des blessures, etc.) sont admises, notamment chez les Baruya. La reproduction joue enfin un rôle de contrôle social, puisqu’une femme enceinte ou allaitant est plus vulnérable et moins mobile.
Une fois ces moyens de soumission contrainte au coït mis en place, l’organisation sociale de la reproduction se charge également d’assurer le succès de l’acte de fécondation, par une surveillance régulière des femmes pour vérifier qu’elles n’utilisent pas de moyens contraceptifs et/ou abortifs et qu’elles ne commettent pas d’infanticide. Certaines sociétés, notamment de chasse et de cueillette, admettent néanmoins un certain contrôle des femmes sur leur reproduction aux moyens de pratiques contraceptives, de l’avortement et de l’infanticide[28]. C’est à ces techniques qu’on attribue une faible croissance démographique des sociétés de chasse et de cueillette, et à un relâchement de ces techniques l’expansion démographique du Néolithique. Les femmes étaient néanmoins surveillées dans de nombreuses sociétés non seulement tout au long de la grossesse, mais également lors de l’accouchement, où l’on surveille que les femmes ne tuent pas « involontairement » leur enfant, surtout à partir du 16ème siècle en Occident. Mais pour ce qui est de l’accouchement, les modalités varient en fonction des sociétés, puisque dans un certain nombre d’entre elles la femme est seule ou au plus assistée exclusivement d’une ou plusieurs autres femmes.
Tabet poursuit en parlant de l’apprentissage masculin dans certaines sociétés des périodes « favorables » de fécondation, destiné à une optimisation de la reproduction. Mais, plus important, elle montre également l’organisation sociale de la réduction du temps de latence entre deux grossesses. Elle rappelle qu’ainsi, en cas d’interruption de l’allaitement, la période anovulaire est rapidement close, et la femme peut concevoir de nouveau. L’anthropologue italienne donne deux exemples de cette interruption sociale de l’allaitement dans l’optique de permettre un nouveau cycle de reproduction : celui de l’infanticide des filles chez les Inuit et celui de la mise en nourrice des enfants à la Renaissance.
Pour ce qui est de l’infanticide des filles, il y a exclusivement des raisons sociales, contrairement à ce que des anthropologues androcentriques ont pu dire : les filles étant interdites de chasser et d’apprendre à se débrouiller sans l’aide des hommes, elles ne pourront nourrir leurs parents lorsqu’ils seront plus âgés, et sont donc considérées comme un poids mort. L’objectif étant néanmoins avant tout d’enclencher un nouveau cycle reproductif, en espérant que l’enfant suivant sera un garçon, les filles sont parfois données pour adoption. L’infanticide des filles inuit, décidé par les hommes et parfois contre l’avis de leurs mères[29], n’est donc pas qu’une limitation de la reproduction, comme il est généralement considéré en démographie, mais aussi et surtout une intensification du travail reproductif (dont certains « produits » sont écartés) des femmes par une multiplication des grossesses.
Certaines sociétés, nomades comme agricoles, n’ont d’autre choix que l’abstinence de coït hétérosexuel pendant une période de 1 à 3 ans pour éviter un sevrage prématuré et ses dangers en termes de survie pour l’enfant. Néanmoins, en cas de conflit entre le « droit » du mari au coït et la nécessité d’un long allaitement maternel, le premier l’emportait fréquemment. Dans certaines sociétés les femmes sont gavées et immobilisées pour s’habituer à ne se consacrer qu’aux désirs sexuels des hommes et à la fonction de reproductrice. Mais au sein des sociétés « de classe », la délégation à une autre femme de l’allaitement est une solution privilégiée par les classes supérieures. Cela permettait de rendre de nouveau libre la femme pour leurs activités professionnelles et/ou des services sexuels à leur mari. Il y avait ainsi une forme de division du travail et de « taylorisation » du travail reproductif, avec un partage des tâches entre deux « machines » spécialisées. Certes, précise Tabet, ce système permet aux bourgeois florentins de produire davantage d’enfants pour leur lignage, et aux ouvriers lyonnais de la même époque davantage de main-d’œuvre pour l’atelier ; mais la mortalité des enfants envoyés en nourrice est très élevée, et les femmes meurent précocement de trop nombreux accouchements. C’est donc loin d’être une technique « rationnelle » en tous points.
L’anthropologie italienne conclue au sujet de toutes ces techniques qu’elles sont loin d’être « naturelles », traduisant au contraire le caractère socialement organisé de la reproduction.
Tabet s’attaque ensuite aux formes d’intervention sociale s’appuyant sur (et apportant de multiples solutions à) un caractère distinction de la biologie humaine : l’absence de lien hormonal déterminant entre pulsion sexuelle et ovulation. Si l’absence de désir sexuel chez une femme n’empêche en rien une reproduction forcée, comme on l’a vu, les sociétés « natalistes » doivent néanmoins régler un problème, celui du caractère potentiellement libre de la sexualité humaine, non conditionnée et même détachée de la reproduction, la reproduction n’étant pas une contrainte inscrite dans les cycles hormonaux (contrairement aux autres mammifères). D’où une sexualité potentiellement polymorphe, pas forcément de type hétérosexuelle et/ou coïtale. L’anthropologue italienne s’attache donc à une description de l’organisation sociale de cette sexualité potentiellement (en raison d’une non-détermination biologique) non-reproductrice, dans l’optique de canaliser celle-ci vers une sexualité reproductrice. Cela s’opère par une distinction institutionnalisée entre des cas (partenaires, âge, etc.) où la reproduction est admise ou même exigée et des cas où la sexualité des femmes ne doit pas être reproductive ; mais également par une hétéro-normativité (même extra-conjugale) et une norme coïtale. Ainsi, s’impose socialement (au moins à certains moments) l’union de la sexualité et de la procréation, alors même que la sexualité humaine n’est pas fondée biologiquement sur cette union.
Toutefois, il existe également une division socialement organisée entre sexualité non-reproductive et sexualité reproductive, étant entendu qu’une majorité des femmes demeure assignée à cette dernière. Il existe ainsi dans de nombreuses sociétés des travailleuses du sexe s’occupant exclusivement de sexualité non-reproductive, et distinguées des femmes reproductrices par des stigmates. La société romaine, par exemple, a divisé les femmes entre courtisanes (pour une sexualité non-reproductive), concubines (pour une sexualité non-reproductive et un travail du care) et épouses (pour une sexualité visant à une production d’enfants légitimes). La sexualité a lieu de préférence de manière extra-conjugale. Les femmes mariées ne doivent pas s’adonner au plaisir, même avec leur mari (et c’est également vrai en France au 19ème siècle, avec un coït monotone souvent forcé d’environ 3-4 minutes, justifié théoriquement par une soi-disant faible pulsion sexuelle des femmes, vision aujourd’hui réfutée scientifiquement). La division du travail sexuel est institutionnalisée : les hommes libres doivent toujours être « actifs », même au sein de relations « homosexuelles » (Philippe Ariès parle d’une « bisexualité de sabrage »), et les femmes (libres ou esclaves) doivent toujours être « passives » et hétérosexuelles. Pour revenir aux travailleuses du sexe, elles ne sont pas censées procréer, en revanche elles demeurent soumises aux mêmes normes. La prostitution est ainsi vue, dans de nombreuses sociétés, comme un « mal nécessaire » visant à éviter des pratiques « homosexuelles ».
L’autre forme de division du travail sexuel s’effectue en fonction de l’âge : les jeunes femmes pré-nubiles ont droit à une sexualité ayant une visée non-reproductive (hétérosexuelle, coïtale, souvent obligatoire sous peine de viol : il ne s’agit pas de « liberté sexuelle ») ; ensuite, les femmes à partir d’un certain âge sont assignées à une sexualité conjugale ayant un but reproductif. Les hommes, eux, ne subissent pas ce genre de contraintes. L’anthropologue italienne explique cette sexualité non-reproductive des jeunes femmes pré-nubiles comme d’une part une spécialisation de ces jeunes femmes en femmes « de plaisir », par opposition aux femmes reproductrices, et comme d’autre part un moyen pour les aînés de détourner les jeunes hommes des femmes nubiles et du pouvoir politique en encourageant une sexualité hyperactive non-reproductrice. La grossesse des jeunes femmes pré-nubiles, quoiqu’il en soit, est évitée aux moyens du retrait ou de l’avortement et de l’infanticide socialement imposés (notamment dans le cas des Rukuba du Nigeria[30]. Être mère n’est pas avant tout une possibilité biologique, c’est un statut social[31]. Tabet prend un exemple des effets de cette division entre période de sexualité non-reproductive et période de sexualité reproductive chez les Yap (îles Carolines). Au cours de la première période, il est encore possible de rompre tant qu’il n’y a pas d’enfants, même après le mariage. Mais la femme est obligée de procréer parce qu’elle n’a accès à la terre que sous cette condition ; et une fois enceinte, dans cette société interdisant les contraceptifs, l’avortement et aussi l’infanticide, la femme devient complètement dépendante. Les femmes voulant garder leur autonomie n’en réalisent pas moins de nombreux avortements : l’avortement secret est un moyen de résistance des femmes au mariage et à ses contraintes. Chez les Hausa de l’Ader (Niger)[32], les jeunes femmes sont d’abord vouées à une sexualité non-reproductive, avec plusieurs partenaires et partiellement coïtale, visant au plaisir des deux partenaires mais surtout de l’homme (la jeune fille ne peut refuser une avance). Ce processus d’inculcation du coït hétérosexuel comme norme appelé tsarance s’achève par le mariage, période de soumission sexuelle à un seul partenaire en vue de la reproduction, avec un coït imposé, subi comme violence et se pratiquant avec violence. Le processus se termine avec l’écrasement de la glande mammaire pour faire des femmes des reproductrices.
Du dressage des femmes au viol conjugal et aux mutilations physiques, c’est ainsi tout un processus de contrainte sociale visant à la transformation chez les femmes d’une sexualité non-reproductrice, polymorphe, désirante en une sexualité reproductrice, coïtale-hétérosexuelle, contrainte : en une sexualité domestiquée. L’excision, typiquement, vise ainsi à une élimination de la dimension non-reproductive de la sexualité féminine. Tout ce processus aboutit à de nombreux traumatismes, qu’ils soient d’ordre physique (complications résultant de l’excision) ou d’ordre psychologique (« frigidité »). La reproduction (forcée) se révèle ici un processus socialement contraignant de suppression (physique ou simplement social) du désir sexuel des femmes. Ici, Tabet renverse l’idéologie du « désir » des femmes d’être mère, en montrant que la contrainte sociale à la reproduction est en réalité une négation du désir (sexuel) des femmes et de leur épanouissement.
Cette partie s’ouvre sur une citation de Colette Guillaumin : « Là était révélé un système de classe si parfaitement au point qu’il en était resté longtemps invisible »[33]. Paola Tabet envisage un renversement de perspective : si, au lieu de considérer la reproduction comme quelque chose d’extérieur aux rapports de classe et au travail productif, on considérait celle-ci comme un rapport de classe et un travail ? En effet, à partir du moment où la reproduction a été décrite comme étant généralement une contrainte sociale imposée par une classe d’individus (les hommes) à une autre classe d’individus (les femmes) et comme une activité contrainte (laquelle est une définition minimale du travail au sens marxiste), il est possible de conceptualiser ainsi la reproduction. Faisant indirectement référence à la définition de Marx du travail comme dépense d’énergie, elle rappelle que la dépense d’énergie nécessaire à la grossesse et aux trois premiers mois d’allaitement est d’environ 144 000 kilos calories, soit l’équivalent de 320 heures de défrichage de forêt ou de coupe de bois, et qu’une journée d’allaitement demande une énergie analogue à celle de 2 heures de coupe de bois (ou 9 heures de marche). D’où, comme les femmes dans une majorité de sociétés ne cessent pas pour autant de travailler pendant cette période ni n’ont accès à une nourriture supplémentaire, un état d’épuisement et de surmenage de l’organisme maternel (perte de poids, vieillissement prématuré, surmortalité). Tabet dénonce que des anthropologues masculins[34], ayant établi des budgets-temps enregistrant jusqu’à la construction (masculine) d’un abri pour les chiens, ne donnent aucune estimation du temps d’allaitement ou du travail de care aux enfants, et se permettent même d’estimer que la contribution des femmes au travail collectif est inférieur à celui des hommes ! La définition de Marx du travail comme « métabolisme avec la nature », de même, inclue potentiellement la reproduction humaine, qui est un métabolisme par excellence.
Quoiqu’il en soit, le caractère socialement organisé et de contrainte de l’activité de reproduction transforme celle-ci en travail, mais d’une manière spécifique précise tout de suite Tabet. Tout d’abord, au sein du processus reproductif, l’objet du travail n’est pas physiquement séparé de la travailleuse – ce qui n’empêche pas qu’il sera, lui aussi, aliéné. Ensuite, les moyens de production (capital, travail, matières premières) sont une seule et même chose, aspects non-discernables d’une même « machine biochimique » reproductrice s’occupant de toutes les étapes du processus (re)productif – ce qui n’empêche pas ces moyens de production d’être également appropriées par les hommes aux détriments des femmes. Les femmes sont d’une certaine façon analogue dans ce cas aux esclaves des Grecs et des Romains, conçues comme « instruments de travail » naturels et même pas comme travailleuses – ce qui est une forme de fétichisme, de naturalisation de l’exploitation.
Pour Tabet, en tout cas, le « travail » reproductif, s’il peut être également libre, est actuellement l’objet d’une exploitation et d’une aliénation-dépossession de son produit. Les relations de l’exploitée et de l’exploiteur sont, dans ce cas, très spécifiques : l’exploiteur s’approprie ici matériellement l’ensemble de l’exploitée et de son produit, et non seulement son travail pendant un certain nombre d’heures (comme dans l’exploitation capitaliste). La proximité de l’exploiteur et de l’exploitée est aussi une spécificité, mais celle entre la femme (re)productrice et son produit contraint l’est également. L’exploitation, de manière générale, consiste ici non seulement dans l’imposition d’une grossesse, mais également dans une privation de l’agente reproductrice de la maîtrise de ses conditions de travail (privation du choix du partenaire, privation du choix des temps de travail), dans une imposition du type de production (sexe – au travers de l’avortement ou de l’infanticide des filles –, légitimité, « race », etc.), dans une expropriation de la (re)productrice de son produit (typiquement, les enfants mâles chez les Baruya, enlevés à leur mère très tôt), et enfin dans une négation idéologique de son travail reproductif (idéologie du travail reproductif comme exclusivement masculin, laboureur d’un simple champ en Grèce antique[35], ou encore réduction de la femme à un simple récipient, voire même à un sac, chez les Nyakyusa de Tanzanie par exemple). Ici, Tabet critique la distinction de Godelier entre domination masculine et exploitation de classe, qu’il dénie aux femmes sous prétexte qu’elles ne seraient pas séparées de leurs moyens de production : en réalité, argumente Tabet, elles sont séparées de la gestion de leurs conditions de reproduction, et si elles ne sont pas séparées matériellement des moyens de production c’est qu’elles en sont un (comme les esclaves, d’ailleurs, qui eux sont considérés par Godelier comme exploités, alors même qu’il n’y a pas de séparation entre eux-mêmes et leurs corps comme moyens de production). Au final, loin d’être une activité naturelle, la reproduction est généralement un travail, une contrainte sociale à la production (d’enfants, en l’occurrence), et a donc une économie politique. En ce sens, on peut dire que la reproduction « naturelle » forcée et la reproduction « artificielle » (GPA marchande) ne s’opposent pas, mais au contraire qu’elles sont deux modalités d’une même exploitation des capacités reproductrices des femmes. Le travail reproductif et son exploitation est, d’une certaine façon, le stade suprême du fétichisme du travail, c’est-à-dire de la naturalisation de l’activité socialement contrainte, que Godelier observait également au sujet de l’activité des esclaves des Grecs et des Romains[36].
La reproduction est bien un travail, pour Tabet : lors d’une location de l’utérus (GPA marchande), il s’agit bien d’un travail, et entre cette situation et celle d’une reproduction « naturelle » forcée, il n’y a pas de différence majeure outre le moyen d’imposition sociale de la reproduction. Idem pour ce qui est du soin aux enfants ou de l’allaitement, reconnu comme travail lorsqu’il est effectué par une nourrice[37]. D’ailleurs, le fait que l’allaitement est un travail ne fait pas de doute pour les comptabilités nationales du 20ème siècle : il a fait l’objet de calculs économiques chiffrant son coût de substitution (en millions de vaches laitières supplémentaires ou en millions de litres de lait artificiel), et on a même calculé que les femmes des « pays en voie de développement » produisaient un quart du lait de ces pays[38]. Tout ceci a abouti non pas à sa reconnaissance comme travail productif, mais à un appel à son utilisation maximale : en Inde, on a même envisagé à un moment la traite industrielle de lait maternel dans un but marchand, calculant qu’une femme indienne produisait autant qu’une vache laitière[39]. La production utérine d’enfants peut de même être analysée comme travail : dans certaines sociétés, une partie du travail reproductif est délégué à des femmes étrangères, notamment chez les Mbaya d’Amérique du Sud qui effectuaient des expéditions guerrières dans le but principal de se procurer des enfants.
Paola Tabet s’intéresse enfin aux transformations actuelles des rapports de reproduction, notamment l’essor des locations d’utérus aux Etats-Unis, où une femme accepte de se faire féconder artificiellement et de produire des enfants pour d’autres personnes contre une rétribution. Pour Tabet, il ne s’agit pas que d’un cas extrême de la « marchandisation du monde » : c’est surtout un révélateur de la situation générale des femmes. En effet, dans cette situation, la femme est au moins reconnue comme libre propriétaire de sa force de travail, pouvant l’aliéner contre une rétribution ; et cette capacité de reproduction n’est aliénée contre une rétribution que pour un temps, celui d’une grossesse. Et cette distinction, rappelle Tabet, est ce qui distingue le salarié, qui n’aliène son activité que pour un certain temps hebdomadaire, des indentured servants, qui vendaient leur force de travail pour des années complètes[40]. La location contemporaine d’utérus éclaire alors la situation de la reproduction au sein des sociétés étudiées précédemment : il s’agissait d’une situation d’aliénation permanente, directement contrainte et non-rétribuée des capacités reproductives, organisée au travers principalement de l’institution du mariage[41] qui est « achat du ventre[42] » et des « parties génitales d’une femme[43] » usque ad finem (jusqu’à la mort). On peut ainsi parler de l’échange matrimonial comme aliénation sous forme de don ou de vente d’une femme et de ses capacités reproductrices sans limitation sociale d’usage ou de temps : il ne s’agit pas d’une transaction assimilable au contrat de travail, mais plutôt à une vente d’esclave, puisque la femme n’est ni propriétaire d’elle-même, ni de sa force de travail, et ne peut déterminer ses conditions de travail ou limiter sa quantité de travail fourni. Même s’il est vrai que dans certains cas, il existe une mesure indirecte du travail reproductif, puisqu’au bout d’un certain nombre d’enfants la mort d’une femme ou son divorce ne donne plus droit au remboursement du prix de la fiancée au mari de la part de la famille de la femme[44].
Au sein des sociétés contemporaines, les femmes, notamment en situation de famille monoparentale, cessent d’être appropriées individuellement, et leur travail reproductif avec : cependant, au niveau global, perdure une situation d’appropriation globale de la classe des femmes et leurs capacités reproductives par la classe des hommes[45]. Pour Tabet, on est donc en présence d’une transformation comparable au basculement des rapports de servage, où « le travailleur lui-même, la force de travail vivante […] sont appropriées », au travail salarié, où « le capital […] s’approprie non pas le travailleur mais son travail »[46]. Mais, s’interroge Tabet, cette situation est-elle susceptible de mettre en cause la domination masculine, ou constitue-t-elle un simple aménagement de celle-ci ? Pour l’anthropologue italienne, étant donné qu’il n’y a pas de transformation radicale des rapports hommes-femmes, les femmes sont en train de payer seules (ou presque) le coût de cette transformation, au travers d’une forte précarité (on constate une pauvreté supérieure des femmes en situation de famille monoparentale par rapport aux femmes mariées). Les hommes peuvent ainsi de plus en plus se décharger des coûts liés au travail reproductif dont ils continuent pourtant à profiter collectivement (en tant que classe et que dominants d’une société ayant besoin d’un renouvellement générationnel) et individuellement (par un moindre investissement dans la prise en charge de leurs enfants ou de ceux de leur conjointe), selon Tabet. Les femmes, au contraire, doivent assumer non seulement de s’occuper davantage de leurs enfants (au moins relativement aux hommes) mais également une part plus grande des dépenses liés aux enfants. Les femmes pourraient donc être encore plus exploitées qu’auparavant, avance Tabet ; on pourra néanmoins nuancer en disant que la socialisation de l’éducation des enfants (école, crèche) et du financement des coûts liés aux enfants (allocations familiales) contrebalance, au sein des pays riches, cette transformation, même si c’est de plus en plus difficilement en situation de crise économique. Pour elle, en tout cas, ces transformations n’entraînent pas plus de destruction du patriarcat que la dissolution des rapports de servage à partir du 14ème siècle n’a entraîné l’abolition de la société de classes.
Au final, Paola Tabet propose une rupture épistémologique dans l’anthropologie des rapports de sexe, en dénaturalisant ceux-ci et en faisant de l’ensemble des faits s’y rapportant des faits sociaux, des constructions sociales aux implications matérielles, et donc des situations susceptibles d’être dépassées.
Le tableau de Tabet, s’il est globalement convainquant, peut être cependant un peu nuancé dans certains cas. En effet, certains systèmes visent à une limitation et non à une multiplication des naissances, à l’instar de la polyandrie fraternelle himalayenne[47], et de manière plus générale les sociétés nomades : sa thèse est donc surtout valable pour les sociétés sédentaires, et d’autant plus pour les sociétés patrilinéaires où chaque chef de famille a intérêt à une maximisation de son nombre de dépendants. D’autre part, certaines sociétés, notamment en Australie aborigène, forcent sexuellement leurs femmes (qui d’ailleurs pratiquaient l’infanticide) sans pour autant que ce soit nécessairement dans une optique de reproduction : pour empêcher une attaque armée, pour résoudre un conflit interpersonnel, pour pratiquer un rite, etc[48]. On peut également ajouter que le mariage n’est pas le seul moyen d’organiser socialement la reproduction : des rapports sexuels extra-conjugaux peuvent également y aboutir tout aussi bien. La caractérisation de la reproduction comme travail est également discutable, mais au moins doit-on reconnaître qu’il ne s’agit pas d’une « fécondité naturelle » passive, même s’il est vrai qu’il est difficile d’évaluer l’extorsion de plus-value dans le cas d’une « location d’utérus ». Enfin, difficile de s’assurer empiriquement de l’évolution strictement parallèle des rapports de production et de reproduction. Au final, ce texte est une piste de recherche solidement étayée qu’il faut encore approfondir, une intuition géniale au sujet du caractère social (et contraint au sein des sociétés patriarcales) de la reproduction humaine.
A. C.
[1] Paola Tabet, « Les mains, les outils, les armes », L’Homme, vol. 19, n°3, pp. 5-61, 1979.
[2] Paola Tabet, « Fertilité naturelle, reproduction forcée » dans Nicole-Claude Matthieu (dir.), L’Arraisonnement des femmes. Essais en anthropologie des sexes, Paris, Éditions de l’EHESS, 1985.
[3] Paola Tabet, La grande arnaque. Sexualité des femmes et échange économico-sexuel, Paris, L’Harmattan, 2004 [La grande beffa. Sessualità delle donne e scambio sessuoeconomico, Rubbettino 2004]. Il s’agit d’un ouvrage d’étude anthropologique des services sexuels échangés contre une rétribution. En Italie, où elle a été longtemps moins reconnue qu’en France, elle a également publié C’era una volta: rimosso e immaginario in una comunità dell’Appennino toscano, Firenze, Guaraldi, 1978, ethnographie des traditions populaires dans un village de Toscane ; La pelle giusta, Torino, Einaudi, 1997, étude systématique autour de la transmission du racisme aux enfants italiens ; et enfin Le dita tagliate, Ediesse, 2014, constitue une synthèse de son analyse anthropologique de l’inégalité sociale des sexes.
[4] Cf. Maurice Godelier, « Modes de production, rapports de parenté et structures démographiques » dans Horizon, trajets marxistes en anthropologie, t. I, Paris, Maspero, 1978.
[5] G. P. Murdock et C. Provost, « Factors in the Division of Labor by Sex : A Cross-Cultural Analysis », Ethnology, vol. 12, n°2, pp. 203-225.
[6] Gayle Rubin, « L’économie politique du sexe : transactions sur les femmes et systèmes de sexe/genre », Les cahiers du CEDREF, 7, 1998, pp. 3-81.
[7] Claude Lévi-Strauss, « The Family » dans H. L. Shapiro (dir.), Man, Culture and Society, London, Oxford University Press, 1956.
[8] Maxine Molyneux, « Androcentrism in Marxist Anthropology », Critique of Anthropology, vol. 3, n° 9-10, pp. 55-81. C’est une idée qu’on retrouve également chez Rubin, « L’économie politique du sexe », op. cit.
[9] Cf. Nicole-Claude Matthieu, L’anatomie politique. Catégorisations et idéologies du sexe, Paris, iXe, 2013 [1991].
[10] Cf. Christine Delphy, L’ennemi principal. Economie politique du patriarcat, Paris, Syllepse, 1998.
[11] Rubin, « L’économie politique du sexe », op. cit.
[12] Murdock et Provost, « Factors in the Division of Labor by Sex : A Cross-Cultural Analysis », op. cit.
[13] W. L. Warner, A Black Civilisation : a Social Study of an Australian Tribe, New York, Harper, 1937.
[14] Cf. Alain Testart, L’amazone et la cuisinière. Anthropologie de la division sexuelle du travail, Paris, Gallimard, 2014.
[15] Cf. Jack Goody, Production and Reproduction : a Comparative Study of the Domestic Domain, Cambridge, Cambridge University Press, 1976.
[16] Cf. Murdoch et Provost, « Factors in the Division of Labor by Sex : A Cross-Cultural Analysis », op. cit.
[17] Claude Meillassoux, Anthropologie économique des Gourou de Côte d’Ivoire, Paris-La Haye, Mouton, 1964.
[18] Cf. Maurice Godelier, « Outils de pierre, outils d’acier chez les Baruya de Nouvelle-Guinée », L’Homme, vol. 13, n°3, pp. 187-220.
[19] Murdock et Provost, op. cit., pp. 211-212.
[20] Maurice Godelier, « Le Sexe comme fondement ultime de l’ordre social et cosmique chez les Baruya de Nouvelle-Guinée », dans Cahiers du CERM, n°128, 1976, p. 31.
[21] Margaret Mead, New Lifes for Old, New York, William Morrow, 1956.
[22] Contra Françoise Héritier, « Famiglia », in Enciclopedia, vol. 6, Torino, Einaudi, 1979.
[23] Monique Wittig, « On ne naît pas femme », Questions féministes, n°8, pp. 75-84.
[24] Cf., par exemple, A. I. Richards, Chisungu : a Girl’s Initiation Ceremony among the Bemba of Northern Rhodesia, London, Faber and Faber, 1956.
[25] Cf. notamment D. Freeman, Margaret Mead and Samoa : the Making and Unmaking of an Anthropological Myth, London, Harvard University Press, 1983.
[26] R. M. Berndt, Excess and Restraint, Chicago, University of Chicago Press, 1962.
[27] Cf. notamment G. Roheim, « Women and the Life in Central Australia », Journal of the Royal Anthropolical Institute, LXIII, pp. 207-265 et Gayle Rubin, « L’économie politique du sexe : transactions sur les femmes et systèmes de sexe/genre », Les cahiers du CEDREF, 7, 1998, pp. 3-81, qui cite comme référence Robert Murphy, « Social Structure and Sex Antagonism », Southwestern Journal of Anthropology, vol. 15, n°1, 1959, pp. 81-96.
[28] Cf. notamment Georges Devereux, A Study of Abortion in Primitive Societies, New York, International Universities Press, 1976, B. Hayden, “Population Control Among Hunter/Gatherers”, World Archeology, n°4, pp. 205-221 et G. Cowlishaw, “Infanticide in Aboriginal Australia”, Oceania, XLVIII, n°4, pp. 262-283.
[29] « Il n’y avait pas moyen de faire autrement, car dans le temps nous avions bien peur de nos maris », Van de Velde, 1954, « L’infanticide chez les Esquimaux », Eskimo, vol. 34, n°8, cité dans Christophe Darmangeat, Le communisme primitif n’est plus ce qu’il était. Aux origines de l’oppression des femmes, Toulouse, Smolny, 2012.
[30] J.-C. Muller, Parenté et mariage chez les Rukuba, Paris-La Haye, Mouton, 1976. Se refusant au retrait ou au préservatif, ils ont fait pression sur J.-C. Muller pour qu’il ne parle pas de pilule à leurs femmes, lequel anthropologue, complice de la domination masculine, a accepté.
[31] Nicole-Claude Matthieu, « Paternité biologique, maternité sociale… », dans Andrée Michel (dir.), Femmes, sexisme et sociétés, Paris, PUF, pp. 39-48.
[32] N. Echard et alii, « L’Afrique de l’Ouest. De l’Obligation à la prohibition : sens et non-sens de la virginité des filles », dans La Première fois ou le roman de la virginité perdue à travers les siècles et les continents, Paris, Ramsay, 1981, pp. 337-395.
[33] Colette Guillaumin, « Femmes et théories de la société », Sociologie et Sociétés, XIII, 2, p. 30.
[34] Notamment R. Lee dans The !Kung San : Men, Women and Work in a Foraging Society, Cambridge, Cambridge University Press, 1979.
[35] Jean-Pierre Vernant, « Introduction » dans Marcel Detienne, Les jardins d’Adonis, Paris, Gallimard, 1972.
[36] Maurice Godelier, « Perspectives ethnologiques et questions actuelles sur le travail », Lumière et vie, n°124, pp. 35-58.
[37] Les nourrices mercenaires cependant n’étaient souvent même pas des travailleuses « libres », puisque leur rémunération allait à leur mari ou à leur père, qui signait un contrat avec l’acheteur du service d’allaitement. Ceci fait écho à une situation plus générale : en France, ce n’est qu’en 1907 que les femmes ont pu toucher leur propre salaire ; et les travailleuses du sexe ne touchaient et pour certaines continuent de ne toucher qu’une partie des bénéfices de la vente de leurs services (l’autre revenant au maître d’esclaves, au mari ou au proxénète).
[38] D. B. Jelliffe et E. F. P. Jelliffe, Human Milk in the Modern World: Psychological, Nutritional and Economic Significance, Oxford, Oxford University Press, 1978.
[39] Dans cette vision, les femmes sont bien plus économiques que des vaches laitières, en somme : pas de coût d’entretien ou de nettoyage d’une étable, mais un travail ménager gratuit d’auto-entretien… et d’entretien des autres membres de la famille. Ce cas-limite nous indique également qu’il faut considérer précautionneusement l’éloge écologiste de l’allaitement comme « naturel » : l’allaitement doit être un choix libre des femmes et non une contrainte naturalisée sous un quelconque prétexte. Ainsi, il ne faut pas uniquement critiquer la marchandisation d’une activité, surtout au nom de la « nature » non-marchande de telle activité (ce qui est réactionnaire et surtout pseudo-anticapitaliste), mais de manière générale son caractère contraint, que cette contrainte soit capitaliste et/ou patriarcale.
[40] L’aliénation de l’activité reproductrice n’est alors que temporaire et formellement « volontaire » (en faisant abstraction des contraintes économiques), alors qu’au sein des cas étudiés elle était permanente et directement contrainte.
[41] Cf. également, au sujet des sociétés contemporaines, Christine Delphy et Diana Leonard, Familiar Exploitation. A new analysis of marriage in contemporary western societies, Cambridge, Polity Press, 1992.
[42] Cf. E. Krige, « Woman-Marriage », Africa, n°44, pp. 11-36.
[43] B. Blackwood, Both Sides of Buka Passage, Oxford, Clarendon Press, 1935.
[44] Ces deux formes de reproduction appartiennent à deux formes d’activité contraintes distinctes, l’une au travail au sens capitaliste, l’autre au servage. On voit bien ici qu’il ne s’agit en aucun cas de critiquer le capitalisme au nom des sociétés pré-capitalistes, mais de rejeter en bloc l’ensemble des formes d’exploitation et de domination sociales ayant existé et/ou qui existent.
[45] Colette Guillaumin, Sexe, race et pratique du pouvoir, Paris, iXe, 2016.
[46] Karl Marx, « Les Principes d’une critique de l’économie politique », dans Œuvres, t.2, Paris, Gallimard, 1968.
[47] Cf. Patrick Kaplanian, « Paola Tabet, La Construction sociale de l’inégalité des sexes. Des outils et des corps », L’Homme, vol. 158-159, 2001, pp. 419-421.
[48] Darmangeat, Le communisme primitif n’est plus ce qu’il était, op. cit.
Vous aimerez aussi

Otto Rühle – La révolution n’est pas une affaire de parti
12 juillet 2017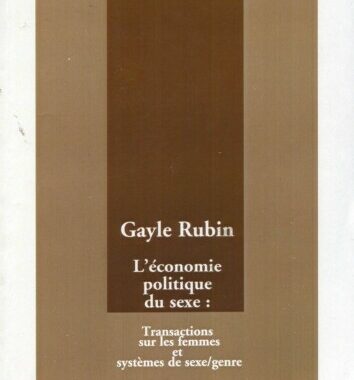
Gayle Rubin – L’économie politique du sexe
9 juillet 2017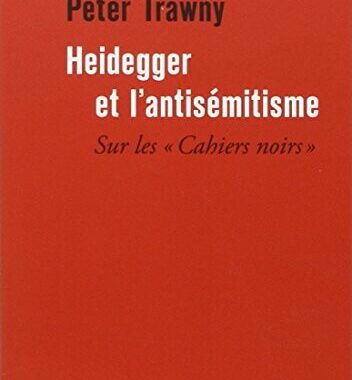


Un commentaire
Ping :