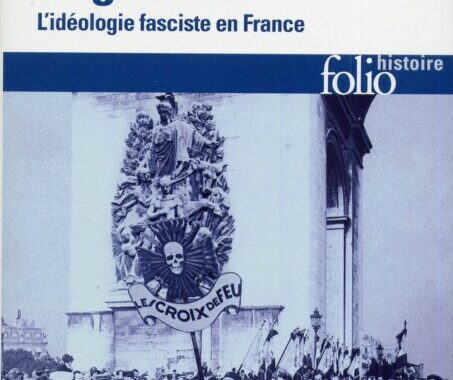Nouvelles Questions Féministes – Violences contre les femmes
Nouvelles Questions Féministes, Violences contre les femmes, Vol. 32, n°1, 2013
Ce numéro de Nouvelles questions féministes, revue universitaire féministe fondée entre autres par Simone de Beauvoir et Christine Delphy en 1981, s’intéresse au sujet de la violence masculine contre les femmes. Les auteures de l’éditorial rappellent l’importance des mouvements féministes dans la politisation de cette question, avec une « remise en cause de l’opposition entre espace public et espace privé, entre les questions publiques dont la société doit se préoccuper et les questions privées tenues au silence » (« le privé est politique », disait-on alors), d’une part, et le fait que « les réflexions menées au sein du mouvement féministe ont mis en évidence la banalité des différentes formes de violence commises par des hommes à l’encontre des femmes – harcèlement dans la rue ou au travail, violences conjugales, violences sexuelles » (p. 4).
Ces réflexions et les recherches qui en ont découlé ont permis de mettre en évidence que « les violences commises contre les femmes sont le fait d’hommes connus (et souvent des proches) de ces dernières » (p. 5), contrairement à une idée fausse et encore courante aujourd’hui selon laquelle il s’agit toujours de « salauds » inconnus étrangers – manière de ne pas remettre en cause la domination masculine ici. L’éditorial dénonce également le fait que « les médias, si prompt à l’indignation lorsque les violences [masculines] sont situées dans les quartiers populaires ou les milieux pauvres, […] se font silencieux ou font preuve d’un remarquable esprit de corps lorsque riches ou puissants sont en cause (voir en particulier l’affaire Strauss-Kahn : Delphy, 2011). » (p. 7). On pourrait toutefois nuancer en disant que les médias (patriarcaux) ne sont pas si prompt que ça, puisque la bourgeoisie a intérêt à camoufler les violences faites aux femmes par d’autres groupes qu’eux puisque cela reviendrait à risquer qu’on s’intéresse à leurs violences. Quoiqu’il en soit, alors que la domination masculine traverse toutes les classes, tous les groupes sociaux, « les violences sont attribuées par les milieux dominants aux classes populaires et exclusivement à elles » (p. 7), classisme qui s’accompagne souvent d’un racisme. « Les violences commises …]. Dans le même temps, l’appareil judiciaire qui ne condamne que rarement les auteurs de violence, condamne d’abord, voir uniquement, les hommes pauvres et racisés » (p. 7). Évidemment, cela ne doit pas conduire à une euphémisation de la violence masculine au sein des classes populaires, et il faut à ce titre critiquer (de manière anti-raciste et féministe) les propos d’Houria Bouteldja dans son dernier livre. Quoiqu’il en soit, l’article de Véronique Le Goaziou démontre que les hommes des classes les plus précarisées sont surreprésentés parmi les accusés et encore davantage parmi les condamnés, tandis que les hommes des classes supérieures sont sous-représentés (pp. 7-8).
Une autre étude « met au jour que le fait d’envisager systématiquement la grossesse comme « un heureux événement » empêche le repérage des situations de violences conjugales », et que donc « les stéréotypes des practicien.ne.s doivent être interrogés et travaillés collectivement pour laisser une place à la parole des femmes » (p. 8).
D’autre part, l’éditorial raconte que « les dérogations aux normes de l’hétérosexualité et de l’exclusivité sexuelle ont souvent servi de justification aux violences sexuelles », notamment dans le cas de viol de lesbiennes (pp. 8-9), et l’article de Lhomond et de Saurel-Cubizolles montre effectivement « que les femmes ayant eu des rapports sexuels avec des femmes sont surexposés aux violences sexuelles » (p. 9).
Les auteures de l’éditorial critiquent également les discours ayant comme « point commun de supposer l’existence d’une symétrie dans l’usage de la violence dans le couple : les femmes seraient aussi violentes que les hommes. Cette affirmation fait écho aux pratiques des hommes violents eux-mêmes : en Espagne, […] les hommes objets d’une plainte déposent désormais quasi systématiquement une contre-plainte, pour laquelle ils utilisent la moindre griffure, afin de prouver, sinon qu’ils sont les principales victimes de la violence, du moins que les violences sont réciproques dans le couple. C’est aussi le cas en France […] : les conjoints violents déposent plainte pour harcèlement contre leur conjointe qui les accuse » (p. 9). Et ce alors que, « sans nier le fait que les femmes puissent user de la violence » [là-dessus, on lira Coline Gardi et Geneviève Pruvost, Penser la violence des femmes, Paris, La Découverte, 2012], ces discours masculinistes peuvent « cacher leurs propres actes de violence », et surtout servent « le but politique antiféministe de nier les violences masculines contre les femmes et d’occulter leur fonction dans le contrôle social » (pp. 9-10). Le problème est que les nouveaux questionnaires concernant les violences conjugales aboutissent à la confusion de deux formes de violences, l’une pouvant aller jusqu’au tabassage ou au viol conjugal, et l’autre étant un emportement occasionnel (structurel lorsqu’il est du fait des mâles) : « Si les femmes peuvent certes user de gestes physiques contre leur conjoint quand elles sont en colère : donner une gifle, pousser, bousculer, insulter, elles ne le font souvent qu’une fois en une année ; cela ne peut être considéré comme suffisant pour définir une situation de violence conjugale exercée par la conjointe sur le conjoint. Car c’est la relation d’emprise, le cumul des différentes formes de violences (verbales, psychologiques, physiques, sexuelles, économiques), leur répétition ainsi que le degré de gravité de leurs conséquences qui définissent la violence conjugale, et non un geste physique seul » (p. 11).
Les auteures de l’éditorial poursuivent en expliquant qu’ « un autre mécanisme politique d’euphémisation de la violence masculine contre les femmes consiste à ne pas nommer la violence. La violence conjugale qui conduit parfois à la mort d’une femme est appelée « drame familial » ou « différent familial » par la presse. Pendant longtemps, on l’a appelée « crime passionnel […] et désormais « homicide conjugal » en lieu et place de féminicide conjugal, ce qui romance et rend invisible le socle social de ces crimes ainsi que le sexe des victimes comme des auteurs. » (p. 11). De plus, « les recherches anglophones, désormais nombreuses, montrent que les homicides conjugaux commis par des femmes ont souvent pour but de se défendre de la violence conjugale ou d’y mettre un terme [cf. Jacqueline Sauvage], alors que ceux commis par les hommes se produisent au paroxysme de cette violence » (p. 11).
Un article consacré au féminicide au Canada montre ainsi que lesdits « meurtres conjugaux » sont « majoritairement des féminicides », et qu’ils « impliquent souvent aussi le meurtre des enfants ou d’une autre personne » (pp. 11-12). Cela montre qu’il faut cesser de psychologiser ou de romancer les violences conjugales, et qu’il faut considérer ce problème de manière radicale (en allant aux racines du problème) et systémique, et critiquant une société restée misogyne et patriarcale. Ainsi, « les homicides, souvent associés dans notre imaginaire […] à des crimes mafieux visant les hommes, se révèlent en fait […] être la plupart du temps des meurtres de femmes et d’enfants liés aux violences conjugales » (p. 12).
Les viols en justice : une (in)justice de classe ?
L’article de Véronique Le Goaziou explique tout d’abord que l’intuition féministe des années 1970 selon laquelle ce phénomène touche « toutes les classes et toutes les races » [Pizzet, 1974] a été « validée par la première grande enquête scientifique française sur les violences faites aux femmes réalisée en 2000 » et par celles qui suivront. Pourtant, la majorité des « auteurs mis en cause par la justice pour des affaires de viol sont majoritairement issus des milieux populaires et même de leur frange la plus précarisée et que, a contrario, la part des agresseurs issus des classes aisées est très faible » (p. 16). L’article s’interroge sur les raisons d’une telle (in)justice de classe. Rappelons qu’annuellement, en France, il y a 13 000 viols déclarés, 75 000 estimés, 198 000 tentatives de viols estimées.
L’auteure commence d’abord par un rappel de la théorisation féministe du viol : « un phénomène massif et courant » (p. 16), mais qui n’est ni un problème individuel (de l’homme), ni relationnel (du couple) ou culturel (d’un groupe socio-culturel), mais une forme de contrôle social structurant et maintenant les rapports de domination patriarcaux [Hanmer, 1977], et ce au sein de l’ensemble des groupes sociaux. Le violeur est ainsi redéfini non comme un malade, un inconnu et un marginal, comme dans l’idéologie dominante, mais comme un sexiste (donc potentiellement de toute culture et de toute classe), un familier (souvent) et un homme ordinaire. Les victimes sont elles-mêmes tous les milieux sociaux : « ainsi est-il établi dans l’enquête CSF que la fréquence des viols (ou leur tentative) ne varie guère en fonction de la catégorie sociale du père des victimes (lorsque ce sont des mineures) ou en fonction de la profession des victimes (lorsque ce sont des adultes) » (p. 18). Deuxièmement, « les agressions sexuelles […] sont des violences de proximité, des liens préexistent entre les agresseurs et les victimes […]. Dans l’ENVEFF, l’auteur est connu de la victime dans sept cas sur huit. Dans l’enquête CSF, lorsque le viol a lieu avant 18 ans, l’agresseur est dans les deux tiers des cas un membre de la famille ou une personne connue de la famille. Et dans l’édition 2007 de l’enquête CVS, parmi les deux tiers des personnes qui ont subi une violence sexuelle à l’extérieur de leur ménage, six personnes sur dix connaissaient l’auteur de l’agression ; pour le tiers restant des victimes, l’agression a lieu au sein du ménage » (p. 18). Le viol est donc un problème socio-politique typique d’une société de domination masculine, pas un acte isolé d’un inconnu déséquilibré. Les viols existent dans les banlieues (« tournantes ») comme dans les hautes sphères (affaire Strauss-Kahn/Diallo), puisqu’il s’agit d’une même société patriarcale.
Pourquoi, dès lors, y a-t-il une surreprésentation des classes populaires, des marginaux, etc., parmi les accusés de viols en justice, et une sous-représentation des classes dominantes ? En raison tout d’abord d’une « réticence des groupes favorisés à utiliser des solutions légales pour des questions d’ordre privé » (p. 23), et d’ailleurs « bien des observatrices et observateurs ont relevé que les violences qui touchaient le couple ou la famille en particulier y étaient sous-estimés » (p. 23). Les classes dominantes ou moyennes ne veulent pas avoir affaire avec des « services sociaux » ou l’institution policière, qu’elles estiment réservées aux classes populaires.
Ensuite, au niveau de la justice même, la proximité sociale entre les justiciables des classes dominantes ou moyennes et les magistrats (d’où l’expression « justice de classe »), d’une part, et les ressources supérieures de ces premiers pour faire face à un procès d’autre part, tout ceci explique une sous-représentation encore plus forte des classes dominantes-moyennes parmi les condamnés (p. 25).
L’auteure de conclure : « Avant toute enquête scientifique, des féministes avaient argué que les violences sexuelles sévissent dans tous les milieux sociaux […]. Mais les positions sociaux (et les rapports de pouvoir qui leur sont liés) réapparaissent sans conteste à l’occasion du (dé)voilement judiciaire de ces violences » (p. 26). D’autre part, « plus la proximité est grande [entre violeurs et victimes] […], plus le silence se maintient » (p. 26). On lira également Le viol, aspects sociologiques d’un crime de la même auteure.
Autres articles
On recommandera également, dans ce numéro, « Est-ce que je peux choisir ? Violence contre les femmes et décisions reproductives » (qui démontre une forte emprise des hommes, avec usage de violences psychologiques et/ou physiques, sur les choix des femmes enceintes d’avortement ou de poursuite de grossesse), « Agressions sexuelles contre les femmes et homosexualité, violences des hommes et contrôle social » (qui démontre un plus grand nombre d’agression sexuelles des lesbiennes par rapport aux femmes hétérosexuelles, ce qui montre bien la lesbophobie systémique de notre société) et « Interroger les femmes et les hommes au sujet des violences conjugales en France et aux États-Unis » (qui montre que s’il existe des violences conjugales « situationnelles » du fait des femmes, celles-ci ne prennent quasiment jamais la forme de « terrorisme conjugal » – qui peut aller jusqu’au féminicide –, contrairement à la violence conjugale du fait des hommes qui peut prendre cette forme).
Conclusion
La violence contre les femmes doit être appréhendée de manière systémique, comme formes d’affirmation et de maintien de la domination masculine, patriarcale. Le viol est le stade suprême de cette violence masculine, comme négation complète du statut de sujet (réification instrumentale) et de l’autonomie des femmes (hétéronomie patriarcale). Il faut donc particulièrement combattre la culture du viol qui sévit encore au sein des milieux militants, et dans toute la société bien entendu. De même, les violences physiques comme psychologiques contre des femmes sont inacceptables, en milieu militant comme partout ailleurs.
Armand Paris
Adieux au capitalisme - avec Jérôme Baschet
Vous aimerez aussi
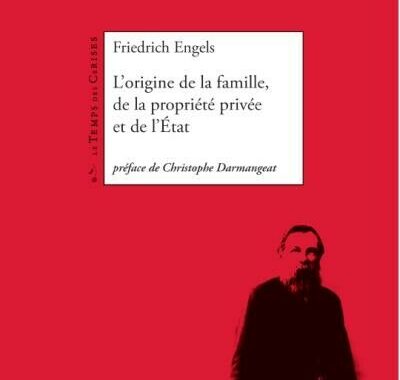
Préface de L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’Etat (Friedrich Engels) – Eleanor Leacock
7 juillet 2017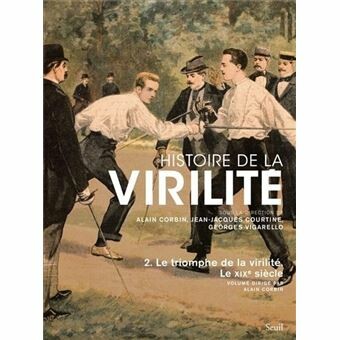
Histoire de la virilité – Le triomphe de la virilité. Le XIXème siècle
6 novembre 2016