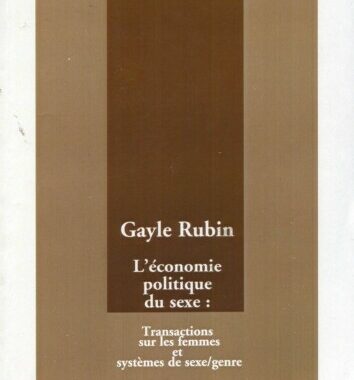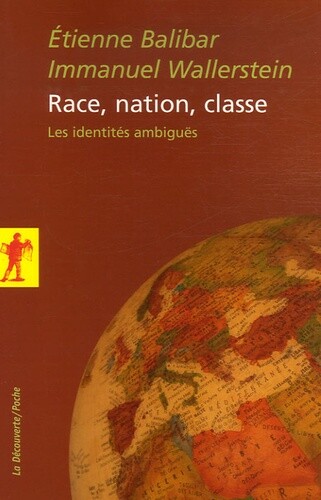
Étienne Balibar et Immanuel Wallerstein – Race, nation, classe
Etienne Balibar et Immanuel Wallerstein, Race, nation, classe. Les identités ambigües, Paris, La Découverte, 1997 [1988]
L’ouvrage de Balibar, philosophe marxiste ayant été l’élève d’Althusser (et donc très problématique), et de Wallerstein, sociologue braudélien-marxiste ayant une conception insuffisamment spécifique du capitalisme, même si donc il a été écrit par des auteurs problématiques, n’en demeure pas moins une porte d’entrée intéressante aux problèmes du racisme et du nationalisme. Il ne s’agira pas ici d’une note de lecture exhaustive, mais simplement d’une présentation et d’une discussion des seules thèses intéressantes de l’ouvrage.
PS : Notre théorie critique du racisme est en constante évolution, il n’y a donc ici aucune théorie « définitive » du racisme, mais un angle d’attaque théorique à un moment T.
Préface
Balibar critique tout d’abord l’idée wallersteinienne d’une « bourgeoisie mondiale », et dit qu’il y a plutôt des bourgeoises d’État, soutenues par un État (pp. 12-13). Cela va de pair avec son idée que l’économie-monde est d’abord « le résultat aléatoire du mouvement de ses unités sociales [nationales] que sa cause » (p. 15). Nous pensons également qu’il y a avant tout des capitalismes étatico-nationaux, cadre fondamental de l’émergence et de l’essor du capitalisme. D’autre part, Balibar propose d’emblée de définir le nationalisme (des périphéries, ajoutera-t-on) « comme réaction à la domination des États du centre » et le racisme « comme institutionnalisation des hiérarchies impliquées dans la division mondiale du travail » (p. 14). Nous sommes plutôt d’accord avec cette définition « matérialiste » du racisme, même si elle doit être affinée. Nous sommes relativement d’accord avec Wallerstein, résumé ainsi par Balibar : « Wallerstein renvoie l’universalisme à la forme même du marché […], le racisme au clivage de la force de travail entre le centre et la périphérie [même au sein des centres], et le sexisme à l’opposition du « travail » masculin et du « non-travail » féminin dans le ménage ou foyer domestique (household), dont il fait une institution fondamentale du capitalisme historique » (p. 18). Même s’il faut complexifier l’analyse de Wallerstein avec celles de Delphy et de Scholz, ses tentatives d’une approche non-idéaliste des idéologies semblent pertinentes. D’autre part, selon Balibar, « Wallerstein propose de distinguer trois grands modes historiques de construction du « peuple » : la race, la nation, l’ethnicité, qui renvoient à des structures différentes de l’économie-monde ; il insiste sur la coupure historique entre l’Etat « bourgeois » (l’Etat-nation) et les formes antérieures de l’Etat (en fait le terme même d’ « Etat » est pour lui équivoque) » (p. 19). L’État est en effet une réalité (et un concept) spécifiquement moderne. Balibar parlera également de « racisation du prolétariat » (p. 23) dans l’ouvrage, un concept extrêmement intéressant.
Le racisme universel
Y’a-t-il un « néo-racisme » (Etienne Balibar)
Pour Balibar, « il n’y a pas, en fait, de racisme sans théorie(s) » (p. 29). On pourrait effectivement définir le racisme comme une cristallisation idéologique d’un rapport d’exploitation, d’oppression et/ou de domination entre deux groupes « étrangers ». Balibar rappelle d’ailleurs l’évolution de l’idéologie raciste : « Le nouveau racisme est un racisme de l’époque de la « décolonisation » […]. Idéologiquement, le racisme actuel, centré chez nous sur le complexe de l’immigration, s’inscrit dans le cadre d’un « racisme sans races » […] : un racisme dont le thème dominant n’est pas l’hérédité biologique, mais l’irréductibilité des différences culturelles […] : ce qu’on a pu appeler à juste titre un racisme différencialiste » (pp. 32-33). Un racisme « différencialiste » étant toujours une cristallisation idéologique d’un rapport d’exploitation, d’oppression et de domination, mais naturalisant celui-ci au moyen d’une culturisation, et non d’une biologisation, voilà tout. Mais cette légère différence implique néanmoins « une déstabilisation des défenses de l’anti-racisme traditionnel » (p. 33). En effet, « le culturalisme anthropologique, tout entier orienté vers la reconnaissance de la diversité, de l’égalité des cultures […] mais aussi de leur permanence transhistorique, avait fourni la meilleure part de ses arguments à l’antiracisme de l’après-guerre […]. Sa valeur s’était trouvée confirmée par la contribution qu’il apportait à la lutte contre l’hégémonie de certains impérialismes uniformisateurs, et contre […] l’ « ethnocide ». [p. 34] Le racisme différencialiste prend au mot cette argumentation […]. Claude Lévi-Strauss […] se trouve maintenant enrôlé, volontairement ou non, au service de l’idée que le « mélange des cultures », la suppression des « distances culturelles », correspondrait à la mort intellectuelle de l’humanité […]. Et cette « démonstration » est immédiatement mise en rapport avec la tendance « spontanée » des groupes humains […] à préserver leurs traditions, donc leur identité. Ce qui se manifeste par là même, c’est que le naturalisme biologique ou génétique n’est pas le seul mode de naturalisation des comportements humains et des appartenances sociales. Au prix d’un abandon du modèle hiérarchique (plus apparent que réel, nous allons le voir), la culture peut elle aussi fonctionner comme une nature, en particulier comme d’une façon d’enfermer a priori les individus et les groupes dans une généalogie, une détermination d’origine immuable et intangible » (pp. 33-34). Pire, « si la différence culturelle irréductible est le véritable « milieu naturel » de l’homme […], alors l’effacement de cette différence finira nécessairement par provoquer des réactions de défense, des conflits « interethniques » et une montée générale de l’agressivité […]. Par une étonnante volte-face, on voit ici les doctrines différencialistes se proposer elles-mêmes d’expliquer le racisme (et de le prévenir) » (pp. 34-35). Au niveau idéologique, « on assiste à un déplacement général de la problématique. De la théorie des races ou de la lutte des races dans l’histoire humaine, […] on passe à une théorie des « relations ethniques » (ou des race relations) […], qui naturalise non pas [tant] l’appartenance raciale mais le comportement raciste. Le racisme différencialiste […] se présente comme ayant tiré les leçons du conflit entre racisme et antiracisme, comme une théorie, politiquement opératoire, des causes de agressivité sociale. Si l’on veut éviter le racisme [pour lui], il faudrait éviter l’antiracisme « abstrait » […] : il faudrait respecter des « seuils de tolérance », maintenir les « distances culturelles », c’est-à-dire, en vertu du postulat qui veut que les individus soient les héritiers et les porteurs exclusifs d’une seule culture, ségréger les collectivités » (p. 35). Pour Balibar, d’ailleurs, l’antisémitisme est un racisme « culturaliste », ce qui est en partie vrai (Hitler parlait lui-même d’un « esprit juif »). L’antisémitisme structurel est cependant assez spécifique [Postone], et il postule une supériorité fantasmatique des « Juifs » (comme comploteurs tout-puissants) : il faut distinguer celui-ci du racisme anti-judaïque (sans doute né en Espagne après 1492), ou antijudaïsme, lequel est un racisme non-complotiste fondé sur une situation d’exploitation, d’oppression et de soumission des minorités juives (même si historiquement, il y a parfois eu mélange de l’antisémitisme et du racisme anti-judaïque).
Le racisme différencialiste est ainsi conservateur, contre-révolutionnaire, plaidant pour une fixité des cultures (des Kultur) et donc des sociétés (pp. 38-39). Pour autant, il peut réintroduire même des éléments du racisme biologique, sous forme de la sociobiologie notamment, car pour lui « sans doute il n’y a pas de « races », il n’y a que des populations et des cultures, mais il y a des causes et des effets biologiques […] de la culture, et des réactions biologiques à la différence culturelle » (p. 40). La naturalisation raciste du rapport d’exploitation, d’oppression et de domination « géopolitique » réintroduit inévitablement une rhétorique biologisante.
Universalisme, racisme, sexisme : les tensions idéologiques du capitalisme (Immanuel Wallerstein)
Wallerstein explique qu’il n’y a pas d’antinomie entre « universalisme » d’une part et « racisme » et « sexisme » d’autre part, mais une relation dialectique (p. 43). L’intuition est vraiment intéressante, mais il n’y a pas de développement satisfaisant.
Racisme et nationalisme (Etienne Balibar)
Balibar propose de distinguer un « racisme institutionnel », hautement théorisé, et un « racisme sociologique », moins théorisé (p. 57) : nous distinguerions plutôt, deux pôles d’un même racisme structurel fondé sur une domination, une exploitation et une oppression d’un groupe par un autre groupe « étranger », avec d’un côté du spectre un racisme basé sur un rapport d’exploitation, d’oppression et de domination direct, clair, fixiste et donc explicitement institutionnalisé, à l’instar du racisme colonial ou néo-colonial ou du racisme impérial ou néo-impérial (qu’on distinguera du racisme impérialiste, fondé sur une domination principalement économique) ; et de l’autre côté du spectre un racisme impérialiste et/ou post-impérial (lorsqu’il y a eu domination impériale) basé également sur un rapport d’exploitation, d’oppression et de domination « indirect » (aux moyens du Marché mondial et de l’échange inégal), aux contours davantage flous que dans une situation (néo)coloniale ou (néo)impériale, avec une dynamique davantage évolutive, et institutionnalisé de manière davantage implicite, à l’instar du racisme entre des membres de centres capitalistes et des membres de périphéries capitalistes non-basées sur une structure coloniale, néo-coloniale ou encore impériale.
Le racisme colonial (et, de manière légèrement différente, « néo-colonial ») est un racisme basé sur un rapport d’exploitation, d’oppression et de domination direct, parce qu’il y a bien une exploitation, une oppression et un asservissement direct d’une classe de colonisés par une classe de colons. C’est un racisme basé sur une exploitation, une oppression et une domination clairs, parce qu’elle visible de manière limpide dans l’espace social. C’est un racisme basé sur une exploitation, une oppression et une domination fixiste (c’est-à-dire fixe au moins théoriquement, et avec une réelle inertie) et explicitement institutionnalisée, puisqu’il s’agit d’une situation de longue durée codifiée juridiquement (code de l’indigénat, traités inégaux, etc.).
Le racisme post-colonial (qu’on distinguera du racisme néo-colonial, fondé sur une permanence d’une domination coloniale simplement restructurée, en Afrique du Sud de manière archétypique) et celui des membres des centres capitalistes envers ceux des périphéries capitalistes (qu’on qualifiera de « impérialiste/post-impérial », et qu’on distinguera du racisme « néo-impérial », fondé sur une domination impériale légèrement restructurée, en Irak après 2003 de manière archétypique), sont partiellement différents. Ils reposent sur une exploitation, une oppression et une domination davantage indirecte en ce qu’il n’y a pas de domination directe sous une forme coloniale ou impériale, et où donc il n’y a pour partie qu’une surexploitation (moindres salaires, moindres droits au travail, etc.), une sur-oppression (davantage de violences étatiques, répression judiciaire davantage forte etc.) et une sur-domination (domination étatique et du Marché davantage fortes) des membres des ex-colonies et/ou des périphéries capitalistes relativement aux membres des ex-métropoles et/ou des centres capitalistes : en France, par exemple, les racisés post-coloniaux et/ou provenant de périphéries capitalistes (Europe de l’Est, Europe du Sud, etc.) sont davantage exploités, davantage opprimés et davantage dominés relativement aux nationaux non-racisés. Toutefois, cette exploitation, cette oppression et cette domination indirectes, générateurs d’une classe de racisés (surexploités, sur-oppressés, sur-dominés) et donc de non-racisés (moins exploités, moins oppressés, moins dominés), se doublent généralement d’une exploitation (exploitation domestique et/ou sexuelle de femmes racisées par des non-racisés, notamment), d’une oppression (« ratonnades », insultes racistes, etc.) et d’une domination (domination policière-judiciaire de policiers et de magistrats non-racisés sur des racisés) directs, fondateurs d’une exploitation, d’une oppression et d’une domination d’une classe raciste sur une classe racisée. Le racisme post-colonial et des membres des centres capitalistes vis-à-vis des membres des périphéries capitalistes est donc fondée sur un mixte d’exploitation, d’oppression et de domination indirectes et en même temps (généralement) directes. Précisons néanmoins que cette exploitation, cette oppression et cette domination des périphéries par des centres se joue au niveau mondial, mais également au niveau continental, national et même régional : il y a une exploitation, une oppression et une domination raciste de la classe des « kurdes » par celle des « turcs » en Turquie, de la classe des « kurdes » par celle des « persans chiites » en Iran, etc., puisqu’il s’agit d’une exploitation, d’une oppression et d’une domination d’une périphérie d’un État par son centre.
Le racisme post-colonial comme celui des membres des centres capitalistes vis-à-vis de ceux des périphéries ont également un caractère davantage flou, mouvant, institutionnalisé de manière implicite relativement au racisme (néo)colonial ou (néo)impérialiste : un Brésilien n’est guère autant racisé qu’un Algérien en France puisqu’il n’est pas clairement un ex-sujet colonial sur-exploité, sur-oppressé, sur-dominé ; parce qu’il bénéficie d’une revalorisation du Brésil comme puissance économique ; et parce qu’il n’y a qu’un échange inégal, et non une situation post-coloniale.
PS : Lorsqu’il y une hostilité mutuelle entre deux groupes « étrangers » sans qu’il y ait d’exploitation, d’oppression et de domination, même légère, même indirecte, entre ces deux groupes, on parlera de xénophobie. Les racisés, eux, peuvent également être hostiles vis-à-vis des non-racisés et/ou des dominants racistes, auquel cas on parlera de racialisme.
Balibar parle également d’une autre distinction, celui entre un « racisme d’extermination » (« exclusif ») et un « racisme d’oppression » et d’exploitation (« inclusif ») [p. 57] : mais comme il remarque, « aucune de ces deux formes n’existe jamais à l’état pur : ainsi le nazisme a combiné […] « solution finale » et esclavage, et les impérialismes coloniaux ont pratiqué à la fois le travail forcé […] et les « génocides » » (p. 58). Ainsi, « il n’existe pas un racisme invariant, mais des racismes » (p. 58).
Balibar affirme également avec justesse que « le racisme est un rapport social, et non pas un simple délire des sujets racistes » (p. 59). Mais c’est un rapport social d’exploitation, d’oppression et de domination, et non un simple relation d’hostilité réciproque, auquel cas on parlera de xénophobie.
Balibar remarque que « l’extériorité des populations « indigènes », ou plutôt sa représentation comme extériorité raciale […] n’a rien d’un état de choses donné. Elle a été, en fait, produite […] dans l’espace même constitué par la conquête et la colonisation […], donc sur le fond d’une certaine intériorité » (p. 61). La domination coloniale implique ainsi une production de l’altérité, une séparation rigide des deux groupes, sous peine d’une disparition de la classe des colonisés-racisés et sa fusion avec celle des prolétaires non-racisés (laquelle impliquerait une exploitation moins bénéfique capitalistiquement puisqu’exempte de surexploitation, et une unité potentielle des dominés).
Le racisme implique également une tension entre un « particularisme raciste » (hostilité nationaliste aux autres dominants racistes) et un « universalisme raciste » (à l’instar du white supremacism) [p. 62].
Balibar pose ensuite un problème complexe : d’un côté, « rien ne nous permet d’identifier purement et simplement le nationalisme des dominants et celui des dominés, le nationalisme de libération et le nationalisme de conquête », et d’un autre côté, « cela ne nous autorise pas pour autant à ignorer qu’il y a un élément commun » entre ces deux nationalismes, et « cette symétrie formelle n’est pas étrangère à la […] transformation des nationalismes de libération en nationalismes de domination » (p. 66). Le nationalisme n’est, pour nous, en aucun cas émancipateur, puisqu’il repose sur une domination d’une « nation » sur d’autres, ou du moins sur une domination étatique et de classe sous couvert d’ « unité nationale ». L’anti-colonialisme, en revanche, peut être émancipateur s’il est également un anti-capitalisme, un anti-nationalisme, un anti-étatisme et un féminisme.
Autre problème : « L’idéologie nationaliste est-elle le reflet […] de l’existence des nations ? Ou bien sont-ce les nations qui se constituent à partir d’idéologies nationalistes ? » (p. 67). Vieille question, à laquelle Eric Hobsbawm comme Gérard Noiriel ont partiellement répondu. Il y a d’abord, selon nous, une dynamique d’uniformatisation des sociétés et des populations sous l’effet d’une centralisation monarchique, puis étatique. Cette uniformisation étatique produit une « nation » comme structure (puisqu’il y a bien des nationaux et des non-nationaux définis juridiquement) construite historiquement. À partir de l’émergence de ces premières « nations » construites étatiquement, disons en fin du 18ème siècle, se créent en réaction (en Allemagne suite aux guerres napoléoniennes, par exemple) et/ou de manière mimétique (nationalisme-racisme hutu notamment, forgé à partir du nationalisme-racisme belge-allemand) des idéologies nationalistes au sein des espaces non-uniformisés étatiquement. Ces idéologies nationalistes peuvent alors devenir des forces matérielles, et faire émerger des États-nations.
Pour Balibar, « si le racisme n’est pas également manifeste dans tous les nationalismes ou dans tous les moments de leur histoire, il représente pourtant toujours une tendance nécessaire à leur constitution » (p. 69). Le racisme inhérent au nationalisme français a notamment été étudié dans l’ouvrage de Gérard Noiriel État, nation et immigration. Vers une histoire du pouvoir.
Balibar affirme enfin de manière forte : « Aucune nation (c’est-à-dire aucun Etat national) ne possède en fait une base ethnique, ce qui veut que le nationalisme ne saurait être défini comme un ethnocentrisme, sinon précisément au sens de la production d’une ethnicité fictive. Raisonner autrement, ce serait oublier que, pas plus que les « races », les « peuples » n’existent naturellement […]. Mais il faut instituer dans le réel […] leur unité imaginaire, contre d’autres unités possibles » (pp. 70-71). La nation est une structure construite, « l’ethnicité » également. Là-dessus, on lira également l’ouvrage de Benedict Anderson, La communauté imaginée.
D’autre part, « le phénomène de « minorisation » et de « racisation » qui vise simultanément des différents groupes sociaux de « nature » tout à fait différente […] ne représente pas une juxtaposition […] mais un système historique d’exclusions et de dominations complémentaires, liées entre elles » (p. 71). C’est vrai qu’il y a une intrication structurelle des racismes. Pour autant, nous nous interdirons de parler de « racisme sexuel » comme Balibar, préférant éviter de subsumer tout sous un même concept de racisme.
Balibar rappelle également qu’il n’y a d’ « égalité » politique moderne qu’ « au regard de la nationalité » (p. 72) : « l’égalitarisme » politique français s’arrête aux seuls nationaux. L’ « universalisme » français est, là-dessus aussi, un mythe.
Balibar affirme également que « tous les « nationalismes officiels » des XIXème et XXème siècles, visant à conférer l’unité politique et culturelle d’une union à l’hétérogénéité d’un État pluriethnique, ont utilisé l’antisémitisme [mélangé avec l’anti-judaïsme chrétien] : comme si la domination d’une culture et d’une nationalité plus ou moins fictivement unifiée (par exemple la russe, ou l’allemande, ou la roumaine) sur une diversité hiérarchisées d’ethnicités et de cultures « minoritaires » […] devait être « compensée » et reflétée en miroir par la persécution racisante d’une pseudo-ethnie absolument singulière (sans territoire propre, sans langue « nationale ») qui figure l’ennemi intérieur commun de toutes les cultures, de toutes les populations dominées » (pp. 75-76). C’est effectivement en partie comme cela que l’antisémitisme a été impulsé au plus haut niveau de l’État tsariste au tournant des 19ème-20ème siècles.
Pour Balibar, d’autre part, le nationalisme développe forcément un racisme (même le nationalisme israélien développe un racisme envers les juifs « orientaux » [p. 76]), et réciproquement : « Le racisme sort sans cesse du nationalisme. […] En France, l’élaboration d’une idéologie de la « race française », enracinée dans le passé « de la terre et des morts », coïncide avec le début de l’immigration massive, la préparation de la revanche contre l’Allemagne et la fondation de l’empire colonial. Et le nationalisme sort du racisme […] : ainsi le sionisme procède-t-il de l’antisémitisme, et les nationalismes du tiers monde procèdent du racisme colonial » (p. 77). Pour autant, on sera en désaccord en partie avec Balibar lorsqu’il affirme « le racisme n’est pas une « expression » du nationalisme, mais un supplément au nationalisme, mieux : un supplément intérieur au nationalisme, toujours en excès par rapport à lui, mais toujours indispensable à sa constitution, et cependant toujours encore insuffisant à achever son projet » (p. 78). Le racisme peut être nationaliste, lorsqu’il procède d’une exploitation, d’une oppression et d’une domination d’un groupe « étranger » par un État-nation, mais il peut également être infra-nationaliste (domination raciste d’un groupe à l’intérieur d’une « nation », des Sunnites en Irak jusqu’en 2003 notamment) et supra-nationaliste (domination raciste des « Blancs » d’Afrique du Sud, d’origine néerlandophone ou anglaise). Ainsi, « le racisme figure à la fois du côté de l’universel et du côté du particulier » (p. 78)
Balibar critique une certaine responsabilité du marxisme orthodoxe « qui n’a pas peu contribué à nourrir les effets de symétrie entre la « lutte des classes » et la « lutte des races », entre le moteur du progrès et l’énigme de l’évolution » (p. 79). L’hégélianisme a nourri l’idéologie raciste comme l’idéologie marxiste. Pourtant, l’idéologie raciste a une téléologie pessimiste, et non optimiste comme l’idéologie marxiste : « Tout racisme n’est pas « pessimiste » catégoriquement, bien qu’il le soit nécessairement hypothétiquement : la race (la culture) supérieure est perdue […] si elle finit par être « submergée » dans l’océan des barbares, des inférieurs. Variante différentialiste : toutes les races (cultures) sont perdues […] si elles se noient réciproquement dans l’océan de leur diversité […]. Le pessimisme historique entraîne une conception volontariste ou décisionniste de la politique : seule une décision radicale, traduisant l’antithèse de la volonté pure et du cours des choses, donc celle des hommes de la volonté et des hommes de la passivité, peut contrecarrer, voire inverser la décadence » (pp. 79-80).
Quoiqu’il en soit, « à coup sûr il n’existe pas une philosophie raciste, d’autant que celle-ci ne prend pas toujours la forme du système. Le néo-racisme contemporain nous confronte aujourd’hui directement à cette variété de formes historiques et nationales : mythe de la « lutte des races », anthropologie évolutionniste, culturalisme « différentialiste », sociobiologie, etc. » (p. 80). L’idéologie raciste n’étant au fond qu’une rationalisation d’une exploitation, d’une oppression et d’une domination, elle peut revêtir de multiples formes.
Le racisme est, selon Balibar, se présente comme une « volonté de savoir » (Foucault) : « Il y a d’abord l’opération fondamentale de classification […]. Cette classification est présupposée par toute hiérarchisation […]. Classification et hiérarchie sont par excellence des opérations de naturalisation, ou mieux, de projection des différences historiques et sociales dans l’horizon d’une nature imaginaire […]. D’où l’importance centrale du critère de la généalogie, qui est tout sauf une catégorie de la « pure » nature : c’est une catégorie symbolique articulée sur des notions juridiques relatives […] à la légitimité de la filiation » (pp. 80-81).
D’autre part, en plus de s’avancer comme une simple classification biologique, « tout racisme théorique se réfère à des universaux anthropologiques […] Parmi ces universaux figurent […] des concepts […] comme l’agressivité humaine ou, inversement, l’altruisme « préférentiel », qui nous amènent aux différentes variantes des idées de xénophobie, d’ethnocentrisme et de tribalisme » (p. 82). Le racisme prétend ainsi être une « anthropologie », en plus d’être une « biologie » : il naturalise donc doublement une hiérarchie sociale dont il est issu.
« Dans le social-darwinisme classique on a […] la figure paradoxale d’une évolution qui doit extraire l’humanité proprement dite […] de l’animalité, mais par les moyens qui caractériseraient l’animalité (la « survivance du plus apte »), autrement dit par une concurrence « animale » entre les degrés d’humanité. Dans la sociologie et l’éthologie contemporaines, on se représente les comportements « socio-affectifs » des individus et surtout des groupes humains […] comme la marque indélébile de l’animalité dans l’humanité évoluée » (pp. 82-83). Mais cette naturalisation d’une hiérarchie sociale sous forme d’ « animalisation » est double, puisqu’il y a également une « « bestialisation » systématique des individus et des groupes humains racisés » (p. 83). Balibar note également un « fréquent couplage du discours de la différence culturelle avec celui de l’écologie (comme si l’isolement des cultures était la condition de la préservation du « milieu naturel » de l’espèce humaine) » et « la métaphorisation intégrale des catégories culturelles en termes […] de sélection, de reproduction, de métissage » (p. 83). Le racisme « culturaliste » est dans un continuum avec celui clairement biologisant, puisqu’il biologise une (grande) partie du culturel.
Mais cette « nature », plus ou moins biologisée, plus ou moins culturalisée, doit être une « scène pour l’affirmation de la « volonté » des hommes supérieurs » (p. 83). Ainsi, « les théories racistes comportent […] nécessairement un aspect de sublimation, une idéalisation de l’espèce dont la figure privilégiée est esthétique : c’est pourquoi elle doit s’achever dans la description et la valorisation d’un certain type d’homme […]. Cet idéal communique à la fois avec l’homme des origines (non dégénéré) et avec l’homme de l’avenir (le surhomme) […]. L’esthétisation des rapports sociaux est une contribution déterminante du racisme » (p. 84). En effet, l’esthétisation des rapports sociaux est une forme de naturalisation fétichiste des rapports et des rôles sociaux : celle de « la mère » exaltée au sein du discours du 3ème Reich a été un moyen d’assigner une place unique aux femmes, celle de reproductrice soumise, ou encore celle contemporaine du manager décrit comme étant « en même temps un sportif et un séducteur » (p. 84). Pierre Ayçoberry dans La Question nazie note que l’esthétique nazie « a pour fonction d’effacer les traces de la lutte des classes en situation chaque catégorie bien à son rang dans la communauté raciale : le paysan enraciné, l’ouvrier athlète de la production, la femme au foyer ».
Balibar accuse également l’esthétique du mouvement ouvrier : « Le renversement symbolique qui, dans la tradition socialiste, a valorisé […] la figure de l’ouvrier comme type accompli de l’humanité à venir […] s’est accompagné […] d’une intense esthétisation et sexualisation qui a permis sa récupération par le fascisme » (p. 84), et ce notamment en raison de son apologie du travail et du mâle viril producteur de marchandises [Scholz].
« La critique des racismes « biologiques » est à l’origine de l’idée […] selon laquelle le racisme serait par définition incompatible avec l’humanisme, donc théoriquement parlant un anti-humanisme, puisqu’il valorise la « vie » au détriment des valeurs proprement humaines […]. Or il y a ici confusion et méprise. Confusion, parce que le « biologisme » des théories raciales […] n’est pas une […] application de la biologie, mais une métaphore vitaliste de certaines valeurs sociales […]. Le racisme biologique lui-même n’a jamais été une façon de dissoudre la spécificité humaine dans l’ensemble plus vaste de la vie, de l’évolution ou de la nature » (p. 85). Le racisme biologique demeure anthropocentrique, affirme une suprématie humaine, mais simplement naturalise tout ce qu’il y a de valeurs socio-historiquement spécifiques et de hiérarchies sociales.
Pour Balibar, d’autre part, « le racisme se présente d’abord comme un sur-nationalisme. […] Le racisme induit en permanence un excès de « purisme » quant à la nation : pour qu’elle soit elle-même, il faut qu’elle soit racialement ou culturellement pure. Il faut donc qu’elle isole en son sein, avant de les éliminer ou de les expulser, les éléments « faux », « exogènes », « métissés », « cosmopolites ». Impératif obsessionnel, directement responsable de la racisation des groupes sociaux dont les traits […] sont érigés en stigmates de l’extériorité et de l’impureté » (pp. 86-87). La nation peut en effet être une « nation-race » (en Allemagne de manière archétypique), et comme il s’agit d’une structure fétichiste, elle tend inévitablement à se constituer comme race, pour être davantage « naturelle ».
Balibar poursuit : « Mais ce processus de constitution de la race en sur-nationalité débouche sur la fuite en avant. Dans le principe il faudrait pouvoir reconnaître à quelque critère sûr d’apparence ou de comportement celui qui est un « vrai national » […]. Mais dans la pratique il faut le constituer à partir de conventions juridiques ou de particularismes culturels équivoques […], ce qui relance la quête de la nationalité à travers la race vers une fin inaccessible […]. C’est pourquoi le racisme a toujours tendance à fonctionner de façon inversée, suivant le mécanisme de projection que nous avons déjà évoqué à propos du rôle de l’antisémitisme dans les nationalismes européens : l’identité raciale-culturelle des « vrais nationaux » demeure invisible [ils sont non-racisés], mais elle s’insuit (et s’assure) a contrario de la visibilité prétendue, quasi hallucinatoire, des « faux nationaux » » (p. 87). La « nation-race » est donc clairement relationelle (et c’est une relation hiérarchique), puisqu’elle doit définir des non-nationaux (dominés, exploités, opprimés) pour se définir elle-même. Mais « elle reste toujours en suspens et en danger : que le « faux » soit trop visible ne garantira jamais que le « vrai » le soit suffisamment. […] De là, à l’extrêmement, le renversement du fantasme racial : faute de pouvoir trouver la pureté raciale-nationale […], on entreprendra de la fabriquer d’après l’idéal d’un surhomme (sur)national. Tel est le sens de l’eugénique nazie […] De là aussi la rapidité avec laquelle on passe du surnationalisme au racisme comme supra-nationalisme. Il faut prendre totalement au sérieux le fait que les théories raciales […] définissent des communautés […] qui ne coïncident pas, en règle générale, avec les Etats historiques [trop « impurs »], bien qu’elles se réfèrent toujours obliquement à un ou plusieurs d’entre eux » (p. 88). Ainsi du racisme supra-nationaliste européen, défenseur d’une « Europe blanche ».
Balibar remarque également quelque chose d’important : « Les mythes classiques de la race, en particulier l’aryanité, ne se réfèrent pas d’abord à la nation mais à la classe, dans une perspective aristocratique. Dans ces conditions, la race « supérieure » […] ne peut jamais coïncider avec la totalité de la population nationale, ni se restreindre à elle […] : il y a bel et bien un […] « supra-nationalisme » raciste, qui tend à idéaliser des communautés intemporelles […] telles que les « Indo-Européens », l’ « Occident », la « civilisation judéo-chrétienne » » (p. 89). Plus on va vers une idéologie spéculative, plus elle s’autonomise vis-à-vis de ses fondements structurels.
Balibar poursuit : « De là […] qu’un signifiant racial doive transcender les différences nationales, organiser des solidarités « transnationales » pour, en retour, assurer l’effectivité du nationalisme. Ainsi l’antisémitisme a fonctionné à l’échelle européenne : chaque nationalisme a vu dans le Juif […] son ennemi particulier et le représentant de tous ses auteurs « ennemis héréditaires » ; mais tous les nationalismes ont eu ainsi le même repoussoir, le même « apatride » […]. Dans le même temps, les nations européennes […], en concurrence acharnée pour le partage colonial du monde, se sont reconnu une communauté et une « égalité » dans cette concurrence même, qu’elles ont baptisée « blanche » […] : car c’est seulement en tant que « racisme » que l’impérialisme a pu se métamorphoser […] en entreprise de domination universelle, en fondement d’une « civilisation » » (p. 90). L’idéologie raciste donne ainsi une identité commune supra-nationaliste aux colonisateurs.
Ainsi, « on devrait moins s’étonner que les mouvements racistes contemporains aient donné lieu à des formations d’ « axes » internationaux, à ce que Wilhelm Reich appelait de façon provocatrice l’ « internationalisme nationaliste » » (pp. 90-91). Le racisme supra-nationaliste est en effet fondé sur une suprématie commune des membres des centres capitalistes et/ou des ex-métropoles vis-à-vis des membres des périphéries capitalistes et/ou des ex-colonies, tout comme l’alliance de l’Allemagne nazie, de l’Italie fasciste et du Japon était fondé sur une commune « infériorité » (Mussolini parlait de « nations prolétaires ») revancharde vis-à-vis de l’Angleterre, de la France et des États-Unis. Les idéologies racistes supra-nationalistes ont également un fondement structurel.

La nation historique
La construction des peuples : racisme, nationalisme, ethnicité (Immanuel Wallerstein)
Wallerstein dans cet article parle du débat autour des « métis » au sein du mouvement anti-apartheid en Afrique du Sud, et des difficultés conceptuelles (et politiques) de définir cette identité collective. Ainsi : « La notion de peuple n’est pas seulement une construction, mais une construction dont les limites changent avec chaque cas particulier » (p. 104).
Le peuple serait une sorte de sur-concept englobant « race », « nation » et « groupe ethnique » (p. 104). Peu importe qu’il soit définit « en termes de groupe génétique continu (race), de groupe socio-politique historique (nation) ou de groupe culturel (groupe ethnique). Ce sont tous là des modes de construction de la notion de peuple, des façons d’inventer le passé, et des phénomènes politiques du présent » (p. 106). Mais surtout : « Chacune des trois catégories correspond à un trait structural fondamental de l’économie-monde capitaliste. Le concept de « race » est lié à la division axiale du travail dans l’économie-monde, c’est-à-dire à l’opposition entre centre et périphérie. Le concept de « nation » est lié […] aux États souverains qui forment le système interétatiques et sont définis par lui. Le concept de « groupe ethnique » est lié à la création de structures de foyers domestique, qui permettent qu’une proportion importante de la force de travail reste non salariée au cours de l’accumulation capitaliste. Aucun de ces termes n’est directement relié au concept de classe » (pp. 106-107). Wallerstein tente donc une définition « matérialiste » des concepts de « race », de « nation » et de « groupe ethnique », et même si cela reste schématique, c’est au moins des pistes intéressantes.
Wallerstein rappelle, au sujet de la « race » : « Il peut sembler évident qu’un nombre important de traits génétiques diffèrent […]. Il n’est pas du tout évident que, pour autant, il faille les rattacher à trois, cinq ou quinze groupes réifiés qu’on appellera « races ». Le nombre des catégories, le fait même d’établir des catégories sont des décisions sociales. Ce que l’on observe, c’est que plus la polarisation [entre centres d’une part et périphéries d’autre part] s’est accentuée [sous la colonisation notamment], plus le nombre de catégories s’est réduit » (p. 108).
Wallerstein poursuit son explication « matérialiste » du concept de « race » : « La race, et donc le racisme, est l’expression, le moteur et la conséquence de concentrations géographiques associées à la différenciation axiale du travail. Cette réalité a été brutalement mise en évidence par la décision de l’Etat d’Afrique du Sud, dans les vingt dernières années, de classer les hommes d’affaires japonais en tournée dans le pays non comme Asiatiques (comme les Chinois locaux) mais plutôt comme « Blancs honoraires ». Dans un pays où les lois sont censées se fonder sur la permanence de catégories génétiques, tout se passe comme si la génétique prenait en compte les réalités de l’économie-monde » (pp. 108-109). Ce que nous dit Wallerstein ici est extrêmement important : les « races » sont des « classes » (naturalisées) d’individus ayant comme rapport social constitutif une place (inégale) dans « l’économie-monde » capitaliste (et donc plus ou moins exploiteurs et/ou exploités, dominants et/ou dominés, oppresseurs et/ou oppressés à ce titre).
Pour Wallerstein, « la nation résulte [elle] de la structuration politique du système-monde. Des Etats qui sont aujourd’hui membres de l’ONU sont tous des créations du système-monde moderne. La plupart d’entre eux n’existaient même pas à titre de noms ou d’entités administratives il y a un siècle ou deux. Quant aux petit nombre d’entre eux qui peuvent revendiquer un nom et l’existence d’une entité administrative permanente sur le même territoire depuis une période antérieure à 1450, il y en a moins qu’on ne pense : la France, la Russie, le Portugal, le Danemark, la Suède, la Suisse, le Maroc, le Japon, la Chine, l’Iran, l’Ethiopie sont peut-être les cas les moins ambigus. Encore peut-on faire remarquer que même ces Etats ne sont devenus des Etats souverains modes qu’avec l’émergence du système-monde actuel » (p. 109). Et ceci est d’une importance capitale, puisqu’ « un examen systématique de l’histoire du monde moderne montrera, je crois, que, dans presque tous les cas, l’État a précédé la nation, et non l’inverse » (p. 110).
« Certes, à partir du moment où le système interétatique a commencé à fonctionner [à partir de 1648 et du traité de Westphalie ?], des mouvements nationalistes ont vu le jour dans de nombreux endroits, pour réclamer la création de nouveaux Etats souverains, et ces mouvements ont parfois atteint leurs objectifs. Mais deux remarques s’imposent. Ces mouvements, à de rares exceptions près, sont apparus à l’intérieur de limites administratives déjà constituées. […] En outre, on peut se demander jusqu’à quel point la « nation » comme sentiment commune existait avant la création effective de l’Etat » (p. 110). Et Wallerstein de prendre l’exemple de la « nation saharaoui » qui n’existera, selon toute vraisemblance, que s’il y a un État saharaoui.
Mais « pourquoi faudrait-il que la création d’un Etat souverain particulier à l’intérieur du système interétatique crée parallèlement une « nation », un « peuple » ? […] Les Etats, dans un tel système, ont des problèmes de cohésion. Une fois que leur souveraineté a été reconnue, ils se trouvent fréquemment menacés à la fois de désintégration interne et d’agression externe. L’apparition d’un sentiment « national » réduit ces menaces. Les gouvernements ont tout intérêt à encourager ce sentiment, de même que toutes sortes de sous-groupes à l’intérieur de l’Etat considéré. Tout groupe qui voit un avantage quelconque à utiliser les pouvoirs légaux de l’Etat pour promouvoir ses propres intérêts à l’encontre d’autres groupes extérieurs à l’Etat ou défendant des intérêts régionaux à l’intérieur de l’Etat a intérêt à encourager le nationalisme pour légitimer ses propres revendications. De surcroît les Etats ont intérêt à l’uniformité administrative qui accroît l’efficacité de leurs politiques. Le nationalisme est l’expression, le moteur et la conséquence d’une telle uniformité au niveau de l’Etat » (pp. 110-111). Ainsi, le nationalisme est souvent d’abord « officiel », d’État (le nationalisme russe, par excellence), ou porté par un groupe d’intérêt bien spécifique (les dirigeants du royaume de Piedmont-Sardaigne dans l’optique d’une annexion de toute l’Italie, ou encore les « Jeunes Turcs » dans l’optique d’une domination turque poursuivie dans l’empire ottoman). Wallerstein sous-estime l’effet d’homogénéisation des populations du fait même de l’existence d’un Etat central, d’où une base « base objective » construite historiquement au nationalisme. Mais il pointe en revanche de manière intéressante l’importance du système interétatique dans l’essor du nationalisme, c’est-à-dire le remplacement progressif des territoires « dynastiques » (i.e. sur lesquels règne une dynastie) par les territoires étatiques (gouvernés par un État) comme unité géopolitique de base dans le système diplomatique de l’Europe moderne, et ce à partir de 1648 et du traité de Westphalie.
Wallerstein rappelle d’ailleurs que « les entités politiques qui existaient en dehors du développement de ce système comme superstructure politique d’une économie-monde capitaliste n’avaient nul besoin d’être des « nations » (p. 111).
« Si l’on se demande à quoi sert d’avoir deux catégories – race et nation – au lieu d’une seule, on voit qu’alors que la catégorie de race est d’abord apparue comme un moyen d’exprimer et de consolider l’antinomie centre-périphérie, la catégorie de nation a été, à l’origine, un moyen d’exprimer la rivalité entre les Etats […]. De manière simpliste, on pourrait dire que la race et le racisme unifient les régions du centre et les régions de la périphérie dans les luttes qui les opposent, chacune dans son aire géographique, alors que la nation et le nationalisme divisent géographiquement les régions du centre et celles de la périphérie dans la rivalité intrarégionale et interrégionale qui, de manière plus complexe, les oppose pour modifier leur rang dans l’ordre hiérarchique. Ces deux catégories expriment la tentative d’améliorer une position au sein de l’économie-monde capitaliste » (p. 112). Sans doute, mais c’est oublier l’existence de « nations-races », c’est-à-dire de groupes ayant en même temps une place distincte dans l’économie-monde capitaliste et un État : l’Allemagne, le Japon, les États-Unis, la Chine, la France, etc.
Pour ce qui est des « groupes ethniques » : « Le système capitaliste est fondé non seulement sur l’antinomie capital-travail […], mais aussi sur une hiérarchie complexe à l’intérieur de l’élément travail qui fait que, bien que tous les travailleurs soient exploités parce qu’ils créent de la plus-value transférée à d’autres, certains travailleurs « perdent » une part plus grande de la plus-value qu’ils ont créée que d’autres. L’institution clé qui permet d’instituer cet état de choses est la variété de foyers domestiques dont les membres ne sont salariés qu’en partie ou pendant une partie seulement de leur existence. Ces foyers sont organisés de telle manière que ces salariés [souvent des femmes] perçoivent un salaire honoraire inférieur à ce que coûte la reproduction de leur force de travail […] Il s’avère en règle générale que ces différences sorte de structures de foyers se rencontrent à l’intérieur de « communautés » appelées « groupes ethniques ». En d’autres termes, la hiérarchie des emplois entraîne l’ « ethnicisation » de la force de travail à l’intérieur des frontières d’un Etat donné [notamment aux Etats-Unis et en Afrique du Sud, mais aussi en France] […]. Il semble y avoir toutes sortes d’avantages à l’ethnicisation des catégories professionnelles. On peut penser que différents types de rapports de production exigent différents types de comportement de la part de la main-d’œuvre. Comme ce comportement n’est pas génétiquement déterminé, il doit être appris. La socialisation de la force de travail doit se faire par l’apprentissage d’attitudes relativement spécifiques. […] Ce qui définit précisément un groupe ethnique, c’est le fait qu’il pratique une forme particulière de socialisation [pour le travail]. L’ethnicisation, la notion de peuple résolvent l’une des contradictions fondamentales du capitalisme historique, à savoir sa recherche simultanée de l’égalité théorique et de l’inégalité pratique » (pp. 113-114). Ici, l’usage d’exemples aurait été bienvenu pour mieux comprendre l’argumentaire de Wallerstein et de juger de sa pertinence. On comprend néanmoins que les « groupes ethniques » sont des classes spécialisées dans un type de travail à l’intérieur du système-monde capitaliste (et de chaque État capitaliste) : Bretonnes comme femmes de ménage en France (au 19ème siècle et au début du 20ème siècle), Andalous comme sous-prolétaires en Catalogne au début du 20ème siècle, Philippines comme femmes de ménage en Arabie Saoudite, etc. Les « groupes ethniques » constitueraient une sorte de sub-division de la « race », laquelle oppose des groupes bien plus large en fonction de leur place globale dans l’économie-monde capitaliste (et non au sein de chaque procès de travail).
« Dans cette tentative, l’instabilité des catégories de peuple dont nous avons parlé s’avère particulièrement importante. […] Le capitalisme […] a aussi besoin de restructurer constamment les processus économiques. Aussi, ce qui fonde aujourd’hui une certaine hiérarchie des relations sociales peut ne plus fonctionner demain. Le comportement de la force de travail doit changer sans mettre en péril la légitimité du système. La naissance, la restructuration et la disparition incessante de groupes ethniques [celui des Bretonnes femmes de ménage, par exemple] sont par conséquent un précieux élément de souplesse dans le fonctionnement de la machine économique » (p. 114).
Wallerstein termine son article ainsi : « Les « peuples » constitués – les races, les nations, les groupes ethniques – correspondent fortement […] à la « classe objective ». Le résultat en est qu’une part très importante de l’activité politique fondée sur la notion de classe a pris la forme d’une activité politique fondée sur la notion de peuple. La chose sera encore plus évidente si l’on analyse attentivement les organisations dites « purement » ouvrières » qui, très souvent, sont de fait implicitement fondées sur l’idée de « peuple » » (p. 115).
La forme nation : histoire et idéologie (Etienne Balibar)
« L’histoire des nations […] nous est toujours déjà présentée dans la forme d’un récit qui leur attribue la continuité d’un sujet. La formation de la nation apparaît ainsi comme l’accomplissement d’un « projet » séculaire, marqué d’étapes […] que les partis pris des historiens feront apparaître comme plus ou moins décisives […] mais qui de toute façon s’inscrivent dans un schéma identique : celui de la manifestation de soi de la personnalité nationale [sur un schéma hégélien]. Une telle représentation constitue certes une illusion rétrospective [une rétroprojection], mais elle traduit aussi des réalités institutionnelles contraignantes. L’illusion est double. Elle consiste à croire que les générations qui se succèdent pendant des siècles sur un territoire [très] approximativement stable, sous une désignation approximativement commune, se sont transmis une substance invariante. Et elle consiste à faire croire que l’évolution, dont nous sélectionnons rétrospectivement [et de manière téléologique] les aspects de façon à nous percevoir nous-mêmes comme son aboutissement, était la seule possible, qu’elle représentait un destin. Projet et destin sont les deux figures symétriques de l’illusion d’identité nationale » (pp. 117-118), et cela au sein des « nouvelles nations » (Algérie, Inde, etc.) comme des « vieilles » (France). La « nation » est en réalité une catégorie moderne, produit de l’Etat moderne et des idéologies nationalistes, et elle n’est que rétro-projetée abusivement sur un passé transformé sous l’effet d’une philosophie téléologique (et naturalisante) de l’histoire.
« Comment tenir compte de cette distorsion ? Les « origines » de la formation nationale renvoient à une multiplicité d’institutions d’ancienneté très inégale. Certaines sont en effet très anciennes : l’institution de langues d’État [comme le français à partir de 1539] distinctes à la fois des langues sacrées du clergé [latin] et des idiomes « locaux », à des fins strictement administratives d’abord, comme langues aristocratiques ensuite, remonte en Europe au haut Moyen Âge. Elle est liée à l’autonomisation […] du pouvoir monarchique. De même la formation progressive de la monarchie absolue a entraîné des effets de monopole monétaire, de centralisation administrative et fiscale, d’uniformisation juridique de « pacification » intérieur relatives. Elle a ainsi révolutionné les institutions de la frontière et du territoire. […] Toutes ces structures nous apparaissent rétrospectivement comme pré-nationales parce qu’elles ont rendu possibles certains traits de l’Etat national, auquel elles seront incorporées avec plus ou moins de changements. Nous devons donc prendre acte du fait que la formation nationale résulte d’une longue « préhistoire ». Mais celle-ci diffère essentiellement du mythe nationaliste D’abord elle consiste en une multiplicité d’événements qualitativement distincts, décalés dans le temps, dont aucun n’implique les suivants. Ensuite, ces événements n’appartiennent pas par nature à l’histoire d’une nation déterminée. Ils ont eu pour cadre d’autres unités politiques [« Sicile », « Catalogne », « Bourgogne »] […] et même ils n’appartiennent pas par nature à l’histoire de l’Etat-nation, mais aussi à d’autres formes concurrentes (par exemple la forme « impériale » [ou monarchique]. C’est un enchaînement de rapports conjoncturels, et non pas une ligne d’évolution nécessaire, qui les a inscrits après coup dans la préhistoire de la forme nation. Le propre des Etats quels qu’ils soient est de représenter l’ordre qu’ils instituent comme éternel, mais la pratique montre que c’est à peu près l’inverse qui est vrai […]. En d’autres termes, des appareils d’Etat non nationaux, visant de tout autres objectifs (par exemple dynastiques), ont progressivement produit les éléments de l’Etat national ou, si l’on veut, ils se sont involontairement « nationalisés » et ont commencé à nationaliser la société » (p. 120). Balibar tente ici une intéressante histoire non-téléologique de la « nation ».
Mais, peut-on se demander, à quel moment peut-on parler d’ « Etat-nation » ? Pour Balibar, cela correspond « au développement des structures de marché et des rapports de classes propres au capitalisme moderne » (p. 120), lequel nécessite un Marché unifié pour se développer et une structure politique capable de garantir ce Marché unifié, son ordre et ses contrats : l’État-nation. La constitution des nations ne se déduit pas de « l’abstraction du marché capitaliste », son caractère « universel », mais de « sa forme historique concrète », le Marché national (p. 121). Pour Balibar, même, « en un sens, toute « nation » moderne est un produit de la colonisation ; elle a toujours été à quelque degré colonisatrice ou colonisée, parfois l’un et l’autre » (p. 121). Cela est d’autant plus vrai si l’on considère qu’un État central colonise nécessairement des périphéries (on parler de « colonisation intérieure) pour constituer son territoire : en France, la monarchie va « coloniser » progressivement l’ensemble du territoire actuel, en Russie, de même.
Balibar explique par ailleurs qu’il y avait plusieurs « bourgeoisies d’Ancien Régime » (l’expression n’est pas de lui mais de Régine Robin), plusieurs bourgeoisies non-capitalistes (avocats, marchands, etc.), mais que c’est celle « nationale » qui a triomphé (p. 122), « parce qu’elles avaient besoin à l’extérieur et à l’intérieur d’utiliser la force armée des Etats existants, et parce qu’elles devaient assujettir les campagnes au nouvel ordre économique » (p. 122).
Balibar fait même l’hypothèse que « bourgeoisie dominante et formations sociales bourgeoises se sont constitués par un « procès sans sujet » » (p. 123), c’est-à-dire un procès historique non-dirigé par un groupe social.
Balibar fait ensuite référence aux travaux d’Eugen Weber et de Gérard Noiriel au sujet de la « nationalisation des sociétés » en France, lequel ne serait intervenu que tard au sein des campagnes françaises : « La scolarisation généralisée, l’unification des coutumes et des croyances par les migrations de main-d’œuvre interrégionales et le service militaire, la subordination des conflits politiques et religieux à l’idéologie patriotique ne sont pas intervenus avant le début du 20ème siècle » (p. 125). Il avance même qu’on ne peut pas vraiment parler d’ « Etat-nation » avant « l’institution de l’Etat national-social, c’est-à-dire d’un Etat « intervenant » dans la […] formation des individus, dans les structures de la famille, de la santé publique et plus généralement dans tout l’espace de la « vie privée » » (p. 126). Ainsi, « une formation sociale ne se reproduit comme nation que dans la mesure où l’individu est institué comme homo nationalis, de sa naissance à sa mort, par un réseau d’appareil et de pratiques quotidiennes » (p. 126). L’homo nationalis est une production sociale.
Balibar se propose également d’en finir avec l’antithèse fantasmatique entre « la communauté « réelle » et […] la communauté « imaginaire ». Toute communauté sociale, reproduite par le fonctionnement d’institutions, est imaginaire, c’est-à-dire qu’elle repose sur la projection de l’existence individuelle dans la trame d’un récit collectif, sur la reconnaissance d’un nom commun, et sur les traditions vécues comme trace d’un passé immémorial (même lorsqu’elles ont été fabriquée et inculquées dans des circonstances récentes [cf. Hobsbawm, L’invention des traditions]). Mais cela revient à poser que seules des communautés imaginaires sont réelles, dans certaines conditions. […] Aucune nation moderne ne possède une base « ethnique » […]. Le problème fondamental est donc de produire le peuple. Mieux : c’est que le peuple se produise lui-même en permanence comme communauté nationale « (p. 127). Balibar écarte donc un faux problème, c’est de « l’authenticité » et du caractère « réel » d’une part et de « l’inauthenticité » et de « l’irréalité » des communautés d’autre part : il n’y a que des communautés construites et en même temps « réelles » lorsqu’elles ont un fondement structurel (un Etat, par excellence).
Autre faux problème : « Il ne s’agit pas d’opposer une identité collective à des identités individuelles. Car toute identité est individuelle, mais il n’y a jamais d’identité individuelle qu’historique [contra l’individualisme abstrait de l’individualisme méthodologique], c’est-à-dire construite dans un champ de valeurs sociales, de normes de comportement et de symboles collectifs. Jamais […] les individus ne s’identifient les uns aux autres, mais jamais non plus ils n’acquièrent une identité isolée, notion intrinsèquement contradictoire » (p. 128).
Balibar refuse qu’ « à la question de la production historique du peuple » on puisse se contenter de répondre « par la description des conquêtes, des déplacements de population et des pratiques administratives de la « territorialisation » […] : le processus d’unification [nationale] […] présuppose la constitution d’une forme idéologique spécifique » (p. 128). Pas de nationalisation sans idéologie nationaliste, donc : mais pas non plus sans « nationalisation des sociétés » du fait de structures homogénéisantes.
Balibar précise ensuite un concept déjà utilisé antérieurement : « J’appelle ethnicité fictive la communauté instituée par l’Etat national. […] Le terme de fiction […] ne doit pas être compris au sens d’une pure et simple illusion sans effets historiques [de manière idéaliste], mais au contraire, par analogie avec la persona ficta de la tradition juridique, au sens d’un effet institutionnel, d’une « fabrication » [structurelle]. Aucune nation ne possède naturellement une base ethnique, mais à mesure que les formations sociales se nationalisent, les populations qu’elles incluent, qu’elles se répartissent ou qu’elles dominent sont « ethnicisées », c’est-à-dire représentées dans le passé ou dans l’avenir comme si elles formaient une communauté naturelle […]. L’ethnicité fictive ne se confond pas purement et simplement avec la nation idéale qui fait l’objet du patriotisme, mais elle lui est indispensable car, sans elle, la nation n’apparaitrait précisément que comme une idée ou une abstraction arbitraire : l’appel du patriotisme ne s’adresserait à personne. C’est elle qui permet de voir dans l’Etat l’expression d’une unité préexistante, de le mesurer en permanence à sa « mission historique » au service de la nation […]. En constituant le peuple comme une unité fictivement ethnique, sur le fond d’une représentation […] qui attribue à tout individu une identité ethnique et une seule, et qui répartit ainsi l’humanité tout entière entre différentes ethnicités correspondant potentiellement à autant de nations, l’idéologie nationale fait beaucoup plus que de justifier les stratégies utilisées par l’État pour contrôler les populations » (pp. 130-131) : elle crée une identification obligatoire des individus avec cette nation, et permet ainsi de les envoyer mourir lorsque cette nation est « en danger ». L’ethnicité (fictive) naturalise la « nation », laquelle est en réalité un produit d’une histoire non-nécessaire.
Mais « comment produire l’ethnicité ? […] L’histoire nous montre qu’il y a deux grandes voies concurrentes : la langue et la race. Le plus souvent elles sont associées, car seule leur complémentarité permet de se représenter le « peuple » comme une unité absolument autonome. L’une et l’autre énoncent que le caractère national […] est immanent au peuple. Mais l’une et l’autre projettent une transcendance [fictive] par rapport aux individus actuels, aux rapports politiques. Elles constituent deux façons d’enraciner les populations historiques dans un fait de « nature » […], mais aussi deux façons de donner un sens à leur durée, de dépasser sa contingence » (pp. 131-132). La dominance d’une ethnicité « linguistique » ou d’une ethnicité « raciale » a bien évidemment des conséquences politiques, qu’il étudie plus loin.
La communauté de langue est une histoire « remarquablement récente. Les anciens empires et les sociétés d’Ancien Régime ont encore reposé sur la juxtaposition de populations linguistiquement séparées, sur la superposition de « langues » incompatibles entre elles pour les dominants et les dominés, pour les sphères sacrées et profanes, entre lesquelles devait exister tout un système de traductions » (p. 132) : pas de langue unique, « nationale », donc. Et cette uniformatisation linguistique va donc devoir être produite : « Il y a une étroite corrélation historique entre la formation nationale et le développement de l’école comme institution « populaire » […]. Que l’école soit aussi le lieu d’inculcation – parfois de contestation – d’une idéologie nationaliste est un phénomène dérivé […]. Disons que la scolarisation est la principale institution qui produit l’ethnicité comme communauté linguistique » (p. 133) : c’est notamment vrai en France.
La langue est pourtant équivoque comme marqueur d’une identité « nationale » : « La construction linguistique de l’identité est par définition ouverte. Aucun individu ne « choisit » sa langue maternelle, ne peut en « changer » à volonté. Pourtant, il est toujours possible de s’approprier plusieurs langues, et de se faire autrement le porteur du discours et des transformations de la langue. La communauté linguistique induit une mémoire ethnique terriblement contraignante (R. Barthes alla un jour jusqu’à la dire « fasciste »), mais qui possède pourtant une étrange plasticité : elle naturalise immédiatement l’acquis. Trop vite, en un sens. […] L’immigrant de la « seconde génération » […] habite la langue nationale […] d’une façon aussi spontanée, aussi « héréditaire » […] que le fils d’un de ces « terroirs » qu’on dit bien de chez nous. […] Idéalement, [la langue] « assimile » n’importe qui, elle ne retient personne. Finalement elle affecte chaque individu au plus profond […], mais sa particularité historique n’est liée qu’à des institutions interchangeables. Lorsque les circonstances s’y prêtent, elle peut servir des nations différentes […], ou survivre à la disparition « physique » des populations qui l’ont utilisée (comme le latin, le grec « anciens », l’arabe « littéraire »). Pour être rattachée aux frontières d’un peuple déterminé, elle a donc besoin d’un supplément de particularité, ou d’un principe de fermeture, d’exclusion » (pp. 134-135). Et ce supplément, c’est l’idée de « race », dont le noyau symbolique est précisément « le schème de la généalogie, c’est-à-dire tout simplement l’idée que la filiation des individus transmet d’une génération à l’autre une substance à la fois biologique et spirituelle » (p. 136). Pourtant, paradoxalement en apparence, « l’idée d’une communauté de race fait son apparition quand les frontières de la parenté se dissolvent au niveau du clan, de la communauté de voisinage et, théoriquement au moins, de la classe sociale, pour être reportées imaginairement au seuil de la nationalité […]. La communauté de race est susceptible de se représenter comme une grande famille, ou comme l’enveloppe commune des relations familiales » (p. 136). Le « discours familiste » (p. 138) naturalise « la race », laquelle naturalise à son tour « la nation ».
Pour retourner à la langue : « Formellement égalitaire, l’appartenance à la communauté linguistique – du fait notamment qu’elle est médiatisée par l’institution scolaire – recrée aussitôt des divisions […] qui recoupent […] les différences de classe […] : accent « étranger » ou « régional », élocution « populaire », « fautes » de langue ou, inversement, « correction » ostentatoire désignant immédiatement l’appartenance d’un locuteur à telle population et spontanément rapportées […] à une disposition héréditaire » (p. 141) : la langue, instrument d’homogénéisation et de « nationalisation » des populations, permet néanmoins de classer ces populations en fonction de leur classe capitaliste et de leur statut de racisé ou de non-racisé : « racisation de la langue et verbalisation de la race » (p. 142).
Balibar conclue en disant que « chaque « peuple » [est un] produit d’un procès national d’ethnicisation » (p. 143).
Les structures du foyer domestique et la constitution de la force de travail dans l’économie-monde capitaliste (Immanuel Wallerstein)
Pour Wallerstein, « les foyers domestiques forment l’une des structures institutionnelles clés de l’économie-monde capitaliste. C’est toujours une erreur que de vouloir analyser les institutions sociales d’une manière transhistorique » (p. 144) : pour lui, il s’agit d’une institution spécifiquement capitaliste, ou du moins ayant une forme différente de celle qu’elle avait auparavant. Il explique l’existence de cette institution par des exigences du capitalisme :
- – « [Les capitalistes] gagneraient à avoir une force de travail dont l’utilisation soit flexible dans le temps. En d’autres termes, les entrepreneurs individus voudraient n’avoir d’autres frais que ceux qui sont directement liés à la production […]. Mais d’un autre côté, chaque fois qu’ils veulent produire, ils veulent aussi disposer immédiatement de gens prêts à travailler » (p. 145).
- – « [Les capitalistes] gagneraient à maintenir le coût de la force de travail aussi bas que possible » (p. 146).
Pour Wallerstein, ce sont « les structures du « foyer domestique », dans leur développement historique, [qui] ont correspondu à cet objectif » (p. 147). D’ailleurs, le « foyer domestique » présente également l’intérêt d’une taille optimale : « Le principal désavantage de la trop petite taille des unités réside […] dans le fait que le niveau de revenu par tête nécessaire à la reproduction collective y est nettement supérieur à celui qu’exigent des unités de taille intermédiaire [et nécessiterait donc des salaires davantage élevés]. […] [D’un autre côté] le principal désavantage de la trop grande taille des unités réside […] dans le fait que la quantité de travail nécessaire pour assurer la survie y reste en dessous d’un seuil trop bas, ce que les agents de l’accumulation n’apprécient pas, parce que cela diminue la pression sur le marché du travail salarié. [D’un autre côté] […] il est très difficile de « déplacer » une communauté » (p. 149) laquelle fait donc obstacle à la mobilité géographique des travailleurs.
Le « foyer domestique » comme institution, sa « plasticité […] (en fait d’appartenance, de limites, de combinaison de formes de travail et de localisation) qui était si profitable aux capitalistes, s’avérait aussi profitable aux travailleurs, à qui elle fournissait le moyen de résister aux pressions économiques ou de les éluder, du moins dans le court terme. De fait, jusqu’à l’avènement des mouvements ouvriers, et même après cet avènement, l’autonomie de gestion du foyer a représenté peut-être […] l’arme politique principale à la disposition de la force de travail dans sa lutte quotidienne […] [et] représentait en réalité autant de parades socio-politiques destinées à défendre certaines valeurs d’usage, ou de simples efforts pour faire baisser le taux d’exploitation » (p. 150). Le problème est qu’il manque une théorie critique du patriarcat dans l’analyse de Wallerstein [Delphy].
Les classes : polarisation et surdétermination
Le conflit de classes dans l’économie-monde capitaliste (Immanuel Wallerstein)
Pour lui, il faudrait définir les « classes » en termes de processus, dans une conception dynamique (p. 160). La classe « capitaliste » ne serait pas l’éternel retour du même, mais une classe en constante évolution, à l’instar du prolétariat. Cette vision paraît logique en raison du caractère dynamique du capitalisme.
Wallerstein parle ensuite des conflits internes à la bourgeoisie en temps de crise économique (de faillites et de concentration économique), où il y a une crispation de la bourgeoisie héréditaire (majoritaire) face aux nouveaux bourgeois, d’où une polarisation politique (p. 161) allant jusqu’à un soutien des premiers au fascisme.
Il s’intéresse également aux travailleurs non-salariés : « Le péon [statut très répandu en Amérique latine au 19ème siècle] […] transférer toute la valeur et, en échange, recevait théoriquement de l’argent, mais pratiquement des biens, et le contrat était théoriquement annuel, mais pratiquement à vie. La différence entre un péon et un esclave existait certainement dans « la théorie », mais également dans la pratique sur deux points. D’une part, un propriétaire pouvait « vendre » un esclave, mais généralement pas un péon et, d’autre part, si un tiers donnait de l’argent à un péon, ce dernier était légalement capable de mettre un terme à son contrat, ce qui n’était pas le cas pour un esclave » (p. 164).
Wallerstein rappelle ainsi que le salariat n’est pas l’unique mode d’exploitation et de travail au sein du capitalisme : « De tous les processus de travail […], le travail salarié est probablement le mieux payé. Par conséquent celui qui reçoit la survaleur préférera […] ne pas s’aliéner le producteur en tant que salarié, mais par quelque autre rapport. […] À partir du moment où le salaire est, du point de vue de la bourgeoisie, un mode de travail relativement coûteux, il devient facile de comprendre pourquoi le travail salarié n’a jamais été exclusif et, jusqu’à récemment, n’a même pas été la principale forme de travail dans l’économie-monde capitaliste » (p. 164).
« Toutefois, le capitalisme a ses contradictions. L’une de ces contradictions de base réside dans le fait que ce qui est profitable à court terme ne l’est pas nécessairement à long terme. La capacité de croissance du système dans son ensemble (nécessaire pour le maintien du taux de profit) se bloque régulièrement dans le goulot d’étranglement d’une demande mondiale devenue insuffisante. L’une des façons d’en sortir est la transformation sociale de certains processus de travail non salarial en travail salarié. Il s’ensuit une augmentation de la fraction de la valeur produite conservée par le producteur, et par conséquent une croissance de la demande mondiale. C’est la raison pour laquelle, tout au long de l’histoire de l’économie-monde capitaliste, le pourcentage mondial du salariat en tant que forme de travail est en augmentation croissante » (pp. 164-165).
Wallerstein souligne également que « nous nous trompons dans notre analyse si nous prenons à la lettre le modèle d’un prolétaire faisant face à un bourgeois. Car la survaleur créée par le producteur passe par toute une série de personnes et de sociétés. La survaleur produite par un prolétaire est, par conséquent, partagé entre beaucoup de bourgeois » (p. 167). Il y a plus de bourgeois et de salariés au sein des centres capitalistes qu’au sein des périphéries.
Marx et l’histoire : la polarisation (Immanuel Wallerstein)
Wallerstein, après avoir dit que « chacun a ses deux Marx » (p. 169), affirme que les capitalistes cherchent à faire reposer une partie des coûts de reproduction de la force de travail de ses travailleurs sur d’autres que lui (le « foyer domestique »), et que c’est « exactement de cette façon, d’ailleurs, que peuvent être payés les salaires scandaleusement bas des zones périphériques de l’économie-monde » (p. 176). Il reparle également de la contradiction entre le coût du salariat et son intérêt pour assurer des débouchés suffisants.
La bourgeoisie : concept et réalité du XIème au XXIème siècle (Immanuel Wallerstein)
« D’après les linguistes, le terme est apparu pour la première fois, dans sa forme latin burgensis en 1007 et il a été transcrit, en français, burgeis, dès 1100. Au départ, il désignait l’habitant « libre » d’un bourg, une localité urbaine. Libre de quoi ? Libre des obligations qui constituaient le ciment social et le lien économique d’un système féodal. Le bourgeois n’était pas un paysan ou un serf, mais il n’était pas non plus un noble » (p. 183). Wallerstein critique la vision hégéliano-marxiste de la bourgeoisie comme classe progressiste : il s’agit en réalité d’une rétroprojection anachronique, puisque « la bourgeoisie » avant le 19ème siècle en France n’est qu’une « bourgeoisie médiévale » puis une « bourgeoisie d’Ancien Régime » (Régine Robin), c’est-à-dire des groupes sociaux non-capitalistes pris dans des rapports sociaux non-capitalistes et ayant des objectifs non-capitalistes.
« En 1932, Adolf A. Berle et Gardiner C. Means écrivirent un livre fameux [The Modern Corporation and Private Property] dans lequel ils mettaient en lumière une tendance dans l’histoire structurelle de l’entreprise moderne – tendance qu’ils appelèrent la « dissociation de la propriété et de la direction ». Ils entendaient par là le passage d’une situation où le propriétaire légal d’une entreprise en était également le directeur à une autre (les entreprises modernes) où les propriétaires légaux sont nombreux, dispersés et virtuellement réduits à n’être que de simples investisseurs du capital […], et où le managers qui disposent d’un pouvoir réel de décision économique ne sont pas nécessairement des propriétaires, même minoritaires, et sont, en termes formels, des employés salariés » (p. 189). Cette tendance à une dissociation existe dès l’émergence du capitalisme, avec une dissociation entre propriétaire capitaliste de terres agricoles et « fermier capitaliste ». Il a donc toujours existé au sein du capitalisme une classe dirigeante distincte de la classe capitaliste (propriétaire) et à son service, qu’on appellera avec Alain Bihr « l’encadrement capitaliste ».
Néanmoins, cet encadrement a cru fortement avec « la montée de cette forme de société » (p. 189), et la polarisation en deux classes (bourgeoisie et prolétariat) qu’avait annoncée Karl Marx ne s’est produite qu’à moitié : s’il y a bien eu une forte diminution du nombre de « petits producteurs agricoles et [de] petits artisans urbains indépendants » (p. 189), au moins au sein des centres capitalistes, l’encadrement capitaliste (ou « nouvelle classe moyenne » pour ce qui est de ses strates intermédiaires, majoritaires numériquement) a cru largement. En Afrique, domine ainsi depuis l’indépendance une « bourgeoisie administrative » (p. 191).
Wallerstein s’attaque ensuite au mythe suivant : « Il était une fois une économie féodale, c’est-à-dire une économie non commerciale et non spécialisée ; il y avait des seigneurs et des paysans ; et il y avait aussi […] quelques bourgeois urbains qui produisaient et commerçaient sur le marché. Les classes moyennes créèrent et étendirent le royaume de la transaction, libérant ainsi toutes les merveilles du monde moderne. Dans une version légèrement différente de la même légende, non seulement la bourgeoisie émergea (sur la scène économique), mais elle se souleva (sur la scène politique) pour renverser l’aristocratie, précédemment dominante » (p. 195). Ellen Meiksins Wood, Robert Brenner, George Comninel, Jean-Yves Grenier ou encore Robert Kurz ont montré l’inanité d’une telle vision de l’histoire.
Wallerstein se lance ensuite dans une analyse intéressante, quoique problématique : « Je voudrais faire une analyse parallèle à celle de Max Weber, en distinguant entre la logique et la psycho-logique de l’éthique capitaliste. Si l’objectif de toute l’opération est l’accumulation illimitée de capital, labeur éternel et abnégation sont toujours logiquement de rigueur. Tout comme les salaires, les profits ont leur loi d’airain. Un centime dépensé pour se faire plaisir est un centime retiré du processus d’investissement et par conséquent d’une plus grande accumulation de capital. Mais si la loi d’airain du profit est logiquement incontournable, elle ne tient pas psycho-logiquement. Pourquoi être capitaliste, entrepreneur, bourgeois si l’on n’en tire aucune satisfaction personnelle ? […] Il n’existe pas de capitaliste qui ne songe à transformer le profit en rente » (pp. 198-199). Il y a deux explications à cet état de fait : d’une part, ceux qui sont forcés de maximiser l’accumulation du capital (l’encadrement supérieur, c’est-à-dire les dirigeants d’entreprise) ne sont pas ceux qui en sont les principaux bénéficiaires (les capitalistes, c’est-à-dire les grands actionnaires) ; et d’autre part, avec le capital fictif, il y a possibilité d’avoir des quantités maximales de capital d’investissement et (du côté des capitalistes) d’avoir une consommation forte.
Wallerstein pense qu’en réalité « l’objectif de tout « bourgeois » est de devenir « aristocrate » (p. 199), c’est-à-dire rentier, « la rente étant un mécanisme pour accroître le taux de profit au-delà de celui que l’on aurait obtenu dans un marché vraiment concurrentiel » (p. 200). « Il convient de noter que […] la rente semble plus ou moins équivalente au profit du monopole. […] Le monopole désigne une situation où, faute de concurrence, le contractant peut obtenir un profit important ou une grande portion de la survaleur générée par toute la filière marchande dont le segment monopolisé fait partie. Il est évident que plus une entreprise monopolise […] plus le taux de profit est élevé. Inversement, plus la condition du marché est soumise à une véritable concurrence, moins le taux de profit est élevé. […] Les capitalistes ne veulent pas la concurrence, mais le monopole. Ils cherchent à accumuler le capital, non par le profit, mais par la rente. Ils ne veulent pas être bourgeois, mais aristocrates » (pp. 200-201). Avec cette affirmation provocante, et sans doute exagérée, Wallerstein permet néanmoins d’illustrer une certaine tendances des capitalistes à vouloir se reposer sur leurs lauriers et à profiter d’une situation de rente : d’où le caractère rentier de la bourgeoisie française jusqu’aux années 1920, d’où aussi l’absence de modernisation suffisante de l’industrie anglaise face à la montée de l’Allemagne et des États-Unis à la fin du 19ème siècle (les capitalistes anglais préférant investir dans le commerce et les colonies, plus rentables), et d’où le caractère rentier de certain-e-s actionnaires aujourd’hui comme Liliane Bettencourt.
Wallerstein tente enfin de caractériser l’encadrement capitaliste (surtout sa strate supérieure) : « À en juger par leur style de vie et de consommation ou le fait qu’elles perçoivent une [partie de la] survaleur, elles sont bourgeoises. Elles ne le sont pas, ou le sont beaucoup moins, quand on les considère par rapport au capital ou aux droits de propriété. Cette contradiction les rend beaucoup moins capables que les bourgeoisies « classiques » de transformer le profit en rente, de s’aristocratiser. Elles vivent de leurs avantages immédiats et non de privilèges [capitaliste] hérités du passé » (p. 203). D’où l’importance de la reproduction scolaire pour cette classe.
De la lutte des classes à la lutte sans classes ? (Etienne Balibar)
L’article de Balibar est globalement problématique (nous sommes en désaccord avec lui sur nombre de questions), et long, nous nous contenterons donc de relever ce qu’il y a d’intéressant. Il développe l’idée que « beaucoup des luttes typiquement ouvrières les plus dures et plus massives de ces dernières années […] apparaissent comme des luttes sectorielles et défensives, des barouds d’honneur privés de signification pour l’avenir collectif […]. Telle serait peut-être la forme la plus radicale de la « disparition des classes » : non pas l’évanouissement pur des luttes socio-économiques et des intérêts qu’elles traduisent, mais leur perte de centralité politique » (p. 213). Là-dessus, on lira également Norbert Trenkle, Les lubies métaphysiques de la lutte des classes, et en contrepoint (mais avec un renouvellement de cette problématique), les travaux des communisateurs comme Bruno Astarian ou Théorie communiste.
Balibar distingue « l’exploitation proprement dite, dans sa forme marchande, en tant qu’extorsion et appropriation de survaleur par le capital » (p. 217), et « domination : c’est le rapport social qui s’établit dans la production même, […] d’abord à travers la simple subsomption formelle du capital sous le commandement du capital, ensuite […] aboutissant à la subsomption réelle du travail sous les exigences de la valorisation » (p. 218).
Balibar explique ensuite de manière intéressante que « ce qui s’est manifesté au 19ème et au 20ème siècle comme une « identité prolétarienne », relativement autonome, doit être compris comme un effet idéologique objectif […] [et] cet effet idéologique n’a rien de spontané, d’automatique, d’invariable » (p. 227). Il va jusqu’à dire qu’ « il n’y a pas de « classe ouvrière » sur la seule base d’une situation sociologique plus ou moins homogène, mais seulement là où il existe un mouvement ouvrier. Et, de plus, qu’il n’y a de mouvement ouvrier que là où existent des organisations ouvrières » (p. 228). C’est un peu fort : il existe une classe ouvrière dès qu’il y a des individus ayant comme condition commune d’être des ouvriers, mais en revanche il n’existe de mouvement ouvrier qu’à partir du moment où existe des organisations ouvrières, effectivement.
Mais il rajoute de manière intéressante : « Aucune organisation de classe (en particulier aucun parti de masse), même lorsqu’elle a développé une idéologie ouvriériste, n’a jamais été une organisation purement ouvrière. Au contraire, elle s’est toujours constituée par la rencontrer, la fusion plus ou moins conflictuelle de certaines fractions ouvrières d’ « avant-garde » et de groupes d’intellectuels […]. De même, aucun mouvement social significatif, même lorsqu’il a revêtu un caractère prolétarien accentué, ne s’est jamais fondé sur des revendications et des objectifs purement anticapitalistes, mais toujours sur la combinaison d’objectifs anticapitalistes et d’objectifs démocratiques, ou bien nationaux, ou pacifistes, ou culturels au sens large » (p. 229). C’est en partie vrai, mais reste à savoir si cela est problématique ou non pour Balibar.
Balibar propose également un élargissement du concept de « lutte des classes » aux luttes internes aux classes, lesquelles « traversent les classes » (p. 229).
Pour Balibar, d’autre part, « la valorisation du capital dans l’économie-monde implique que pratiquement toutes les formes d’exploitation historiques soient simultanément utilisées : des plus « archaïques » (le travail non payé des enfants […]) jusqu’aux plus « modernes » […], des plus violentes (le péonage agricole dans les domaines sucriers du Brésil) jusqu’aux plus civilisées. […] [Mais] ces formes largement incompatibles entre elles […] doivent rester séparées » (p. 237).
Balibar affirme enfin qu’ « il n’y a pas de séparation fixe […] des classes sociales : il faut arracher la pensée de l’antagonisme à la métaphore militaire et religieuse des « deux camps » » (p. 239). C’est vrai qu’il y a une multiplicité de camps, en réalité, et que la lutte des classes prend rarement une forme d’affrontement entre prolétariat complet d’une part et bourgeoisie complète d’autre part. Pour autant, Balibar se défend que cette vision n’est en rien une négation des antagonismes de classe, mais leur complexification. « En somme la « disparition des classes », leur perte d’identité et de substance, est à la fois une réalité et une illusion » (p. 241), mais ses explications ne sont guère convaincantes, et on lira plutôt Théorie communiste (et la critique de la valeur) là-dessus.
Déplacements du conflit social ?
Conflits sociaux en Afrique noire indépendante : réexamen des concepts de race et de « status-group » (Immanuel Wallerstein)
Wallerstein s’attaque d’abord à un problème conceptuel au sujet de la « race » et du « groupement ethnique ». Il fait d’abord un état des lieux dans l’Afrique pré-coloniale : « Certains de ces États [africains pré-coloniaux] comportaient des « ordres sociaux » ou « états » (Estates), c’est-à-dire des catégories de personnes dont le statut social se transmettait par voie héréditaire : nobles, roturiers, artisans, esclaves, etc. Certains se composaient de « groupes ethniques », c’est-à-dire de catégories de personnes portant des noms différents qui indiquaient vraisemblablement des ascendances distinctes. C’était là généralement le résultat de situations de conquêtes. De nombreux Etats comptaient, en outre, une catégorie reconnue de « non-citoyens » ou « étrangers ». Enfin, les sociétés non hiérarchisées elles-mêmes répartissaient habituellement leur population suivant un principe de classification déterminé qui créait un groupe de descendance fictive, souvent appelé « clan » par les anthropologues, ou suivant les générations, c’est-à-dire par « groupes d’âges » (pp. 252-253). On voit qu’il existe donc une certaine complexité difficilement réductible aux seuls concepts de « race » et de « groupe ethnique ». Wallerstein note également qu’ « il peut arriver que la division en classes conserve l’apparence d’une position tribale ; il en était ainsi dans les monarchies de la zone interlacustre de l’Afrique orientale (Rwanda, Burundi, etc.) où les conquérants éleveurs tutsi constituaient l’aristocratie dominant les autochtones paysans hutus » (p. 253). C’est d’ailleurs la racisation de ces classes (« hutus roturiers » et « tutsis aristocrates ») qui est une précondition nécessaire (sans doute décisive) au génocide rwandais.
Wallerstein démontre l’instrumentalisation idéologique des catégories « ethniques », notamment dans « les expulsions publiques ou semi-publiques de contingents importants d’ « étrangers » [des Etats africains post-coloniaux] : des Dahoméens (et des Togolais) de la Côte-d’Ivoire, du Niger et d’ailleurs ; des Nigérians et des Togolais du Ghana ; des Maliens du Congo. Dans chacun de ces cas, ceux qui furent expulsés avaient occupé des positions importantes dans l’économie monétaire à un moment où le chômage allait croissant. Les groupes en question se trouvèrent soudain qualifiés de non-ressortissants du pays plutôt que d’Africains » (p. 258). L’expulsion des « étrangers » sous prétexte de nationalisme est ainsi une forme de « liquidation » de la concurrence économique.
Pour Wallerstein, « il n’y a aucune utilité à faire la distinction entre de prétendues variétés de « status-groups », tels que groupes ethniques, groupes religieux, races, castes. Ce sont des variations d’un seul et même thème : un regroupement de personnes par une affinité qui précède mythiquement la scène économique et politique et qui est la revendication d’une solidarité qui outrepasse les groupes définis en termes de classes [au sens large] et d’idéologie » (p. 259). Ainsi, « si on pouvait le démontrer, le tribalisme pourrait être considéré comme une réaction à la création d’une structure politique complexe plutôt qu’un stade préliminaire nécessaire à son évolution. Dans la situation du monde moderne, un « status-group » représente une revendication collective du pouvoir et de l’attribution de biens et de services au sein d’un Etat-nation » (p. 260).
Wallerstein propos alors de manière audacieuse de « repenser la trinité weberienne de classe, de « status-group » et de parti et [de] ne plus considérer ceux-ci comme trois groupes différents qui se recoupent, mais comme trois formes existentielles différentes de la même réalité […]. Dans ce cas, la question […] porterait […] sur les conditions nécessaires pour qu’une stratification sociale se constitue elle-même en classe, en « status-group » ou en parti. Pour accepter cette conception, il ne serait pas nécessaire de soutenir que les frontières du groupe resteraient identiques quelle que soit la forme que celui-ci ait adoptée – bien au contraire, sinon il n’y aurait aucune raison de lui donner des appellations différentes -, mais bien d’affirmer qu’il existe, dans toute structure sociale et à n’importe quel moment, un ensemble limité de groupes qui sont, soit en relation, soit en conflit les uns avec les autres » (p. 262). Autrement dit, il y aurait un chevauchement des groupes sociaux, la question étant de savoir le(s)quel(s) de ceux-ci est/sont pré-dominant(s) par rapport aux autres, ou même laquelle(s) de ces « communautés imaginées » réelles est davantage mobilisée. Aujourd’hui, par exemple, la nation française est davantage mobilisée que la classe prolétaire par des individus appartenant à ces deux « communautés imaginées » réelles.
« Une autre approche, suggérée par Rodolfo Stavenhagen, est de considérer les « status-group » comme des « fossiles » de classes sociales : « Les stratifications (c’est-à-dire les hiérarchies de groupements sociaux) représentent généralement ce que nous pourrions appeler des fixations sociales – fréquemment même des fixations juridiques et dans tous les cas des fixations mentales – de certains rapports de production représentés par les rapports de classe. […] Comme tous les phénomènes de la superstructure sociale, la stratification acquiert une inertie propre qui la maintient, bien que les conditions qui en furent l’origine aient changé. À mesure que les relations entre les classes se modifient, les stratifications se transforment en « fossiles » des rapports de classe sur lesquels ils se sont basés à l’origine » […] Dans une analyse ultérieure, Stavenhagen, utilisant des éléments d’information recueillis en Amérique centrale, découvre comment, dans une situation coloniale, deux « status-groups » de basses castes (dans ce cas, des indios et des ladinos) ont pu émerger, s’incruster et survivre aux différentes pressions dues à ce que l’on pourrait appeler clarification des classes. Il démontre que deux formes de dépendance, une forme coloniale […] et une forme de classes (basée sur les relations de travail) ont crû côte à côte et ont reflété un système parallèle de rangs. Après l’indépendance, et en dépit du développement économique, la dichotomie entre les indios et les ladinos, « profondément enracinée dans les valeurs des membres de la société », demeura comme « une force essentiellement conservatrice » dans la structure sociale. « En reflétant une situation du passé… [cette dichotomie] agit comme un frein sur le développement des nouveaux rapports de classe ». Dans cette version, la stratification actuelle est encore un fossile du passé mais elle n’est pas simplement un fossile des relations de classe en soi. » (pp. 263-264).
« Une autre approche consisterait à concevoir les classes et les affiliations aux « status-groups » comme des options offertes aux divers membres de la société. C’est l’approche qu’a utilisée Peter Carstens » (p. 264). Ainsi, les groupes sociaux auxquels appartient l’individu seraient des « communautés imaginées » réelles (même fossiles) potentiellement mobilisables. « Carstens commence par affirmer que « le maintien ou la reconnaissance de loyautés tribales ténues sont des moyens dont les gens disposent pour établir leur prestige ou conquérir l’estime […]. L’utilisation des statuts est, dès lors, considérée comme la meilleure stratégie pour franchir les frontières de classes ». La puissance de la stratification par « status-groups » peut être considérée de ce point de vue. L’honneur social n’est pas uniquement un mécanisme destiné à maintenir, pour les parvenus de jadis, leurs avantages sur le marché contemporain, c’est-à-dire la force rétrograde décrite par Weber ; c’est aussi le mécanisme grâce auquel les arrivistes atteignent leurs fins au sein du système » (p. 265). Pour Wallerstein, la conscience de classe ne se manifeste qu’au sein des situations révolutionnaires, donc rarement.
Pour une explication matérialiste du triomphe des communautés imaginaires (« nation historique », « race »)
Les individus au sein du capitalisme ont des conditions communes du fait des structures sociales. La condition commune construite-structurelle au sein du processus global de production capitaliste s’appelle « classe ». La condition commune construite-structurelle aux individus membres d’une même communauté politico-étatique s’appelle « nationalité ».
Les conditions communes construite-structurelle peuvent être de différentes natures :
– Elles peuvent être dynamiques, auto-ajustées dans leur changement aux structures sociales auxquelles elles sont rattachées. Les classes sont ainsi perpétuellement redéfinies en raison de l’évolution du procès global de production capitaliste. Les nationalités sont également perpétuellement redéfinies en fonction des actes de nationalisation ou de déchéance de nationalité d’un État donné, et de l’existence de cet État. Les « sexes » (genres) sont définis juridiquement et ont une place structurelle-tendancielle au sein du procès global de production et de reproduction capitaliste.
– Elles peuvent être « fossiles » (Stavenhagen), décrochées du changement des structures sociales auxquelles elles étaient rattachées. Les ordres, castes et autres groupes de statuts, même s’ils n’ont plus de reconnaissance légale et qu’ils n’ont pas/plus de condition commune de classe (« en soi »), sont des fossiles des classes pré-capitalistes, et elles demeurent uniquement parce qu’elles restent mobilisées (« pour soi ») par leurs membres « héritiers ». Pourquoi restent-elles mobilisées ? En raison de leur utilité sociale pour leurs membres « héritiers » : elle permet aux individus ayant comme condition commune cette héritage de groupe « fossile » de se mobiliser collectivement et de s’entre-aider pour se maintenir (individuellement ou collectivement) ou même progresser au sein de l’actuelle société de classe. Les « races » (même sociales), « nations historiques » ou autres « ethnies » sont également des groupes « fossiles » de groupes construits (mais réels au niveau juridique et en termes de stratification sociale) du capitalisme du 19ème siècle, n’ayant plus de reconnaissance légale (en France), mais demeurent parce qu’elles continuent d’être mobilisées par leurs membres « héritiers », d’une part, et aussi parce qu’elles ont un héritage en termes de stratification sociale : les héritiers de la « race-classe » « afro-américaine » (aux Etats-Unis) ou « indigène » (en France) demeurent majoritairement-structurellement en bas de l’échelle sociale, comme au temps du colonialisme, de l’Apartheid et/ou de la ségrégation, tandis que les héritiers de la « race-classe » « blanche » demeurent majoritairement-structurellement en haut de l’échelle sociale relativement aux héritiers de la « race-classe » « indigène ». D’où une mobilisation poursuivie du fossile de la « race-classe » « blanche » du côté de ses héritiers du prolétariat et des classes moyennes menacées (réellement et/ou fantasmatiquement) dans leur statut social par des héritiers de la « race-classe » « indigène » ou « afro-américaine » (ou par des non-héritiers de ce fossile : migrants d’Europe de l’Est, d’Asie, etc.), laquelle a conduit notamment à une victoire de Trump aux élections, et d’où une mobilisation naissante du fossile « indigène » du côté de ses héritiers des classes moyennes (PIR), bloquées en bas des classes moyennes par une inertie des structures racistes de classe.
Le capitalisme génère donc structurellement des conditions communes à des individus. Ces conditions communes peuvent même être pré-capitalistes, mais ont été également des conditions communes d’un stade antérieur du capitalisme. Elles peuvent, quoiqu’il en soit, être auto-ajustées (donc actuelles) ou « fossiles ». La difficulté réside dans ce que certaines « identités collectives » sont assez largement fantasmatiques (au sens où elles n’ont jamais constituées de conditions communes : « germanique », « indo-européenne », etc.) tandis que d’autres sont construites mais bien réelles puisqu’elles ont une réalité juridique ou socio-économique (classes, nationalités, genres), et d’autres sont dans l’entre-deux mais ont eu un fondement plus ou moins réel (« races », « nations historiques », etc.). De manière générale, on peut dire qu’une condition commune auto-ajustée est clairement réelle-structurelle (quoique socio-historiquement construite), qu’une condition commune « fossile » a une réalité-structuralité moindre au fil du temps (la condition commune d’héritiers de tel ou tel ordre de l’Ancien Régime ayant une réalité marginale aujourd’hui en France, tandis que celle d’héritiers de la « race-classe indigène » a une prégnance du fait qu’il s’agit d’une stratification sociale relativement récente) mais qu’elle conserve dans une certaine mesure du fait de l’inertie (plus ou moins forte : forte au niveau des « races-classes », faible au niveau des « ordres ») des structures sociales.
S’il faut balayer d’un revers de main l’ensemble des identités fantasmatiques comme fantasmatiques (« indo-européenne », « nordiciste », « germanique »), il faut prendre davantage au sérieux celles ayant eu ou ayant actuellement un fondement réel-structurel, tout en se souvenant qu’il s’agit de constructions socio-historiques dépassables. Les vieux « fossiles » pré-capitalistes doivent être considérés comme des constructions socio-historiques obsolètes. Il faut prendre vraiment au sérieux, en revanche, des fossiles plus récents comme ceux de la « race » et de la « nation historique », puisqu’elles sont extrêmement mobilisées et qu’elles ont un fondement davantage réel (globalement-structurellement, en France, les héritiers de la « race-classe blanche » et de la « nation historique » – laquelle est en partie fantasmatique, puisqu’on y inclut plus ou moins aujourd’hui des gens qui en étaient radicalement exclus il y a un siècle : descendants d’Espagnols, de Portugais, de Polonais… – sont à un niveau socio-économique supérieur aux héritiers de la « race-classe indigène » et des exclus de la « nation historique »). S’il faut évidemment rappeler leur statut de fossile de constructions socio-historiques, il n’en demeure pas moins qu’elles ne peuvent être dépassées qu’au travers d’une fantasmatique « égalité totale », dans une perspective réformiste, ou de l’abolition de l’État et des classes, dans une perspective émancipatrice. En attendant, il est nécessaire de soutenir de manière critique les combats des héritiers des « indigènes » pour une égalité réelle au sein de l’actuelle société de classe capitaliste, même s’il doit s’agir en dernière instance d’abolir les classes et les fossiles du capitalisme historique.
On ne peut donc se contenter de dénoncer comme des « communautés imaginées » (Benedict Anderson) des identités collectives qui, si elles sont effectivement fétichisées, n’en ont pas moins une réalité historique. Il s’agit en même temps de considérer qu’il s’agit de construction socio-historiques dépassables et non d’entités transhistoriques, naturelles, etc., mais qu’elles ont une force réelle au sein du capitalisme en raison de leur capacité de rassembler des individus ayant une condition commune ou étant héritier (plus ou moins fantasmatiques) d’une condition commune historique.
Pourquoi néanmoins certaines conditions communes sont davantage mobilisées que d’autres ? On peut s’étonner que celle de la « classe », pourtant auto-ajustée, soit moins mobilisée que celle de la « nation historique », pourtant fossile. Plusieurs raisons :
– Plus une condition commune est compatible avec l’ordre établi et plus elle rassemble de gens, plus elle sera médiatisée, et plus elle sera mobilisée par des partis de gestion « ordinaire » du capital. La « nation », sous une forme plus ou moins historique (le PS mobilisant moins la « nation historique » que LR), est privilégiée puisqu’elle est trans-classiste (elle est donc appréciée des bourgeois et de l’encadrement puisqu’elle ne remet pas en cause leurs intérêts, mais également de certains prolétaires puisqu’elle permet de faire alliance avec des puissants), qu’elle rassemble l’ensemble des électeurs (pour un parti, ce n’est guère négligeable), etc. La « classe », en revanche, est largement moins compatible avec l’ordre établi, rassemble moins de gens, et n’est donc mobilisée que par des partis ouvriéristes (PCF, LO) dans une optique électoraliste. Les prolétaires auraient davantage intérêt à s’en réclamer, puisque se réclamer de « la nation » c’est se réclamer de l’ordre établi à leur défaveur, mais pour des raisons d’éclatement de la condition prolétarienne (condition commune de moins en moins évidente, avec une multiplication des différents statuts de prolétaire – chômeurs, précaires, etc.), d’effondrement des structures organisationnelles du mouvement ouvrier (plus de classe « pour soi »), d’idéologies individualiste comme trans-classiste triomphantes, et enfin parce que cela comporte un désavantage politique, celui de ne pouvoir s’allier avec des membres des classes supérieurs disposant de moyens financiers et politiques, et donc un coût (celui de se mettre à dos l’ensemble de la bourgeoisie, degôche, centriste, de droite ou de droite extrême). La « race », de même, comporte l’avantage d’être trans-classiste, de ne pas remettre en cause l’ordre établi, de s’allier avec des membres des classes supérieurs (Trump), et même que « l’ennemi » soit clairement identifiable à sa couleur de peau et/ou ses traits physiques. Si la nation et la « race » triomphent aujourd’hui au sein des classes populaires, c’est parce qu’il s’agit d’un moyen de se faire entendre avec davantage de succès, de défendre ses intérêts avec davantage d’alliés des classes supérieures. Le FN représente, en France, ce moyen aisé de se faire entendre lorsqu’on est un prolétaire blanc, et de « défendre ses intérêts » (en réalité, uniquement vis-à-vis des prolétaires héritiers de l’ « indigénat », mais certainement pas des autres classes). Pour mettre fin à cette situation, il faut faire comprendre au prolétaire « blanc » qu’il défend davantage ses intérêts d’être humain en s’alliant avec des prolétaires « indigènes », femmes, etc., qu’avec des classes l’exploitant, l’instrumentalisant et le dominant.
Pour revenir au cas de l’Afrique post-coloniale, Wallerstein montre que « certains groupes (un ou plusieurs) sont représentés de façon disproportionnée dans la classe bureaucratique, tout comme d’autres sont représentés de façon disproportionnée parmi les travailleurs urbains. Presque partout vit un groupe de Blancs qui jouissent d’un haut statut social et occupent des situations de techniciens. Leur prestige a à peine changé depuis la domination coloniale. Le rang élevé des Blancs sur le plan local reflète la situation de ces pays dans le système économique mondial » (pp. 266-267). La situation de concurrence forte, et d’absence d’un nombre suffisant d’emplois, « force les groupements d’élites à trouver des critères qui leur permettent de primer certains [groupes] […] et d’en rejeter d’autres. […] En certains endroits, la division se fait selon les ethnies, dans d’autres selon les religions, dans d’autres encore selon les « races » et, dans la plupart, selon une combinaison implicite des trois » (p. 267). Il faudrait rajouter que cette division ne se fait pas en fonction de critères aléatoires, mais en fonction des groupes sociaux auxquels appartiennent les classes dirigeantes.
Quoiqu’il en soit, « ces tensions entre « status-group » sont l’expression […] des frustrations de classe. […] Derrière la « réalité » ethnique affleure un conflit de classe. Je veux exprimer par là la proposition très nette et empiriquement vérifiable qui suit […] : si les différences de classes qui correspondent (ou coïncident) avec les différences des « status-groups » venaient à disparaître par suite d’un changement dans les circonstances sociales, les conflits entre « status-groups » disparaîtraient » (pp. 267-268).
Or, pour Wallerstein, « lorsque nous employons le mot « race », nous voulons essentiellement désigner un « status-group » qui dépasse les frontières nationales. […] [Et] la couleur de la peau n’est pas pertinente. […] Dans le monde contemporain, la race est la seule catégorie internationale de « status-group ». Elle a pris la place de la religion qui avait joué ce rôle depuis le VIIIème siècle de notre ère au moins. C’est le rang plutôt que la couleur de peau qui détermine l’appartenance au « status-group ». C’est ainsi qu’il put y avoir, à la Trinité, un mouvement appelé « Black Power » qui fut dirigé comme un gouvernement homogène de Noirs, en raison des fonctions d’alliés de l’impérialisme d’Amérique du Nord qu’assuma ce gouvernement. C’est ainsi que les séparatistes du Québec pouvaient s’appeler eux-mêmes [de manière exagérée] « les nègres blancs » de l’Amérique du Nord. C’est ainsi que le panafricanisme peut comprendre les Arabes à peau blanche de l’Afrique du Nord mais exclure les Afrikaners à peau blanche de l’Afrique du Sud » (p. 270). Wallerstein est peut-être un peu schématique lorsqu’il qu’« en tant que catégorie de « status-group », la race est une représentation collective un peu brouillée d’une catégorie de classe internationale. Le racisme n’est, dès lors, qu’un moyen de maintenir la structure sociale internationale existante » (p. 270), mais c’est une intuition fondamentale.
Pour conclure, Wallerstein affirme que « les « status-groups » […] sont une représentation collective un peu brouillée des classes [au sens large]. […] Au fur et à mesure que le conflit devient plus aigu, les limites des « status-groups » s’approchent de façon asymptotique des classes et c’est alors qu’on peut déceler le phénomène de « conscience de classe ». […] Une conscience accrue du « status-group » international, ou identification raciale […] ne [peut-être] vaincue ou surmontée que lorsque l’on s’approcherait de l’asymptote de la conscience de classe » (pp. 269-270).
Le « racisme de classe » (Etienne Balibar)
Certains développements de Balibar dans cet article sont problématiques, notamment sa remise en cause d’une analyse de classe au profit d’une thèse farfelue (le racisme ferait émerger une classe « petite-bourgeoise » !). La suite est davantage intéressante : « L’hétérogénéité des formes historiques du rapport entre le racisme et la lutte des classes fait problème. Elle va depuis la façon dont l’antisémitisme s’est développé en « anticapitalisme » [Postone] de pacotille […], jusqu’à la façon dont la catégorie de l’immigration combine aujourd’hui le stigmate racial et la haine de classe. Chacune de ces configurations est irréductible […], ce qui interdit de définir un quelconque rapport simple d’ « expression » […] entre racisme et lutte de classes » (p. 274). « Dans la manipulation de l’antisémitisme en tant que leurre anticapitaliste, entre 1870 et 1945 pour l’essentiel […], nous ne trouvons pas seulement la désignation d’un bouc émissaire à la révolte des prolétaires, l’exploitation de leurs divisions, ni seulement la représentation projective des maux d’un système social abstrait par la personnification imaginaire de ses « responsables » (bien que ce mécanisme soit essentiel au fonctionnement du racisme). Nous trouvons la « fusion » de deux récits historiques susceptibles de se métaphoriser l’un l’autre : d’un côté le récit […] de l’unité perdue de l’ « Europe chrétienne », de l’autre celui du conflit entre l’indépendance nationale et l’internationalisation des relations économiques […], à laquelle risque de correspondre une internationalisation des luttes de classes. C’est pourquoi le Juif, exclu intérieur commun à toutes les nations mais aussi, par la haine théologique dont il est l’objet, témoin de l’amour qui est censé unir les « peuples chrétiens », peut être imaginairement identifié au « cosmopolitisme du capital » » (pp. 274-275). Balibar fait d’ailleurs remarquer de manière intéressante que « la personnification du capital, rapport social, commence avec la figure même du capitaliste. Mais celle-ci n’est jamais suffisante pour mobiliser l’affect. C’est pourquoi, suivant la logique de l’ « excès », d’autres traits réels-imaginaires s’accumulent sur lui : mœurs, descendance (les « deux cents familles »), origines étrangères, stratégies secrètes, complot racial (le projet juif de « domination mondiale » [Heidegger]), etc. » (p. 275).
Cependant, selon Balibar, « la figure est tout autre quand le racisme anti-immigrés réalise l’identification maximale de la situation de classe et de l’origine ethnique » (p. 275). Il est vrai qu’entre l’antisémitisme structurel, visant « le Juif » comme personnification du « capital », comme organisation secrète visant à une domination mondiale aux moyens de complots et de guerres, et le racisme anti- « immigré », il s’agit deux phénomènes bien distincts. Mais cependant depuis au moins une dizaine d’années, et de toujours plus, « l’islam » devient également l’épouvantail d’une organisation visant à une domination mondiale aux moyens de complots (d’attentats) et de guerres (de civilisation), et dont les « immigrés arabo-musulmans » seraient la 5ème colonne (chargée du « Grand Remplacement »), ceux-ci devenant des ennemis de l’intérieur à l’instar des Allemands de confession juive des années 1930. Cela n’en reste pas moins une analogie, mais certains des éléments de l’antisémitisme structurel sont repris dans l’idéologie raciste anti-musulmans.
Balibar souligne d’autres aspects : « Ainsi les thèmes de l’ « invasion » de la société française par les Maghrébins, de l’immigration responsable du chômage sont-ils connectés avec celui de l’argent des émirs du pétrole […]. Ce qui explique en partie pourquoi les Algériens, les Tunisiens ou Marocains doivent être désignés génériquement comme des « Arabes » » (p. 276). Le thème d’une France soumise aux émirs fait d’ailleurs penser au concept de « « nation prolétaire », peut-être inventé dans les années vingt par le nationalisme japonais » (p. 276).
« La complexité de ces configurations explique aussi pourquoi il est impossible de retenir purement et simplement l’idée d’une utilisation du racisme contre la « conscience de classe » […]. Nous soupçonnons d’ailleurs que les visions instrumentalistes, conspiratives, du racisme dans le mouvement ouvrier ou parmi ses théoriciens (on sait de quel prix élevé elles allaient être payées […]), de même que les visions mécanistes qui voient dans le racisme le « reflet » de telle condition de classe, ont aussi largement pour fonction de dénier la présence du nationalisme dans la classe ouvrière et dans ses organisations, autrement dit le conflit interne entre nationalisme et idéologie de classe dont dépend la lutte de masse contre le capitalisme (aussi bien que la lutte révolutionnaire contre le capitalisme). C’est l’évolution de ce conflit interne que je voudrais illustrer en discutant ici […] du « racisme de classe » » (pp. 276-277).
Balibar rappelle en effet : « Plusieurs historiens du racisme (Poliakov, […], Colette Guillaumin, E. Williams à propos de l’esclavage moderne, etc.) ont souligné que la notion moderne de race, en tant qu’elle est investie dans un discours de mépris et de discrimination, qu’elle sert à scinder l’humanité en « sur-humanité » et « sous-humanité », n’a pas eu initialement une signification nationale (ou ethnique), mais une signification de classe, ou plutôt (puisqu’il s’agit de représenter l’inégalité des classes sociales [au sens transhistorique] comme une inégalité de nature) une signification de caste. Elle a, de ce point de vue, une double origine : d’une part la représentation aristocratique de la noblesse héréditaire comme une « race » supérieure […] ; d’autre part la représentation esclavagiste des populations soumises à la traite comme « races » inférieures, toujours déjà prédestinées à la servitude […]. D’où les discours du sang, de la couleur de peau, du métissage. C’est seulement après coup que la notion de race a été « ethnicisée » pour s’intégrer au complexe nationaliste […] Dès le début, les représentations racistes de l’histoire sont en rapport avec la lutte des classes » (p. 277).
« L’aristocratie ne s’est pas pensée et présentée elle-même d’emblée sous la catégorie de la « race » : il s’agit d’un discours tardif [17ème siècle, avec Boulainvilliers, comme l’a montré Foucault], dont la fonction est clairement défensive, en France par exemple (avec le mythe du « sang bleu » et de l’origine « franque » ou « germanique » de la noblesse héréditaire), qui se développe quand la monarchie absolue centralise l’Etat aux dépens [partiellement] des seigneurs féodaux et commence à « créer » en son sein une aristocratie nouvelle […]. Plus intéressant encore est le cas de l’Espagne, tel que l’analyse Poliakov : la persécution des juifs après la reconquête, ressort indispensable à la constitution du catholicisme en religion d’Etat, est aussi la trace de la culture « multinationale » contre laquelle s’effectue l’hispanisation (ou plutôt la castillanisation). Elle est donc étroitement liée à la formation de ce prototype du nationalisme européen. Mais elle revêt une signification encore plus ambivalente lorsqu’elle débouche sur l’institution des « status de la pureté du sang » (limpieza de sangre) dont héritera tout le discours du racisme […] : venue de la dénégation du métissage originel avec les Maures et les Juifs, la définition héréditaire de la raza (et l’inquisition correspondante de ses titres) sert en effet à la fois à isoler une aristocratie intérieure [les nobles] et à conférer à tout le « peuple espagnol » une noblesse fictive, à en faire un « peuple de maîtres » » (p. 278). Ainsi « le racisme aristocratique (prototype […] [du] racisme « autoréférentiel », qui commence par ériger le maître du discours lui-même en race […]) est déjà indirectement lié à l’accumulation primitive du capital, ne serait-ce que par sa fonction dans les nations colonisatrices » (pp. 278-279).
Mais « la révolution industrielle […] fait surgir le nouveau racisme de l’époque bourgeoise (le premier « néo-racisme », historiquement parlant) : celui qui vise le prolétariat, dans son double statut de population exploitée (et même surexploitée […]) et de population politiquement menaçante. Louis Chevalier notamment en a décrit le réseau de signification [Louis Chevalier, Classes laborieuses et dangereuses à Paris pendant la première moitié du XIXème siècle]. C’est alors, à propos de la « race des ouvriers », que la notion de race se détache de ses connotations historico-théologiques pour entrer dans le champ des équivalences entre sociologie, psychologie, biologie imaginaire et pathologie du « corps social ». […] Pour la première fois [selon Balibar, car en réalité on peut en douter, notamment avec Elsa Dorlin dans La matrice de la race : l’esclavagisme et le patriarcat modernes avaient déjà sécrétés de tels discours], viennent se condenser dans un même discours les aspects typiques de toute procédure de racisation d’un groupe social : ceux de la misère matérielle et spirituelle, de la criminalité, du vice congénital (l’alcoolisme, la drogue), les tares physiques et morales, de la saleté corporelle et de l’incontinence sexuelle, des maladies spécifiques qui menacent l’humanité de « dégénérescence » – avec l’oscillation caractéristique : soit les ouvriers constituent eux-mêmes une race dégénérée, soit c’est […] la condition ouvrière qui constitue un ferment de dégénérescence pour la « race » des citoyens, des nationaux. À travers ces thèmes se construit l’équation fantasmatique des « classes laborieuses » et des « classes dangereuses », la fusion d’une catégorie socio-économique et d’une catégorie anthropologique et morale, qui servira de support à toutes les variantes du déterminisme sociobiologique (et aussi psychiatrique) en empruntant des garanties pseudo-scientifiques à l’évolutionnisme darwinien, à l’anatomie comparée et à la psychologie des foules, mais surtout en s’investissant dans un réseau serré d’institutions de police et de contrôle social » (pp. 279-280). Sur ce dernier point, la domination policière au sein des quartiers actuels n’a ainsi pas qu’une origine coloniale [cf. Rigouste] : elle a également une origine dans ce contrôle policier des ouvriers au 19ème siècle.
Comme Laqueur l’a suggéré au sujet des femmes : « L’idée d’une différence de nature entre les individus était devenue [avec la Révolution française] juridiquement […] contradictoire, sinon impensable. Elle était pourtant politiquement indispensable, aussi longtemps que les « classes dangereuses » […] devaient être […] cantonnées sur les marges de la cité : aussi longtemps […] qu’il important de leur dénier la citoyenneté en montrant […] qu’il leur « manquait » constitutionnellement les qualités de l’humanité achevée » (p. 280). Puisqu’il n’est plus possible de fonder des inégalités politiques pour des raisons sociales (comme sous l’Ancien Régime), il faut fonder celles-ci sur des inégalités de nature.
« Or, dès le début, cette opération est surdéterminée par l’idéologie nationale. Disraeli (par ailleurs étonnant théoricien impérialiste de la « supériorité des juifs » sur la « race supérieure » anglo-saxonne elle-même) l’avait admirablement résumé en expliquant que le problème des Etats contemporains est la scission tendancielle de « deux nations » [two nations] au sein d’une même formation sociale. Il indiquait par là même la voie qui pourrait être empruntée par les classes dominantes confrontées à l’organisation progressive des luttes de classes : d’abord diviser la masse des « misérables » (en particulier en reconnaissant à la paysannerie, aux artisans « traditionnels », les qualités d’authenticité nationale, de bonne santé, de moralité, d’intégrité raciale exactement antinomiques de la pathologie industrielle) ; ensuite déplacer progressivement les marques de la dangerosité et de l’hérédité des « classes laborieuses » dans leur ensemble sur les étrangers, en particulier les immigrants et les colonisés […] [D’où] un retard caractéristique du fait sur le droit : une persistance du « racisme de classe » envers les classes populaires » (pp. 280-281) sous la forme d’un racisme anti-« immigrés » (même si celui-ci procède surtout du racisme esclavagiste-colonialiste, rappelons-le).
Balibar affirme ainsi l’existence d’une « racisation institutionnelle du travail manuel […]. Il n’y a pas à cet égard de différence signification entre la façon dont s’exprime le mépris du […] travailleur manuel chez les élites philosophiques de la Grèce esclavagiste et la façon dont un Taylor décrit en 1909 la prédisposition naturelle de certains individus pour les tâches fatigantes, salissantes et répétitives qui demandent de la vigueur corporelle mais pas d’intelligence ni d’esprit d’initiative (l’ « homme-bœuf » des Principles of Scientific Management […]). Pourtant la révolution industrielle et le salariat capitaliste opèrent ici un déplacement. Ce qui fait maintenant l’objet du mépris […] n’est plus le travail manuel pur et simple (on assistera au contraire, dans le contexte d’idéologies paternalistes, archaïsantes, à une idéalisation théorique de celui-ci, sous les espèces de l’ « artisanat ») : c’est […] le travail corporel mécanisé, devenu « l’appendice de la machine » […] [Et] qu’il y ait des hommes-corps veut dire qu’il y a des hommes sans corps ; que les hommes-corps [les ouvriers] soient des hommes au corps morcelé et mutilé […] veut dire qu’il faut doter les individus de […] l’autre espèce d’un sur-corps, développer le sport, la virilité ostentatoire, pour parer à la menace suspendue sur la race humaine » (pp. 281-283). Ainsi, « seule cette situation historique, ces rapports sociaux spécifiques permettent de comprendre complètement le processus d’esthétisation [notamment fasciste] […] du corps qui caractérise toutes les variantes du racisme moderne, en donnant lieu tantôt à la stigmatisation des « traits physiques » de l’infériorité raciale, tantôt à l’idéalisation du « type humain » de la race supérieure » (p. 283).
« Ce que le racisme de classe (et a fortiori le racisme nationaliste de classe, comme dans le cas des immigrés) tend à produire, c’est […] l’équivalent d’une fermeture de caste pour une partie au moins de la classe ouvrière […] : c’est la fermeture aussi complète que possible dans l’ordre de la « mobilité sociale » » (p. 284).
Balibar tente alors un argumentaire audacieux : « La logique de l’accumulation capitaliste comporte […] deux aspects contradictoires : d’un côté, mobiliser, déstabiliser en permanence les conditions de vie et de travail, de façon à assurer la concurrence sur le marché du travail, puiser sans cesse de nouvelles forces dans l’ « armée industrielle de réserve », entretenir une surpopulation relative ; de l’autre, stabiliser sur de longues durées […] des collectivités ouvrières […] Il faut qu’au moins une partie des ouvriers soient des fils d’ouvriers, que s’institue une hérédité sociale. Mais avec elle, en pratique, ce sont les capacités de résistance et d’organisation qui s’accroissent aussi. De ces exigences contradictoires sont nées les politiques démographiques, les politiques d’immigrations et de ségrégation urbaine […] mises en œuvre à la fois par le patronat et par l’Etat à partir du milieu du XIXème siècle, avec leur double aspect paternaliste […] et disciplinaire, de « guerre sociale » […] et de « civilisation » […] de ces mêmes masses, dont on trouve l’illustration parfaite aujourd’hui dans le traitement socio-policier des « banlieues » […]. Ce n’est pas un hasard si le complexe raciste actuel se greffe sur le « problème de la population » […] et se fixe par prédilection sur la question de la seconde génération dite abusivement « immigrée » […]. Maintenir « à leur place », de génération en génération, ceux qui n’ont pas de place fixe [et de plus en plus pas de place] : il faut bien, dès lors, qu’ils aient une généalogie » (pp. 284-285).
Balibar poursuit dans son argumentaire, en disant qu’il faut étudier « la façon dont un certain ouvriérisme, centré sur les critères de l’origine de classe […] et de la sur-valorisation du travail […] reproduit une partie des représentations de la « race des ouvriers ». Il est vrai que les formes radicales de l’ouvriérisme, du moins en France, sont plutôt le fait d’intellectuels et d’appareils politiques […] qu’elles ne sont le fait des ouvriers eux-mêmes. Reste qu’elles correspondent à une tendance à se constituer en « corps » fermé pour préserver des positions acquises, des traditions de lutte, et pour retourner contre la société bourgeoise les signifiants du racisme de classe. De cette origine réactive découle l’ambivalence qui caractérise l’ouvriérisme […] Dans la mesure où ils projettent sur les étrangers leurs craintes et leur ressentiment, leur désespoir et leur défi, ce n’est pas seulement […] la concurrence qu’ils combattent, c’est, beaucoup plus profondément, leur propre condition d’exploités qu’ils cherchent à mettre à distance. C’est eux-mêmes, en tant que prolétaire, ou en tant qu’ils risquent d’être repris dans le moulin de la prolétarisation, qu’ils haïssent » (p. 286).
Balibar conclut : « En somme, de même qu’il y a constante détermination réciproque du nationalisme et du racisme, il y a détermination réciproque du « racisme de classe » et du « racisme ethnique » (p. 287). Nous dirions plutôt du « racisme de classe » et du « racisme colonialiste ».
Racisme et crise (Etienne Balibar)
Balibar s’interroge sur les liens entre la montée du racisme et la crise du capitalisme. S’il critique toute explication de type mécaniste, il n’en reconnaît pas moins « des corrélations indiscutables. C’est la désindustrialisation, la paupérisation urbaine, le démantèlement du Welfare State, le déclin impérial qui, en Angleterre depuis les années soixante-dix, ont précipité les conflits de communautés, alimenté par le nationalisme, favorisé […] l’adoption de politiques répressives de law and order, accompagnées d’une intense propagande désignant les populations de couleur comme foyer de criminalité » (p. 290). Pour Balibar, il faut « qualifier, spécifier la crise sociale comme crise raciste, et aussi enquête sur les caractéristiques du « racisme de crise », tout en rappelant que « le racisme est ancré dans des structures matérielles […] de longue durée » (p. 291).
Balibar, à contrepied de son article précédent, rappelle que « l’idéologie raciste est essentiellement interclassiste (non seulement au sens d’un dépassement, mais d’une négation active des solidarités de classe). […] Du moins devient-il un facteur déterminant du consensus qui relativise les clivages de classe » (pp. 292-293). Il n’y a en effet pas plus interclassiste que le Front National, dirigé par des grands bourgeois comme Jean-Marie Le Pen et aux nombreux électeurs petits patrons, rentiers, précaires ou chômeurs déclassés.
Après avoir rappelé que « les immigrés ne grèvent pas les ressources de la Sécurité sociale, mais l’alimentent ; [que] leur renvoi massif ne créerait aucun emploi, voire en supprimerait en déséquilibrant certains secteurs économiques » (p. 293), Balibar explique que « c’est l’implication, la responsabilité présumée des immigrés dans toute une série de problèmes différents qui permet de les imaginer comme autant d’aspects d’un seul et même « problème », d’une seule et même « crise ». On touche là à […] l’une des caractéristiques essentielles du racisme : sa capacité d’amalgamer sous une cause unique, circonscrite au moyen d’une série de signifiants dérivés de la race ou de ses équivalents plus récents, toutes les dimensions de la « pathologie sociale ». Mais il y a plus. Les catégories mêmes d’immigrés et d’immigration recouvrent un deuxième paradoxe. Ce sont des catégories à la fois unifiantes et différenciantes. Elles assimilent à une situation ou à un type unique des « populations » dont la provenance géographique, les histoires propres […], les conditions d’entrée dans l’espace national et les statuts juridiques sont complètement hétérogènes. Ainsi, […] un Français est le plus souvent incapable de désigner différemment un Algérien, un Tunisien, un Marocain, un Truc (tous sont des « Arabes », désignation générique qui constitue déjà un stéréotype raciste, et qui ouvre la voie aux insultes proprement dites : bougnoules, ratons, etc.) » (pp. 293-294). Or on sait avec Joseph Gabel que la réification, l’homogénéisation de l’hétéorogène, est un mécanisme fondamental du racisme. « Plus généralement « immigré » est une catégorie d’amalgame, combinant des critères ethniques et des critères de classe, dans laquelle sont déversés pêle-mêle des étrangers, mais non pas tous les étrangers ni rien que des étrangers. En fait c’est une catégorie qui permet précisément de cliver l’ensemble apparemment « neutre » des étrangers […] : un Portugais sera plus « immigré » qu’un Espagnol (à Paris), moins qu’un Arabe ou un Noir ; un Anglais ou un Allemand ne le seront certainement pas ; un Grec, peut-être ; un ouvrier espagnol, a fortiori un ouvrier marocain seront « immigrés », mais un capitaliste espagnol, voire un capitaliste algérien, ne le seront pas » (p. 294-295). C’est ici qu’il faut souligner qu’aujourd’hui au moins, l’idéologie raciste s’entremêle avec l’idéologie classiste (et sexiste).
« Nous découvrons ainsi, pour notre part, que dans la France actuelle « immigration » est devenu par excellence le nom de la race […] de même qu’ « immigrés » est la principale caractéristique permettant de ranger des individus dans une typologie raciste. C’est le lieu de se souvenir que le racisme colonial avait déjà […] [forgé] l’étonnante catégorie générale de l’ « indigène » » (p. 296). Cette catégorie générale allait de pair avec une division des populations en « ethnies » : là-dessus, J. L. Amselle, E. M’Bokolo, Au cœur de l’ethnie, La Découverte, 1985.
« Les effets induits par la formation d’une catégorie générique de l’immigration ne s’arrête pas là. Elle tend à englober des individus de nationalité française qui se trouvent alors cantonnés ou rejetés dans un statut plus ou moins honteux d’extériorité, dans le moment même où le discours nationaliste proclame l’unité indivisible des populations historiquement rassemblées dans le cadre d’un même Etat : c’est le cas, en pratique, des Antillais noirs, et bien entendu de nombre de Français « d’origine étrangère » […]. On aboutit ainsi à des contradictions […]. Un Kanak indépendantiste en Nouvelle-Calédonie est théoriquement un citoyen français qui porte atteinte à l’intégrité de « son pays », mais un Kanak en « métropole » […] n’est jamais qu’un immigré noir. […] Le phénomène le plus signification à cet égard est l’obstination avec laquelle l’opinion conservatrice […] désigne comme « deuxième génération immigrée » […] les enfants d’Algériens nés en France et s’interroger sans fin sur leur « possibilité d’intégration » à la société française dont ils font déjà partie » (pp. 296-297).
Balibar s’attache alors à une théorisation de « l’extension du racisme populaire et surtout du racisme de la classe ouvrière » (p. 298). Il explique que la xénophobie de la classe ouvrière n’est pas une nouveauté, mais qu’ « elle n’est pas tant liée au simple fait de l’immigration structurelle et à la concurrence sur le marché du travail […] qu’à la façon dont le patronat et l’Etat ont organisé la hiérarchie des travailleurs, réservant les emplois qualifiés et d’encadrement aux « Français » plus ou moins récents, et les emplois déqualifiés à la main-d’œuvre immigrée, voire choisissant des modèles d’industrialisation qui exigeaient une abondante main-d’œuvre déqualifiée pour laquelle existait la possibilité de recourir massivement à l’immigration […]. Ainsi le racisme des ouvriers français était-il organiquement lié aux privilèges relatifs de la qualification, à la différence entre exploitation et surexploitation. […] Il est […] peu douteux que la défense de ces privilèges, si minces et fragiles qu’ils aient été, est allée de pair avec la force du nationalisme dans les organisations de la classe ouvrière » (pp. 299-300). Pour autant, Balibar rappelle que « la part prise par le mouvement ouvrier organisé dans le dreyfusisme […], si elle n’a pas empêché la xénophobie de la classe ouvrière, a du moins, pour trois quarts de siècles, fait obstacle à sa théorisation comme substitut de l’anticapitalisme » (pp. 300-301), pour une majorité d’ouvriers du moins. D’un autre côté le PCF et son nationalisme aux accents xénophobes sont déjà pressentis (en 1985) comme un potentiel pourvoyeur du Front National, ce qu’il a effectivement été.
« Il y a crise raciste, et racisme de crise, lorsqu’ils deviennent politiquement inextricables » (p. 302).
Postface (Immanuel Wallerstein)
Que retenir de cet ouvrage de 300 pages ? « Primo, les multiples « communautés » auxquelles nous appartenons tous […] sont toutes des constructions historiques. Et, ce qui est encore plus important, ce sont des constructions historiques qui sont perpétuellement en reconstruction. […] Elles ne sont jamais originaires et, de ce fait, toute description historique de leur structure et de leur développement à travers les siècles est nécessairement une idéologie du présent. Secundo, on nous a toujours présenté l’universalisme comme […] à l’opposé complet des pôles particularistes […]. Ce contraste, cette antinomie nous a paru être une vision fausse sinon trompeuse de la réalité. Plus on les examine, plus on se rend compte du degré auquel ces idéologies s’impliquent réciproquement, au point qu’on est amené à soupçonner qu’elles représentent les deux faces d’un même médaille » (pp. 303-304). Pour notre part, nous pensons que cet ouvrage fournit une utile base pour une théorie non-idéaliste (« structurelle ») du racisme et du nationalisme, pour cesser de se fourvoyer dans des théories idéalistes du racisme et du nationalisme, lesquelles ont été, sont et seront impuissantes à endiguer leur montée en période de crise (comme aujourd’hui).
A. Paris

Willy Gianinazzi - André Gorz, une vie
Vous aimerez aussi

Philippe Descola – L’écologie des autres. L’anthropologie et la question de la nature
27 novembre 2016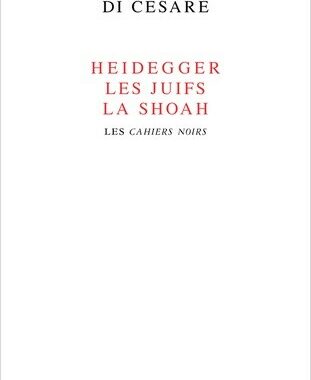
Donatella Di Cesare – Heidegger, les juifs, la Shoah
5 mai 2017