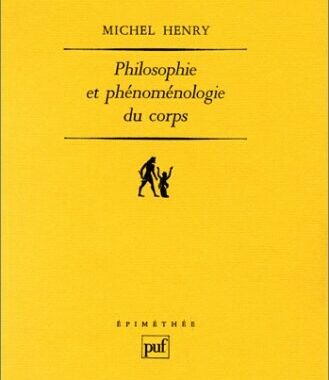Colette Guillaumin – Sexe, race et pratique du pouvoir
Colette Guillaumin, Sexe, race et pratique du pouvoir. L’idée de nature, Éditions iXe, 2016
Introduction
Ce recueil d’articles de Colette Guillaumin, chercheuse au CNRS, historienne de l’idéologie raciste, féministe matérialiste, est une précieuse contribution à une théorie critique du racisme et du sexisme comme rapports de domination – 1ère partie du recueil – et comme idéologies – 2ème partie du recueil –. Elle effectue une analyse pénétrante des « relations de pouvoir » de « sexe » et de « race », qu’elle rapproche puisque « ces catégories occupent en effet une place spécifique dans les rapports sociaux, celle d’être considérées comme des catégories « naturelles » » (8). Pour autant,
« cette croyance en un fondement somatique (physiologique, génétique, chromosomique, neuro-cérébral, etc.) des conduites humaines accompagne toujours et constitue l’une des faces (un des aspects) d’une très matérielle relation. Être « naturel », immanquablement, désigne des groupes humains d’un type particulier, ceux qui sont engagés dans une relation inégalitaire, certes, mais une relation inégalitaire spécifique : celle d’appropriation. Ces groupes sont, ou ont été récemment dans l’histoire, appropriés, c’est-à-dire la propriété […] d’un autre groupe humain. Le sexage, l’esclavage sont des rapports de cette sorte. La possession d’autres êtres humains implique qu’on en fait usage : leur appropriation […] est un usage corporel d’abord. Cet usage peut prendre plusieurs formes, de la libre exploitation (l’exploitation sans limites) de la force de travail – physique bien sûr mais aussi mentale et affective – jusqu’au libre usage (l’usage sans limites) du corps lui-même » (8).
La théorie critique du patriarcat et du genre, notamment celle de Colette Guillaumin, ayant déjà été largement abordée dans d’autres notes de lecture, nous nous concentrerons dans cette note de lecture sur la théorie du racisme, principal apport de Colette Guillaumin à une critique anti-naturaliste et matérialiste des dominations sociales. Néanmoins, nous aborderons certains aspects de sa théorie critique du patriarcat, et particulièrement ses apports originaux à une théorie matérialiste du patriarcat.
PS : Le concept de travail est utilisé ici au sens transhistorique d’activité productrice, et non comme catégorie spécifique du capitalisme.
PS 2 : La présente note de lecture ne s’intéresse qu’à une minorité des articles de l’ouvrage, étant donné l’impossibilité de tout aborder. La lecture du livre de Colette Guillaumin demeure donc indispensable.
Pratique du pouvoir et idée de Nature
Colette Guillaumin développe dans cet article dans Questions féministes l’idée d’une « appropriation de classe des femmes par la classe des hommes », manifestée par une appropriation sexuelle, reproductive, de leur travail domestique, etc. Mais également par leur désignation perpétuelle en tant que femmes : « Ce qi est dit et uniquement dit à propos des êtres humains femelles, c’est leur position effective dans les rapports de classe : celle d’être en premier et fondamentalement des femmes » (15). Les personnes assignées à la classe des femmes sont ainsi perpétuellement rappelées à leur appartenance à cette classe subordonnée, perpétuellement réduites à cette appartenance et donc à leur fonction de reproductrice, d’exploitée domestique, d’objet sexuel, etc. Pour Guillaumin, la « nature spécifique de l’oppression des femmes » est donc « l’appropriation », depuis « l’échange des femmes » jusqu’au mariage des sociétés contemporaines. Et c’est « un coup de force permanent » perpétuellement justifiée par une idéologie naturaliste. Guillaumin s’attache donc à une théorie critique de l’appropriation de la classe des femmes par celle des hommes et à une étude de l’idéologie exprimant, justifiant, renforçant cette appropriation :
« Le fait et l’effet idéologique sont les deux faces d’un même phénomène. L’une est un rapport social où des acteurs sont réduits à l’état d’unité matérielle appropriée. […] L’autre, la face idéologico-discursive, est la construction mentale qui fait de ces mêmes acteurs des éléments de la nature » (16-17).
Pour Guillaumin, les femmes ont ceci de particulier, ceci de commun avec l’esclavage, et ceci de différent avec l’exploitation capitaliste, qu’elles ne possèdent même pas leur force de travail (contrairement aux ouvriers) au sein du mariage et du couple classique, d’où leur exploitation domestique non-rémunérée – manifestée par l’inégalité de répartition des tâches ménagères – et d’où leur exploitation sexuelle non-rémunérée – manifestée par une prégnance du viol conjugal. Les femmes au sein du mariage et du couple classique sont, pourrait-on dire, des femmes de ménages non-rémunérées et des travailleuses du sexe non-rémunérées (et loin d’être toujours consentantes) : c’est donc bien d’appropriation de leur force de travail domestique et sexuelle qu’il s’agit. La culture du viol exprime également cette appropriation sexuelle de la classe des femmes par celle des hommes : le viol est une appropriation du corps des femmes. Pour autant, du fait de l’existence historique de l’esclavage, du servage, c’est-à-dire d’une variété de formes d’activité productive non-libre, « le rapport d’appropriation physique directe n’est donc pas une forme qui serait propre aux relations de sexe » (18). Certes, cette appropriation n’est plus comparable aujourd’hui, en France, à de l’esclavage ou du servage, mais elle l’a été partiellement – la condition de femme-esclave étant toutefois infiniment pire que celle de femme non-esclave – et elle demeure sous une forme ou une autre : il y a toujours massivement de l’exploitation domestique et du viol conjugal.

L’appropriation de la classe des femmes par celle des hommes prend des formes particulières :
« a) l’appropriation du temps ; b) l’appropriation des produits du corps ; c) l’obligation sexuelle ; d) la charge physique des membres invalides du groupe (invalides par l’âge – bébés, enfants, vieillards – ou malades et infirmes) ainsi que des membres valides de sexe mâle » (19).
Appropriation du temps de la classe des femmes par celle des hommes : les femmes n’ont pas de période où elles sont exemptées du travail domestique ou du « devoir conjugal », contrairement au travail salarié. Il n’y a « aucune mesure de ce temps, aucune limitation à son emploi » (19). Ainsi,
« toujours et partout, […] on attend que les femmes […] fassent le nettoyage et l’aménagement, surveillent et nourrissent les enfants, balayent ou servent le thé, fassent la vaisselle ou décrochent le téléphone, recousent le bouton ou écoutent les vertiges métaphysiques et professionnels des hommes, etc. » (20).
Appropriation des produits du corps des femmes : la reproduction a longtemps été forcée, les enfants devenant propriété du père. La situation est aujourd’hui différente, mais il est encore attendu des femmes qu’elles « donnent » des enfants à leur mari/partenaire.
Obligation sexuelle : les femmes sont soumises à une forte pression pour avoir des rapports sexuels, cette pression allant jusqu’au viol conjugal. Il ne s’agit plus d’une obligation légale, comme au sein du contrat de mariage classique (et encore : aujourd’hui encore, l’absence de partage du lit est un motif d’annulation du mariage), mais d’une obligation normative.
Charge physique des membres du groupe : les femmes doivent « assurer hors salariat l’entretien corporel, matériel et éventuellement affectif de l’ensemble des acteurs sociaux » (27). Certes, de plus en plus, cet entretien devient salarié, mais il n’en demeure pas moins qu’il s’agit alors d’un entretien quasi-exclusivement dévolu aux femmes, avec une forte précarité, des mauvaises conditions de travail, une absence de reconnaissance sociale et un faible salaire ; et surtout, cet entretien continue de s’effectuer en-dehors du salariat, et il est du fait des femmes. La charge mentale comme matérielle des enfants, des malades et des personnes âgées continue de peser sur la classe des femmes, tout comme celle des hommes valides d’ailleurs. Et cette charge est véritablement écrasante, et même aliénante, puisque l’existence des femmes « est absorbée dans d’autres individualités » (29), à commencer par celle des enfants, des malades et des personnes âgées. Une absorption dénoncée dans Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Au final,
« quand on est approprié matériellement on est dépossédé mentalement de soi-même » (31).

Pour Guillaumin,
« le mariage n’est que la surface institutionnelle (contractuelle) d’un rapport généralisé : l’appropriation d’une classe de sexe par l’autre » (35).
On ne peut donc s’arrêter à une critique du mariage, comme trop souvent au sein du marxisme ou de l’anarchisme. On renvoie ici aux travaux de Christine Delphy, qui développe un argumentaire analogue à celui de Guillaumin dans cet article.
Mais
« quels sont les moyens de l’appropriation de la classe des femmes ? a) le marché du travail ; b) le confinement dans l’espace ; c) la démonstration de force ; d) la contrainte sexuelle ; et e) l’arsenal juridique et le droit coutumier » (38).
Le marché du travail discrimine massivement les femmes, en termes de salaires, d’emplois, de promotion, etc. Les femmes restent tendanciellement plus confinées dans des espaces intérieurs, notamment du fait de l’appropriation masculine de l’espace public et d’une charge matérielle domestique supérieure des femmes. Les femmes font fréquemment l’objet de micro-agressions sexistes dans une multitude d’espaces, et de violences psychologiques et/ou physiques de la part de leur partenaire.
« La contrainte sexuelle sous forme de viol, de provocation, de drague, d’épuisement, etc. est, d’abord, l’un des moyens de coercition employé par la classe des hommes pour soumettre et apeurer la classe des femmes en même temps que l’expression de leur droit de propriété sur cette même classe » (40).
Tout n’est pas sexuel dans cette contrainte sexuelle :
« ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la symbolique littéraire de la sexualité masculine est policière (aveux, supplice, geôlier, etc.), sadique, militaire (place forte, à la hussarde, faire le siège, vaincre, etc.) et si réciproquement les rapports de force ont un vocabulaire sexuel (baiser la gueule, enfiler, etc.) » (41).
En effet, on sait que tout n’est pas sexuel dans le viol, mais qu’une bonne partie des motivations du violeur est de (ré)instaurer un rapport de domination. L’arsenal juridique du patriarcat, enfin, est en cours de démantèlement en France, mais lentement et sous pression de la classe des femmes : il n’y a pas eu de « cadeau », c’est grâce aux luttes des femmes, notamment au cours des années 1970, que ce démantèlement a été initié.
Certes, cette appropriation n’est pas sans contradiction, puisque les femmes vendent également (et de plus en plus) leur force de travail et que leur appropriation juridique a été considérablement affaiblie. Malgré tout, la valeur de la force de travail des femmes est tendanciellement inférieure à celle des hommes, notamment du fait de la naturalisation de leurs qualités professionnelles (niées dès lors comme qualifications acquises), et leur appropriation sociale (notamment sexuelle) se poursuit très largement. Et cette appropriation se traduit idéologiquement : c’est l’objet du reste de l’article de Colette Guillaumin.
En conclusion,
« du fait que les femmes sont une propriété matérielle concrète [de la classe des hommes], se développe sur elles (et contre elles) un discours de la Nature […]. Et ces choses vivants sont vues telle car, dans un rapport social déterminé, le sexage, elles sont des choses » (76). Or, la conscience de classe des femmes se construit « contre la croyance spontanée que nous sommes d’une espèce naturelle […] Ce sont les rapports sociaux très concrets et très quotidiens qui nous fabriquent et non une Nature transcendante […] ni une mécanique génétique interne qui nous aurait mises à la disposition des dominants » (78).
Cet article de Colette Guillaumin est une brillante démonstration du caractère socialement construit des « différences » femmes-hommes. La « différence » est produite idéologiquement en mélangeant « des données anatomo-physiologiques et de l’autre des phénomènes socio-mentaux » (80), et matériellement : différence de vêtements, de chaussures, d’accessoires, d’activités, de hobbies… La différence est une (re)production quotidienne, contraignante, normative. La différence est une production de signes différents, assignés à chaque genre, et l’attribution d’une signification sociale à des différences biologiques en tant que telles insignifiantes socialement. La différence étant une production visant à une reproduction de groupes sociaux hiérarchisés distinct, elle ne doit pas être revendiquée mais abolie au travers de l’abolition du rapport hiérarchique l’ayant constituée (et reproduite). La différence est en effet aussi une inégalité : différence de salaires, différence de tâches ménagères, différence de rapport aux enfants… La différenciation est également interne à la classe des femmes, comme moyen de hiérarchiser les femmes (plus ou moins belles, plus ou moins de bonnes cuisinières, plus ou moins sexuellement douées) – et de les diviser au plus grand avantage de la classe des hommes.
Race et nature. Système de marques, idée de groupe naturel et rapports sociaux
La notion de race
Au sein de son chapitre « Race et Nature. Système de marques, idée de groupe naturel et rapports sociaux », Colette Guillaumin démontre que « l’idée de race » est un « fait historique », un « fait social ». En effet, s’il y a bien un recoupement entre « les Blancs » et « les Noirs » comme catégories de l’anthropologie physique raciste et comme groupes sociaux réellement existants, l’existence d’« individus qui, appartenant à deux (ou plusieurs) « races », montrent qu’il n’y en a qu’une [biologiquement]. La constitution d’un groupe « colored » [métis] exprime qu’il n’est pas vrai qu’il n’y ait pas de frontière infranchissable entre « Noirs » et « Blancs » » (167). Et cela contredit l’idée qu’ « on ne peut appartenir qu’à l’un OU l’autre de ces groupes (ou bien à quelque autre groupe), mais en aucun cas à l’un et l’autre » (167), c’est-à-dire l’idée même de race. L’existence de métis a été vigoureusement combattue par de nombreuses sociétés fondées sur une hiérarchie raciste, précisément parce que cette existence démentait celle des races, ou du moins brouillait leurs frontières. Et ce brouillage des frontières raciales entraînait un brouillage des frontières entre racisants – donc dominants – et racisés – donc dominés –, menaçant l’ensemble de l’ordre raciste. L’existence des métis a donc été :
- Prévenue par une interdiction des relations « interraciales » ;
- Cette interdiction s’avérant généralement très inefficace, ils ont été souvent assimilés à des racisés, manière de dénier leur existence comme métis ;
- Lorsque cette assimilation n’a pas été employée et/ou n’a pas été fonctionnelle, c’est-à-dire fréquemment, ils ont été renvoyés à une catégorie intermédiaire bénéficiant de certains privilèges vis-à-vis des racisés – manière de les intéresser matériellement à l’existence d’une société raciste – sans être au niveau des racisants – manière de préserver leur domination globale –, et ont parfois été utilisés comme défenseurs militaires de l’ordre racial.
L’existence de métis a donc été intégrée matériellement à l’ordre raciste, sans pour autant qu’il y ait d’intégration de leur existence à l’idéologie raciste, puisque cela aurait détruit l’idée même de races séparées et donc toute légitimation des hiérarchies racistes. Ainsi, « ce qui se passe est l’inverse de l’impossibilité qu’on nous affirme : nulle clôture ni séparation » mais une « simple continuité somatique » (168).

Mais comme l’explique Guillaumin, l’enjeu n’est pas là :
« Il n’y a de groupes présumés naturels que pour autant qu’ils entretiennent des relations telles qu’effectivement chacun des groupes est fonction de l’autre. Il s’agit en somme de rapports sociaux […]. On ne se préoccupe guère d’affirmer la naturalité lorsqu’il y a indépendance économique, spatiale, etc., entre groupes quelconques ; seules des relations déterminées (de dépendance, d’exploitation) amènent à postuler l’existence d’ « entités naturelles hétérogènes ».
La colonisation d’appropriation des hommes (trafic d’esclaves, puis de main-d’œuvre) et des terres […] ont induit la proclamation de la nature spécifique des groupes qui subissaient ou subissaient ces relations » (168-169). En effet, ce n’est qu’avec l’esclavage européen des Africains que la catégorisation des groupes étrangers comme « biologiques » et non comme « culturels » émerge globalement. Ces « entités naturelles hétérogènes » sont d’ailleurs reproduites socialement, loin d’être un produit « naturel » :
« Dans les Etats-Unis du XVIIIème siècle celui qui était par quelque côté […] enfant d’esclave était esclave : enfant d’esclave-homme et de femme libre, il était esclave (Maryland dès le XVIIème siècle), enfant d’esclave-femme et d’homme libre, il l’était également (tous les Etats esclavagistes). On dit […] que l’enfant de la femme esclave était esclave « parce qu’un enfant est difficilement dissociable de sa mère », mais qu’en est-il de cet argument lorsque l’enfant esclave est celui d’une femme libre ? » (169).
Ici, Guillaumin ne se contente pas de pointer l’écart entre l’idéologie raciste et ce qui se passe effectivement à un niveau social : elle montre également l’intersection entre race, genre et propriété capitaliste, puisque si tout enfant d’esclave est un esclave – même s’il a une mère libre ou un père libre – c’est parce que tout produit d’un-e esclave est la propriété du maître (169).

La racialisation, comme processus de (re)production des races comme naturalisation de groupes sociaux, s’écarte parfois encore plus de « l’idée [biologisante] de race » :
« Le système américain, d’abord esclavagiste, lorsqu’il s’est transformé en système racial au cours du XIXème siècle avec l’abolition de l’esclavage, a défini l’appartenance dite de « race » bel et bien selon des critères de classe [au sens de critères sociaux] puisque « Noirs » furent [légalement jusqu’aux années 1960] […] les Blancs [d’apparence] qui ont (ou auraient) un ancêtre esclave présumé. Ainsi, un arrière-grand parent, c’est-à-dire un géniteur direct sur huit […], vous renvoie à un groupe social déterminé […] [malgré] sept grands-parents blancs. […] La situation sociale est qu’on est Noir car c’est ainsi qu’en décident les définitions (sociales) » (170).
La race est donc bien une catégorie sociale – parfois légale – prétendant à être naturelle, mais ce n’est pas qu’une pure idée puisqu’elle a bien une force matérielle puisqu’être apparemment blanc mais légalement noir pouvait valoir d’être expulsé des lieux réservés aux Blancs comme catégorie socio-légale.
Les systèmes de « marques »
« Distinct de l’idée de nature et même en un sens contraire à celle-ci puisqu’il témoigne de l’inscription conventionnelle et artificielle des pratiques sociales, le système des marques est présent depuis fort longtemps pour accompagner les clivages sociaux » (172) construits historiquement. Pour distinguer immédiatement dans l’espace public les dominants des dominés, un système de marques existe : « marque[s] vestimentaires » et/ou d’apparence pour distinguer les hommes des femmes, les chrétiens des Juifs (l’étoile jaune), les « white-collars » (cadres, et leur vêtement blanc) des « blue-collars » (ouvriers, et leur vêtement bleu), les militaires des civils ; marques au corps pour distinguer les non-esclaves des esclaves, les « Aryens » des Juifs, les « honnêtes citoyens » des bagnards. Le système de marques vise également à marquer une « permanence du rapport de pouvoir », notamment pour ce qui est des marques au corps. Pour Guillaumin, la cristallisation des rapports coloniaux comme d’esclavage au XVIIIème siècle aboutit au passage « d’une association conjoncturelle entre rapport économique et traits physiques », d’où « naissait un nouveau type de marque (la « couleur ») […], et des développements ultérieurs le feront passer du statut traditionnel d’emblème à celui de signe d’une nature spécifique des acteurs sociaux » (174-175). De pair avec cette évolution,
« on a commencé alors à fabriquer des taxinomies qui seront ensuite progressivement qualifiées de « naturelles » […]. Les taxinomies se sont transformées en systèmes de classement à marquer morphologique, où cette dernière est supposée précéder le classement » (175),
et ce alors même que c’est l’existence de rapports d’esclavage ou de colonisation qui ont créé ces différents groupes a posteriori racialisés. En effet, « la « marque » morphologique ne précède pas davantage le rapport social que ne le font l’inscription au fer rouge ou le tatouage d’un numéro » (175) : la racialisation est un processus de naturalisation d’une différence sociale de caractère hiérarchique et de création d’une différence « naturelle » à partir d’une différenciation sociale déjà existante. La racialisation peut opérer à partir de n’importe quel marque « naturelle » : la couleur, la religion (en Espagne au XVème siècle), la langue et/ou l’accent (les Irlandais dans l’Angleterre du XIXème siècle), etc. Au fond, peu importe, puisqu’il s’agit de pouvoir distinguer dans l’espace public et de pouvoir naturaliser cette distinction créée. Comme l’explique Christine Delphy : « Le sexe est simplement un marqueur de la division sociale [hiérarchique de genre] ; il sert à reconnaître et identifier les dominants des dominé[e]s » (L’ennemi principal [II]. Penser le genre). L’idée de race procède ainsi d’une hiérarchie en cours de construction qu’elle vient cristalliser idéologiquement (et légitimer), et non d’une réalité biologique pré-existante :
« Le processus de prélèvement des esclaves était déjà en cours depuis un siècle environ lorsque interviennent les premières taxinomies qui incluent des caractères somatiques ; la marque suivait l’esclavage et ne précédait nullement le groupe des esclaves ; le système esclavagiste était déjà constitué lorsqu’on s’est avisé d’inventer les races » (175).
Plus précisément,
« ce système se développait à partir de tout autre chose que l’apparence somatique de ses acteurs. […] L’idée de « réduire ‘les nègres’ en esclavage » est une idée moderne, qui n’est advenue que dans une conjoncture déterminée où le recrutement des esclaves (qui au départ étaient noirs et blancs) s’est focalisé. On faisait des esclaves n’importe où on le pouvait, et en fonction des besoins… puis à un certain moment historique, progressivement à la fin du XVIIème siècle, en fait, les esclaves ont cessé d’être recrutés en Europe car leur force de travail était désormais nécessaire sur place, avec le développement de l’industrialisation ; corollairement, ils furent alors pris en totalité dans une région du monde déterminée [l’Afrique de l’Ouest] » (176).
Si Guillaumin effectue quelques raccourcis historiques dans son argumentaire, il est clair qu’il y a bien une antécédence de l’esclavage sur l’idée d’une race « nègre » et d’une race « blanche », toutes deux créées idéologiquement, socialement et légalement à partir du XVIII siècle. Ainsi, « dans la période de recrutement euro-africain il n’y avait pas (pas encore) […] de réflexion sur la nature somato-physiologique des esclaves ; cette réflexion d’ailleurs n’interviendra que postérieurement au marquage par le signe somatique lui-même : les taxinomies ont précédé les théories racistes » (176).
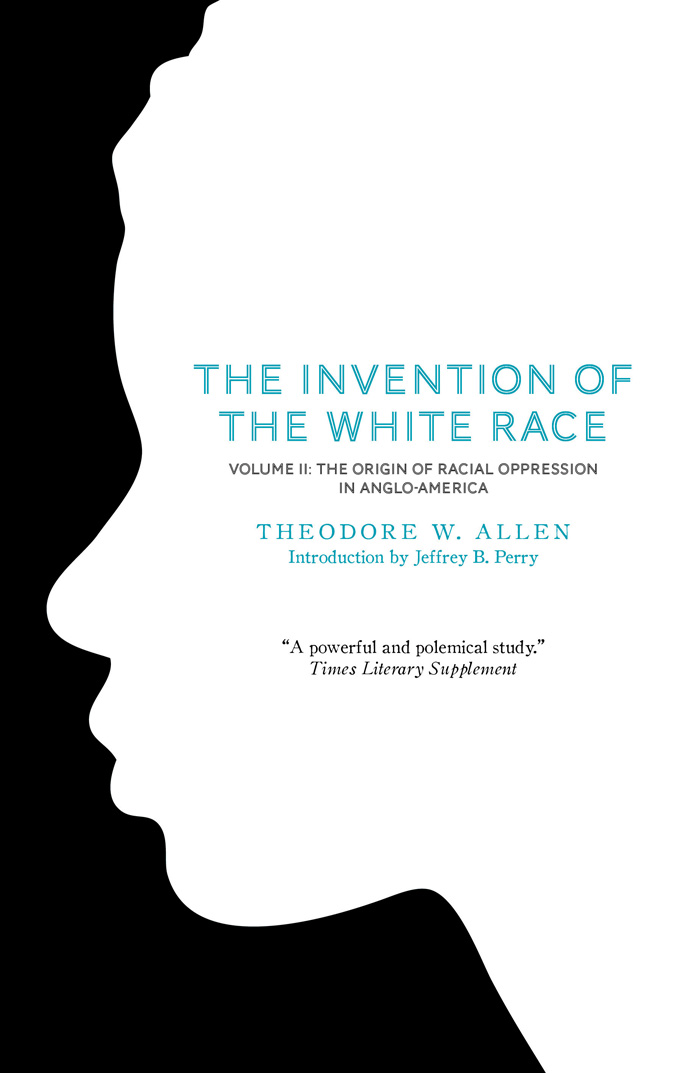
« Au cours des XIXème et XXème siècles, il y eut […] beaucoup de chercheurs en quête d’une « naturalité » des classes et des groupes exploités. […] Cette option est fort combattue […] ; toutefois, la censure n’intervient qu’en ce qui concerne la partie mâle, blanche, métropolitaine de la classe exploitée ; toute censure ou hésitation disparaît dès qu’il est question de la partie femelle, ou de la partie immigrée, ou de la partie néo-colonisée, dans les rapports d’exploitation [de classe] » (176).
Ainsi, la racialisation des ouvriers blancs de métropole, de ladite « race des travailleurs », n’a pas perduré et n’est jamais devenue une catégorie légale, contrairement à la distinction de genre des individus de sexe différent et à la racialisation. Ceci est notamment liée au racisme et au sexisme d’une grande partie des ouvriers blancs, qui ont préféré affirmer leur masculinité et leur blanchité plutôt que de se solidariser avec la partie non-blanche et non-masculine de leur propre classe, comme l’explique Roedlinger dans Le salaire du blanc.
« En somme l’idée de groupe naturel est la synthèse mouvante de deux systèmes : le système traditionnel de la marque, purement fonctionnel en ce qu’il n’a aucune implication endogénique et qu’il n’est ni plus ni moins que le marquage du bétail, et le système déterministe archéo-scientifique qui voit dans un objet quelconque une substance qui sécrète ses propres causes, qui est à elle-même sa propre cause » (177).
Ainsi, l’exploitation domestique des femmes est naturalisée en une nature féminine propice aux tâches ménagères, le chômage des racisés en une nature arabe/noire de fainéantise, etc. En fait,
« l’idée spontanée de nature introduit une relation erronée entre les faits, elle change le caractère même de ces faits […] : un rapport social, ici un rapport de domination, de force, d’exploitation, celui qui sécrète l’idée de nature, est considéré comme le produit de traits internes [naturels donc] à l’objet qui subit le rapport […]. Parler d’une spécificité des races, des sexes, parler d’une naturelle spécificité des groupes sociaux, c’est dire […] qu’une « nature » particulière est directement productrice d’une pratique sociale et faire l’impasse sur le rapport social que cette pratique actualise. […] C’est ainsi que l’esclavage devient un attribue de la couleur de la peau, la non-rémunération du travail domestique un attribue de la forme du sexe » (178)
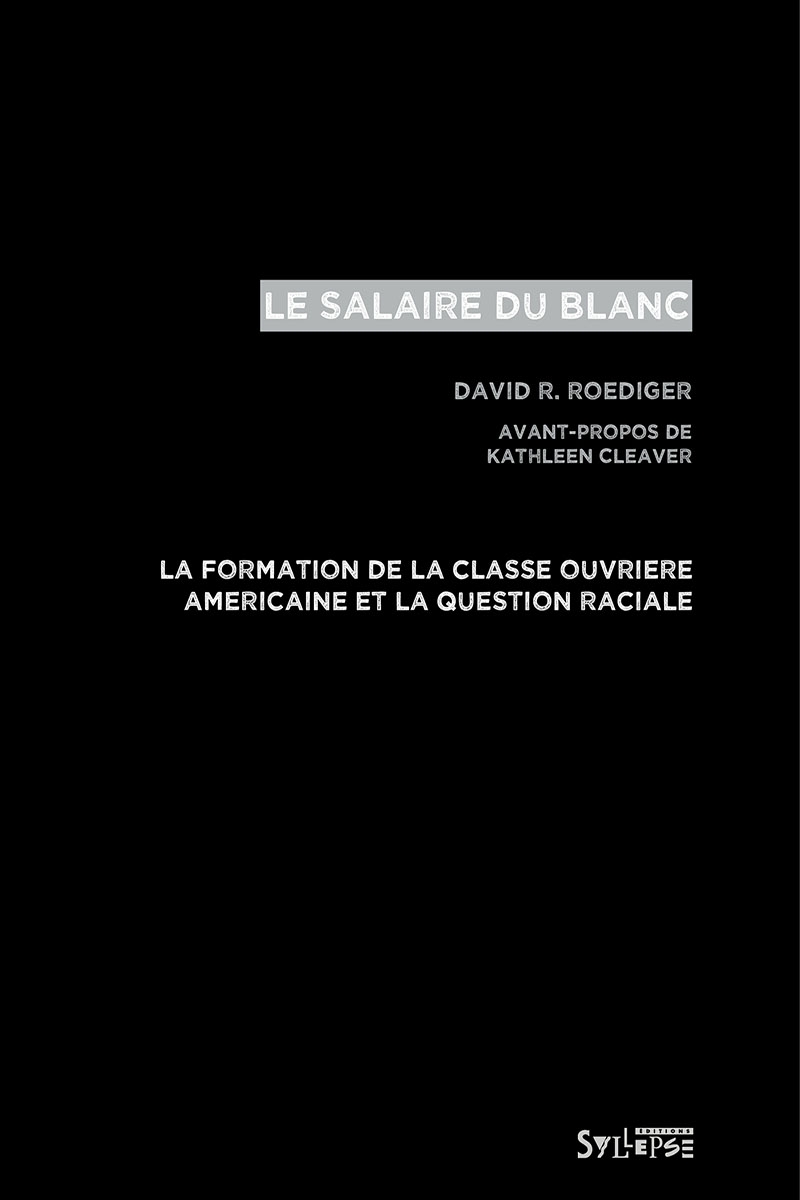
Colette Guillaumin explique ensuite de manière capitale que
« des notions de race et de sexe on peut dire qu’elles sont des formations imaginaires, juridiquement entérinées et matériellement efficaces » (179).
Le racisme est ainsi une idéologie, un système légal de discrimination (Jim Craw Laws au sud des Etats-Unis, lois de Nuremberg dans l’Allemagne nazie, système de l’indigénat dans l’Empire colonial français, lois d’Apartheid en Afrique du Sud…) et un rapport inégalitaire, la race étant une « communauté imaginaire », une catégorie légale et un groupe social constitué par une hiérarchie. La critique du racisme, explique Guillaumin, ne peut se contenter d’une réfutation scientifique de l’existence des races, puisque l’existence de groupes sociaux marqués par des signes « biologiques » et recoupant des « races » suffit à une confirmation quotidienne de l’idéologie raciste. Une critique radicale du racisme doit donc s’attaquer à l’existence même de ces groupes sociaux, et donc au système hiérarchique, discriminatoire, inégalitaire présidant à leur (re)production. En effet, « l’idée de spécificité interne, somato-physiologique, des groupes sociaux concernés est une formation imaginaire […] associée à un rapport social » (182). Il s’agit donc bien de s’attaquer au rapport social raciste, et non simplement à un imaginaire qui, de toute façon, survivra tant que ce rapport social existera. Tant qu’il y aura des groupes sociaux recoupant des « races », l’imaginaire raciste restera fermement ancré dans l’esprit d’une majorité des gens. L’abolition « matérielle » du racisme est donc absolument nécessaire à son abolition « idéelle ».

Le racisme biologique nazi n’est pas, pour Guillaumin, « une dysfonction énigmatique mais le fruit d’une logique de rapports sociaux antérieurs » (183). La question de l’antisémitisme ne peut être abordée uniquement d’un point de vue « matérialiste » (Postone), mais il est clair que l’exclusion des Juifs de nombreux emplois durant des siècles et leur surreprésentation au sein des professions financières du fait de cette exclusion a été un terreau « matériel » de l’antisémitisme. Pour Guillaumin, « les rapports de fait viennent s’exprimer dans une des formes superstructurelles possibles : institutions juridiques ou science » (184). Ce schéma est sans doute réducteur, et il n’insiste pas suffisamment sur l’autonomie (relative) de l’idéologie raciste vis-à-vis des rapports racistes, mais néanmoins il insiste sur l’origine « matérielle » du racisme scientifique. Rapport social fondamentalement inégalitaire, puisque du côté des racisants il y a des privilèges, une liberté bien supérieure et une absence d’interdits alors que du côté des racisés il y a des discriminations, des contraintes supplémentaires et des interdits :
« Les dominés se trouvent dans la situation symétrique et inverse de celle des dominants, car : 1) tout leur empêche certaines pratiques, et 2) tout leur impose au contraire de faire le travail domestique gratuitement, d’être manœuvre, d’être au SMIC (et au-dessous du SMIC), etc. » (186).
En conclusion :
« L’invention de la nature ne peut pas être séparée de la domination et de l’appropriation d’êtres humains. Elle se développe dans ce type précis de relations. […] Si ce qui est énoncé sous le terme « naturel » est la pure matérialité des objets impliqués, alors rien de moins naturel que les groupes en question qui, précisément, sont constitués PAR un type précis de relation : la relation de pouvoir, relation qui les constitue en choses (à la fois destinés à et mécaniquement orientés), mais bien qui les constitue puisqu’ils n’existent comme choses que dans ce rapport. Ce sont les rapports sociaux où ils sont engagés (l’esclavage, le mariage, le travail immigré…) qui les fabriquent tels à chaque instant ; en dehors de ces rapports ils n’existent pas, ils ne peuvent même pas être imaginés. Ils ne sont pas des données de la nature, mais bien des données naturalisées des rapports sociaux » (186-187).
Conclusion
Nous finirons notre note de lecture par une citation éclairante de Colette Guillaumin dans un autre article de cet ouvrage incontournable :
« Non, la race n’existe pas. Si, la race existe. Non certes, elle n’est pas ce qu’on dit qu’elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale, des réalités » (211).


Prisons

Pour une théorie matérialiste du racisme
Vous aimerez aussi
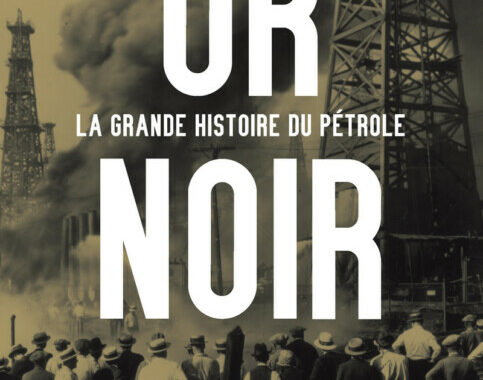
Matthieu Auzanneau – Or noir. La grande histoire du pétrole
24 janvier 2017
Histoire de la virilité – L’invention de la virilité. De l’Antiquité aux Lumières
5 novembre 2016