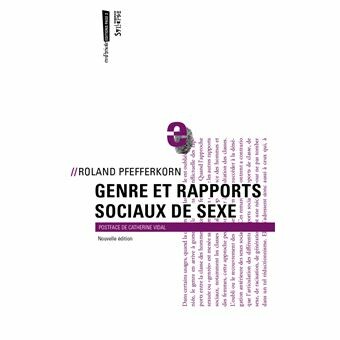
Roland Pfefferkorn – Genre et rapports sociaux de sexe
Roland Pfefferkorn, Genre et rapports sociaux de sexe, Lausanne/Paris, Page 2/Syllepse, 2016
L’ouvrage consiste en une brillante synthèse des travaux féministes autour des « rapports sociaux de sexe » et du « genre » (avec une intéressante critique de l’approche post-moderne), même s’il y a des développements critiquables et des points aveugles (absence d’une critique du travail). On en trouvera un résumé dans cette vidéo. Roland Pfefferkorn est un sociologue de l’Université de Strasbourg.
Le féminisme, commence Pfefforkorn, est un mouvement de luttes contre l’oppression des femmes, et il a développé un éventail de concepts de luttes, concepts dont l’optique était de rompre avec l’idéologie patriarcale d’une naturelle « complémentarité des sexes » (hiérarchique, en réalité) : patriarcat, mode de production domestique, travail domestique, sexe social, sexage, classe de sexe. Il enchaîne en parlant de la dégradation des conditions d’existence des femmes depuis 30 ans du fait de la crise structurelle du capitalisme et du « tournant néolibéral » : précarisation, disparition des crèches, nécessité d’assumer une partie croissante des soins aux personnes dépendantes, entres autres [Hommes-Femmes, quelle égalité ?]
Le travail domestique et sa mondialisation
Le « travail domestique » (qu’on appellera « servage domestique » ou « labeur domestique » lorsqu’il n’est pas rémunéré) est au cœur de l’analyse féministe, puisqu’il est réservé aux femmes. La mondialisation capitaliste complexifie l’analyse du labeur domestique, puisque « les femmes qui sont affectées à ces travaux en outre de plus en plus souvent des migrantes venues des pays pauvres. Il faut donc prendre en compte […] cette « chaîne internationale du care […]. Dans les pays « riches » ces femmes prennent en charge une part croissante des travaux liés aux soins, à la sollicitude et, plus largement, à l’entretien des personnes et des locaux. Elles travaillent au domicile des ménages des catégories supérieures, voire moyennes, comme femmes de ménage, baby-sitters, aides auprès de personnes âgées ou travailleuses salariées, presque toujours mal rémunérées, mais aussi dans les hôpitaux, maisons de retraite ou hôtels, sans compter celles qui vendent des services sexuels » (p. 7). Ces femmes migrantes sont une illustration archétypique de l’intrication des rapports sociaux de domination dont il est question plus loin dans l’ouvrage :
- Elles sont des femmes assignées à un travail domestique (en plus de leur servage domestique) déqualifié, précaire, sous-payé (comme l’ensemble des travaux réservés aux femmes au sein du patriarcat capitaliste) ;
- Elles sont des prolétaires forcées de vendre leur force de travail (et à un faible prix, donc elles constituent une fraction sur-dominée du prolétariat) ;
- Et elles sont non-nationales, venant de périphéries dominées, racisées, impliquant (dans une approche « matérialiste ») qu’elles seront particulièrement exploitées.
[On pourrait rajouter qu’elles sont également soumises de manière particulièrement forte aux structures impersonnelles du capitalisme et de l’État]
On recommandera là-dessus Jules Falquet et alii (dir.), Le sexe de la mondialisation. Genre, classe, race et nouvelle division du travail, Paris, Presses de Sciences Po, 2010 (et Jules Falquet, De gré ou de force. Les femmes dans la mondialisation, Paris, La Dispute, 2008).
On lira également, sur recommandation de Pfefferkorn, au sujet des violences contre les femmes, Marylène Lieber, Genre, violences et espaces publics – la vulnérabilité des femmes en question, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2008 et Natacha Chetcuti et Maryse Jaspard (dir.), Violence envers les femmes – Trois pas en avant deux pas en arrière, Paris, L’Harmattan, 2007.
Enfin, au sujet de l’androcentrisme des auteurs classiques des sciences sociales, on lira Danielle Chabaud-Rychter et alii (coord.), Sous les sciences sociales, le genre. Relectures critiques, de Max Weber à Bruno Latour, Paris, La Découverte, 2010.
Engels
Les hommes ont peu réfléchi de manière critique au patriarcat, explique Pfefferkorn, et cela n’a rien d’étonnant puisqu’ils constituent des dominants au sein de ce système. Engels a été un des premiers hommes à s’y coller, même si son analyse est extrêmement limitée du fait de l’atmosphère idéologique de son temps. L’origine de la famille, de la propriété et de l’État (1885) parle d’une oppression des femmes ayant des racines socio-historiques, et non « naturelles », mais il reste différencialiste (essentialiste), il ne parle pas de sexualité, il est naïf en croyant que l’accès au travail salarié des femmes changera tout, sa croyance au « matriarcat primitif », etc. Cependant, par rapport à un misogyne comme Proudhon, ou un Durkheim théoricien de « la complémentarité fonctionnelle des hommes et des femmes » (p. 13) naturalisant complètement l’exploitation domestique des femmes [Hélène Charron, La sociologie entre nature et culture. 1896-1914. Genre et révolution sociale dans l’Année sociologique, Presses universitaires de Laval, Québec, 2011], c’est une petite brèche dans l’idéologie patriarcale. Brèche insuffisante, comme en témoignera l’opposition des marxistes orthodoxes au féminisme tout au long du 20ème siècle.
L’approche « matérialiste »
La conceptualisation des « femmes » comme catégorie sociale et comme produit du système patriarcal n’intervient cependant qu’au cours du 20ème siècle. La « masculinité » est largement pensée comme sociale et comme culturelle, au contraire d’une « féminité » renvoyée au naturel, notamment en ethnologie comme l’a montré Nicole-Claude Mathieu dans L’anatomie politique. Le concept de « rapports sociaux de sexe » permet selon Roland Pfefferkorn de rompre avec tout naturalisme et de penser un antagonisme de classe entre « la classe des hommes » et « la classe des femmes » (p. 17), laquelle n’aura de résolution qu’avec une abolition du système patriarcal. Ce concept résume l’approche du « féminisme matérialiste », qu’il présente comme une tentative d’éclairage du processus de hiérarchisation socio-historique entre « hommes » et « femmes ». Pour ce courant, « les sexes ne sont pas de simples catégories biosociales, mais des classes (au sens marxien) constituées par et dans le rapport de pouvoir des hommes sur les femmes, qui est l’axe même de la définition du genre (et de sa précédence sur le sexe) : le genre construit le sexe » (Nicole Claude-Mathieu, citée p. 18). Le concept de genre constitue un apport pour Pfefferkorn, parce qu’il permet « d’insister sur le fait que les hommes et les femmes résultent d’une fabrication sociale et qu’ils ne sont en aucun cas réductibles aux sexes biologiques » (p. 20). Pour autant, il existe différentes utilisations de ce concept, et il faut critiquer celles gommant l’oppression structurelle des femmes, ou occultant l’inextricable lien entre celle-ci et d’autres systèmes de domination sociale.
Chapitre 1. Rompre avec le naturalisme
Pfefferkorn commence par une distinction conceptuelle issu du féminisme matérialiste : « L’exploitation implique qu’un groupe – ici celui des hommes – s’approprie les services ou les biens produits le [labeur] d’un autre groupe – celui des femmes – sans contrepartie équivalente. La domination renvoie au pouvoir exercé par le groupe des hommes sur celui des femmes […]. La discrimination se traduit par des droits collectifs moindres ou par un traitement individuel différencié en raison d’un préjugé visant les femmes. Enfin, la stigmatisation se traduit par une dévalorisation liée à un attribut de sexe jugé de manière négatif. De plus, ces différents processus oppressifs sont simultanés et non parallèles. Par exemple, un rapport d’exploitation peut être structuré par un rapport de domination » (p. 23). Mais ici, il y a une forte intimité entre classe d’oppresseurs et classe d’oppressées (p. 24).
Au cours des années 1970, « les chercheuses féministes sont parties de l’idée que les hommes et les femmes constituent des catégories qui procèdent d’une mise en force sociale d’un donné naturel » (pp. 24-25). C’était un progrès par rapport aux conceptions en termes de « condition féminine » et de « rôles de sexe », mais depuis le féminisme matérialiste est allé au-delà en affirmant qu’il y a une primauté du genre sur le sexe et que même celui-ci est défini socialement.
Les féministes matérialistes ont également montré que l’invention de la famille moderne, avec une femme au foyer et un homme au travail, « a pris forme dans les classes moyennes anglaises lors de la « révolution industrielle » » (p. 25), même si au sein de l’ensemble des sociétés patriarcales (y compris non-capitalistes) les femmes sont contraintes de s’occuper des tâches ménagères – mais en plus elles doivent des activités extra-domestiques.
La transposition du concept de classe aux groupes sexués date des années 1970, permettant de dépasser ce que Nicole Claude-Mathieu appelle le « caractère fétiche du sexe », lequel concept naturalisant masque une domination sociale. Les féministes matérialistes-marxiennes parlent également de « mode de production domestique », antérieur au capitalisme mais s’articulant avec lui depuis son émergence historique (on pourrait même dire qu’ils s’interpénètrent, notamment dans l’agriculture ou dans l’artisanat comme l’a montré Delphy).
Le patriarcat et le mode de production domestique
« Le concept de capitalisme en tant que système ou en tant que mode de production sera à l’origine de l’élaboration du concept de patriarcat. Celui-ci sera envisagé la plupart du temps comme un […] « système autonome d’exploitation de domination » [Delphy] présidant à la fourniture de services domestiques gratuits. Suivant le sens donné par Marcel Mauss au « fait social total », le patriarcat est défini comme un « système total […] ». Delphy défendra l’existence, à côté du mode de production capitaliste, d’un mode de production domestique qui serait la base du patriarcat. Ce mode de production spécifique permet aux hommes de s’approprier le travail domestique des femmes effectué gratuitement et d’exploiter les femmes en tant que classe. » (pp. 27-28)
L’idée d’un mode de production autonome provient du fait qu’une grande partie du « féminisme marxiste » considérait qu’il ne s’agissait (l’oppression des femmes) que d’un résultat du capitalisme. On ne peut en effet plus considérer l’oppression des femmes comme un simple sous-produit du capitalisme depuis que l’anthropologie féministe [Nicole-Claude Mathieu] a montré qu’elle existait au sein de l’ensemble des sociétés connues. Aujourd’hui, maintenant qu’il est admis qu’il existe un système patriarcat antérieur au capitalisme et donc ne pouvant s’y résumer, et qu’il faut donc également lutter contre le patriarcat et pas uniquement contre le capitalisme, on peut tenter avec Roswitha Scholz notamment de montrer l’interpénétration du système patriarcal et du système capitaliste, et de parler de « patriarcat producteur de marchandises » (distinct des autres formes du système patriarcal) qu’il faudrait abattre.
Christine Delphy, au final, parle du patriarcat comme « système de subordination des femmes aux hommes dans les sociétés industrielles contemporaines », ayant comme base l’exploitation des femmes au sein du mode de production domestique. Là-dessus, on lire Christine Delphy, L’ennemi principal, tome 1, Paris, Syllepse, 2013 (et son ouvrage intitulé Pour une théorie générale de l’exploitation), et Sylvia Walby, Patriarchy at work, Cambridge, Polity Press, 1986.
Le patriarcat n’est donc pas réductible au capitalisme, il s’agit de deux systèmes s’interpénétrant de manière inextricable. En effet, contrairement au mode de production capitaliste, le mode de production domestique implique une exploitation sans rémunération (et non une exploitation marchande) de femmes parentes de l’exploiteur (et non d’individus anonymes, interchangeables, « étrangers »), comme l’explique Christine Delphy. Au sein du mode de production domestique, « le caractère gratuit des services domestiques n’est pas lié au caractère spécifique des tâches réalisées par les femmes » (p. 30), puisque toute tâche domestique peut être marchande (ménage, repassage, production alimentaire, cuisine, etc.), mais au fait qu’il y a une non-rémunération de ces tâches au sein du mariage. L’exploitation domestique n’est, au sein du mariage, pas rémunérée, et constitue donc l’archétype du « sexage » dont parle Colette Guillaumin (en référence au « servage »). Comme l’affirme Delphy : « L’appropriation et l’exploitation de leur travail [ou labeur, lorsqu’il n’y a pas de vente du produit de l’exploitation domestique] dans le mariage constituent l’oppression commune à toutes les femmes. En tant qu’êtres destinées à devenir « la femme de » quelqu’un, les femmes destinées au même rapport de production ne constituent qu’une seule classe. Quand elles participent à la production capitaliste elles entrent en plus dans d’autres rapports de production » (cité, p. 30). Là-dessus, on lira également Christine Delphy, Diana Leonard, Familiar exploitation : a new analysis or marriage in contemporary western societies, Cambridge, Polity Press, 1992.
Le travail/labeur domestique
Colette Guillaumin parle elle d’une appropriation masculine complète des femmes, et non seulement de leur force de travail, d’où son concept de « sexage » (proche également de celui d’esclavage). Cette appropriation est non seulement concrète mais également idéelle (p. 33), comme elle l’explique dans Sexe, race et pratique du pouvoir. L’idée de nature, Editions iXe, 2016 [1992]. Les femmes sont continuellement asservies aux tâches domestiques.
L’extension du travail des femmes bouleverse le mode de production domestique
Le labeur/travail domestique ne peut être pour autant étudié comme s’il était du fait des seules « femmes au foyer » (p. 34), alors qu’il est également du fait des femmes ayant un emploi, quoique celles-ci sont incitées financièrement à se retirer du marché du travail au travers des « aides familiales » (lesquelles ont donc pour but, selon Delphy, de maintenir l’ordre patriarcal de l’exploitation domestique). Mais malgré cela, et malgré un recul du travail des femmes des années 1920 aux années 1960, il y a eu une forte augmentation du travail des femmes depuis 1954 en France (p. 36). Au Ghana, les politiques d’ajustement structurel du FMI ont conduit à une montée du chômage masculin et parallèlement (et en compensation) à une augmentation du travail féminin, les mères devenant commerçantes tandis que leurs filles doivent assumer une grande partie des tâches ménagères (p. 36) – et là, on voit que les conséquences de l’actuelle crise du capitalisme retombe davantage sur les femmes que sur les hommes, comme l’affirme Roswitha Scholz. Elles retombent également plus sur les femmes prolétaires, surtout migrantes, lesquelles doivent assumer une partie croissante des charges domestiques des femmes des classes moyennes ou supérieures des centres capitalistes (p. 37) : « Se croisent alors de manière particulièrement nette les rapports sociaux de sexe, de classe, de racisation, voire de génération ». Pfefferkorn critique alors Delphy pour sa conception « fixiste » du patriarcat (p. 40), celle-ci étant incontestablement dynamique : certes, mais cela n’empêche pas une permanence des structures de base du patriarcat. D’autre part, il loue Christine Delphy d’avoir insisté davantage sur « l’articulation de la domination patriarcale avec la domination capitaliste » (p. 41). [cf. également Françoise Bourgeois et alii, « Travail domestique et famille du capitalisme », Critique de l’économie politique, nouvelle série, n°3, Maspero, avril-juin 1978, p. 23]
La dialectique production/reproduction
La famille n’est pas qu’un espace de « reproduction » du capital : c’est également un espace de production de marchandises, au sein du cadre de « l’exploitation familiale » agricole ou artisanale (p. 42). Cf. là-dessus, Le sexe du travail. Structures familiales et système productif, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1984, et un article de Danièle Kergoat dans Se battre, disent-elles, Paris, La Dispute, 2012.
Les femmes, d’autre part, affirment dorénavant un droit au travail, donc à une indépendance économique vis-à-vis de leur mari/compagnon, et revendiquent un partage total des tâches ménagères, même si l’idéologie maternelle empêche également un partage total des « soins aux enfants » (p. 44). C’est ainsi qu’on observe une explosion du déséquilibre entre hommes et femmes en termes de labeur domestique après l’arrivée d’un enfant, et ce alors même qu’il n’y a qu’une minorité de tâches liées aux enfants non-partageables avec les hommes (l’allaitement, et peut-être une autre).
Chapitre 2. L’invention du genre et sa polysémie
Le concept de « genre » a connu une large diffusion depuis une dizaine d’années, en raison de sa polysémie et donc de son caractère unificateur (puisque des courants divergents peuvent s’en réclamer, de certaines féministes matérialistes comme Delphy jusqu’à des institutions internationales !) : ainsi, les deux principales revues universitaires consacrées au patriarcat s’intitulent Les Cahiers du genre et Travail, genre et sociétés. Seules des institutions réactionnaires comme l’Académie française, opposant de longue date aux féminisations « des noms de métiers, de titres et de fonctions » [Eliane Viennot et alii, L’Académie contre la langue française. Le dossier féminisation, Donnemarie, Editions iXe, 2015] et véritable « police des mots », s’opposent à son utilisation (p. 51). « Dans son acception sociologique le gender est apparu en 1972. Le genre renvoie d’abord aux significations culturelles que prend le sexe et en ce sens le genre se distingue du sexe biologique. Par la suite, la prise en compte des contextes sociaux dans lesquels sont constitués les sujets a conduit différentes théoriciennes [comme Christine Delphy ou Gayle Rubin] à envisager le genre comme le produit d’un système [patriarcal] ou comme le résultat de contraintes organisationnelles ou institutionnelles. A partir des années 1990 il a été revisité et complexifié par la théorie queer qui a ouvert de nouveaux chantiers en questionnant les sexualités. Enfin, de nombreuses auteures ont privilégié (comme Delphy) la dimension relationnelle et asymétrique du genre, en mettant l’accent sur l’antagonisme entre la classe des hommes et celle des femmes et sur les rapports de pouvoir » (p. 53).
Le genre désigne le sexe social
Le concept de genre a eu comme apport de permettre de distinguer ce qu’on appellera faute de mieux des types reproductifs « mâles » et « femelles » (eux-mêmes faisant l’objet de représentations sociales, et donc n’étant pas des simples « donnés biologiques » [Laqueur], de même qu’une capacité d’enfanter n’implique pas forcément un enfantement effectif, celui-ci pouvant être contraint socialement [Tabet]) des « hommes » et des « femmes » comme catégories/classes sociales et du « masculin » et du « féminin » comme catégories de l’idéologie patriarcale. Cependant, « si cette définition permet de dénaturaliser les rapports entre les sexes [sociaux], […] elle laisse cependant dans l’ombre la dimension inégalitaire des rapports entre hommes et femmes, la hiérarchisation des catégories et les rapports de pouvoir » (p. 55). Toutefois, « cette définition introduit une rupture avec les présupposés sociologiques et anthropologies antérieurs qui mettaient l’accent sur les rôles spécifiques de chacun des deux sexes [sociaux] » (p. 55). La sociologie de Durkheim et celle de Parsons étaient ainsi basés sur une naturalisation du patriarcat sous couvert de « complémentarité » fonctionnelle : « Talcott Parsons […] ne questionne ni la hiérarchie, ni la division du travail qu’il considère comme naturelle » (p. 56). De manière générale, là-dessus, on lira Virgine Descouture et alii, Sous les sciences sociales, le genre. Relectures critiques de Max Weber à Bruno Latour, Paris, La Découverte, 2010.
« Le corollaire fondamental de cette vision dynamique [socio-historique] du genre est la possibilité de penser le changement et les variations. Il est désormais possible de faire et de défaire le genre. Dans Doing Gender, […] Candace West et Don Wimmerman conçoivent précisément le genre comme une production sociale » (p. 56). En France, on parle plutôt de « sexe social », avec Nicole Claude-Mathieu, laquelle élabore son concept de manière analogue au concept de genre chez Ann Oakley (p. 57). Si Nicole Claude-Mathieu s’est montrée réticente vis-à-vis du concept de genre, qu’elle accuse de dissoudre l’asymétrie entre classe des hommes et classe des femmes. « Par contre Christine Delphy a intégré dès 1976 ce concept à son arsenal théorique […] : « Le seul fait de disposer d’un terme distinct, ne comportant plus le mot de sexe, constituait un potentiel de développement » [Delphy, citée p. 58]. Elle fait partie du bagage conceptuel anti-différencialiste de Christine Delphy.
Le genre renvoie à un système patriarcal ou à une organisation genrée
« Aux Etats-Unis, c’est Gayle Rubin qui ajoutera une pièce essentielle dans l’élaboration du genre en introduisant, en 1975, la notion de système de sexe/genre : un « système de relations par lequel les femmes deviennent la proie des hommes » [Gayle Rubin, Surveiller et jouir. Anthropologie politique du sexe, Paris, Epel, 2010 » (cité p. 60).
Rubin, loin d’être une féministe postmoderne, « place au cœur du système de sexe/genre la hiérarchie et la contrainte systémique » (p. 61), y compris l’ « hétéronormativité » même si elle n’utilise pas encore ce concept, forgé en 1991 par Michael Warner : « Le genre […] entraîne aussi que le désir sexuel soit orienté vers l’autre sexe. La division sexuelle du travail entre en jeu dans les deux aspects du genre – elle les crée homme et femme, et elle les crée hétérosexuels. Le refoulement de la composante homosexuelle de la sexualité humaine, avec son corollaire, l’oppression des homosexuels [surtout des lesbiennes], est par conséquent un produit du même système qui, par ses règles et ses relations, opprime les femmes » (cité p. 61).
Joan Acker envisage elle, dans « Hierarchies, Jobs, Bodies : A Theory of Gendered Organization » (Gender and Societies, vol. 4, n°2, juin 1990, pp. 139-158), « le genre comme une structure sociale ou plus précisément comme une sous-structure au sein des organisations. Le caractère désincarné des emplois et de la hiérarchie, qui renvoient à des postes et non à des personnes, gouverne les organisations et la perception gender neutral qu’on en a. Le type de travailleur s’approchant le plus du poste correspond cependant implicitement à un salarié masculin entièrement centré sur son emploi. Les femmes qui travaillent, considérées comme ayant des obligations légitimes autres que celles exigées par le poste, ne correspondent pas au poste abstrait » (p. 62).
Le genre trouble les catégories binaires et sape les identités
« Ultérieurement, Judith Butler propose une relecture critique de l’essai de Gayle Rubin […]. Elle insiste avant tout sur le fait que le sexe lui-même [comme catégorie sociale objet de discours et de pratiques] est déjà une production sociale. Cette idée avait aussi été développée par Thomas Laqueur dans son ouvrage La fabrique du sexe. Essai sur le corps et le genre en Occident dans lequel il montre que le sexe biologique a aussi une histoire. […] Il fait l’hypothèse de deux modèles conceptuels, sous-jacents à l’explication anatomique, qui auraient fonctionné dans le temps : le modèle du « sexe unique » et le modèle à « deux sexes ». Le premier qui aurait prévalu de l’Antiquité au XVIIIème siècle pense les hommes et les femmes comme étant de même nature. Les différences figurent sur un continuum [hiérarchique] se distribuant entre deux pôles [inégaux]. Le second qui se met en place à partir du XVIIIème siècle considère désormais les hommes et les femmes comme incommensurablement différents, par essence. Les différences de comportements, d’attitudes, de vertus et de rôle sont désormais expliquées par le biologique, plus précisément par les différences sexuées. Ce que Laqueur formule ainsi : « A la biologie de la hiérarchie cosmique succède la biologie de l’incommensurabilité ancrée dans le corps » » (pp. 63-64). Et difficile de ne pas voir dans ce basculement une nécessité du capitalisme patriarcal de justifier l’inégalité entre des groupes sociaux après avoir postulé l’égalité des sujets abstraits : l’argument d’une différence de nature entre « hommes » et « femmes » permettait d’exclure celles-ci du statut de sujet au nom de la nature et non de la société (ce qui n’était plus idéologiquement concevable après l’abolition de l’Ancien Régime). D’où l’importance jusqu’à aujourd’hui du discours naturaliste-différencialiste pour justifier l’inégalité sociale (en termes de salaire, d’exploitation domestique, etc.)
Pfefferkorn poursuit : « Butler remet en question la catégorisation binaire univoque en deux sexes, voire en deux types de pratiques sexuelles (hétéro et homosexuelles). Elle s’oppose notamment à Monique Wittig pour qui la catégorie femme n’existe qu’en opposition à celle d’homme dans le cadre binaire dominant dans lequel le sexe mâle représente le référent universel. Wittig soutient l’idée que les lesbiennes ne sont pas des femmes. En se soustrayant à l’appropriation des hommes, les lesbiennes seraient libérées du joug patriarcal et contribuerait ainsi à mettre fin au système hétérosexuel et aux classes de sexe [Monique Wittig, La pensée straight, Paris, Editions Amsterdam, 2007]. Butler propose de redéfinir la catégorie de genre en s’écartant de ces schémas binaires, hétéro-homo, et masculin-féminin [et effectivement, l’anthropologie linguistique a montré que de nombreuses sociétés vont au-delà du binarisme dans leur expression linguistique, cf. Catherine Alès, Cécile Barraud, Sexe absolu ou sexe relatif ? De la distinction de sexe dans les sociétés, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2001]. Elle défend l’idée d’une continuité des catégories de sexes et de sexualités en prenant en compte la diversité des pratiques sexuées et sexuelles. Tandis que Wittig cherche à renverser ou à abolir le système de l’hétérosexualité obligatoire, Butler part de l’hypothèse qu’il existe une multitude d’orientations sexuelles entre l’hétérosexualité et l’homosexualité et qu’en conséquence tout discours et toute stratégie reposant sur l’identité sexuelle […] sont vains. C’est dans ce sens qu’elle affirme que le genre [auto-défini] brouille ou « trouble » les catégories binaires. Dans cette perspective, chaque individu a la possibilité de « jouer » un répertoire sexué et sexuel très large et de se libérer grâce à sa performance des assignations de genre. Par contre tout mouvement collectif ne pourra être que fugitif en raison de la variété et de la fluidité des identités. L’intérêt de l’approche proposée réside dans la possibilité de subvertir […] les identités assignées de genre. Hormis un certain hermétisme commun à la plupart des théoriciennes queer, une des limites de son approche réside cependant dans sa tendance à traité l’individu comme une « unité isolée » [Fabienne Malbois, Déplier le genre. Enquête épistémologique sur le féminisme antinaturaliste, Zurich, Seismo, 2011] » (pp. 64-65). En effet, une des limites de Judith Butler est qu’elle considère le genre comme une identité fluide résultant d’une auto-décision individuelle, alors même que dans l’optique de Christine Delphy il s’agit du produit d’un système patriarcal qu’il faut contester frontalement (et collectivement). De plus, le binarisme n’est pas un produit de la pensée dont il suffit de se défaire individuellement, mais une structure sociale dont il faut se défaire collectivement.
Ainsi, conclut Prefferkorn, « la théorie queer est peut-être davantage occupée par des questions de différence culturelle et par l’opposition binaire qui sous-tend l’hétérosexualité normative que par la question de l’oppression. En perdant de vue la structure sociale hiérarchique et les inégalités matérielles qui en découlent, elle risque de perdre de son tranchant critique. Car les identités, les significations et les subjectivités vécues sont largement contraintes par les contextes sociaux et culturels » (p. 67).
Le genre signifie des rapports de pouvoir
« L’historienne Joan Scott [« Genre : une catégorie utile d’analyse historique »] a développé ses analyses en réaction au questionnement limité de l’identité masculine qui le plus souvent apparaissait encore, dans les années 1970, comme un donné, voire comme une norme, alors qu’à l’opposé l’identité féminine en tant que production sociale était au centre des réflexions dès les premiers travaux sur le genre. Scott insiste sur la dimension relationnelle du genre » (p. 68). Le genre peut donc être conçu comme un système hiérarchique, comme chez Ilana Löwy qui nous rend attentif au fait que « les rôles esthétiques inégaux inscrits dans les corps des hommes et des femmes, activés notamment dans les pratiques de séduction, contribuent aussi en retour à assurer la permanence des rapports inégaux entre les deux sexes. « Le maintien de la définition des femmes comme le « beau sexe », loin d’être un des attributs de leur émancipation est indissolublement lié à leur statut subalterne » (citée p. 70).
« L’expression de Joan Scott, le « genre « signifie » les rapports de pouvoir », doit être prise dans un double sens. […] Cette formule permet aussi de souligner le fait que le pouvoir s’exprime dans le langage du genre. Une métaphore féminine sera fréquemment utilisée dans le but d’inférioriser un homme, une femme, voire un groupe social ou une nation. En revanche, pour marquer la supériorité on aura davantage recours à des métaphores viriles. Par exemple « les Allemands en lutte contre Napoléon voyaient les Français comme décadents et efféminés » [George Mosse, L’Image de l’homme : l’invention de la virilité moderne, Paris, Editions Abbeville, 1997]. De même, lors des débats politiques français de la fin du XIXème siècle, les républicains « féminisaient » le peuple afin de pouvoir l’inférioriser alors que les socialistes le « virilisaient » pour le magnifier » (pp. 70-71). Toutefois, dès 1999, Joan Scott estimait que le genre « est un terme qui a perdu de son tranchant critique » [Joan W. Scott, Gender and the Politics of History, New York, Columbia University Press, 1999].
Chapitre 3. Le genre et ses limites
« Le concept de genre et, davantage encore, ses multiples usages ont suscité de nombreuses critiques. […] Tout d’abord, des réserves se sont manifestées en raison de la polarisation sur le discours d’une partie des recherches sur le genre conjuguée aux présupposés culturalistes fréquents aux États-Unis. Cette polarisation a amené nombre de théoriciennes à davantage s’intéresser aux aspects symboliques de l’oppression des femmes et aux représentations plutôt qu’aux aspects matériels. […] Si la distinction entre sexe et genre a été très utile et a contribué à la rupture indispensable avec le naturalisme, cette opposition a aussi eu l’inconvénient de laisser le sexe dans un statut de réel biologique et physiologique incontournable. La distinction sexe/genre risque de laisser en dehors de la réflexion sociohistorique les corps sexués envisagés exclusivement comme substrat naturel ou biologique. Cette distinction peut conduire à une réification de la naturalité du sexe sans interroger sa fabrication sociale et historique. En troisième lieu, la dimension critique du concept peut être occultée par certains usages du mot, en particulier quand le terme apparaît au pluriel. La dimension conflictuelle disparaît même parfois explicitement de certaines analyses y compris quand le mot est utilisé au singulier. […] Malgré ces limites, nous défendrons cependant l’idée que le genre reste un concept utile […] à condition toutefois de conserver sa dimension critique » (pp. 73-74).
Une polarisation fréquente sur le discours
Le « tournant linguistique » et post-moderne a conduit certain-e-s auteur-e-s comme Joan Scott à faire de l’expérience un « événement linguistique » et du sujet un « effet des discours », alors qu’un E. P. Thompson lui faisait de l’expérience « la traduction subjective de la condition matérielle objectivement vécue et partagée par les membres d’un groupe » (p. 74). Pfefferkorn critique ce « tournant linguistique » qui « néglige la mise en relation [des discours] avec les éléments sociohistoriques de contexte, par exemple les conditions économiques et politiques qui ont conduit à reléguer les femmes dans la sphère domestique. […] La déconstruction opérée par le tournant linguistique aboutit ainsi à un véritable « renoncement scientifique » car au bout du compte, c’est la société qui disparaît comme objet d’étude [Simona Cerruti, « Le linguistic turn : un renoncement », J. Boutier et D. Julia (dir.), Passés recomposés. Champs et chantiers de l’Histoire, Paris, Autrement, 1995]. Cette manière de procéder conduit à « subordonner les choses aux mots » alors que dans les sciences sociales « à travers les mots [l’historien ou le sociologue] se propose toujours de saisir les choses » [Pierre Vilar]. Certains auteurs de ce courant vont jusqu’à dénier à la vie matérielle d’être un angle d’attaque pertinent pour comprendre les phénomènes sociaux ou culturels. Du coup […] les aspects matériels de l’oppression des femmes, l’accaparement par le travail, la fatigue ou l’usure des corps due aux maternités répétées, sont évacuées purement et simplement [par une abstraction linguistique du concret et du vécu]. En outre, la polarisation de ces approches post-modernes, qui ne s’avèrent en définitive qu’un avatar du vieil idéalisme, sur les textes comporte un autre risque, celui d’écarter d’emblée l’étude des groupes humains qui ne laissent pas (ou peu) de traces écrites [comme les femmes prolétaires]. Enfin, comment expliquer le changement de contenu des catégories discursives [en termes d’épistémè chez Foucault notamment] dans le temps sans prendre en compte ce qui se passe au niveau des pratiques sociales ? » (pp. 75-76). Pfefferkorn dresse ainsi un tableau utile des apories du post-modernisme.
« En somme, des catégories comme le « masculin » et le « féminin » sont envisagés par Joan Scott et les théoriciennes postmodernes comme construites essentiellement par les structures linguistiques » (p. 76) et non par les structures sociales concrètes comme chez Christine Delphy. D’autre part « les analyses se polarisent […] sur ce que les sociolinguistes appellent la performativité du langage, c’est-à-dire sa capacité à faire advenir du réel, mais sous-estiment le fait qu’il est lui-même expression des expériences humaines. En effet, les discours ne sont pas seulement le moteur, mais aussi le produit des pratiques sociales » (p. 76). Le discours certes participe à la production des structures sociales (il a effectivement des effets performatifs), mais il est loin d’être seul dans cette production et il est lui-même en grande partie un produit des structures sociales elles-mêmes.
La distinction entre sexe et genre en question
« La distinction entre sexe et genre […] a été utile pour remettre en question les certitudes liées à la division considérée comme « naturelle » de l’humanité en deux sexes et à l’attribution de caractéristiques précises et stables à chacun d’eux. Cependant, comme le souligne Nicole-Claude Mathieu : « Laisser le sexe hors champ du genre risque de lui conserver le statut de réel incontournable (et celui de réel immuable en oubliant que la « biologie » et notamment la physiologie de la fécondité – est largement dépendante de l’environnement social) ». La délimitation entre sexe et genre risque en effet de laisser en dehors de la réflexion sociohistorique les corps sexués envisagés exclusivement comme substrat naturel ou biologique […]. Ce noyau dur peut alors être fantasmé comme irréductible à la construction sociale et le risque est grand que la distinction sexe/genre ne conduise à une réification de la naturalité du sexe sans s’interroger sur sa propre construction. C’est ce qu’explique Nelly Oudshoorn : « La distinction sexe/genre n’a pas remis en cause la notion essentialiste du corps naturel […] » » (p. 77). Cependant, la distinction entre « sexe social » et « sexe biologique » n’est guère plus satisfaisante. Quoiqu’il en soit, tandis que Thomas Laqueur a montré qu’on était passé d’une représentation d’un sexe unique (avec des analogies anatomiques entre corps « masculins » et corps « féminins ») à un dualisme radical (avec une différence radicale entre anatomies) – ce qui signifie que même le corps « biologique » n’est guère un invariant dans l’ordre du discours –, Colette Guillaumin est allée encore plus loin en montrant comment « les rapports de domination fabriquent les corps humains comme corps sexués dans son article « Le corps construit ». Elle s’attache à démontrer comment les caractéristiques physiques, par exemple le poids, la taille, mais surtout la motricité, la mobilité corporelle, l’agilité musculaire, la « libre disposition de son corps » sont les résultantes d’une socialisation différentielle des sexes. Ce traitement social des corps s’applique à tous les individus, mais restreint et contraint le corps des femmes, par des manipulations sociales qui ont pour but non seulement de le différencier du corps des hommes (lui aussi manipulé par ailleurs) mais surtout de soumettre les premières » (pp. 78-79). La fertilité et la maternité sont également loin d’être des données exclusivement « naturelles », comme l’a montré Tabet.
D’autre part, « Cynthia Kraus et Ilana Löwy [« Intersexe et transsexualité : les techniques de la médecine et la séparation du sexe biologique du sexe social »] montrent que le sexe biologique se présente comme un continuum, avec certes massivement, aux deux extrêmes, les sexes [reproductifs] mâles et femelles clairement définis. Mais entre les deux, il existe une gamme de situations intermédiaires, les individus « intersexes » » (p. 79), produit du fait qu’au départ l’embryon est un être asexué, et qu’un même organe originel peut se développer en pénis ou en clitoris, ou en quelque chose d’intermédiaire (d’où « inter-sexe »).
« Ces recherches montrent que le sexe social [attribué arbitrairement aux individus intersexes] peut apparaître comme une variable dépendante des structures biologiques, ce qui permet de conforter la thèse qui a été exposée par Thomas Laqueur et par Christine Delphy que « les différenciations de genre précèdent les différenciations de sexe » ou […] « le genre précède le sexe ». Autrement dit le sexe est à son tour appréhendé via le genre, c’est-à-dire dans le cadre de rapports sociaux, dans un contexte social et historique donné. Le sexe est donc également une production sociale et historique [et puisqu’il est un fait social, on doit l’expliquer par un fait social, précepte fondateur de la sociologie durkheimienne]. Il peut être appréhendé comme « l’expression naturalisée du genre » ou « la représentation biologisée du rapport de pouvoir que soutient l’idéologie du genre » [Elsa Dorlin, « Corps contre nature. Stratégies actuelles de la critique féministe »] » (pp. 79-80).
Ainsi, « au cours des années 1980 et 1990, la fixité des perceptions du sexe biologique a été remise en cause. L’idée que les différences biologiques entre les sexes ont aussi une histoire s’est progressivement imposée. La coupure sexe/genre telle qu’elle avait été construite au début des années 1970 a été rediscutée. Judith Butler a, par exemple, développé l’hypothèse que le sexe est le produit d’un processus par lequel les normes régulatrices hétérosexistes le matérialisent. Si certains corps (les corps mâles, blancs et hétérosexuels) sont valorisés par ces normes, d’autres (les corps lesbiens ou noirs) sont rejetés et dévalorisés par ce que non conformes aux normes [Judith Butler, Ces corps qui comptent, Paris, Editions Amsterdam, 2009]. L’ambigüité des individus « intersexes » a par ailleurs conduit à l’affirmation que la bi-catégorisation sexuée des individus n’a de sens que dans le cadre de la reproduction. La question de la matérialité du sexe semble alors plus complexe encore. Quand on aborde cette question par le biais de la biologie, on se rend compte que les définitions matérielles entre les sexes, selon que l’on prenne en compte le sexe hormonal, phénotypique, gonadique, chromosomique ou génique, sont construites en s’appuyant non seulement sur des données matérielles disponibles, mais aussi, explique Cynthia Kraus, sur un « impératif culturel qui exige que tous les individus aient un – et seulement un – sexe déterminé et fixe » [Cynthia Kraus, « La bicatégorisation par sexe à l’ « épreuve de la science ». Le cas des recherches en biologie sur la détermination du sexe chez les Humains » in Delphy Gardey, Ilana Löwy (dir.), L’invention du naturel. Les sciences et la fabrication du féminin et du masculin, Paris, Editions des archives contemporaines, 2000. Cf. également Anne Fausto-Sterling, Corps et tout genre. La dualité des sexes à l’épreuve de la science, Paris, La Découverte, 2012]. Par conséquent, la pratique scientifique ne se contente pas de découvrir la différence sexuelle, mais elle « la fabrique en sexuant le biologique de manière dichotomique et selon les oppositions traditionnelles de genre ». En somme, « le sexe dans la tête » détermine « le sexe en flacon » [Ilana Löwy] » (pp. 80-81).
Quand le genre gomme le conflit, oublie ou dissimule la classe
« Si le concept se diffuse rapidement, c’est aussi parce que […] elle […] permet de se dissocier des courants se revendiquant explicitement du féminisme que certain.e.s universitaires considèrent comme trop militants, voire « non objectifs ». Parler de gender studies plutôt que de feminist studies peut alors paraître plus « neutre », plus « académique », voire plus « scientifique » […]. Joan Scott exprimait déjà cette idée quand elle faisait observer : « Le genre inclut les femmes sans les nommer et paraît ainsi ne pas constituer de menace critique ». En effet le simple fait de nommer les femmes est déjà considéré comme excessif par certains, a fortiori si c’est le féminisme qui est mentionné. Cependant, le principal effet d’un tel usage est surtout l’occultation du rapport social ou du rapport de pouvoir lui-même » (pp. 81-82). Le « genre » bénéficie ainsi d’une certaine reconnaissance institutionnelle du fait de sa charge dépolitisante, et a marginalisé d’autres concepts davantage subversifs comme « rapports sociaux de sexe » ou « patriarcat ».
« Les termes genders ou genres au pluriel désignent […] les deux éléments du rapport, les hommes et les femmes, mais le rapport lui-même disparaît, emportant avec lui la séparation, l’opposition, la hiérarchie, le conflit, le pouvoir et l’antagonisme » (p. 84). L’auteur raconte alors son expérience lorsqu’il a du faire une conférence au Conseil de l’Europe sur ce sujet, et qu’on lui a interdit de mettre « L’égalité hommes-femmes : une lutte indispensable » comme titre puisqu’il y avait une dimension conflictuelle.
Pfefferkorn critique ensuite ladite « sociologie de la famille », qui « a peut-être eu tendance à euphémiser la prise en compte réelle des rapports de sexe […]. Les hommes et les femmes y sont le plus souvent envisagés comme des partenaires équivalents du point de vue de leur « liberté contractuelle » et les rapports sociaux de sexe sont ramenés in fine aux seuls rapports conjugaux » (pp. 85-86). D’autre part, cette sociologie a souvent comme objet d’enquête des familles des classes moyennes ou supérieures, et il serait discutable de généraliser ses conclusions à l’ensemble des classes sociales : Pfefferkorn parle même d’un « ethnocentrisme de classe » (p. 86).
L’auteur termine enfin par dire que nous sommes passés d’une période où il y avait une prise en compte des classes sociales mais une occultation des rapports de sexe (c. 1945-1970) à une période où l’on masque les classes (conséquence d’un recul d’influence des analyses marxiennes) tout en prenant davantage en compte les rapports de sexe (depuis les années 1980), ce qui est problématique puisqu’il faut mettre l’accent sur l’interpénétration des rapports « de classe, de sexe, de génération, de racisation » (p. 88).
Le genre, un concept fédérateur
En France, après avoir parlé de « sexe social » au début des années 1970, on a parlé de « rapports sociaux de sexe » jusqu’aux années 1990, avant qu’il y a une unité (relative) autour du concept de « genre ». Sa légitimité institutionnelle et son utilisation par une grande majorité des universitaires étrangères y a contribué. Pfefferkorn raconte ce basculement (pp. 88-96), en expliquant notamment qu’en 2004 « le département Sciences de l’Homme et de la Société du CNRS avait envisagé en 2004 de retirer le soutien accordé aux rares spécialisées sur le genre » (p. 92), signe du « retard français » universitaire dans ce domaine.
Chapitre 4. Division sexuelle du travail et rapports sociaux de sexe
« Le concept de rapports sociaux de sexe est directement inspiré de rapports sociaux de classe […]. Le concept de rapports sociaux de sexe ne désigne cependant pas un champ de tension autonome et indépendant des rapports de classe. Ce concept vise à articuler explicitement et étroitement rapports de sexe et rapports de classe et, à l’opposé de certaines conceptions iréniques, à souligner la dimension antagonique des rapports entre la classe des hommes et celle des femmes » (pp. 97-98). On se demande néanmoins s’il ne vaudrait pas mieux parler de « rapports sociaux de sexe/genre » (à l’instar de Gayle Rubin), de manière à ce qu’il s’agisse d’un concept moins naturaliste, et sans pour autant oublier l’appui idéologique du patriarcat sur « la nature » et « le biologique ».
La division sexuelle du travail
« Pendant des décennies la sociologie du travail n’interrogeait pas la ségrégation des hommes et des femmes au travail [Silvia Walby (ed.), Gender Segregation at Work, Open University Press, Philadelphy, 1998] » (p. 99). Leur présence massive « sur des postes d’OS, sur des emplois à horaires discontinus, à temps partiel ou dans des emplois impliquant une « relation de service » ou une « relation à autrui » » (p. 99) n’était que rarement problématisée, rappelle Pfefferkorn. Laura Lee Downs dans L’inégalité à la chaîne : la division sexuée du travail dans l’industrie métallurgique en France et en Angleterre [Paris, Albin Michel, 1992] « a décrit comment en France et en Grande-Bretagne les femmes sont entrés dans la métallurgie, une industrie dont elles étaient exclues jusqu’à la Première Guerre mondiale. Elle note la coïncidence entre l’entrée des femmes, le contexte de la guerre et la mise en œuvre des méthodes de production tayloriennes dans cette branche. Ces méthodes permettaient d’employer une nouvelle catégorie d’ouvriers, les ouvriers spécialisés (OS) […], c’est-à-dire situés entre les professionnels et les manœuvres. Elle montre que la définition de cette catégorie n’est pas indépendante du fait que ce sont massivement des femmes qui ont occupé ces postes. L’invention des OS et la déqualification du travail sont directement liées à sa sexuation. Les caractéristiques de ce travail étaient définies selon les stéréotypes féminins d’aptitudes supposées acquises dans les activités domestiques : notamment son caractère répétitif, exercé sans formation et en position subordonnée. Il était par ailleurs exclu que les femmes puissent déclencher des conflits au travail parce que l’univers domestique était appréhendé comme un lieu pacifié. Enfin, les industriels n’hésitaient pas à associer la « nature féminine » aux nouvelles méthodes de production. Ils définissaient ainsi un ordre social fondé sur la différence sexuelle. Le refus des entreprises françaises de se séparer de leur main-d’œuvre féminine, en dépit de la crise des années 1930 et des idéologies natalistes favorables au retour des femmes au foyer, montre combien les femmes occupaient une place particulière dans la politique patronale de l’emploi » (pp. 99-100). Les femmes étaient employées massivement aux postes déqualifiés parce qu’elles étaient sous-payées du fait de la valeur-dissociation patriarcale (les femmes étant du côté de la « nature », elles n’ont pas de compétences professionnelles qu’il faut rémunérer, mais des « qualités naturelles » non-rémunérées) : c’est parce que leur travail est dévalorisé qu’elles étaient massivement embauchées, et ce n’est qu’en revalorisant leur travail (idéologiquement mais aussi concrètement) qu’un mouvement ouvrier digne de ce nom pouvait lutter contre le patronat, et non en s’opposant de manière réactionnaire au travail des femmes. De même, ce n’est qu’en luttant contre la dévalorisation du travail des « immigrés », produit de la valeur-dissociation raciste-géopolitique (on est globalement d’autant moins payé qu’on vient d’un espace périphérique ayant une productivité faible et une puissance limitée), qu’un mouvement ouvrier digne de ce nom peut lutter contre le patronat, et non en s’opposant de manière réactionnaire au travail des migrants.
D’autre part, « Delphine Gardey a étudié la transformation de l’univers des employés de bureau entre 1890 et 1930. Elle a mis en évidence […] les liens étroits entre la féminisation du milieu des employés de bureau et la mise en place de la mécanisation et de la rationalisation, accompagnée d’une diminution des salaires. Inversement, l’exclusion des femmes de certaines professions a aussi été le fait de leurs collègues de travail masculins. Cynthia Cockburn a montré comment les ouvriers typographes anglais, fortement syndiqués, se sont opposés à l’entrée des femmes dans leur métier au début du XIXème siècle. […] En concevant des machines adaptées à des personnes de grande taille et disposant d’une certaine force physique (alors que d’autres choix techniques auraient pu être effectués), ces ouvriers ont pu exploiter une légère différence physique en taille et en force pour écarter les femmes » (pp. 100-101). La domination masculine est ainsi matérialisée technologiquement (« la masculinité de la technologie s’inscrit dans la technologie elle-même » [Judy Wajcman]), et « d’autre part […] les syndicats ne défendent pas seulement les ouvriers et leur qualification face à leurs employeurs, mais aussi les hommes face aux femmes [Sylvia Walby, Patriarchy at Work, Cambridge, Polity Press, 1986] » (p. 102). Au lieu d’intégrer les femmes et de revaloriser leur travail de manière à ce que leur embauche n’entraîne pas de dumping salarial (et donc d’avantage patronal), certains métiers ont adopté une politique réactionnaire qui s’est finalement avéré inefficace.
Pfefferkorn poursuit : « Les préjugés sur la « nature » des femmes ont permis de définir comme « naturelles » les capacités de celles-ci, contrairement à la qualification des hommes qui était définie par la formation reçue ou par l’expérience du travail acquise en atelier. Les catégories élaborées pour justifier les bas salaires dans les industries à main-d’œuvre féminine, comme le textile-habillement, ont été appliquées à l’emploi des femmes dans la métallurgie lorsque celle-ci est devenue une industrie d’emploi mixte [cf. notamment Michelle Perrot (dir.), « Travaux de femmes dans la France du XIXème siècle », Le Mouvement Social, n° 105, octobre-novembre 1978 et « Métiers de femmes », Le Mouvement Social, n° 140, juillet-septembre 1987, ainsi que Yvonne Guichard-Claudic, Danièle Kergoat, Alain Vilbrod (dir.), L’inversion du genre. Quand les métiers masculins se conjuguent au féminin… et réciproquement, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008]. […] Le résultat le plus tangible est la surreprésentation massive des femmes parmi les OS dans presque toutes les branches industrielles. En revanche, dans l’imaginaire collectif, ordinaire et savant, c’est toujours la figure de l’OS masculin, fréquemment immigré, du secteur automobile qui s’est imposée comme modèle idéal-typique du travailleur à la chaîne. De manière analogue, on considère que les femmes sont prédisposées et invitées à s’investir « naturellement » dans le « relationnel », dans les soins ou dans la sollicitude. Par exemple, les métiers d’infirmière, de sage-femme, d’assistance sociale, de secrétaire, d’ « hôtesse d’accueil » ou d’aide à domicile sont massivement occupés par des femmes. Les compétences mises en œuvre auront tendance à ne pas être reconnues comme qualification » (pp. 102-103). Pfefferkorn prend également l’exemple d’un de ses terrains d’enquête [« Des femmes chez les sapeurs-pompiers », Cahiers du Genre, n°40, 2006, pp. 203-230] : chez les sapeurs-pompiers, « l’introduction de la mixité s’accompagne du développement d’une division sexuée des tâches au niveau formel et informel […]. Deux versions du métier tendent à se développer, l’une masculine valorisée, l’autre féminine considérée comme subalterne. Les femmes sont affectées au secourisme, notamment au secours des victimes. Cette division des tâches renvoie à l’ordre des évidences et du naturel. Des qualités féminines supposées « naturelles » seront invoquées tant par les sapeurs-pompiers masculins que féminins : la douceur, la patience, le « feeling », l’écoute, le dialogue plus facile, la confiance qu’elles inspirent, les « qualités d’approche », le sourire. On retrouve ici l’idée que les femmes, à la différence des hommes, ne construiraient pas leurs compétences, mais disposeraient d’un fond naturel de dons et de qualités féminines (dextérité, minutie, patience, empathie, etc.) et de ce fait « les prestations féminines sont considérées comme normales de la part d’une femme » » (pp. 103-104). La valeur-dissociation patriarcale implique ainsi une association entre « femmes » et « nature », laquelle sert de fondement idéologique à une dévalorisation du travail des femmes. Pourtant, « à partir de la clinique et de l’approche psychodynamique du travail, Pascale Molinier a montré que pour les infirmières, la compassion n’est pas une capacité psychologique « naturelle », mais bien une construction collective mobilisée par l’expérience soignante [Pascale Molinier, « Travail et compassion dans le monde hospitalier, Cahiers du genre, n°28, 2000, pp. 49-70] » (p. 104). Grâce à une mobilisation collective et des luttes de longue haleine, « les infirmières (ou les assistantes sociales) ont pu […] construire un rapport de force favorable et obtenir (partiellement) satisfaction » (pp. 104-105) en termes de qualification de leur travail.
Malheureusement, « lorsque les savoirs et savoir-faire requis sont proches de l’univers domestique, ce qui est le cas par exemple des « emplois de proximité d’aide à la vie quotidienne » […] occupés à 99 % par des femmes, un tel travail de mise en forme est plus difficile à mettre en œuvre. Ces emplois […] représentent une « externalisation » du [labeur] domestique gratuit habituellement réalisé par les femmes. Ils replacent celles qui assurent ces tâches professionnellement dans des postures « traditionnelles » de don et naturalisent les compétences nécessaires. […] En raison des bas salaires, des exonérations de cotisations patronales et des diminutions d’impôt qu’elles valent à leurs employeurs, elles accomplissent quasi gratuitement (au regard des bénéficiaires) des travaux qui se substituent à ceux effectués gratuitement par les femmes en tant qu’épouses, filles et (ou) mère [cf. notamment Christelle Avril, Les aides à domicile : un autre monde populaire, Paris, La Dispute, 2014 » (p. 105).
« Là où les qualifications, les compétences, la formation, les savoir-faire, les connaissances des hommes sont reconnus et rémunérés collectivement, [celles] […] des femmes sont naturalisés et individualisés, considérés comme propres à la personne, et non comme acquis ou conquis. Ces « qualités » sont recherchées et mises en valeur par les employeurs parce qu’elles ne bénéficient pas de reconnaissance sociale et sont rémunérées à un niveau inférieur à celles des hommes. Les femmes qui savent coudre et faire la cuisine ou élever des enfants ne sont pas reconnues comme qualifiées. Leurs compétences, pourtant exploitées [dans de nombreux domaines] […] ne sont pas rétribuées. Elles continuent à être perçues comme dépourvues de qualification. Pourtant un des acquis importants des analyses déjà anciennes de Pierre Naville, comme des analyses féministes plus récentes [de Danièle Kergoat], montre que la qualification n’a rien de substantielle. Elle est le résultat de ce qui se joue en permanence dans les rapports sociaux : aussi bien le rapport de classe que le rapport de sexe » (p. 106). Le capitalisme est intrinsèquement patriarcal, puisqu’il est fondé sur une dévalorisation avantageuse (pour lui) du travail des femmes. La déqualification, non-qualification, sous-qualification du travail des femmes est au cœur de la valeur-dissociation patriarcale. Le capitalisme, loin d’être anti-patriarcal comme l’affirme l’extrême-droite (et notamment Francis Cousin), a été, est et restera patriarcal, parce qu’il a intérêt à une reproduction gratuite de la force de travail (qu’il s’agisse de produire des futurs prolétaires au travers d’une « reproduction forcée » [Tabet] ou du labeur domestique [Delphy]) et parce qu’il a intérêt à une sous-qualification (donc à une moindre rémunération) d’une partie des travailleurs, les femmes (et les racisé-e-s). Cette partie-là (centrale, essentielle, constitutive) du patriarcat, il n’y touchera pas de lui-même. Le capitalisme voudrait-il payer pour faire produire aux femmes des futurs prolétaires, ou préfère-t-il bénéficier du natalisme (sous forme de reproduction forcée) inhérent au patriarcat ? Évidemment qu’il préfère une reproduction forcée gratuite (ou alors, si nécessaire, subventionnée aux moyens des allocations familiales). Le capitalisme voudrait-il payer à ses prolétaires l’ensemble des services assurés aujourd’hui gratuitement par leurs compagnes ? Évidemment qu’il préfère un labeur domestique gratuit. Le capitalisme voudrait-il payer davantage ses salariées au nom de l’égalité hommes-femmes ? Évidemment qu’il préfère une sous-qualification et une sous-rémunération du travail des femmes. Capitalisme et patriarcat sont deux systèmes de domination sociale aux logiques distinctes, certes, mais imbriquées, enchevêtrées, s’interpénétrant, et qu’il faut nécessairement combattre de pair : d’où l’intérêt d’une théorisation en termes de valeur-dissociation.
Des rapports sociaux aux rapports sociaux de sexe
Après avoir rappelé que « l’élément social, la réalité dernière à laquelle l’analyse doit s’arrêter, ce n’est […] pas l’individu (ou les individus) pris isolément, mais bien le rapport social (ou mieux les rapports sociaux et leur articulation) », que « l’individu isolé est en effet une abstraction mentale », et avoir cité Marx (« L’essence humaine n’est pas quelque chose d’abstrait qui réside dans l’individu unique. Dans sa réalité effective, c’est l’ensemble des rapports sociaux » [6ème thèse sur Feuerbach, 1845] (p. 109), Pfefferkorn explique : « Les êtres humains sont à la fois les agents et les acteurs de ces rapports. Ils produisent ces rapports comme tels dans et par les actes mêmes par lesquels ils et elles les mettent en œuvre, en accomplissant les injonctions, dispositions, sollicitations et potentialités. Le processus de totalisation est toujours inachevé et contradictoire. Ces rapports sociaux étroitement intriqués ne sont que partiellement cohérents. En outre les rétroactions – ou effets de totalité – de cette unité inachevée et contradictoire sur les rapports et processus partiels qui lui donnent naissance viennent complexifier les processus. Dans une approche dialectique, il s’agit de penser en même temps comment les sujets, hommes et femmes, suivant leur place dans les rapports sociaux sont contraints structurellement et sont façonnés au niveau et dans l’espace où ils se trouvent ; et comment ces mêmes sujets, par leur activité, individuelle et collective, par leurs actions réciproques, peuvent construire des marges de liberté et d’action leur permettant de déplacer ces rapports sociaux » (pp. 109-110). Par exemple, les femmes sont contraintes à la reproduction, mais elles sont parvenues à avoir davantage de maîtrise sur celle-ci en obtenant de haute lutte des droits (contraception, avortement). Pfefferkorn poursuit : « En ce sens mettre l’accent sur le concept de rapport social permet de mieux prendre en compte la dialectique entre déterminisme et possibilité de changements ou entre reproduction (du même) et production (du neuf). Les rapports sociaux de sexe, comme tous les rapports sociaux, se transforment ou se déplacent suivant les rapports de force, et il est possible d’en faire une approche historique, d’en proposer des périodisations et de faire des comparaisons d’une société à une autre. Ce sont cet inachèvement structurel, ces contradictions en permanence renouvelées et la relative incohérence des rapports sociaux qui contribuent aussi aux marges de liberté qui peuvent être saisies par les êtres humains, individuellement et collectivement, pour bousculer ces rapports » (p. 110). Enfin, Pfefferkorn affirme qu’il « conviendrait de développer aussi la question de l’articulation de la situation objective (du groupe considéré […]) et de la subjectivité – et de l’expérience vécue – des membres de ces différents groupes : dialectique […] qu’il faut garder en mémoire notamment dès lors qu’on souhaite échapper à une « compréhension fixiste centrée sur la reproduction incessante des rapports sociaux » » (p. 111). Cela implique « de se placer dans la perspective de la transformation de ces rapports qui tous, à des degrés certes variables, impliquent domination, discrimination, stigmatisation et […] exploitation » (p. 112).
Pfefferkorn mentionne également dans une note de bas de page l’ouvrage de Leonore Davidoff et Catherine Hall Family Fortunes, lequel montre « comment en Angleterre la séparation entre espace public et espace privé a été produite dans la première moitié du XIXème siècle dans la (petite) bourgeoisie, le premier attribué aux hommes, le second aux femmes » (pp. 111-112). On a ici l’archétype de la valeur-dissociation des sphères « masculines » et « féminines », lequel est donc un phénomène récent.
Les rapports sociaux de sexe/genre, de racisation et de classe ne doivent pas être simplement additionnés, comme dans une version vulgaire de « l’intersectionnalité », mais compris comme intriqués, co-extensifs, consubstantiels, comme l’affirme Danièle Kergoat : « Les rapports sociaux sont consubstantiels : ils forment un nœud qui ne peut être séquencé au niveau des pratiques sociales, sinon dans une perspective de sociologie analytique ; et ils sont co-extensifs : en se déployant, les rapports sociaux de classe, de genre, de « race », se reproduisent et se co-produisent mutuellement » [Danièle Kergoat, « Dynamique et consubstantialité des rapports sociaux », cité p. 113]. Ainsi, poursuit Pfefferkorn, « les rapports de sexe, de classe, de racisation interagissent les uns sur les autres et structurent ensemble la totalité du champ social. Ses différentes configurations résultent toujours de constructions historiques particulières. Ces rapports sociaux étroitement imbriqués et entremêlés se construisent, se reproduisent et se transforment sans cesse en rapport les uns avec les autres. Chaque rapport social imprime sa marque sur les autres » (p. 113).
Danièle Kergoat apporte également une distinction entre « rapport social » et « relation sociale », même si cette dernière s’inscrit toujours dans des rapports sociaux d’ensemble : « L’un et l’autre recouvrent deux niveaux d’appréhension de la sexuation du social. La notion de « rapport social » rend compte de la tension antagonique se nouant en particulier autour de l’enjeu de la division du travail et qui aboutit à la création de deux groupes sociaux ayant des intérêts contradictoires. La dénomination « relations sociales » renvoie, elle, aux relations concrètes qu’entretiennent les groupes et les individus […] Travailler en termes de rapports sociaux ne signifie pas faire l’impasse sur les relations sociales, mais signifie les mettre à leur juste place. La société bouge au niveau des rapports sociaux entre les hommes et les femmes, mais sans doute beaucoup plus vite au niveau des relations sociales. Distinguer les deux permet de déconstruire des paradoxes comme : dans la situation des femmes, tout bouge […] et rien ne change (les rapports sociaux de sexe continuent à agir, ce qui explique, entre autres, le maintien des différentiels de salaire, l’assignation inchangée au travail domestique des femmes, les viols et les violences qui perdurent » (cité pp. 114-115).
Mais en ce qui concerne les rapports sociaux de sexe/genre, les deux ont tendance à se confondre, et pour cause, « les femmes vivent avec les hommes […]. Elles ne constituent pas un groupe ségrégué comme d’autres groupes dominés. Certes, les espaces sont par ailleurs fortement sexués. Certes, comme le montre Erving Goffman, l’étiquetage lié au sexe au moment de la naissance […] conduit à une socialisation différentielle, à des pratiques sexuées et […] à une véritable « sous-culture » de sexe [L’arrangement des sexes, Paris, La Dispute, 2002]. Mais […] les femmes ne connaissent pas les fréquents regroupements spatiaux liés à la classe sociale d’appartenance ou la ségrégation liée [au racisme]. […] [Goffman] note aussi que la ségrégation périodique qui rythme le cours de la journée relève de la production institutionnelle des différences de genre : « La ségrégation des toilettes est présentée comme une conséquence naturelle de la différence entre les classes sexuelles, alors qu’en fait c’est plutôt un moyen […] de produire cette différence » (p. 116). C’est cette proximité entre dominants et dominées qui faisait que Christine Delphy parlait, non sans jeu de mots, de familiar exploitation…
Le travail levier de la domination…
« À partir d’enquêtes empiriques, Pascale Molinier a montré que le noyau dur de la production sociale des sexes réside bien dans le travail et non dans la sexualité » (p. 117). Peut-être faudrait-il dire dans le travail et son envers nécessaire, le labeur domestique, puisqu’il faut éviter de confondre le travail comme « forme moderne de l’activité » (Marx, L’idéologie allemande, 1845) productrice de marchandises et le labeur domestique comme production gratuite de services non-marchands (mais pouvant effectivement l’être, d’où une certaine porosité entre travail et labeur domestique, lequel peut devenir « travail domestique » lorsqu’il y a marchandisation de la production de biens et de services dans l’espace domestique – mais sans rémunération pour les femmes). Le concept de travail est trop général, et il faut distinguer travail non-domestique, travail domestique et labeur domestique pour être rigoureux. C’est tout le problème du féminisme matérialiste lorsqu’il parle de manière non-spécifique de « division sexuelle/sexuée du travail ». Admettons néanmoins que ce courant a eu le mérite de « mettre l’accent sur le fait que la production sociale des sexes repose d’abord sur une base matérielle » (p. 118) et sociale, la valeur-dissociation patriarcale (y compris le mode de production domestique), et non sur des discours performatifs. Et « dire cela n’est […] [pas] faire l’impasse sur l’existence de représentations, de croyances ou d’idéologies, mais insister […] sur les fondements matériels [ou structuraux] des rapports sociaux de sexe » (p. 118).
D’ailleurs, « l’une des [nombreuses] limites de la réflexion de Pierre Bourdieu dans La domination masculine réside précisément dans sa minoration des aspects matériels, économiques ou physiques, de la domination masculine par rapport aux aspects symboliques […]. Anne-Marie Devreux a bien mis en évidence cette tendance à la survalorisation symbolique chez Bourdieu et ses conséquences fâcheuses quant à l’oubli du travail et de l’usure physique » (pp. 118-119). Là-dessus, on lira également l’excellent (et drôle) article de Nicole-Claude Mathieu intitulé « Bourdieu ou le pouvoir auto-hypnotique de la domination masculine ».
Le travail levier de l’émancipation ?
Le travail est sans aucun doute (j’insiste) un moyen pour les femmes au sein du capitalisme de gagner en indépendance vis-à-vis des hommes et du patriarcat privé. Les femmes doivent certainement travailler, ou (mieux) satisfaire leurs besoins de manière indépendante des hommes dans le cadre de communes anti-capitaliste/anti-patriarcales, sous peine d’être complètement soumises au patriarcat privé. D’un autre côté, le capitalisme sous-rémunère leur travail, les assigne à des travails difficiles, mal-payés, précaires, et de toute façon les contraint à cette aliénation qu’est intrinsèquement le travail [émission]. Les femmes peuvent conjointement s’émanciper du patriarcat et du travail (du capitalisme), par une insurrection généralisée contre le capitalisme et contre le patriarcat qui détruira les hommes et les femmes [Incendo]. C’est ce que Pfefferkorn n’avance pas, englué dans l’idéologie du travail (et c’est sans doute son seul défaut, avec une absence de critique de l’Etat, mais il est majeur), même s’il critique avec justesse Engels et ses illusions qu’il suffisait aux femmes de travailleur pour qu’elles cessent d’être opprimées (p. 120), alors même qu’elles demeurent soumises au patriarcat et qu’en plus elles deviennent soumises au capital (et donc au travail !).
Conclusion. Articuler les rapports sociaux. Rapports de sexe, de classe, de racisation
« La première originalité du concept de rapports sociaux de sexe par rapport à d’autres conceptualisations (en termes de système de sexe/genre ou de mode de production domestique par exemple) réside dans le fait qu’il est construit explicitement en articulant de manière co-extensive et consubstantielle les rapports de classe, les rapports de sexe et les rapports de racisation [sur lesquels aurait partiellement écrit Marx en fin de vie, affirme Kevin B. Anderson dans Marx at the Margins. On Nationalism, Ethnicity, and Non-Western Societies] » (p. 123), rappelle une nouvelle fois Roland Pfefferkorn. Ainsi, « ces rapports sociaux mêlés de façon inextricables interagissent les uns les autres, chacun imprime sa marque sur les autres et ils structurent ensemble la totalité du champ social » (p. 123). Il faudrait ajouter dans cette totalité du champ social, et Pfefferkorn l’oublie, les rapports sociaux de domination impersonnelle, c’est-à-dire les rapports sociaux entre sujets de l’État et l’État (instance impersonnelle, mais personnifiée par une classe d’encadrement) d’une part, et d’autre part les rapports sociaux entre sujets du Capital comme totalité impersonnelle (le Marché, même planifié) et le Capital (personnifié par une classe du travail, une classe d’encadrement capitaliste et une classe capitaliste) lui-même. Mais cela, Pfefferkorn l’oublie comme d’autres, en raison d’une méconnaissance de la domination impersonnelle au sein des courants critiques. Pfefferkorn rappelle ensuite l’importance d’une approche dialectique, au-delà du déterminisme objectiviste et du subjectivisme faisant du social un simple rapport de volontés individuelles non-déterminées (p. 124).
Articuler les rapports sociaux et comprendre la production des catégories sexuées
« Une sociologie des rapports sociaux ne réifie pas les catégories […]. Au contraire, elle met en évidence leur production sociale et leur reconfiguration incessante » (p. 124). Les foucaldiens ont fait un (en partie) mauvais procès aux théories marxiennes-matérialistes, puisqu’on peut être constructiviste et en même temps avoir une approche « structurale » des phénomènes sociaux : le patriarcat est ainsi une structure construite socio-historiquement (Delphy).
D’autre part, « si chaque catégorie est coproduite par plusieurs rapports sociaux, alors l’hétérogénéité qui la traverse devient intelligible et logique. Par exemple, la classe ouvrière a du mal à agir comme un seul Homme parce que les rapports sociaux de sexe fabriquent, en même temps que la classe, des ouvriers et des ouvrières tandis que les rapports sociaux de races fabriquent, simultanément, des ouvrier-e-s blancs et des ouvrier-e-s non-blancs : la classe ouvrière est ainsi le produit d’au moins trois rapports de pouvoir » (p. 125). Ainsi, la question de la conscience de classe (ou de genre, ou des racisé-e-s) et de l’unité de classe s’en trouve profondément complexifié (pp. 125-126).
Pfefferkorn parle également du black feminism et de l’intersectionnalité : « La juriste Kimberlé Crenshaw distingue l’intersectionnalité structurelle et l’intersectionnalité politique. La première prend en compte le positionnement des femmes de couleur [racisées], à l’intersection de la « race » et du genre, qui rend leur expérience concrète de la violence conjugale [et] du viol […] qualitativement différente de celle des femmes blanches [non-racisées]. La seconde dénonce la marginalisation de la question de la violence contre les femmes de couleur [racisées] induite par les politiques féministes et antiracistes » (pp. 126-127). Cependant, pour Pfefferkorn, « l’une des faiblesses de ces analyses en termes d’intersectionnalité tenait au fait qu’elles ignoraient, et continuent le plus souvent à ignorer, […] les rapports de classe » (p. 127) : et les rapports de domination impersonnelle, pourrait-on ajouter. D’ailleurs, « Danièle Kergoat rappelle que c’est Toni Morrison, première femme noire et seul auteur afro-américain à avoir reçu le prix Nobel de littérature en 1993, et donc peu suspecte d’indifférence aux questions de race et de genre, qui explique que « derrière les tensions raciales aux États-Unis, se cache en réalité un conflit entre classes sociales. Et [que] c’est un tabou beaucoup plus grand que le racisme » (p. 127). Enfin, « ces approches peinent en outre à embrasser la complexité des pratiques sociales » (p. 127), et Danièle Kergoat de signaler que celles-ci « se laissent mal appréhender par des concepts géométriques […] … tant elles sont mouvantes, ambigües et ambivalentes » (cité p. 127). Des concepts « organiques » comme celui de consubstantialité paraissent davantage adéquats pour désigner des systèmes s’interpénétrant : « En effet, une telle conception cartographique de la domination […] tend inévitablement à figer les catégories […] : l’ensemble des rapports sociaux se produisent et se reproduisent en effet mutuellement, ils ne peuvent pas être découpés en tranches » (p. 128).
Construire des marges de liberté et d’action
Pfefferkorn appelle également à une critique « des impasses des approches structuralistes qui peuvent tendre vers le fatalisme. C’est son instance sur la « reproduction » qui explique pourquoi […] Pierre Bourdieu dans La domination masculine tend à inscrire cette domination dans l’éternité. […] Elle relèverait in fine d’une nécessité ontologique, sans qu’on puisse entrevoir la possibilité d’agir à son encontre. […] Or les rapports sociaux se produisent, se reproduisent ET se transforment sans cesser » (p. 128), et peuvent être dépassés de manière émancipatrice. Et Pfefferkorn de citer Pierre Macherey : « En réintroduisant la notion de possible dans le champ de son anthropologie, Lefebvre a été accusé par ses détracteurs staliniens de dérive idéaliste. Le possible, n’est-ce pas ce qui s’oppose au réel, au nécessaire, c’est-à-dire à ce qui donne un objet consistant à une approche scientifiquement responsable ? Prendre en compte le possible, n’est-ce pas s’exposer à sombrer dans l’utopie ? Lefebvre, proche à cet égard d’un Bloch et son « principe espérance », écarte cette objection ; une doctrine de la nécessité, ne concevant aucune place au possible, conduit inévitablement au fatalisme, ce qui revient à fermer au devenir humain toute perspective de libération. Ce qui faut comprendre, c’est donc en quoi le possible, au lieu de se placer en alternative au réel, lui est consubstantiellement uni : c’est le réel qui projette en avant de lui-même ses possibles, sans décider à l’avance lesquels de ceux-ci seront réalisés » » (pp. 128-129). Les femmes sont façonnées par un système d’exploitation, d’oppression et de domination, et en même temps peuvent transformer celui-ci ou même l’abolir.
Et Pfefferkorn de conclure en citant Macherey dans Petits riens. Ornières et dérives du quotidien (Bordeaux, Le Bord de l’Eau, 2009) : « Rien dans la société n’est jamais acquis, ni pour les individus, ni pour la collectivité qui […] révèle une essentielle fragilité, au point de vue de laquelle tout est à craindre, mais aussi tous les espoirs sont permis, étant déjà amorcé le processus de transformation social dont rien ne permet d’affirmer qu’il doit aller dans un sens plutôt que dans un autre » (cité pp. 129-130). Les dominé-e-s peuvent s’émanciper du patriarcat, du capitalisme et du racisme.
A. Paris
Vous aimerez aussi
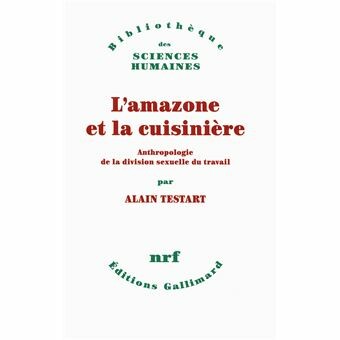
Alain Testart – L’amazone et la cuisinière. Anthropologie de la division sexuelle du travail
26 septembre 2016
Philippe Descola – L’écologie des autres. L’anthropologie et la question de la nature
27 novembre 2016
