Christine Delphy – L’ennemi principal. Penser le genre
Christine Delphy, L’ennemi principal. Penser le genre, Paris, Syllepse, 2001
Préface. Critique de la raison naturelle
La critique du différentialisme et du naturalisme
Christine Delphy explique d’emblée que « dans ce deuxième tome de L’ennemi principal, il s’agit toujours de construire une vision théorique de l’oppression des femmes à partir de prémisses matérialistes, […] non-naturalistes » (p. 7). Elle critique l’idéologie différentialiste, selon laquelle aux racines de la situation sociales des « hommes » et des « femmes » il y aurait des « différences biologiques » fondamentales entre « sexes », en rappelant :
- « Ces différences ont été créées de toutes pièces, précisément pour constituer des groupes. Elles ont ensuite été « découvertes » comme des faits extérieurs à l’action de la société [à l’image du mythe des « deux cerveaux »].
- Ces différences ne sont pas seulement des différences, mais aussi des hiérarchies. La société s’en sert pour justifier son traitement « différentiel » – en réalité inégal, hiérarchique – des groupes […]. L’impossibilité de rendre compte de leur constitution par autre chose que la volonté de hiérarchiser les individus (de les rassembler en groupes d’inégale valeur) est la clé de voûte de ma théorie. » (pp. 8-9).
Le « différentialisme » est pourtant une idéologie soutenant « que tous les hommes doivent ressembler ou tendre à ressembler à un modèle unique, et idem pour les femmes » (p. 11), véritable négation de l’autonomie des individu-e-s. Christine Delphy dénonce « le fait que notre société n’analyse pas de façon juste les phénomènes de racisation et de « sexage » ; elle continue de croire que les différences physiques sont autoporteuses de classifications sociales » (p. 12), et ce qu’il s’agisse du racisme ou du genre. Pour Delphy, l’idéologie différentialiste est une façon « de faire accepter la hiérarchie » (p. 14), un « naturalisme » (p. 28). Pire, avec l’apologie de « la différence », et « quand la personne de sexe « opposé » est présentée comme le seul « autre », les personnes de « même sexe » étant toutes « identiques », le lien hétérosexuel devient un « must » éthique sauf à courir le risque d’être accusé-e d’autisme » (p. 29). Delphy critique une pseudo-justification biologique de cette « différence », basé sur une biologie surannée (ou falsificatrice) et en négligeant complètement les acquis récents de la biologie. Enfin, l’idéologie différentialiste interdit de penser l’égalité.
Christine Delphy critique également une persistance de l’idéologie naturaliste : « Il est souvent dit que les contraceptions et l’avortement ont « mis fin à la fatalité des grossesses non désirées ». Les différentes étapes qui conduisent à une grossesse [« contrainte à l’hétérosexualité », obligation du coït au détriment d’autres pratiques sexuelles] ne sont pas considérées comme les coutumes historiques et contingentes qu’elles sont, mais comme le résultat d’une « fatalité ». Nos pratiques sexuelles patriarcales sont donc vues comme découlant directement de la nature […]. La sexualité est naturalisée » (p. 15). « Une autre preuve de la naturalisation de la sexualité réside dans le fait que, en dépit de l’existence des nombreuses recherches historiques prouvant en contraire, la plupart des gens pensent que la contraception est une découverte scientifique du 20ème siècle » (p. 16). De même pour ce qui est de « l’insémination artificielle » (qu’il faut distinguer de la FIV, fécondation in vitro), une pratique ancienne et très simple. Delphy rappelle également le caractère social de l’adoption et de la filiation.
Christine Delphy s’attaque également au statut de « mineur », faisant des enfants des possessions de leurs parents et des individus (relativement) privés de droits. Et encore une fois, « la dichotomie légale [entre « majeurs » et « mineurs »] est traitée comme un reflet de leurs différences « réelles » (naturelles), qui deviennent ontologiques » (p. 19). Le mouvement féministe a réussi depuis une trentaine d’années à montrer l’importance du phénomène des violences incestueuses : « Qui aurait pu dire il y a vingt ans que sa maison est l’endroit le plus dangereux pour une femme, que c’est dans sa chambre, par un père, un oncle ou un ami de la famille qu’une petite fille risque le plus d’être violée, qui aurait imaginé qu’une petite fille sur six (un petit garçon sur dix) est victime de violences sexuelles ? » (p. 20).
Christine Delphy revient également sur certaines critiques de son premier tome de L’ennemi principal : « Beaucoup ont cru qu’en identifiant la gratuité du travail domestique comme l’une des bases de l’oppression matérielle des femmes, je tombais dans l’économisme. Bien au contraire. Je n’ai pas « étudié l’économie », pour la bonne raison que […] « l’économie » est traditionnellement limitée au marché. […] Cette exploitation ne repose pas sur un mécanisme économique au sens classique, […] mais sur un statut, celui de dépendants du chef de famille. Ce statut à son tour définit en partie et est défini par une structure sociale, la famille ; et celle-ci est le point nodal du domaine que l’on appelle « le privé » » (p. 21). Pour Delphy, « le privé » est une structure socio-historiquement construite, émergeant en même temps que son envers nécessaire, « le public ».
Le genre
Christine Delphy explique ensuite au sujet du genre que « le seul fait de disposer d’un terme distinct [de « sexe »], constituait une potentialité de développement. Ce développement n’était pas inscrit dans le terme lui-même cependant. Il a été, et est encore utilisé d’une façon qui le rattache au sexe, au lieu de l’en éloigner » (p. 24). Pour Delphy, « c’est la hiérarchie [sociale] qui induit la division du travail ; c’est cette division du travail au sens large que l’on appelle « genre ». Il en découle que si le genre [comme système d’exploitation, d’oppression et de domination sociale] n’existait pas, ce qu’on appelle le sexe serait dénué de signification, et ne serait pas perçu comme important : ce ne serait qu’une différence physique parmi d’autres » (p. 26). Elle en conclue « que le genre n’avait pas de substrat physique – plus exactement que ce qui est physique (et dont l’existence n’est pas en cause) n’est pas le substrat du genre. Qu’au contraire c’était le genre qui créait le sexe : autrement dit, qui donnait un sens à des traits physiques qui, pas plus que le reste de l’univers physique, ne possèdent de sens intrinsèque » (p. 27).
Elle définit plus loin plus précisément ce qu’elle entend par « genre » : « « Genre », « oppression des femmes » et « patriarcat » […] [sont] à mes yeux [des] aspects du même phénomène […]. Le « genre » est le système de division hiérarchique de l’humanité en deux moitiés inégales. Dans mon acception, la hiérarchie est un trait de ce système aussi important que la division, et c’est pourquoi il peut être utilisé comme synonyme de patriarcat. […] « Patriarcat » doit être maintenu, comme une façon d’insister sur l’aspect [systémique] […] global et fermé [de l’oppression des femmes], tandis que « genre » dénote un processus […]. Son caractère de processus, jamais fini, lui donne une dimension dynamique, que le concept de patriarcat ne contient pas » (p. 43).
Pour Delphy, l’utilisation post-moderne (c’est-à-dire idéaliste) du concept de « genre » au sein du féminisme étasunien à partir de Judith Butler, ni même sa récupération institutionnelle comme substitution au « sexe », ne justifie son abandon, et de toute façon « l’institution peut neutraliser n’importe quel concept, et jamais un concept ne possède en lui-même le pouvoir de se prémunir contre ce danger » (p. 43). Delphy critique Judith Butler et son idée d’une « multiplication des genres » : « Introduire plus de degrés entre les pôles d’un continuum n’abolit par ce continuum […]. Mais surtout, cette position ne dénaturalise pas le genre. Elle le détache du sexe, certes, et donc de la naturalisation par la biologie. Mais elle considère le genre comme une dimension indispensable et nécessaire présente de la sexualité. Le genre est ainsi re-naturalisé par un trait psychologique présumé universel, une « nature de la sexualité humaine » (p. 45). Pour elle, premièrement, le « genre » n’est pas principalement une assignation discursive comme chez Judith Butler, mais un ensemble de contraintes matérielles différenciées à partir de l’enfance : assignation aux tâches ménagères des petites « filles », liberté de mouvement laissée aux petits « garçons », etc. Deuxièmement, le « genre » ne se défait pas individuellement au travers du travestisme et d’une redéfinition identitaire individuelle : la société patriarcale continue de considérer les individu-e-s transgenres comme soit des « femmes » soit des « hommes », et ces individu-e-s continuent d’être assignés comme tels dans l’espace public. Troisièmement, les individu-e-s transgenres n’échappent guère aux assignations structurelles « matérielles » de leur genre : les assignées « filles » (même transgenre) restent des cibles du viol et des exploitées domestiques en puissance. Il ne s’agit évidemment surtout pas de critiquer les personnes transgenres (contrairement au féminisme transphobe), mais de montrer les limites structurelles à leur émancipation du fait de l’existence bien « matérielle » du patriarcat. Seule l’abolition du patriarcat et donc du système de genre permettra, selon elle, de mettre fin aux assignations de genre (et aux genres eux-mêmes d’ailleurs).
Delphy explique une partie de la confusion autour du concept de sexe : « Le mot désigne, dans notre langue et dans beaucoup d’autres, à la fois sexe « physique » (les organes génitaux), sexe « social » (le classement des organes génitaux en deux et seulement deux catégories reflétées dans le « sexe » de l’Etat civil, bref le sexe de la « différence sexuelle » ou du genre), l’orientation du désir (on parle d’hétéro ou d’homosexualité), et l’activité sexuelle. Les personnes qui utilisent le mot font généralement cette quadruple confusion (de la même façon que la gestation, l’accouchement et l’élevage des enfants [qui, lui, peut être potentiellement pris intégralement en charge par les « hommes », d’où l’aberration de l’actuelle répartition de l’élevage des enfants], qui sont autant d’activités distinctes, sont mélangés exprès dans le terme « maternité » [pour que les femmes aient l’impression que cette charge leur retombe intégralement pour des raisons « naturelles »].
Delphy explique que d’ailleurs « le genre et l’hétérosexualité ont partie liée de façon évidente : sans « sexes », les notions mêmes d’hétérosexualité et d’homosexualité tombent » (p. 45). Dans une société post-patriarcale, chacun-e aura des relations sexuelles avec celleux de son choix (y compris avec personne, avec une seule personne, avec uniquement des « femmes », avec uniquement des « hommes », selon son seul choix).
L’idéologie maternaliste, nouvel avatar du différentialisme
Delphy s’attaque ensuite à un nouvel avatar du différentialisme, l’idéologie maternaliste : « C’est vers le rôle des femmes dans la procréation que s’est déplacé l’argumentaire de la différence. Les féministes, ou les femmes plus généralement, en tirent cependant des conclusions différentes que les hommes. Il s’agit souvent pour elles de revendiquer, au nom de ce rôle, une place éminente dans la parentalité, tandis que pour […] les hommes, il s’agit de continuer à faire reposer tout le poids de l’élevage des enfants sur les femmes. Bien que leurs buts soient légèrement différents – les femmes en souhaitant plus les « avantages » que les inconvénients – il semblerait qu’il existe une communauté d’intérêts entre la société des hommes, qui veut continuer à récolter les bénéfices de l’exploitation des femmes, et la majorité des femmes, qui sont prêtes à accepter cette exploitation contre un rôle mineur mais reconnu – celui des mères – et les satisfactions affectives de la maternité » (p. 33).
L’idéologie materniste est d’ailleurs un moyen d’avancer un nouvel impératif : celui de « la conciliation ». « La conciliation « travail-famille », car c’est de cela qu’il s’agit, s’adresse aux femmes et à elles seules. Ainsi, les femmes sont libres de faire ce qu’elles veulent, une fois qu’elles ont fait ce qu’elles doivent. […] La seule chose qu’elles n’aient pas le droit de faire, c’est de ne pas « concilier » (pp. 33-34). La conciliation peut se faire au travers d’une augmentation de la « productivité » domestique (avec des appareils ménagers), mais elle doit se faire.
Delphy s’attaque même à « la parité », et « en effet, la campagne pour la parité a confirmé les Français-es dans leur conviction que les femmes et les hommes sont deux sous-espèces qui doivent être prises en compte en raison de leurs différences et de leur « complémentarité », et a renforcé leur naturalisme » (p. 37). Et il ne s’agit pas ici, pour Delphy, d’une critique de toute réforme au nom d’une volonté révolutionnaire anti-patriarcale : elle critique cette réforme comme bloquant l’avenir, comme différencialiste. Delphy considère cette idéologie comme une catastrophe et une impasse, parce qu’elle interdit toute égalité et toute abolition du patriarcat. Même une soi-disant égalité entre groupe des « femmes » et groupe « des hommes » serait insatisfaisante, puisqu’elle nierait l’origine sociale de ces groupes, et surtout leur origine hiérarchique (p. 42). Et pour Christine Delphy, une erreur est de considérer implicitement « que les groupes existent sui generis et ne viennent en rapport qu’une fois constitués […]. Ne pas s’interroger sur l’origine de ces groupes [qu’il s’agisse des « sexes », des « races » ou des « nations »], c’est admettre que cette origine est « naturelle » » (p. 28). Pour Delphy, « c’est dans le même moment et par le même mouvement que les groupes sont créés et sont créés dominants ou dominés » (p. 29).
Méthodologie critique
La théorie critique du patriarcat de Delphy est d’une part une théorie établissant l’autonomie analytique d’un système d’exploitation, d’oppression et de domination sociale (notamment vis-à-vis du capitalisme), mais d’autre part c’est également une théorie ouverte à des tentatives de comparaison : « Je considère l’oppression des femmes comme un cas particulier du phénomène général de la domination – pas plus particulier qu’un autre cependant. Le but d’une lutte politique, c’est de permettre aux personnes l’exercice de la singularité. En revanche, le but d’une analyse scientifique de l’oppression […] n’est pas de célébrer – ou de se lamenter sur – la singularité de chaque [phénomène] […] Sinon, chaque phénomène reste enfermé dans sa spécificité phénoménale » (pp. 46-47). Delphy promeut plutôt une démarche « matérialiste » qui soit « valable pour toute oppression : aucune n’est unique dans ses mécanismes, même si chacune est spécifique » (p. 47). C’est peut-être excessif, mais « l’oppression des personnes appelées femmes par une division hiérarchique, le genre, résulte comme toute oppression d’une combinaison particulière certes, mais réalisée avec des éléments (des mécanismes) que l’on peut trouver dans n’importe quel phénomène de domination sociale » (p. 47). Du moins les systèmes d’exploitation, d’oppression et de domination sociale peuvent-ils (et sans doute doivent-ils) faire l’objet de comparaisons, et même d’analyse communes (dans leur genèse historique comme dans leur interpénétration actuelle).
Delphy conclue que son ambition « est de démontrer la nature sociale, donc humaine et donc modifiable de notre organisation sociale. Que ce soit en re-conceptualisant le travail domestique, auparavant vu comme naturel, ou en montrant que la division privé/public […] est une construction sociale » (p. 48). La dénaturalisation des rapports sociaux, des catégories sociales comme « sexe », « race », « classe », etc., permet d’envisager leur dépassement émancipateur.
L’état d’exception : la dérogation du droit commun comme fondement de la sphère privée
Christine Delphy explique l’invention de la dissociation du « privé » et du « public », laquelle dissociation a comme effet de donner l’ensemble des pouvoirs au chef de famille, au patriarche, notamment au sein du Code civil de 1804. « Ce qui explique les violences conjugales, […] c’est que la société a créé une catégorie sociale – le « privé ». Les règles qui s’appliquent partout ailleurs [en théorie], […] [qui] bannissent l’usage de la force […] dans le « privé » […] sont suspendues ou plus exactement, remplacées par d’autres qui déclarent légitime l’usage de la force » (p. 177). La notion de « viol conjugal » n’a ainsi été reconnu qu’en 1992 au sein du droit français, et encore de manière formelle puisqu’il n’est quasi-jamais appliqué in situ : c’est parce qu’il existe un « droit patriarcal » de facto au sein de la sphère privée. Il ne s’agit pas ici d’appeler à une abolition du privé au sens du totalitarisme d’Arendt, mais de défendre plutôt l’autonomie individuelle plutôt que « le privé ». La défense du « privé », en réalité, recouvre souvent une défense du patriarcat.
Minorité légale ou incapacité réelle ? Le statut des enfants
Christine Delphy s’attaque alors au problème des enfants, autres victimes centrales du « privé » et du patriarcat. « La notion du « privé » […] englobe et a pour centre une institution sociale, la famille là où sont les femmes et les enfants […]. Le rapprochement entre les femmes et les enfants […] est ancien : le Code Napoléon, comme le droit romain, faisait un parallèle explicite entre la situation de « la femme » et celle de « l’enfant ». Le Code civil […] stipulait que « sont privées de droits les mineurs, les malades mentaux et les femmes mariées » » (p. 179). Ce statut d’« éternelles mineures » des femmes mariées était justifié par une « nature » inférieure des femmes, intellectuellement notamment. Les enfants sont-ils également « naturellement » des mineurs, des incapables, des privés de droit ? Les enfants doivent-ils être des propriétés privées jusqu’à 18 ans ? Christine Delphy prend un exemple éclairant : « La DASS […] encourage les parents qui abandonnent leurs enfants à « garder leurs droits parentaux » : à refuser de les rendre adoptables. Et ces « droits » créés par la filiation biologique ne sont compensés par aucun devoir. Qu’on en juge : il suffit au(x) parent(s) naturel(s) de renouveler leur opposition à l’adoption une fois par an, autant d’années qu’ils le désirent, sans aucune autre preuve d’intérêt, pour « conserver leurs droits parentaux », et continuer ainsi d’empêcher l’adoption de ces enfants. Une minorité de ces parents décident l’élever leurs enfants, parfois au bout de plusieurs années, mais la majorité ne le fait pas et « leurs » enfants restent des enfants de la DASS/ASE et passent toute leur vie jusqu’à dix-huit ans dans des institutions ou chez des parents nourriciers. Et pour décider ainsi du sort d’êtres humains in suffit de s’être donné la peine de les procréer et de signer un papier une fois par an. […] Les enfants […] sont gravement lésés. On doit en conclure que tous ces coûts humains sont infligés à seule fin d’affirmer deux principes : les enfants sont sous certains aspects assimilables à des propriétés, les droits détenus sur ceux étant semblables à ceux que l’on peut avoir sur des objets ou des animaux, et le droit d’abuser – y compris de rendre malheureux un enfant pour lequel on n’assume aucune responsabilité – fait partie de ces droits ; ces droits extravagants – qui sont contraires aux libertés inscrites dans les déclarations des droits de la personne – sont « ouverts » par la seule procréation » (pp. 180-181). En France, les enfants victimes de violences restent souvent dans leurs familles, et 1-2 enfants meurent chaque jour sous les coups de leurs parents : « Ces deux morts par jour sont le prix de la préférence pour le maintien des liens entre l’enfant et ses géniteurs biologiques » (p. 182).
Ce problème est lié à une naturalisation du mineur, lequel est pourtant un statut social : « En effet, la question du statut sociologique de « l’enfance » n’est jamais posée. Elle est considérée comme une catégorie sociale naturelle », à l’instar de la « féminité ». « Or, si l’on examine le statut des enfants sous l’angle juridique, il correspond de façon frappante à une privation de droits, du même type que celle dont les femmes étaient victimes dans ce pays jusque bien avant dans la seconde moitié du 20ème siècle » (pp. 182-183).
Pour Delphy, « le débat français est en retard sur le débat nord-américain : la position des « libérationnistes » – demandant tout simplement des droits égaux pour les enfants – n’est pas représentée en France ; d’autre part, ce sont les adversaires des droits des enfants qui ont dicté les termes du débat dans ce pays ; ils ont identifié toute perte de pouvoir des parents à une attaque contre « la famille ». Les défenseurs des droits des enfants […] se sont interdits la seule démarche efficace, celle de leurs homologues américains : mettre en cause les notions de base qui justifient le dénie de droit dont les mineurs sont victimes » (p. 184). L’argument justifiant ce statut de mineur, cette privation de droits aux enfants, du fait d’une incapacité intellectuelle, est peut-être valable jusqu’à quelques années de vie (sans qu’il n’autorise aucune action allant contre l’enfant, par exemple des violences physiques ou des insultes), mais il devient intenable à partir au moins de l’adolescence. Cette dissociation juridique radicale entre « mineurs » et « adultes » n’a aucun sens au niveau intellectuel : entre 17 ans et 364 jours et 18 ans, il n’y a aucune modification de l’intellect, et pourtant il y a un basculement fort au niveau des droits (aussi limités soient-ils). Ce statut de mineur est généralement invoqué comme moyen de protection de ceux-ci : mais des violences physiques aux insultes, des privations de droit de porter plainte à une imposition du lieu de résidence, difficile de croire que ce statut a comme but principal une protection des dits-mineurs. Elle consacre en réalité une supériorité juridique, celle des adultes, et une infériorisation juridique, celle des non-adultes, des « minorisés ». « Le statut de l’enfant se poursuit jusqu’à dix-huit ans et s’applique à des populations ayant des niveaux d’autonomie très divers ; il s’applique notamment à toute une population d’adolescents qui sont non seulement en possession de tous leurs moyens, mais en possession de plus de moyens, physiques et intellectuels, que la population adulte qui les « garde » » (p. 185). Des nonagénaires auront ainsi beaucoup plus de droits (de conduire, de voter, etc.) que des adolescents de 16-17 ans. Le problème est notamment au niveau juridique [même si des choses ont évolué positivement depuis l’écriture de cet article] : « Quand même les enfants arrivent à alerter la justice sur les sévices parentaux (ce qui est extrêmement rare puisqu’ils sont dans l’illégalité dès qu’ils sortent de chez eux sans autorisation) leurs droits sur le plan pénal sont extrêmement limités ; ils n’ont par exemple pas le droit à un conseil juridique. Dans les cas d’inceste qui viennent devant les tribunaux français, le violeur a un avocat, sa victime – qui est sa fille ou son fils – n’en a pas. Mieux, la victime était censée être représentée par l’avocat de l’offenseur (jusqu’en 1990, date à laquelle la loi française a pris acte de la Convention internationale des droits de l’enfant) […] L’enfant n’a toujours pas le droit de parler en son nom propre – il ne peut qu’être entendu au mieux, c’est-à-dire traité comme un témoin, même dans des affaires qui le concernent au premier chef » (pp. 185-186).
Quelle est la base du statut de « mineur » ?
« La minorité est créée par l’institution – politique et juridique – de la majorité » (p. 189) : la minorité comme la majorité sont le fruit d’une dissociation sociale-historique. Une partie de l’humanité a été assignée au statut de mineur, l’autre au statut de majeur, avec des inégalités énormes entre ces deux catégories. Y’a-t-il des justifications à ce statut de mineur ? « L’incapacité de gagner sa vie » ? Elle est « partagée par les personnes au chômage » ; « L’incapacité de se donner des soins à soi-même » ? Elle est « partagée par les personnes âgées et malades ». « L’incapacité de « pensée formelle » » ? Elle est « partagée par les personnes déficientes mentales ». L’accompagnement des enfants par des adultes dans leur développement ne justifie pas grand-chose non plus à cette inégalité flagrante ; et celle-ci d’ailleurs est une prophétie auto-réalisatrice, parce qu’elle génère des enfants incapables, non-autonomes, et se justifie ainsi de par son propre résultat. Même chose avec l’incapacité de gagner sa vie : un adolescent de 15 ans n’ayant pas droit de travailler (même si c’est une servitude qu’il faudra nécessairement abolir) voit justifié son statut de mineur … parce qu’il ne gagne pas sa vie.
Christine Delphy observe également (p. 192) un deux poids deux mesures au sujet des assassins d’enfants : certains réclament une peine de mort pour ceux-là, mais en oubliant qu’une majorité des assassins d’enfants sont leurs propres parents, et en réclamant cette peine uniquement pour des « étrangers » ; de même que de nombreuses personnes continuent, comme au temps des colonies, à vouloir condamner de mort un violeur « étranger », tout en faisant l’autruche (ou pire) au sujet des violeurs « proches » (plus nombreux, pourtant).
Delphy note également une absence de liberté de déplacement des mineurs : « La gendarmerie ramène le mineur « en fugue » de force, sur simple demande de ses parents ; après 18 ans il est simplement « en voyage » […] ; le concept même de « fugue », qui est inapplicable aux majeurs sauf s’ils sont des criminels incarcérés, est révélateur du caractère de « prisonnier » du mineur » (p. 193). Un-e adolescent-e de 17 ans victime de parents violents peut ainsi être ramené-e à ceux-ci comme les esclaves fugitifs à leurs maîtres au temps de l’esclavage (sans forcer cette comparaison, bien sûr).
« Enfin, il faut remarquer la « majorité » elle-même est à géométrie variable – que les différentes majorités ne se recoupent pas à l’intérieur d’un même pays […] [et entre pays] […] On peut donc […] faire l’hypothèse que le couple majorité/minorité n’a aucun fondement naturel » (p. 193) : s’il y a effectivement un non-développement complet des capacités intellectuelles du côté des jeunes enfants, cela ne justifie en rien un statut foncièrement inégalitaire. « Ce qui est au principe de la privation de droits des enfants, c’est la majorité, qui crée, dans un système d’opposition classique, la minorité : une situation purement juridique, qui n’a aucun rapport avec une mesure quelconque des aptitudes des personnes » (p. 193).
Christine Delphy conclue en avançant « les hypothèses suivantes : le groupe « les enfants » n’a pas de réalité – d’unité – autre que celle de son statut juridique ; la base de ce statut est une privation de droits (encore plus extrême que celle des femmes mariées avant les réformes du Code civil) ; enfin, […] c’est au nom du « besoin de protection » des enfants qu’ils sont laissés à l’arbitraire d’autres personnes privées et que l’égale protection de la loi, c’est-à-dire la protection de la collectivité, leur est refusée, en particulier la protection contre leurs « représentants légaux », c’est-à-dire leurs parents » (p. 194).
Droits spécifiques ou droits communs
Christine Delphy s’en prend aux féministes défendant un droit spécifique aux femmes en tant que femmes, c’est-à-dire un droit inégalitaire (puisque différent de celui des hommes) : « S’il faut dire et répéter que l’universalisme de la loi est […] un faux universalisme, on peut se demander pourquoi les auteurs qui le dénoncent finissent par renoncer à rechercher les conditions d’un véritable universalisme ; et comment elles peuvent soutenir qu’aucune loi n’est neutre quant au genre (gender-neutral), ce qui va dans le sens d’affirmer que le sujet de droit, même quand le sexe n’est pas mentionné, implicitement de sexe mâle, et dans le même plaider pour des lois spécifiques dans certains domaines seulement, ce qui aboutirait à conforter la masculinité de la loi dans tous les autres domaines ? » (p. 198). Ici on pense (toutes proportions gardées évidemment) aux justifications de l’Apartheid aux Etats-Unis comme « égalité dans la séparation », même s’il s’agirait ici d’une prétendue « égalité dans la différence », laquelle permet de justifier toute inégalité en termes de « différence ».
Le mariage comme dérogation au droit commun
Delphy revient également sur une partie de sa théorie critique du mariage, et l’approfondit. Elle soutient qu’il s’agit d’une dérogation au droit commun, notamment dans sa désincitation de contracter et donc d’être rémunérée pour un travail producteur de marchandises (les agricultrices mariées, par exemple), et avant 1992 de jure et jusqu’à aujourd’hui de facto une exemption du conjoint de l’interdiction (légale, théorique) du viol de sa conjointe.
Le « privé » ou la privation de droit
Même si l’on peut parfaitement critiquer un certain « légalisme » (et donc un étatisme) de Delphy, on peut néanmoins souscrire à cette conclusion :
« Le « privé » n’est pas une catégorie naturelle de rapports que la société se contenterait d’entériner. C’est une catégorie de rapports créée par la société, et qui peut se caractériser du point de vue juridique […] par l’exception au droit commun [aussi liberticide soit-il]. Cette exception réalise, pour les maris et les parents ès qualités : l’acquisition d’un surcroît de droits, et plus précisément l’acquisition de droits sur d’autres personnes ; une exemption des sanctions de la loi, exemption qui leur confère de facto des droits supplémentaires [d’insulter, de frapper, de violer] sur les personnes des épouses et des enfants. Cette même exception réalise, du point de vue des enfants et des épouses ès qualités : la privation de certains droits sur eux-mêmes de jure, la privation de facto des droits qu’ils détiennent juridiquement par l’absence de protections et de sanctions.
Cette exception constitue donc, au niveau juridique, c’est-à-dire le plus légalement du monde [et c’est là qu’il y a une critique du droit chez Delphy, dans cette conception du droit comme faiseur d’exception à son propre règne : cf. Politique de crise], des catégories antagonistes et complémentaires de dominants [eux-mêmes dominés par une structure impersonnelle, l’Etat et son droit, en l’occurrence : et ce qu’oublie de préciser Delphy] et de dominés » (p. 203).
Le patriarcat, le féminisme et leurs intellectuelles
Après un rappel de sa critique du féminisme marxiste, selon lequel l’exploitation domestique des femmes bénéficierait avant tout au capitalisme et non aux hommes [sic], et de son axiome méthodologique au sujet du genre (« Nous pensons […] que c’est l’oppression qui crée le genre ; que la hiérarchie de la division du travail est antérieure, d’un point de vue logique [et non historique], à la division technique du travail et crée celle-ci : crée les rôles sexuels, ce qu’on appelle le genre ; et que le genre à son tour crée le sexe anatomique [comme discours, comme élément d’une idéologie] dans le sens que cette partition hiérarchique de l’humanité se transforme en distinction pertinente pour la pratique sociale une différence anatomique en elle-même dépourvue d’implications sociales ; que la pratique sociale et elle seule transforme en catégorie de pensée un fait physique en lui-même dépourvu de sens comme tous les faits physiques » [p. 212]), Christine Delphy discute d’un obstacle « à l’engagement des femmes dans la lutte féministe » : le fait que « lutter, c’est reconnaître qu’on est opprimée, et reconnaître qu’on est opprimée est douloureux » (p. 214), et que par conséquent beaucoup de femmes répugnent à se reconnaître comme opprimées. Elle explique ainsi « l’ouvriérisme » de nombreuses féministes socialistes : « Je pense à la pratique maintenue pendant longtemps par toute une partie des féministes socialistes françaises : la lutte féministe consistait pour ces femmes à se battre précisément et exclusivement contre l’exploitation des ouvrières, dont elles n’étaient pas ; ceci correspondait évidemment, au premier degré, aux consignes de leur organisation mixte, et reflétait l’ouvriérisme sévissant dans ce type de groupe d’extrême gauche. Mais je crois que ces consignes rencontraient un vœu chez ces femmes : celui de ne pas être confrontées au fait qu’elles étaient aussi des femmes » (p. 214), et donc des opprimées. Et cet ouvriérisme faisait également l’impasse sur l’exploitation domestique des femmes, notamment par leurs compagnons ouvriers. Delphy rappelle ensuite qu’il existe plusieurs rapports de classe (de classe capitaliste, de genre, de racisation), et qu’être dominé dans un n’absous pas pour autant le fait d’être dominant dans un autre.
Delphy s’attaque ensuite au cœur de son propos : les risques pour les féministes de privilégier une théorisation sophistiquée du patriarcat à une prise de conscience révolutionnaire des femmes. « Ne nous trompons pas : l’analyse a ses limites. Elle peut nous dire le comment, à la rigueur le pourquoi de l’oppression ; mais elle ne peut pas plus prétendre à fonder la révolte, qui résulte de la conscience de l’oppression, puisqu’elle-même ne peut procéder qu’à partir du moment où cette réalité est établie : sinon elle n’a pas d’objet. L’oppression est à la fois une réalité et une interprétation de la réalité : une perception de la réalité comme insupportable, c’est-à-dire précisément oppressive […] Non seulement nos analyses ne peuvent se substituer à la révolte, mais nous devons garder présent à l’esprit que bien au contraire ces analyses procèdent elles-mêmes de la révolte et ne peuvent procéder que d’elle » (p. 218). C’est pourquoi elle affirme « le rôle primordial que doit jouer la colère, notre colère, dans notre travail […] L’Université produit une connaissance à la fois nécessaire à la révolution et refusée à ses protagonistes ; elle ne peut produire des connaissances que sur un mode qui les rend inconnaissable aux masses [ce n’est pas vrai pour toute production théorique, en revanche], et du même coup, aliénantes pour elles » (p. 219) Elle s’interroge : « Dans quelles mesures notre féminisme subvertira-t-il l’Université ? Dans quelle mesure au contraire sera-t-il récupéré par elle, pour ses propres fins ? » (p. 219). Elle pointe par exemple que « quand nous critiquons le sexisme des travaux de nos collèges mâles, il est évident que nous le faisons dans l’intention que cela serve à la lutte féministe », mais « nous aurons, dans le temps, établi une complicité bien plus fondamentale [avec eux], une complicité fondée sur l’exclusion de tous les non-intellectuels, groupe où se trouve aussi la majorité des féministes » (pp. 219-220).
Delphy n’a pas de solution miracle, mais indique quelques écueils qu’il faudrait éviter : « Si la critique du sexisme des disciplines scientifiques est importante, elle n’est importante que dans la mesure où les discours de ces disciplines sont la version savante de l’idéologie patriarcale vulgaire. C’est celle-là qui nous importe, que nos critiques doivent atteindre. Ce qui doit nous intéressant, ce ne sont pas les arguments de nos collègues masculins pour eux-mêmes, mais le fait qu’ils donnent une caution « scientifique » à l’idéologie dominante ; c’est parce que la mystification de la science redouble la mystification de l’idéologie que ces discours savants doivent être analyses. Mais la ligne est fine : si les autres femmes ne comprennent pas nos critiques, si elles ne peuvent pas les utiliser, si cela ne leur apporte rien, alors nous nous serons en fait adressées à nos collèges mâles, nous aurons réaffirmé notre solidarité avec l’institution mystifiante en sus que d’avoir été inutiles au combat féministe ; nous aurons donc été doublement traîtres à la classe des femmes. Utiliser l’Université pour le combat féministe débouche nécessairement sur la dénonciation de l’Université, sur la dénonciation de la double mystification du discours savant ; la première étant qu’il ne fait que paraphraser, redoubler l’idéologie dominante ; la deuxième étant qu’il lui donne la légitimité du mythe de la Science, Pure, Neutre, Universelle. La seule entrée des féministes, ou des préoccupations féministes, dans l’Université, ne garantit pas que les ressources de l’Université vont être récupérées par nous, c’est-à-dire utilisées contre le rôle de la classe intellectuelle et pour la révolution » (p. 220). Delphy poursuit en allant jusqu’à critiquer l’étude universitaire du travail ménager : « La seule raison valable d’étudier le travail ménager, puisque nous sommes dans la position privilégiée de pouvoir étudier, est que des millions de femmes, chaque jour et chaque minute, souffrent dans leur chair d’être « rien que des ménagères ». En faire un problème académique, c’est nier, pire, insulter cette souffrance. C’est prendre parti pour la classe intellectuelle contre les opprimées, contre les ménagères, c’est les réifier une deuxième fois. La seule façon de ne pas opérer ce renversement involontaire d’alliances, c’est d’avoir tout le temps présente à l’esprit cette souffrance et de savoir qu’elle est la seule raison valable d’étudier le travail ménager ; de même que la seule valeur d’une analyse réside dans la contribution qu’elle peut apporter aux moyens de mettre fin à cette situation. Et la seule façon de ne pas oublier la souffrance des autres c’est de commencer par reconnaître la sienne » (p. 221).
Certes, « ce n’est pas facile, et ne va pas de soi », mais Delphy conclue sur son absolue nécessité : « L’accès de questions féministes au rang de questions académiques apparaît souvent comme un progrès pour la lutte féministe elle-même, non seulement parce que l’Université leur donne ainsi un brevet de « sérieux » ; mais aussi parce que le cadre universitaire assure, mieux, exige une dépassionalisation des problèmes ; et qu’en retour cette dépassionalisation nous semble garantir une approche plus rigoureuse parce que plus sereine. Ceci est un piège […] de l’idéologie dominante qui a créé un mythe de la science. Mais si nous y succombons si facilement, c’est que cette dépassionalisation nous intéresse aussi plus directement, affectivement. Avant même d’y chercher les intérêts de la science, nous y trouvons une protection contre notre propre colère. Car il n’est pas facile, contrairement à ce que l’on croit, d’être et surtout de rester en colère. C’est un état douloureux […]. Mais pour nous, intellectuelles, l’oublier, ne fût-ce qu’un instant, c’est abandonner le fil qui nous relie à notre classe de femmes […]. Notre seule arme contre la trahison potentielle inscrite dans notre statut d’intellectuelle, c’est précisément notre colère. Car la seule garantie que nous ne serons pas, en tant qu’intellectuelles, traîtres à notre classe, c’est la conscience d’être, nous aussi, des femmes, d’être celles-là même dont nous analysons l’oppression. Et la seule assise de cette révolte, c’est notre colère » (pp. 221-222).
Penser le genre : problèmes et résistances
Christine Delphy approfondit dans cet article ce qu’elle affirmait déjà dans son introduction, c’est-à-dire une critique du présupposé méthodologique d’une « antécédence du sexe sur le genre » (p. 221). Pour elle, « le point commun aux impasses intellectuelles et aux contradictions politiques est l’incapacité ou le refus de penser de façon rigoureuse le rapport entre division [en groupes] et hiérarchie » (p. 221). Après une critique de Margaret Mead (qui, selon Delphy, reste naturaliste), Christine Delphy rappelle que le principal problème de la définition du genre d’Ann Oakley est qu’il manque la dimension hiérarchique. Le genre présente l’avantage, pour Delphy, d’insister sur une dimension arbitraire des rapports patriarcaux, ou du moins variable, et donc susceptible de changement ; lorsqu’il est utilisé au singulier, cela « permet de déplacer l’accent des parties divisées vers le principe de partition lui-même » (p. 225), et donc potentiellement de penser la hiérarchie. Le problème, pour Delphy, est qu’« on continue de penser le genre en termes de sexe : de l’envisager comme une dichotomie sociale déterminée par une dichotomie naturelle. En somme le genre serait un contenu, et le sexe un contenant. Le contenu peut varier, et certaines estiment qu’il doit varier ; mais le contenant est conçu comme invariable ; il est la nature […] ; et de cette nature semble faire partie une vocation à recevoir un contenu social » (p. 225). Ainsi, certes Mead montre une assignation variable entre différentes sociétés océaniennes des traits de caractères (colère, force, douceur, etc.) aux hommes et aux femmes, mais elle ne met pas en cause ces deux catégories (« hommes » et « femmes ») comme dichotomie socialement pertinente.
Pour Delphy, d’un point de vue sociologique, et dans l’optique d’une explication du patriarcat et des inégalités de genre, « le sexe est simplement un marqueur de la division sociale ; il sert à reconnaître et identifier les dominants des dominés » (p. 230). Et, du coup, la conséquence logique de l’abolition du patriarcat et de la hiérarchie de genre sera « la disparition du genre » (p. 231). Et c’est ce qu’un résidu différentialiste d’une large part du féminisme refusera : « Tout se passe comme si on voulait abolir la hiérarchie et éventuellement les rôles mais pas la distinction ; abolir les contenus mais pas les contenants. Tout le monde veut garder quelque chose du genre […] mais au moins la classification ; peu semblent prêtes à se contenter de la simple différence sexuelle, toute nue, non signalée par une reconnaissance et un marquage sociaux » (p. 233). Pour Delphy, cette position est simplement celle d’un primat méthodologique du social.
Pour Delphy, la suppression de la domination patriarcale entraîne nécessairement celle des dominants et des dominés, et donc des « hommes » et des « femmes » comme catégories sociales (p. 236). Elle dit même que « peut-être ne pourrons-nous vraiment penser le genre que le jour où nous pourrons imaginer le non-genre » (p. 238).
Genre et classe en Europe
Christine Delphy commence par un rappel : « Le marché du travail n’est pas purement capitaliste : il est aussi patriarcal [Kergoat 1982] » (p. 269). Ainsi, depuis l’industrialisation, les femmes ont été « soit poussées hors du travail ou de certains travaux par les hommes – tactique de l’exclusion – soit maintenues dans les emplois inférieurs et mal payés – tactique de la ségrégation […]. Cette tactique des hommes organisés, dans des syndicats locaux ou nationaux, […] est moins visible aujourd’hui, mais n’a pourtant pas disparu […]. Les syndicats ne font rien pour éliminer, ni même pour réduire la segmentation sexuelle de l’emploi, qui a pour résultats que les femmes qui sont sur le marché du travail sont, dans l’ensemble, payées 30 % de moins que les hommes, dans tous les pays européens » (p. 271). Et « cette différence s’explique par la discrimination pure et simple « à travail égal » – mais il y a de moins en moins de travaux « égaux », c’est-à-dire appelés de la même façon qu’ils soient occupés par une femme ou par un homme ; par la ségrégation verticale : les femmes dans chaque profession ou catégorie socioprofessionnelle occupent les positions les plus basses ; par la ségrégation horizontale : l’existence de branches où il n’y a que des femmes, et où sont la majorité des femmes, et qui sont globalement sous-payées » (p. 271). Et ce, sans compter un chômage supérieur du côté des femmes, et un temps partiel imposé (soit par le capital, soit par le patriarcat). A cela s’ajoute ce que Christine Delphy a longtemps développé ailleurs, à savoir le travail domestique producteur de marchandises, produit du travail « bel et bien porté et vendu sur le marché, mais pas par elle. Il est vendu comme le travail du mari, et elles n’ont aucun doit sur le revenu engendré par leur travail. Aucun salaire, ni aucun droit à une retraite. Leurs droits à la sécurité sociale, qu’il s’agisse d’assurance-maladie ou de retraite, sont dits « dérivés » » (p. 276).
Le travail domestique producteur de marchandise cependant recul, au profit d’un mixte entre travail salarié inégalement rémunéré et travail ménager, la fameuse « double journée ». « Dans ce mode mixte, les femmes travaillent au dehors et gagnent donc une mesure d’indépendance [vis-à-vis du patriarcat], mais, quand elles sont mariées ou en concubinage, au prix d’une charge de [labeur] considérable, car elles ne sont pas pour autant exemptées de leurs « responsabilités » domestiques. Elles en font seulement un peu moins que les femmes au foyer, celles qui sont dans le mode de production domestique pur. Ainsi, l’indépendance qu’un homme a au prix de 8 heures de travail par jour, doivent-elles l’acheter au prix de 11 à 12 heures de travail [tout confondu] par jour. Et encore ne s’agit-il pas exactement de la même indépendance : elles ne sont pas payées autant, et elles dépendent plus du revenu monétaire de leur mari qu’il ne dépend du leur » (p. 276). Et le divorce les place dans une situation financière bien plus précaire que leur ex-mari.
« Les femmes au foyer […] travaillent [tout confondu] globalement moins que les femmes « actives » (seulement 50 heures par semaine), mais au prix d’une dépendance totale. Ainsi l’exploitation patriarcale est constituée d’un mélange de surexploitation « capitaliste » […] et d’exploitation domestique » (p. 277).
Christine Delphy s’attache ensuite à une description de « La dégradation de la situation des femmes sur le marché du travail » : « Les quinze dernières années [l’article date de 1996] ont vu deux mouvements allant en sens contraire : d’une part, la poussée des femmes sur le marché du travail ; d’autre part l’accroissement de la segmentation sexuée […] Ce sont les femmes qui font les frais de la crise. Et […] cette dégradation de leur situation relative sur le marché du travail se caractérise par deux traits : elles sont deux fois plus chômeuses que les hommes, et elles occupent la quasi-totalité des emplois à temps partiel. Cette forme de régulation du marché du travail a été créée récemment, en France, et elle a été créée pour les femmes. Maintenant, le quart de la main-d’œuvre féminine est à temps partiel en France, la moitié en Angleterre […]. La flexibilité de l’emploi a été trouvée par un accord tacite entre le patronat et les travailleurs masculins : au lieu de réduire le temps travaillé pour tout le monde […], on met les femmes à temps partiel » (p. 278). Cette « stratégie » a cependant ses limites : les secteurs exclusivement masculins (souvent industriels), dont sont exclues les femmes, sont plus durement touchés par la crise que les secteurs assignés aux femmes (souvent « de service »). Pour autant, les travailleurs masculins s’en sortent mieux : « Les femmes qui « rapportent » déjà moins d’argent à la maison, même en travaillant à temps plein, ce qui est utilisé par les hommes pour résister aux demandes de partage du travail ménager, n’ont plus, quand elles sont à temps partiel, aucun pouvoir de négociation ; non seulement leur apport financier au ménage est encore réduit, mais leur « temps libre » (sic) est augmenté. Et en effet, avec le travail à temps partiel, les contributions déjà maigres des hommes au travail ménager cessent complètement » (p. 279). Quoiqu’il en soit, « dans tous les cas de figure les femmes accomplissent le travail ménager. Pour diminuer leur charge globale de travail, elles doivent renoncer au travail rémunéré et donc à l’indépendance [N.B. : derrière « indépendance », il faut entendre « indépendance vis-à-vis des hommes », et non vis-à-vis du capitalisme] ; pour gagner quelque indépendance tout en gardant un niveau de vie correct, elles doivent assumer une double journée » (p. 279).
Christine Delphy passe ensuite en revue « L’action des gouvernements récents en France », en l’occurrence des gouvernements sous Mitterrand. Elle note un fort développement du temps partiel, lequel était quasi-absent en France, une politique familialiste incitant les femmes à se retirer du marché du travail ou à ne pas y entrer (première allocation parentale d’éducation en 1985), un impératif de « conciliation » (entre travail salarié et travail ménager) réservé aux seules femmes, revalorisation symbolique du travail ménager pour les seules femmes, rattachement des droits des femmes au ministère de la famille en 1995 (les femmes étant donc conçues comme des épouses soumises, des « poules pondeuses » et des éleveuses des enfants de la Nation), maintien d’une politique familialiste d’ « aides familiales » assignant les femmes à leur rôle de « poule pondeuse » (il ne s’agit pas d’une critique du fait d’avoir des enfants, mais de l’idéologie et des pressions sociales poussant au fait d’avoir des enfants), etc. Christine Delphy rappelle que la femme au foyer est une invention récente (du 19ème siècle), et qu’il n’y a qu’au sein des classes petites-bourgeoises et bourgeoises que ce sinistre « idéal » patriarcal a été réalisé : pour autant, les politiques d’« aides familiales » comme l’idéologie familialiste promeuvent un tel « idéal féminin ». Et cette assignation de la femme au foyer a également été promue dans une partie du mouvement ouvrier après Proudhon. Delphy rappelle qu’au 19ème siècle se développe également l’idéologie de « l’éducation » des enfants comme spécialité féminine : « Tous ces développements culminent dans la figure de la mère oblative, comprenant ses enfants à mi-mot et se dévouant pour eux jour et nuit. Cette image pieuse, née dans la tête de Jean-Jacques Rousseau et des autres philosophes […], n’a plus rien à voir avec la paysanne […] qui même si elle savait quelque chose de la « psychologie enfantine », n’avait pas une minute pour s’en occuper ; ni avec la réalité de l’aristocrate qui confiait ses enfants à des nourrices et à des précepteurs. Cependant, à force d’être invoquée, cette image s’est faite chair : la « mère » est advenue, spécialiste du foyer, et au cours du 19ème siècle, une nouvelle division de genre est née, ou plutôt un nouveau contenu a été donné à la division de l’humanité en deux genres […]. Cette division du travail, justifiée dans la théorie des « sphères séparées », en donnant à la femme-mère un « domaine » propre, est plus valorisante que celle de la femme-à-tout-faire, de « l’aide » qu’elle est et reste chez les « travailleurs indépendants », ce qui explique que le modèle de la femme au foyer soit devenu si attrayant pour ces femmes bêtes de somme, en particulier les agricultrices. C’est sur cette figure mythique que beaucoup de revendications féministes du début du siècle vont s’appuyer, c’est sur cette figure que le différentialisme moderne se construit : la femme est d’abord une mère, elle a des dons spéciaux, une mission spéciale, qu’il faut reconnaître et rétribuer » (pp. 283-284). Mais c’est là naturaliser une assignation historique des femmes au foyer, et refuser d’envisager son dépassement.
Christine Delphy aborde alors un sujet qu’elle traite assez rarement, celui de l’oppression sexuelle des femmes : « La répression ou la restriction du droit à l’avortement n’est que l’un des aspects du continuum de la part que l’on peut […] appeler « sexuelle » de l’oppression des femmes. Mais cette oppression sexuelle est bien plus large que le non-accès à la maîtrise de la reproduction. Avant d’en arriver là – c’est-à-dire à une conception involontaire – il y a la contrainte à l’hétérosexualité, et tout ce qu’elle comprend, en particulier une définition restrictive et mutilante de la sexualité : les rapports sexuels forcés, dont le viol « public » n’est que la partie la plus visible […] Il apparaît que plus d’un tiers de femmes ont été soumises à un inceste ou à un rapport sexuel forcé au cours de leur vie, que la moitié des femmes risquent d’être violées au moins une fois au cours de leur vie ; les violences exercées par les maris et les concubins, et souvent liées au viol conjugal, commencent seulement d’être révélées dans leur banalité ; de même que les violences sur les enfants […], violences beaucoup plus souvent commises par des parents ou des proches que par des étrangers […]. C’est la famille qui est le lieu le plus dangereux pour les enfants des deux sexes » (pp. 284-285). Elle parle également du harcèlement sexuel, aujourd’hui rendu visible avec Paye ta shnek. Christine Delphy s’attaque ensuite aux anti-avortement, pour lesquels « la vie et la santé des femmes sont des « pertes collatérales […]. Leur premier objectif […] est de démoraliser les femmes, de leur contester la qualité de personnes humaines à part entière. […] Comme le viol, l’avortement clandestin entraîne des souffrances physiques […]. Dans l’analyse que font les féministes aujourd’hui, voilà les buts poursuivis par le combat actuel contre l’avortement : non pas un but nataliste, car l’interdiction de l’avortement ne fait pas remonter les taux de naissance [en Russie, par exemple] ; non pas un but « humanitaire » car les anti-avortement n’ont que faire de la vie humaine. Leur invention du fœtus comme « personne » est purement tactique » (pp. 285-286). Les anti-avortement, en réalité, sont des défenseurs de l’ordre patriarcal, nataliste, maternaliste, et leur sacralisation du fœtus révèle son hypocrisie lorsqu’on connaît les autres positionnements des anti-avortement : acritiques vis-à-vis de la (néo)colonisation et ses morts, opposés aux luttes des femmes combattant des pratiques meurtrières, opposés aux luttes sociales combattant des conditions de travail faisant des milliers de morts annuellement, favorable aux forces militaro-policières et leurs bavures, etc.
Christine Delphy parle ensuite de l’interprétation de Dworkin dans Les femmes de droite pour expliquer l’anti-avortement de certaines femmes : « Pour des femmes convaincues qu’il est inutile et même dangereux de lutter dans un monde d’hommes, ce n’est que dans la spécificité et plus précisément dans le rôle de mères qu’elles peuvent trouver le salut et une place, inférieure certes, mais stable en ce sens qu’elle sera uniquement la leur, dans la société. Refusant ce qu’elles voient comme une concurrence où elles ont perdu d’avance avec les hommes, elles ne voient de solution que dans la spécialisation : se faire une niche où elles sont irremplaçables. Cette niche, c’est la maternité […]. Ainsi toute attaque, tout refus de la part de certaines femmes « d’assumer » la procréation est-il vu par ce courant de l’opinion féminine comme une trahison mettant en péril leur place dans la société. Cette conception de la répartition des rôles et des pouvoirs entre les sexes, bien que profondément inégalitaire, ne sépare pas cependant clairement les féministes des non-féministes – sans même parler du fait que certaines femmes d’extrême droite s’intitulent féministes. Les féministes maternalistes sont contre la hiérarchie des rôles ; et c’est ce qui les distingue des femmes et des hommes réactionnaires. Mais elles recherchent une égalité entre les groupes, pas entre les individus : « l’égalité dans la différence ». Elles espèrent revaloriser la « part » des femmes, et même la mettre à parité avec la part des hommes. C’est par la spécialisation des femmes, la mise en exergue et l’accentuation de spécificités physiques, psychologiques, morales et sociales, de l’un et l’autre genre – qu’elles identifient au sexe –, qu’elles espèrent rehausser le statut des femmes. La continuité de ces positions avec les théories différentialistes qui font florès aujourd’hui ne peut être sous-estimée. Bien que les différentialistes contemporaines aujourd’hui ne s’opposent pas à l’avortement, il faut rappeler que l’exaltation de la fonction maternelle de « la » femme a conduit les féministes en France en 1920 à approuver, au moins tacitement, le passage de la loi scélérate de 1920 criminalisant l’avortement et qu’en Allemagne aujourd’hui, une partie non négligeable des jeunes féministes sont opposées à l’avortement » (pp. 286-287).
Christine Delphy s’attaque à une autre tendance, celui de l’augmentation des « aides familiales » et ses effets conservateurs : « A chaque étape historique tout au long de la seconde moitié du vingtième siècle, on assiste à l’extension de prestation de plus en plus généreuses aux femmes au foyer. A celles ou à ceux qui bénéficient de leur travail ? […] On peut l’interpréter de deux façons contraires : soit comme une conquête des femmes qui travaillent pour les autres ; pour maintenir certaines femmes au foyer, la société serait obligée de réduire, ou à tout le moins de maintenir constant l’écart entre les femmes qui travaillent et les femmes au foyer et ainsi les femmes qui travaillent tireraient les autres vers le haut, pour le bien de toutes. Mais on peut à l’inverse considérer que mitiger les conséquences de la dépendance aboutit à rendre celle-ci plus tolérable, donc à désinciter les femmes de se procurer les bases de l’indépendance » (p. 289). Chirac proposait même en 1995 de faire un « salaire maternel » ou « allocation de libre choix », pour favoriser un retour des femmes au foyer. « Tant que l’exemption des hommes du travail domestique n’est pas mise en cause » (p. 290), il n’y aura pas d’égalité à ce niveau, mais simplement une double journée.
L’invention du « French feminism » : une démarche essentielle
Christine Delphy fait une critique du courant différencialiste qu’on a abusivement appelé « French feminism » : celui de Luce Iriguaray, d’Hélène Cixous et de Julia Kristeva. On conseillera vivement aux personnes ayant eu des cours d’études de genre aux Etats-Unis de lire cette partie.
Conclusion
Au final, Christine Delphy nous offre ici une théorie matérialiste du genre, avec comme perspective émancipatrice une abolition du patriarcat et une abolition des identités normées de genre, c’est-à-dire une égalité et une liberté réelles. Cet horizon doit cependant nécessairement se doubler, sous peine d’une émancipation incomplète, d’un horizon d’émancipation vis-à-vis de l’ensemble des formes d’oppression, d’exploitation et de domination sociales, y compris celle du capitalisme, du travail et de l’Etat.
Armand Paris.

Bhagat Singh - Pourquoi je suis athée
La sécurité, catégorie fondamentale du capital
Vous aimerez aussi
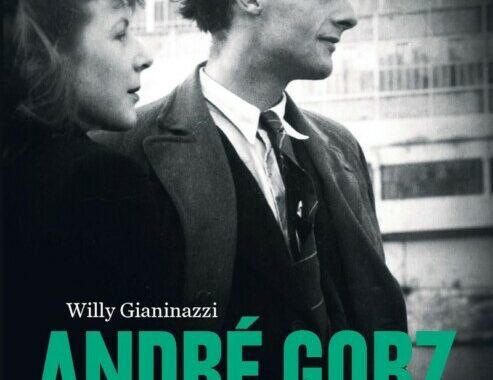
Willy Gianinazzi – André Gorz, une vie
29 janvier 2017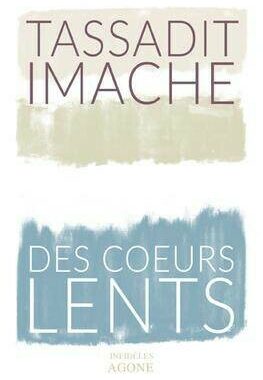
Tassadit Imache – Des cœurs lents
4 septembre 2018
Un commentaire
Ping :