
Paola Tabet – La grande arnaque. Sexualité des femmes et échange économico-sexuel
Paola Tabet, La grande arnaque. Sexualité des femmes et échange économico-sexuel, Paris, L’Harmattan, 2004
Dans cet ouvrage fondamental, Tabet parvient d’une part à une critique implacable des discours moralistes-conservateurs visant à une stigmatisation des « prostituées » et des « putains », en montrant qu’ils visent à un maintien de l’ordre patriarcal, et d’autre part à une analyse complexe des différentes formes d’échange économico-sexuels en montrant qu’in fine ceux-ci constituent une « grande arnaque » au bénéfice des hommes comme classe dominante, même si certains types d’échanges constituent clairement un gain d’autonomie économico-sexuel des femmes (contrairement à ce qu’affirme un certain discours misérabiliste-abolitionniste[1]). Basé sur des entretiens avec des travailleuses du sexe du monde entier et une immense bibliographie, cet ouvrage publié au sein de l’excellente collection « Bibliothèque du féminisme » des éditions L’Harmattan (comme La construction sociale de l’inégalité des sexes, son jumeau, et Le prisme de la prostitution de Gail Pheterson, une référence majeure de Tabet) constitue une somme et un éclairage magistral sur ce sujet polémique. Par ailleurs, même s’il s’agit d’un ouvrage composé d’articles écrits à des moments différents[2], Paola Tabet a réussi à en faire un véritable livre avec une progression quasi-linéaire au fil des chapitres, grâce à une fusion et une réécriture judicieuses. On écoutera également sur ce sujet Lilian Mathieu, et on lira quoiqu’on en pense Morgane Merteuil. Enfin, les recherches de Paola Tabet ont été prolongées dans L’échange économico-sexuel (EHESS, 2014).

- Problèmes de définition, question de pouvoir
Paola Tabet explique d’emblée pourquoi elle ne dit pas « prostitution » mais plutôt « échange économico-sexuel » :
« 1) le terme prostitution […] a un terme trop étroit pour englober toutes les formes de relations que je me propose d’étudier ; 2) il est trop marqué : sa connotation morale négative devrait elle-même donner lieu à une réflexion ; 3) enfin c’est un terme galvaudé. Quand on dit « prostitution », chacun croit comprendre, bien savoir a priori de quoi il est question. Le sens commun tient la prostitution pour un phénomène évident, immuable, anhistorique, lié de façon quasi-biologique aux relations entre les sexes : n’est-ce pas, comme on le répète à l’envi, « le plus vieux métier du monde » ? » (p. 7).
Tabet s’attaque donc d’emblée au fétichisme de la prostitution, à sa naturalisation et à son caractère « évident ».
Tabet pointe également une dissociation radicale dans l’idéologie patriarcale des femmes en deux catégories, les « prostituées » (définies négativement) et les « épouses » (définitivement positivement), alors même qu’une critique fondamentale du patriarcat (comme celle de Simone de Beauvoir, laquelle faisait du mariage un statut moins enviable que celui de prostituée) rapprocherait ces deux formes de subordination sexuelle des femmes aux hommes. D’ailleurs, d’un autre côté, Tabet montre qu’il y a une épée de Damoclès qui pèse au-dessus des têtes des femmes : celle du stigmate de « putain », véritable « marquage des femmes comme classe de sexe » (p. 8), et manière « de faire passer pour un fait de nature » et une essence ce qui est une construction sociale (discours idéologique mais aussi rapport social). Le refus du stigmate de putain pour qui que ce soit est donc une marque de solidarité indispensable des femmes entre elles, qu’on voit notamment lors des Slut Walk.
Tabet va donc s’intéresser ici à l’ensemble des « relations sexuelles entre hommes et femmes qui impliquent une transaction économique » (p. 8), d’où l’expression d’ « échange économico-sexuel » (p. 9). Contre une dissociation absolue des « prostituées » et des « épouses », Tabet argue qu’il y au contraire un « continuum dans les formes de relations sexuelles entre homme et femme impliquant un échange économico-sexuel » (p. 9). Il s’agit « d’opérer un déplacement, une déconstruction de l’actuel concept de prostitution, qui s’avère inutilisable et chargé d’idéologie » (p. 9). Le statut de « prostituée » comme catégorie permanente de certaines femmes est d’ailleurs une construction historique, puisqu’en Afrique, de nombreuses femmes alternaient « des périodes de « prostitution », de concubinage ou de mariage » (p. 12), véritable continuum biographique de rapports sexuels de type patriarcaux, comme en Angleterre jusqu’au 19ème siècle :
« La création d’une catégorie permanente de femmes, les prostituées, en fait sa constitution en groupe de parias (« outcast group »), résulte de mesures politiques et législatives. […] Les jeunes filles des classes pauvres pouvaient avoir des relations prostitutionnelles pendant une certaine période, des relations d’union libre ou de concubinage ou bien encore de mariage pendant d’autres périodes [au 18ème siècle en Angleterre]. Ce sont les lois sur la répression des maladies vénériennes qui ont valu aux femmes des classes les plus pauvres qui se prostituaient pendant des périodes relativement brèves de leur existence – deux à trois ans – d’être identifiées, fichées et contrôlées. Elles se retrouvèrent complètement isolées de leur milieu, de leur classe d’origine et, partant, plus vulnérables. La vente de leurs services sexuels, que jusque-là ces femmes avaient en majorité gérée elles-mêmes, passa de plus en plus sous le contrôle des hommes et fit l’objet d’une exploitation. Ces lois (pour l’abrogation desquelles des luttes furent menées) eurent un effet patent et immédiat. Dans les deux décennies suivant leur entrée en vigueur, l’âge moyen des femmes identifiées comme prostituées augmenta considérablement […]. Les femmes qui étaient entrées dans cette activité eurent dès lors de très graves difficultés à en sortir. De travail temporaire avant l’application des lois, la prostitution devint une condition, les femmes qui l’exerçaient une catégorie délimitée, définitive, ghettoïsée » (pp. 10-11).
Il existe également un continuum entre « mariage » et « prostitution » (comme catégories de l’imaginaire occidental). Les Amharas d’Ethiopie ont ainsi un type de mariage religieux quasi-indissoluble, un type de mariage civil où il est relativement facile de divorcer, mais également un type de mariage « temporaire et de durée définie » (d’une semaine, d’un mois ou d’un an) avec une négociation du salaire de l’épouse. Dans ce type de mariage, l’homme « à l’occasion de voyages, de séjours prolongés sur des marchés, ou dans d’autres situations de ce genre […] s’assure, par un contrat à terme, l’ensemble des services sexuels et domestiques d’une épouse » (p. 14), distinct de la « prostitution » en ce qu’il s’agit d’un mariage légal où « la femme peut recourir au tribunal si elle n’est pas payée conformément aux accords passés ; l’enfant éventuellement né de l’union aura [même] droit à une part de l’héritage paternel » (p. 14). On est donc loin de « notre dichotomie stéréotypée – mariage à vie/prostitution de quelques minutes », puisqu’on est face à un « éventail de variations avec, en son centre, un mariage temporaire » (p. 14), mais aussi des « paying lovers » (amants payeurs), des relations quasi-conjugales (services sexuels accompagnés de services domestiques), etc.
La « prostitution » contemporaine, exclusivement sexuelle, clairement tarifée, est une production historique, puisqu’on trouve dans son histoire « l’absence de tarification rigoureuse » et « la présence du travail domestique » (p. 16). Ainsi, la « malaya » du Nairobi (Kenya) colonial (1909-1950), « attend ses clients à domicile, elle leur rend non seulement un service sexuel étroitement défini mais aussi tout un ensemble de services domestiques » (p. 16). L’ethnologue ayant produit cette étude propose même de considérer « la prostitution tout court comme travail domestique » (p. 17) : on est donc face à un continuum de l’exploitation domestique, dirait Delphy.
« Le continuum apparaît dans toute son ampleur : dans l’éventail des variations de relations économico-sexuelles se trouvent incluses certaines relations matrimoniales et différentes sortes de relations sexuelles non matrimoniales » (p. 17). La pire des relations économico-sexuelles n’est d’ailleurs pas celle qu’on croit dans certaines sociétés : « De plus en plus nombreuses sont les femmes Digo […] qui « quittent leur mari pour mener leur vie hors de toute cohabitation permanente ou semi-permanente : elles échangent alors de la sexualité contre de l’argent ou des biens, acquérant un degré considérable de liberté sexuelle » » (p. 18). Ainsi, dans cette société, par rapport au mariage religieux comme civil (pas de compensation économique de l’épouse, droits sexuels, domestiques ou encore agricoles absolus du mari), cette situation est largement préférable.
La coupure entre « mariage » et « prostitution », auquel cas, ne se trouve pas là où on croit. Les femmes Digo pensent qu’il y a une rupture dans ce continuum parce que dans un cas, celui du mariage, elles sont l’objet d’une transaction, alors que dans l’autre, elles sont « partenaires de la transaction économico-sexuelle et […] seules bénéficiaires de la rémunération de leurs services sexuels (et parfois domestiques) » (p. 20). Le fait de vendre sa force de travail (sexuel) est préférable au servage (matrimonial), bien évidemment, et permet même aux femmes de racheter leur liberté vis-à-vis du système matrimonial. Les femmes Bakweri ont ainsi pu divorcer de manière croissante en rachetant « le prix de l’épouse » : « Libération d’un lien de servage, forme de mainlevée, que ces femmes obtiennent par la vente de leurs propres services sexuels » (p. 21).
Évidemment,
« il ne s’agit pas ici de glorifier le phénomène de la vente des services sexuels. Mais plutôt de marquer que ce service […] est [de toute façon] cédé à l’intérieur du mariage […] dans un rapport permanent, c’est-à-dire de durée indéfinie, contraignant, souvent porteur de très faible autonomie pour la femme. Cette autonomie, les femmes la trouvent […] en émigrant vers les villes où elles subsistent grâce à la prestation des services sexuels quand elles ne trouvent pas d’autres travaux ou bien quand ces travaux constituent des alternatives encore pires. […] Il ne s’agit pas d’une « prostitution » comme alternative temporaire au mariage. Souvent les femmes refusent le mariage tout court. […] La ville se présente pour elles un peu comme pour les serfs du Moyen Âge » (pp. 21-22). Si l’abolition du travail est évidemment une forme d’émancipation infiniment supérieure au travail du sexe, celui-ci reste préférable au servage domestique. Les malaya de Nairobi ont même fini par constituer une « nouvelle classe sociale », avec des solidarités fortes, des mariages entre femmes, des formes de parenté adoptive, des sociétés de secours mutuel, et même une « transmission de l’héritage par des femmes sans enfants à d’autres femmes » (p. 22).
« Il y a donc [bien] une coupure importante qu’il convient de définir avec précision : celle-ci n’est pas, cependant, celle que nous avons coutume de tenir pour pertinente […]. La coupure qui nous apparaît maintenant ne sépare pas la « prostitution » du mariage […], elle sépare plutôt certains rapports de service sexuel des autres. […] La séparation […] s’effectue entre d’une part un rapport d’échange économico-sexuel géré au moins à titre de partenaire, donc de sujet, […] et […] une transaction […] [où] la femme n’est pas un partenaire de l’échange […] mais l’objet de l’échange » (pp. 22-23).
Après avoir établi cette première conclusion, Tabet poursuit sa déconstruction du concept de prostitution en montrant que « multiplicité des partenaires » et « rétribution » « ne sont ni spécifiques de la seule relation de prostitution, ni suffisants pour identifier toutes les formes de relations sexuelles définies comme prostitution. […] La présence de l’un ou des deux éléments en général considérés comme constitutifs du rapport prostitutionnel [se retrouve également] dans des rapports qui ne sont absolument pas qualifiés ainsi par les populations qui les pratiquent […] Sont [réciproquement] qualifiés de prostitution des rapports dépourvus de ces deux traits ou au moins de l’un des deux et, partant, […] sont définies « putains » des femmes [n’ayant pas une multiplicité de partenaires et n’étant pas non plus rétribuées] » (pp. 23-24).
Ainsi, les femmes Birom ont une multiplicité de partenaires et sont rétribuées pour leurs services sexuels, sans pour autant qu’elles soient catégorisées comme prostituées :
« Toute femme mariée a au moins une relation njem, c’est-à-dire une relation avec un homme qui n’est pas son mari mais un amant qui aura sollicité du mari la permission d’accéder sexuelle à elle et qui aura payé à celui-ci le prix coutumier d’une chèvre […]. Par le versement du prix de l’épouse, le mari acquiert les pleins droits sur la sexualité de sa femme […] [et] il peut [donc] la céder à ces tiers, moyennant le paiement d’une chèvre […]. Mais, outre le rapport économique entre mari et amant njem […], il existe […] une série d’échanges économiques directs entre la femme et son partenaire njem : il lui fera sans cesse des dons […]. Chez les Birom, il est inconcevable qu’une femme ne choisisse pas d’avoir des rapports njem et même […] plusieurs rapports njem qui procurent davantage d’argent. Cette relation reconnue et régulière est toutefois bien distincte du mariage. Il ne s’agit pas d’une forme de polyandrie […]. La relation njem n’a pas davantage à voir avec l’adultère, relation clandestine » (pp. 24-25).
De même, « chez les Hausa (du Niger et du Nigéria), il existe une institution, la tsarance, qui constitue une initiation [contrainte] des jeunes filles prépubères à la sexualité. Pendant un temps, […] elles ont des relations sexuelles avec les hommes qui en font la demande au « chef ». Les postulants doivent payer celui-ci et faire également des dons aux jeunes filles en manière de rémunération. […] Or, ces rapports sexuels des jeunes filles ne sont nullement considérés comme de la prostitution, ni ces jeunes filles comme des putains » (p. 26).
Au final, donc, « des traits comme la multiplicité des partenaires et la rémunération […] n’appartiennent pas aux seuls rapports dites de prostitution et donc ne sont pas suffisants pour les distinguer des autres rapports non définis comme tels » (pp. 26-27). Réciproquement, « des relations définies, dans une culture donnée, comme « prostitution » ne contiennent pas nécessairement ces deux traits (rémunération, multiplicité des partenaires) ou l’un des deux » (p. 27).
La multiplicité des partenaires n’est pas une caractéristique de la « prostitution », et pire, elle peut être une contrainte non-rémunérée :
« Chez les Hima d’Ouganda […] la femme mariée […] devra avoir des rapports non seulement avec son époux mais en premier lieu avec le père de celui-ci […], avec les frères du beau-père et ceux du mari, bref avec toute la parentèle agnatique de son mari (y compris les fils qu’il aurais eus d’un autre lit). Mais cette obligation de service sexuel peut s’étendre […] aux amis et alliés du mari, à tous ceux avec qui il effectue des transactions […]. La femme […] est contrainte d’avoir des rapports sexuels avec tous les hommes que son mari lui désigne pour partenaires […]. Est adultère la femme qui a des rapports avec quelqu’un de non agréé par le mari : elle viole de ce fait le droit de celui-ci à la gestion exclusive […] de sa sexualité à elle […] La prostitution [elle] réside […] dans le choix d’une relation totalement hors du domaine marital » (pp. 27-28).
La multiplicité des partenaires peut donc être une contrainte maritale, alors qu’elle est précisément associée aux relations « prostitutionnelles ». En revanche, en Ouganda comme dans l’Occident victorien, toute relation choisie extra-conjugale est qualifiée de prostitution, alors même qu’il n’y a pas (forcément) de rémunération.
« La définition de la prostitution comme prestation professionnelle rémunérée disparaît donc progressivement au profit de la représentation d’une activité sexuelle hors des règles […] établies. […] Comme le montre E. Benabou, dans des définitions de juristes de l’Ancien Régime (celle de Jousse, par exemple : « On entend par prostituées publiques (…) les femmes ou les filles qui s’abandonnent […] au premier venu, soit gratuitement, soi pour de l’argent »), « l’aspect « mercenaire » n’y apparaît nullement au cœur du délit » » (p. 29). Ainsi, « on appelle également prostituées ou putains des femmes qui se trouvent dans des situations très différentes […] Chez les Manus de Nouvelle-Guinée […], est définie comme « prostituée du village » la jeune fille qui, sans l’avoir choisi et sans recevoir de rémunération, sert sexuellement la totalité du groupe des femmes : c’est une jeune fille qui a été capturée au cours d’une razzia et qui sera utilisée jusqu’à son épuisement total, et parfois jusqu’à sa mort ; c’est donc une prisonnière de guerre soumise au viol répété. […] Dans certaines régions d’Italie, le viol collectif suffit aujourd’hui encore à faire traiter la jeune victime de putain. Et dans les villes françaises du 15ème siècle, la violence collective constituait un mode habituel de recrutement des prostituées : définie comme putain durant et à travers cet acte, la victime n’avait d’autre choix que d’entrer au bordel » (pp. 29-30).
Et « si l’on passe maintenant du terme technique « prostitution » à des mots […] tels que « putain », l’extension de la définition augmente encore, et ces mots peuvent servir alors à désigner également des femmes […] qui font un choix autonome hors du contrôle paternel ou marital » (p. 30), notamment chez les Irigwe du Nigéria (p. 30).
Au final, « une femme peut avoir beaucoup de relations rémunérées et ne pas être définie « putain » (cas des îles Trobriand) ; une femme peut ne pas avoir une multiplicité de rapports et ne pas être rémunérée, mais au contraire avoir un seul rapport non rémunéré, et néanmoins être considérée comme putain […] (cas Irigwe ou cas hébraïque) […]. Il y a une logique et une cohérence sous-jacentes à cette diversité et à cette incohérence apparentes. Ce qui me semble relier des situations si différentes […] [c’est] l’usage de la sexualité hors et à l’encontre des structures de l’échange des femmes » (pp. 31-32). Et ceci, qu’il s’agisse d’une femme se posant comme sujet autonome de sa sexualité ou d’une esclave sexuelle de guerre[3]. Autrement dit, « la catégorie « prostituée » ou « putain », « prostitution » ne se peut distinguer ni définir par un contenu concret qui lui sera propre, ou par des traits spécifiques. C’est une catégorie définie par une relation : cette catégorie est une fonction des règles de propriété sur la personne des femmes dans les différentes sociétés. Et, plus précisément, la transgression, la rupture de ces règles » (p. 32). Cette catégorie pseudo-morale a donc uniquement comme visée un maintien de l’ordre patriarcal. Les discours de stigmatisation sont des discours de réaffirmation de l’ordre patriarcal, « des discours sur les formes de propriété des femmes », des « discours sur l’usage légitime et sur l’usage légitime qui peut être fait du corps des femmes » : « Les définitions de putain-prostituée ont en fait une fonction normative […] Ces définitions constituent en même temps une énonciation des rapports de pouvoir […] et un instrument de conditionnement et d’imposition de ce pouvoir » (pp. 33-34). Ces définitions servent également à créer une division de la classe des femmes, à opérer une désolidarisation des femmes ordinaires vis-à-vis des rebelles à l’ordre patriarcal. Enfin, ces définitions forment partie d’un véritable gouvernement patriarcal de l’ordre sexuel, et servent de « moyen de domination » (p. 38).
Au final, ce premier chapitre constitue une déconstruction implacable de l’idéologie et du fétichisme de la prostitution : il s’agit d’une catégorie socio-historiquement spécifique, et non d’une évidence naturelle transculturelle, et surtout d’une catégorie stigmatisante visant à un maintien de l’ordre patriarcal.
II. Sexualité des femmes et échange économique
« Notre société n’admet explicitement l’existence d’un rapport économi[co-sexuel] […] que pour la seule prostitution » (p. 39). Au contraire, Tabet démontre dans ce deuxième chapitre qu’il existe une multiplicité de rapports économico-sexuels[4], lesquels vont jusqu’au mariage. Tabet s’attache tout d’abord à une résolution du « problème de Malinowski » :
« Aux Trobriand les actes sexuels féminins sont régulièrement récompensés. Et ce, dès l’enfance et l’adolescence : aux petites filles, puis aux jeunes filles, leurs compagnons de jeux ou d’exercices sexuels font des dons […]. Après une nuit passée avec une jeune fille on lui fait un cadeau ; si la relation devient plus stable […], il y aura des dons plus substantiels de temps en temps […]. Cette rémunération vaut également pour les rapports sexuels dans le mariage. Le mari fait à son épouse des dons pour les services sexuels qu’elle lui a rendus […]. Malinowski a [ainsi] fait, selon nous, une très grande découverte : les services de toutes sortes rendus à sa femme par le mari sont considérés comme un salaire-don [en compensation des services sexuels] (pp. 43-44).
Or, « le don-rémunération suppose […] une différence constante entre la demande de sexualité faite par les hommes et l’offre de sexualité faite par les femmes : celles-ci ne donneraient pas de la sexualité simplement en échange de sexualité. Pourquoi ? Deux hypothèses sont possibles. La première, qui correspond aux idées les plus répandues dans nos sociétés, pose que les femmes ont « par nature » des pulsions et des besoins sexuels plus faibles. On peut faire pièce à cette hypothèse […] à la lumière des propres recherches de Malinowski et de tout ce que l’on connaît sur d’autres sociétés, mais également à la lumière des recherches sur la sexualité » (p. 49). L’autre hypothèse, c’est qu’il s’agit d’une compensation pour une soumission aux seuls désirs sexuels masculins : c’est ce que répondra Paola Tabet en fin de chapitre.
Tabet critique au passage l’universalité prétendue de l’échange des femmes de Lévi-Strauss (même si elle souligne l’usage intéressant qu’en a fait Gayle Rubin) : « Ce ne sont pas nécessairement des femmes qui s’échangent entre les groupes, on peut également échanger des hommes, ou encore échanger des hommes ou des femmes entre des groupes composés d’hommes et de femmes » (p. 47).
Tabet s’interroge : « Si, comme semble le démontrer l’existence de quelque autonomie sexuelle des femmes dans certaines sociétés, cette sexualité de service n’est ni universelle ni, moins encore, « naturelle », comment, par quels moyens de contrainte, quelles pressions matérielles et psychiques les différentes sociétés sont-elles parvenues à produire une si profonde domestication de la sexualité féminine, à transformer des sujets possédant en propre une sexualité […] en pâles prestatrices de services sexuels – en objets sexuels ? » (p. 47). Elle poursuit son enquête qu’elle avait commencée dans « Fertilité naturelle, reproduction forcée ». Au sein des villes africaines, « de l’âge de quatre-cinq ans à l’adolescence, garçons et filles forment de petits groupes dans lesquels ils se livrent à des jeux sexuels, pratiques des caresses et ensuite des rapports génitaux, tant avec les camarades du même sexe que du sexe opposé » (p. 50), alors qu’au contraire à partir de l’adolescence l’homosexualité est interdite et « les rapports hétérosexuels des très jeunes filles avec des adultes sont bien vus, même quand il s’agit de rapports rémunérés. En tant que conditionnement à […] une sexualité génito-procréative, ils sont encouragés. […] La très jeune fille […] aura tendance à accorder sa préférence à celui qui offre le don le plus important. À mesure qu’ils grandissent, les garçons auront davantage de moyens, les jeunes filles des besoins et des exigences accrus. Quand des adultes, susceptibles d’offrir des dons-récompenses très supérieurs, entrent dans le groupe, la très jeune fille accepte leurs propositions, même si c’est parfois sans enthousiasme : « C’est encore un jeu mais le partenaire féminin y prend déjà moins de plaisir. Insensiblement, le « cadeau » va apparaître comme déterminant, les refus devenir plus rares » » (pp. 50-51). Le don est donc un moyen pernicieux de domestication sexuelle des femmes. Et Tabet de conclure sur ce point :
« Cet éventail de relations sexuelles que connaissent les adolescentes africaines, on peut le définir comme un continuum, une série de passages graduels […] entre une sexualité de jeu érotique et une sexualité de service et, parallèlement, […] entre le don, le don-paiement et le prix du service ou tarif. Dans ce continuum, on devra analyser […] les constantes qui, dans une société donnée, acheminent, poussent ou forcent les femmes à une sexualité de service en général […] ou au strict service ou travail sexuel rétribué […]. Et on pourra considérer l’unidirectionnalité de l’échange économique […] d’un côté comme un indicateur important de l’inégalité entre les sexes […] et d’un autre côté comme un élément essentiel dans la transformation de la sexualité féminine en une sexualité de service » (p. 51).
Revenant au « problème de Malinowski », Tabet explique que « pour pouvoir établir l’équivalence de la sexualité des hommes et des femmes, nous devrons nous demander qui peut requérir de la sexualité et quelle sexualité est requise, quels choix sexuels sont possibles. Et encore, dans quelle mesure les modalités de sexualité admises répondent aux besoins d’un sexe ou de l’autre. Pour que la sexualité des femmes […] puisse se manifester sur un plan d’égalité, il faudrait donc que les femmes disposent de la même liberté dans le choix du partenaire, de la même liberté d’initiative et de la même liberté d’expression sexuelle que les hommes, et que l’on reconnaisse aux actes sexuels des deux sexes une égale valeur. Or il est aisé de montrer que ce n’est pas ce qui se produit » (p. 53), y compris dans notre société capitaliste-patriarcale. Pour ce qui est des Trobriandais :
« Les données de Malinowski montrent, en contradiction avec ses propres conclusions, que les besoins sexuels des deux sexes sont traités différemment. L’initiative, par exemple, doit être masculine […]. Et il semble que la jeune fille ne puisse pas s’y dérober, au moins dans certaines situations […], car « elle offenserait gravement et mortifierait l’homme ». La femme qui prend l’initiative directe […], la femme qui « va d’elle-même vers un homme (disent les Trobriandais) nous l’appelons naka’ulatile (femme facile, putain) » […] « female copulator », « grand vagin toujours inassouvi » […]. Et Malinowksi note que « l’incapacité à dominer son désir, qui porte à une sexualité compulsive et agressive, […] n’est jugée véritablement répugnante que pour les femmes » […]. Déjà cette limite de l’initiative […] – sans même parler de la répression […] qui frappe les formes de sexualité autres que l’hétérosexualité génitale – suffit à confirmer que les deux sexes n’ont pas une égale possibilité d’expression de leur propre sexualité. Preuve supplémentaire : quand les garçons vont faire l’amour dans d’autres villages, ils peuvent être insultés et éventuellement malmenés par leurs partenaires du village d’origine ; quand ce sont les jeunes filles qui y vont, au retour « les coupables sont insultées et battues, et […] parfois elles sont violées en public par leurs amants » […] Voilà pour la réciprocité sexuelle ! […] Que les Trobriandais définissent la sexualité des femmes comme un service rendu aux hommes par les femmes n’apparaît donc pas comme une affirmation arbitraire mais comme une preuve de clairvoyance sociologique » (pp. 53-54).
Tabet peut donc théoriser : « Le don suppose et constamment impose une différence entre les sujets sexuels. Pour qui le reçoit, il implique un renoncement, fût-ce partiel, à ses propres besoins sexuels, à son désir propre. En ce sens, le don parle le langage de la domination. Le seul fait de donner systématiquement […] en échange de l’acte sexuel d’une autre personne […] suppose que l’on ne reconnaît pas à la sexualité de l’autre la même urgence, la même nécessité et la même autonomie. […] À travers le don […] la sexualité des femmes est déclarée (et rendue) différente de la sexualité des hommes ; l’acte sexuel des femmes est nié en tant qu’expression équivalente de sexualité propre, à égalité de droit, et se transforme […] en service » (p. 55). Le « devoir conjugal » occidental n’avait même pas de compensation (et n’en a toujours pas), c’est dire l’ampleur de l’inégalité sexuelle femmes-hommes dans l’Occident contemporain… D’ailleurs, l’évergétisme (Paul Veyne) des aristocrates de l’Antiquité montre bien que le don est une manifestation de puissance.
Le monopole masculin de la chasse et de la pêche, développé dans l’autre ouvrage de Paola Tabet, permet également d’échanger de la viande ou du poisson contre de la sexualité. Les hommes et femmes Mehinaku sont ainsi dans une situation asymétrique. Mais cette asymétrie sexuelle est générale. Les femmes sont violées collectivement si jamais elles pénètrent au sein de la maison des hommes, mais pas seulement : « Le recours au viol collectif semble également viser à remettre dans le droit chemin des femmes au comportement trop rebelle ou insuffisamment soumis. Le viol collectif est une mise à mort sociale, sinon physique, de la femme » (p. 58). Le viol individuel est également très fréquent. Logiquement, dans cette société, « les hommes déplorent que les femmes soient « avares de leur sexe ». Certaines femmes sont qualifiées de […] « femmes qui n’aiment pas ça ». Ces femmes qui refusent leurs prétendants sont considérées comme des « femmes de rien » […]. [Il faut dire que] la sexualité qu’offrent les hommes est très limitée : hors un petit nombre d’exceptions, « les hommes ne se livrent pas à des préliminaires ni ne touchent le sexe de leurs partenaires » ; il n’y a pas de mot en langue Mehinaku pour l’orgasme des femmes et « assurément, ce n’est pas une attente qu’elles ont lors des relations sexuels » » (pp. 59-60).
Les Kung ! ont été souvent idéalisés. Pourtant un terrible patriarcat sexuel existe chez eux, comme l’a montré Tabet dans son autre ouvrage. Et cela dès l’enfance : « Les petits mâles ont fait leur apprentissage en […] cherchant à s’imposer : « … ils voulaient me prendre, dit Nisa. Quand je refusais, parfois ils me jetaient à terre, ils me déchiraient le tablier de cuir » » (p. 62). Les rapports sexuels sont donc forcés dès l’enfance. Il y a un apprentissage violent, traumatisant même, et ensuite les femmes sont censées « accepter le désir du mari comme prioritaire, faire l’amour, [et même] y avoir du désir, y avoir du plaisir » (p. 63). Au final, le système de domination sexuelle est fait de « la division sexuelle du travail qui crée une différence et une dépendance, le don/rémunération, […] le viol comme moyen de coercition et de domestication – l’amalgame hybride et efficace de la nécessité, de la violence et de la gratification » (p. 64). « La dépendance économique est mise en place par la violence sexuelle. Et c’est la violence, notamment la violence sexuelle, qui maintient et verrouille la structure matrimoniale et l’inégalité dans la division du travail. De même qu’elle conditionne directement la vie et la sexualité des femmes » (pp. 65-66). Mais d’un autre côté,
« inscrit dans cette structure de domination et de domestication, le don se révèle ainsi un instrument de pouvoir […] : le fouet fait le chien, le don fait l’esclave, rappelle le dicton esquimau. Car en fait le don scelle une domestication qui s’actualise à travers un puissant mélange de violence et de récompense/valorisation pour faire accepter une norme imposée […]. Le don révèle sa logique de domination, en récompensant et en valorisant une sexualité requise et imposée comme un service. C’est dans la combinaison difficilement désintricable de service et de désir […] que le conditionnement à une sexualité […] de service atteint sa pleine réussite. Mais, paradoxalement, son échec partiel aussi. Car la plasticité humaine se manifeste sans cesse dans la possibilité de soutirer quelque chose de bon pour soi, de résister d’une façon ou d’une autre à l’oppression, de se servir des cartes disponibles pour en jouer et avoir du plaisir » (pp. 66-67),
même s’il ne faudrait pas exagérer ce dernier point et faire un pouvoir quelque chose d’exclusivement « productif » (Foucault) et oublier sa dimension fondamentalement répressive (Reich). Pour ce qui est des Kung !, on renvoie au texte original pour plus de détails.
Au final, « les relations économico-sexuelles hors mariage, qu’elles soient préconjugales ou extraconjugales, ne constituent pas pour les femmes une alternative au mariage […]. Et même les relations extraconjugales […] semblent plutôt constituer une intégration au système qu’une transgression » (p. 68), du coup dans de nombreuses sociétés où ces relations sont organisées socialement. Il y a ainsi une organisation sociale duale de la sexualité :
« Il y a dans ces sociétés un contingent de femmes engagées dans des rapports économico-sexuels […] [qui] les extraient (de façon momentanée ou permanente) du mariage et en particulier […] de la structure de la division sexuelle du travail et de la reproduction qui s’actualisent dans le mariage. On pourrait même y voir […] une forme de division sociale du travail spécifique et interne à la classe sociale des femmes […]. La mondialisation montre [d’ailleurs] bien la continuation et l’extension de cette division du travail spécifique à la classe des femmes, avec les énormes migrations de femmes vers les pays industrialisés où elles travaillent essentiellement dans les secteurs du travail domestique, de l’assistance aux infirmes et aux vieux, et dans le travail du sexe » (p. 69).
L’existence même des rapports de dépendance économico-sexuels présuppose une séparation des femmes des moyens de production (sans parler de salaires inégaux et parfois même d’un accès difficile au travail), tout comme l’existence des rapports capitalistes de travail présuppose une séparation des prolétaires de moyens de production non-marchands, et ce même si ces rapports de dépendance économico-sexuels peuvent être relatifs (services sexuels « librement » exercés, même s’il peut s’agir de « survival sex » à un extrême) ou absolus (esclavage sexuel). Les femmes sont contraintes par ce système de dépendance à fournir des services sexuels lors du passage d’une frontière, du permis ou d’un examen, ou dans de nombreuses situations comme l’obtention d’un travail ou d’une promotion (ce qui est resté, en Occident, partiellement une réalité, partiellement un fantasme pornographique – manière, dans ce dernier cas, de maintenir au moins au niveau de l’imaginaire ce rapport de dépendance économico-sexuel fondamentalement patriarcal). Le fait que des femmes puissent se penser comme des fournisseuses occasionnelles de services sexuels, y compris en Occident, et se comporter comme telles, ne constitue donc certainement pas une « perversion morale », mais une auto-réification comme moyen de s’en sortir dans un monde patriarcal les considérant comme des choses sexuelles.
Dans l’histoire du capitalisme, on passe graduellement « du don, plus ou moins obligatoire et de nature variée, au prix ou tarif ; […] d’une durée indéterminée […] à la négociation du temps de travail ; […] à la définition et au prix de chacun des actes ou services fournis » (p. 79). Les rapports de dépendance économico-sexuels se nichent partout, jusqu’aux « innocents » cadeaux ou bouquets de fleurs. Le don doit être réciproque (on s’offre mutuellement des cadeaux) et non unilatéral, sinon il se trahit comme reflet et comme vecteur de rapports de domination. Il faudra, à terme, en finir avec l’ensemble des rapports de dépendance économico-sexuels.
Les trois autres chapitres de La grande arnaque présentent également un fort intérêt. « Les dents de la prostituée : négociation et mesure dans l’échange explicite », montre que dans certains cas, la « prostitution » constitue un « moyen de transformer une relation unilatérale [de soumission aux « désirs » masculins] en une relation réciproque [avec un pouvoir de négociation] » (Stansell), loin des clichés misérabilistes faisant des « prostituées » uniquement des pauvres hères incapables de négocier durement : une partie non-négligeable des prostituées (en Occident, moins ailleurs) sont capables de fixer des limites à ce qu’elles veulent bien faire, de choisir leurs clients, de mettre un tarif à tout acte (même anodin), de séparer leur sexualité personnelle du travail sexuel (sex work), et peuvent ainsi avoir une capacité de négociation analogue aux salarié-e-s (parfois supérieure). « Ruptures dans le continuum : choix des femmes, répression des hommes », montre l’imposition (souvent violente) d’une sexualité forcée aux femmes au sein du mariage, les tentatives de s’échapper de cette sexualité contrainte (même si Tabet rappelle qu’elle existe également hors du mariage) ; la précarité d’une partie importante des « prostituées » et en contraste les réussites de certaines femmes qui parviennent à acquérir une autonomie économique au travers du travail du sexe et même à quitter celui-ci ensuite ; l’opposition des hommes aux formes d’échanges économico-sexuels accordant une autonomie économico-sexuelle aux femmes (« par cette utilisation personnelle de leur corps sexualité, elles se soustraient au travail gratuit et accèdent à une autonomie économique. Aussi s’agit-il […] d’une échappée hors du rapport d’appropriation privé. Les réinsérer dans ce rapport devient donc un but prioritaire de la politique des hommes. Le moyen en est la répression » [p. 125]) ; les politiques locales ou même étatiques Zimbabwe, Gabon, etc.) de criminalisation de l’autonomisation économico-sexuelle des femmes (Kenya, Ghana, Nigéria), de rafle des prostituées avant de contraindre celles-ci au mariage (Zimbabwe, Gabon, Chine des années 1950), ou encore de limitation de l’autonomie économico-sexuelle par un système étatique de réglementation et de recrutement forcé des prostituées (France jusqu’au 20ème siècle, Chine impériale) ; et enfin les migrations des femmes des périphéries (autonomes, pour échapper au patriarcat local et/ou aux ravages du capitalisme de crise, ou hétéronomes, lorsqu’elles tombent dans des réseaux de trafic), leur travail du sexe ou genré (services à la personne) au sein des centres capitalistes, les retombées économico-sociales du transfert d’argent de ces femmes migrantes travailleuses du sexe. « La grande arnaque : échange, spoliation, censure de la sexualité des femmes », conclue à une exploitation sexuelle des femmes par la classe des hommes (jusqu’à leur spoliation tendancielle du produit de leur travail du sexe), à une contrainte patriarcale et/ou capitaliste plus ou moins violente au travail du sexe, et à une sexualité phallocentrique, l’ensemble étant permis par une dépossession et une exploitation générale des femmes et par une exclusion des femmes du savoir et du savoir-faire sexuel, empêchant ainsi qu’elles aient une conscience autonome de leur sexualité :
« Avec l’échange économico-sexuel, nous nous trouvons devant une gigantesque arnaque fondée sur le plus complexe, le plus solide et le plus durable des rapports de classe de toute l’histoire humaine, le rapport entre hommes et femmes […]. L’échange économico-sexuel constitue ainsi […] la charnière du rapport de classe entre les hommes et les femmes […]. On se trouve face à un rapport global qui lie oppression sexuelle, limitation de la connaissance et exploitation sexuelle » (pp. 169-170).
Paola Tabet parvient à une position remarquable au sein du débat autour du travail du sexe, échappant en même temps à une idéalisation libérale du travail du sexe (parfois promue par des travailleuses du sexe elles-mêmes pour combattre – à raison – la stigmatisation de leur travail, mais du coup occultant l’exploitation qui existence dans leur travail comme dans tout travail) et à un misérabilisme justifiant des politiques d’oppression des travailleuses du sexe.
Tant qu’on sera dans une société capitaliste-patriarcale, il y aura du travail du sexe, et il faudra être aux côtés des travailleuses du sexe, notamment en s’opposant aux lois discriminantes dites « abolitionnistes », tout en luttant contre l’ensemble des structures d’exploitation et de trafic des travailleuses du sexe (y compris donc en permettant à celles ne souhaitant pas/plus être des travailleuses du sexe de quitter leur travail[5], mais surtout sans aucune injonction moralisatrice comme le Nid). Il n’y a pas de raison anticapitaliste de faire une critique du seul travail du sexe, et non du travail de manière générale, car comme disait très maladroitement Marx : « [La] prostitution n’est qu’une expression particulière de la prostitution générale du travailleur » (Manuscrits de 1844). Ce n’est que dans un processus révolutionnaire de dépassement émancipateur du patriarcat et du capitalisme qu’aura lieu une (auto)abolition du travail, et notamment du sexe, et des contraintes à la sexualité des femmes, et notamment des échanges économico-sexuels (mariage comme « prostitution »[6]) : « Les prolétaires doivent […] abolir la condition d’existence qui fut jusqu’ici la leur, et qui est en même temps celle de toute l’ancienne société : ils doivent abolir le travail » (Karl Marx, L’idéologie allemande, 1845).
Armand Paris
[1] Cf. Claudine Legardinier, Prostitution: une guerre contre les femmes, Paris, Syllepse, 2015. Il ne s’agit pas ici de contester des faits évidents (les violences de l’industrie capitaliste du sexe), mais de critiquer une argumentation unilatérale, aveugle aux gains relatifs de certaines travailleuses du sexe par rapport, notamment, au mariage. Par rapport à une société post-patriarcale, évidemment, ces gains sont très relatifs.
[2] Cf. Paola Tabet, « Du don au tarif. Les relations sexuelles impliquant une compensation », Les Temps Modernes, n°490, mai 1987, pp. 1-53 ; Paola Tabet, Etude sur les rapports sexuels contre compensation. Rapport présenté à l’UNESCO, Division des Droits de l’Homme et de la Paix, 1988 ; Paola Tabet, « Les dents de la prostituée : échange, négociation, choix dans les rapports économico-sexuels », dans M. C. Hurtig, M. Kail, H. Rouch (dir.), Sexe et genre. De la hiérarchie entre les sexes, Paris, Editions du CRNS, 1991, pp. 227-243 ; Paola Tabet, « La Grande Arnaque », Actuel Marx, n°30, 2001.
[3] On est donc face à des situations très différentes, rassemblées dans une même catégorie en ce qu’elles sont en rupture avec l’ordre marital. Aujourd’hui encore, sont stigmatisées comme « putains » des femmes ayant des situations très différentes : des femmes ayant une sexualité autonome non-rémunérée, des femmes vendant leurs services sexuels de manière indépendante, des femmes ne touchant qu’une partie du produit des ventes de leurs services sexuels, et enfin des femmes esclaves sexuelles rapportant de l’argent à des tiers.
[4] Pour l’anecdote, « à Nagovisi, société matrilinéaire où les femmes jouaient un rôle considérable dans le processus de décision, il existait (dans les couchées élevées) un […] prix de l’époux. […] L’adultère, s’il venait à être découvert, entraînait le paiement d’indemnités à diverses personnes. L’homme adultère devait dédommager sa propre épouse ainsi que le mari de son amante. La femme adultère dédommageait son mari ainsi que l’épouse de l’homme avec qui elle avait commis l’adultère » (pp. 40-41). Cela tranche avec l’inégalité habituelle entre femmes et hommes en termes de punition de l’adultère, même si cette catégorie devrait être évidemment jetée aux poubelles de l’histoire.
[5] Cf., avec de nombreuses réserves, Trine Rogg Korsvik et Ane Stø (dir.), Elles ont fait reculer l’industrie du sexe. Le modèle nordique, Paris, Syllepse, 2015.
[6] Comme disait Alexandra Kollontaï, féministe bolchévique : « Il n’est pas important qu’une femme se vende à un homme ou à plusieurs, qu’elle soit catégorisée comme une prostituée professionnelle vendant ses faveurs à une succession de clients ou comme une femme se vendant à son mari. »

Voline - La révolution russe

L’affaire Sacco-Vanzetti – avec Ronald Creagh
Vous aimerez aussi

Otto Rühle – La révolution n’est pas une affaire de parti
12 juillet 2017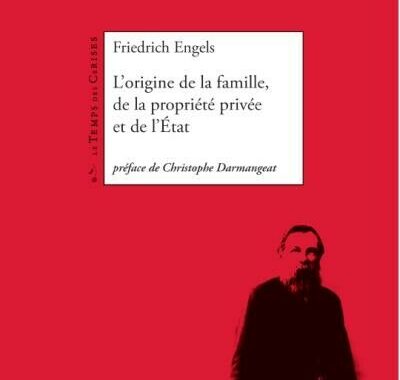
Préface de L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’Etat (Friedrich Engels) – Eleanor Leacock
7 juillet 2017
Un commentaire
Ping :