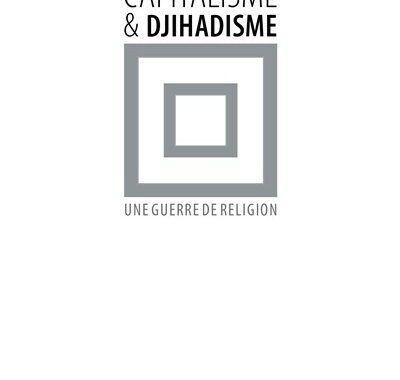Emmanuel Mbolela – Réfugié
Emmanuel Mbolela, Réfugié, Paris, Libertalia, 2017
Version audio (une nouveauté de Sortir du capitalisme !)
Version écrite
C’est un ouvrage poignant qu’on lit d’une traite, ou presque. La condition de réfugié-e, de migrant-e, peu importe puisqu’il s’agit des mêmes victimes du capitalisme mondial, des dictatures et des guerres civiles des périphéries du système-monde capitaliste, ou encore du patriarcat, y est décrit de manière brut. Brut, et c’est en effet un parcours d’une brutalité inhumaine, parsemée de rackets, de violences et de viols, et avec souvent au bout d’une mort violente, que nous décrit l’auteur, réfugié congolais. Et encore ce récit (pourtant difficile) est-il en-dessous de l’horreur vécue par un grand nombre de migrant-e-s : notre auteur vient d’une famille de classe moyenne, cultivée, et c’est un homme. Il nous raconte donc, mais sans l’avoir vécu, des viols, des morts, des migrant-e-s obligés de s’arrêter en chemin faute d’avoir de l’argent pour acheter leur passage – et donc de se prostituer, sexuellement ou autrement, à un prix misérable. Les éditions Libertalia ont été promptes (avec l’encouragement de Paul Braun) à publier ce témoignage indispensable, d’abord paru en allemand en 2014, et ce de plus à un prix abordable (10 euros) : on pourra s’en féliciter. La couverture est également réussie, et on appréciera qu’il y ait une écriture inclusive : quoi de plus logique, lorsqu’on sait qu’environ 50 % des migrants sont des migrantes ? [émission Dégenrée]. Inutile, en revanche, de chercher dans Réfugié une théorie critique des causes profondes de l’émigration [Henri … Echanges&Mouvement] et de ses horreurs : l’auteur se contente d’une dénonciation susceptible de faire écho à un grand nombre de personnes, avec un langage démocratiste (ce n’est nullement un reproche évidemment). On essayera seulement de pointer quelques pistes d’analyse critique à partir de son ouvrage.
Préface de l’édition française
L’auteur entame d’emblée avec un fait d’actualité, celui d’une embarcation échouée avec 700 migrant-e-s à son bord en mai 2016 : « Corps sans vie de migrant-e-s sur le rivage de la Méditerranée […]. Ces êtres humains n’ont pas de pays ni de nom. On les nomme tous et toutes « clandestins ». Leur vie n’a aucune valeur et leur mort ne provoque plus aucune émotion. On exhibe les dépouilles sans aucune marque de respect – est-ce pour dissuader les autres ? » (p. 9). Bien évidemment, mais cela témoigne également du statut du migrant-prolétaire racisé au sein du capitalisme mondial de crise : un statut de « déchet social », de non-rentable, de sous-prolétaire. L’auteur poursuit : « L’Europe se barricade. Les frontières sont hermétiquement fermées. Des murs se construisent […]. Pour renforcer encore ce dispositif, l’Europe a lancé en novembre 2014 […] le « processus de Khartoum », soit des accords avec la Somalie, le Soudan, l’Afghanistan, l’Erythrée et l’Ethiopie « afin de renforcer leurs capacités en matières de gestion de la migration ». Autrement dit, « l’Union européenne entend favoriser le contrôle des victimes par ceux qui les persécutent » [Olivier Favier, « Murs et barbelés. Les envoyer en détention ou les livrer à une dictature : voilà comment l’Europe « délocalise » ses réfugiés », Bastamag]. Les voies légales d’immigration se rétrécissent comme peau de chagrin. Même le regroupement familial est devenu quasiment impossible. C’est ainsi que des femmes et des enfants en viennent à risquer leur vie sur des embarcations de fortune : si l’on se demande comment c’est possible, c’est que l’on oublie les obstacles dressés par leur route par les Etats européens. Frontex, les polices des frontières et les bureaucraties nationales font preuve d’une redoutable efficacité dans la dissuasion des candidats à l’immigration » (pp. 9-10). Il raconte l’histoire de Hola, morte noyée avec ses enfants au milieu du détroit de Gibraltar à cause d’un bateau surpeuplé préalablement saboté par des passeurs. C’est l’histoire d’une vie parmi tant d’autres : 200 000 personnes sont mortes en 20 ans en tentant de rejoindre l’Europe, et près de 4000 rien qu’en Méditerranée en 2016 : « L’Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde [dont elle est pourtant en grande partie responsable, depuis l’esclavage jusqu’au néo-colonialisme], entend-on. Au nom de ce principe, les Européens laissent mourir des hommes, des femmes et des enfants devant leur porte. […] La Méditerranée est devenue la fosse commune de milliers de migrants » (pp. 15-16). [Carte Sciences Po + visionscarto.net/mourir-aux-portes-de-l-europe] C’est leur histoire, celle de victimes du capitalisme, de l’État, du racisme et du patriarcat, qui va être racontée.
Avant-propos. Une histoire parmi d’autres
L’auteur commence par un rappel de l’abominable situation en République démocratique du Congo (RDC, ex-Zaïre, ex-Congo Belge), périphérie dominée du capitalisme mondial en proie à une guerre civile sanglante depuis une vingtaine d’années et une dictature depuis un demi-siècle. Là-dessus, on renvoie aux documentaires … et au livre de David Van Reybrouck, Congo. Une histoire, Arles, Actes Sud, 2012. L’avant-propos démontre une certaine naïveté politique de l’auteur (peut-être liée à sa position originaire de classe moyenne ayant fait des études de sciences économiques), en appelant aux « droits de l’homme » et en aspirant à un capitalisme social-démocrate redistributeur des richesses minières du Congo (il est qu’en Afrique, c’est déjà difficile d’obtenir un capitalisme non-dictatorial…).

Au pays. Du Kongo à la République démocratique du Congo
L’auteur fait un rappel de l’histoire du Kongo (qu’il faut distinguer du Congo Brazzaville, ex-Congo français : cf. Le Rapport Brazza. Mission d’enquête au Congo : rapport et documents (1905-1907), Le Passager clandestin, 2014) depuis l’infâme colonisation belge, son travail forcé et ses millions de morts [documentaire Léopold et Adam Hochschild, Les Fantômes du roi Léopold : la terreur coloniale dans l’Etat du Congo, 1884-1908, Paris, Tallandier, 2007], l’assassinat de l’indépendandiste Lumumba (qu’il regrette alors qu’il était un bourgeois social-démocrate qui se serait sans doute révélé autoritaire : mais c’est vrai qu’après 30 ans de Mobutu…), l’interminable dictature (1965-1997) de Mobutu, son pillage des revenus miniers et sa fin de règne génocidaire, et enfin une période de guerre civile (à partir du génocide rwandais et son exportation en RDC [Pensée radicale], chaque pays voisin ayant sa propre faction armée et jouant ses propres cartes dans l’optique d’une appropriation des richesses minières de l’Est du Congo) ayant fait au moins 5 millions de morts, de « processus de démocratisation » jamais aboutis et de dictature renouvelée (des Kabila). Le Kongo a été exploité pour son ivoire, son caoutchouc, son uranium, et enfin son coltan, et ce de manière particulièrement prédatrice (avec une surexploitation incroyable). Emmanuel Mbolela naît dans ce pays (qu’il vante beaucoup par sa beauté et sa diversité) en 1973, dans une famille de classe moyenne de l’opposition, et fait des études de sciences économiques : ceci explique son adhésion au mouvement social-démocrate d’opposition non-violent (il est vrai qu’en face, il n’y a que des factions armées et une dictature…), et sa croyance dans un idéal qui nous paraît suranné vu d’ici (mais qui, en RDC, constituerait néanmoins une franche amélioration). Il est peu critique vis-à-vis du patriarcat traditionnel (son père était chef de famille avec plusieurs épouses, il y a une ségrégation genrée au niveau des repas, etc.), mais il devient plus lucide sur cette question au fur et à mesure de son périple. Il raconte ensuite son engagement politique au sein de l’UDPS, un parti social-démocrate non-violent, et milite en faveur d’une redistribution des richesses (ce qui est une bonne chose, mais insuffisante) et d’un « Etat de droit » (on connaît… mais c’est vrai que c’est encore pire en RDC). En 2002, il participe à une grande manifestation non-violente, qui s’achève par des arrestations, des incarcérations, des tortures (« nous subissions quotidiennement des tortures physiques et psychologiques ») et des morts. Il s’évade grâce à sa famille au bout de deux mois de prison, et décide sous contrainte de s’exiler. L’exil est toujours une contrainte : personne ne souhaite quitter ses proches et son environnement de vie, sauf si cette personne est opprimé-e par une dictature, qu’elle veut fuir un patriarcat étouffant ou une misère insoutenable. Les migrant-e-s ne sont pas une arme du capital (comme l’affirme l’extrême-droite), mais des « victimes » du capital, de l’État, du (néo)colonalisme et du patriarcat cherchant comme tout sujet humain à survivre ou à améliorer (un peu) une vie proprement insupportable en raison de ces systèmes d’oppression.

En route. Le temps de l’exil
L’auteur commence par une présentation de ses compagnons d’exil : « Il y avait celles et ceux qui fuyaient les guerres de l’est du Congo […]. Leurs visages étaient marqués par les souffrances endurées. Certain-e-s avaient vu leurs parents brûlés vifs. D’autres avaient été violé-e-s ou contraints sous la menace des armes de violer leurs propres parents, leurs frères et sœurs. Je me souviens de l’un d’eux qui me disait que son esprit était resté au pays. Il revoyait sans cesse les atrocités auxquelles il avait assisté, entre autres ses sœurs violées et enlevées par les militaires […]. Tous n’étaient pas des fugitifs […] certains […] poussées par la misère […] avaient choisi de partir à l’aventure » (pp. 55-56). Il ne faudrait toutefois pas opposer des « réfugiés politiques » et des « migrants économiques » : tous deux sont des victimes du même système capitaliste mondial, ces premiers étant simplement des victimes de ses conséquences politico-militaire et ces derniers de ses conséquences socio-économiques. Mourir dans un bidonville ou dans une guerre civile, survivre avec peine dans un cas comme dans l’autre, y’a-t-il une énorme différence ? Certaines enfin fuient une terrible oppression patriarcale « comme cette Béninoise […] : sa fille aînée était morte trois ans auparavant des suites de son excision [pratiquée encore en Europe au 19ème siècle], mais sa belle-sœur avait tout de même insisté pour que la cadette soit excisée à son tour. Ce qui avait provoqué une telle mésentente […] qu’elle s’était résolue à divorcer et à prendre la fuite avec sa fillette » (p. 57). La classe d’origine est un facteur déterminant : « Du Congo Brazzaville au Mali […] la circulation […] dépend du contenu de votre bourse. Tant que cette dernière se porte bien vous pouvez vous rendre sans problème d’un pays à l’autre – il faut juste savoir « coopérer » avec les gardes-frontières, c’est-à-dire savoir leur glisser discrètement l’argent dans la main. […] [Ceux] qui n’en n’ont plus et qui n’ont pas de proches en Europe ou au pays pour leur envoyer un mandat, restent sur place et doivent chercher du travail » (pp. 56-57). L’auteur reste au Mali, à Bamako, en espérant un dénouement favorable d’un énième « Dialogue intercongolais » : ses compatriotes d’un milieu modeste lui disent qu’il ne faut pas y croire, lui continue d’y croire en raison de ses origines sociales, et finalement c’est eux qui ont raison : « Moi j’avais confiance […]. J’avais calculé qu’une fois rentré au pays je profiterais des deux ans de transition vers la démocratie prévus dans les projets d’accord pour terminer mes études universitaires puis entamer une carrière politique. Je pensais que m’engager dans la politique était un bon moyen de contribuer au changement qui permettrait le développement du pays. Mais l’analyse de mes camarades, qui se fiaient moins que moi aux diverses déclarations et discours officiels, se révéla plus lucide que la mienne » (p. 67). Ici, l’auteur laisse poindre ses illusions bourgeoises de devenir un politicien intègre, alors même que c’est l’État capitaliste lui-même qui est un problème. Illusions toujours : « Je décidai de continuer mon chemin, d’aller où je pourrais poursuivre la lutte [démocratiste], où mon cri pour l’instauration d’un État de droit [sic] et de la démocratie [sic] dans mon pays serait entendu par les hauts décideurs de ce monde [resic] […] Mon espoir était de me retrouver dans un pays où règne l’ordre, la paix et surtout la liberté […]. Je devais donc me préparer à demander l’asile dans un pays d’Europe [sic] » (p. 69). C’est là qu’on voit l’ampleur des illusions vendues au monde entier, dont d’ailleurs l’auteur s’est partiellement rendu compte lorsqu’il est arrivé en Europe et en fréquentant des militant-e-s européen-ne-s. L’auteur décide donc de poursuivre sa route en direction de l’Algérie. Mais en Algérie, sa couleur de peau sert de marqueur, de signe, à un statut social de migrant-prolétaire racisé : il est donc tendanciellement identifiable comme tel. Ce n’est pas à un type physique que s’en prend des individus et/ou une institution (policière) racistes : c’est à un type d’individu non-national (donc illégal), sous-prolétaire, racisé du fait de son infériorité dans l’ordre du capitalisme mondial ; et ici le physique (couleur de peau, traits « caractéristiques », etc.) n’est qu’un marqueur censé permettre au premier coup d’œil de repérer ce certain type d’individu, mais c’est un marqueur décisif : « Dorénavant nous serions trahis par la couleur de notre peau » (p. 70). L’auteur s’embarque donc dans un périple dangereux, et d’autant plus si on est une femme : celles-ci sont violées tout au long du périple, par des policiers maliens (« La police débarqua pendant la nuit. […] Trois femmes furent appelées […]. Elles partirent avec les policiers pour ne revenir qu’à l’aube, la mine défaite »), puis par des policiers algériens, et parfois par des bandits du désert… Mais l’auteur reste naïf : « Si nos pays avaient été bien gouvernés par des dirigeants soucieux du bien-être de leur population, ces femmes […] n’auraient pas subi cette violence » (p. 73). Et pourtant, elles sont agressées quotidiennement par leur conjoint ou d’autres hommes, même en Europe…
Les passeurs sont généralement des ordures, des entrepreneurs de trafic humain, violant leurs voyageuses avec leurs complices (« une des femmes me confia que le chauffeur et les agresseurs se connaissaient bien, qu’ils s’étaient partagé l’argent et les femmes »). La migration a un genre [Falquet, Le genre de la mondialisation]. Après de nouveaux rackets et avoir failli mourir de faim, de soif et de fatigue, l’auteur arrive dans un ghetto migrant du sud de l’Algérie, où il est de nouveau racketé et est témoin du réseau de prostitution de Nigérianes (accompagnées de leur proxénète, cette ordure de contremaître et de capitaliste) : « Les jeunes filles nigérianes […] étaient affreusement maltraitées par les membres de leur propre communauté, qui les abusaient sexuellement et qui les vendaient aux membres des autres communautés [et aux policiers algériens]. [Mais] les Nigérianes n’étaient pas les seules à subir la violence des hommes. Les femmes de tous les ghettos y étaient exposées. Et elles étaient aussi terrorisées par les militaires et les policiers, qui venaient les chercher le soir et les ramenaient tôt le matin » (pp. 78-79). En route vers Tamanrasset, ville du Sud algérien, l’auteur est de nouveau racketté de 520 dollars, après une fouille y compris anale par des brigands (sans doute complices du chauffeur). Après avoir de nouveau failli mourir d’épuisement et de froid, l’auteur arrive là-bas, et est contraint de travailler. La surexploitation des migrant-e-s est abominable (eh oui, il n’y a pas qu’en France, la surexploitation raciste existe partout) : « On travaillait dans des conditions d’esclavage. […] Tu travaillais durement pour être payé en monnaie de misère. Parfois on te faisait vider les WC sans aucune précaution d’hygiène. Tu n’avais aucun droit de revendiquer quoi que ce soit. […] Parfois aussi, tu travaillais mais à la fin, on te congédier sans te payer et en menaçant d’appeler la police si tu protestais. Tamanrasset était aussi un lieu de prostitution pour les femmes. Certaines étaient obligées de recourir à ce moyen pour continuer leur voyage. D’autres y étaient contraintes par leur maquereau » (p. 85). En route vers Alger, l’auteur est de nouveau racketté par des policiers. Arrivé là-bas, il croit être arrivé au bout de ses peines, mais va vite déchanter.
« Dans la rue la plupart des regards sont des regards de dédain. Nous sommes tout juste bon-ne-s pour les travaux les plus pénibles et les plus salissants. À Alger, surtout dans les quartiers populaires, être noir-e c’est être exposé à toutes sortes d’humiliations. On nous traite d’ « Azzi », ce qui veut dire esclave. Certains jeunes n’hésitent pas à nous jeter des pierres en criant « Azzi ! ». […] Les discours haineux sont également propagés par la presse algérienne » (p. 92). Ce témoignage montre bien qu’il existe structurellement du racisme partout au sein du capitalisme mondial, même des Algériens envers des Africains subsahariens, loin d’être l’apanage exclusif des ex-colonisateurs (lesquels sont évidemment des sujets racistes), contrairement à ce que voudrait nous faire croire une Houria Bouteldja [Race, nation, classe]. Mais si on pourrait croire que ce racisme n’est qu’une affaire d’ex-colonisés, il n’en est rien : « Ce traitement inhumain dont nous, les Subsaharien-ne-s, sommes victimes dans les pays du Maghreb, a été fortement encouragé par l’ « externalisation de la gestion des flux migratoires », comme disent les eurocrates. L’Union Européenne accorde des moyens considérables à ces pays pour protéger ses frontières tout en sachant bien que les droits humains les plus élémentaires y sont foulés aux pieds. La politique européenne contre l’immigration clandestine est directement responsable de la mort des migrant-e-s dans le désert, des noyades en Méditerranée et de l’intensification du racisme et de la xénophobie » (p. 92).
L’État algérien, toutefois, n’est guère en reste : « À Alger, les migrant-e-s sont sans cesse menacé-e-s d’être arrêté-e-s et expulsé-e-s. On les voit rarement circuler librement dans les rues de la ville. Seules les femmes et leurs bébés trouvent grâce mais, là encore, elles doivent en payer le prix. Les mêmes policiers qui ont terrorisé le ghetto dans la journée reviennent la nuit exiger des services sexuels des femmes, et celle qui ose refuser est menacée de refoulement » (pp. 92-93). Ces femmes migrantes sont ainsi au croisement de trois oppressions : de genre, raciste, et étatique. Mais même en prison, les migrant-e-s sont victimes de leurs propres co-détenus : « Ces prisonniers, pour la plupart algériens, torturent, violent, font subir toutes sortes d’atrocités » (p. 93). Preuve, s’il en est, qu’on ne peut s’en tenir à un grand discours autour de l’unité naturelle du prolétariat et de sa solidarité indéfectible : celui-ci est structurellement segmenté, et sera tel jusqu’au dépassement de cette segmentation au sein d’un processus révolutionnaire de communisation [TC].
L’auteur, lui, reste en revanche épargné par une partie des oppressions, patriarcale mais aussi de classe : « Une jeune fille malienne […] me demanda […] où j’habitais, je lui répondis : à Dely Ibrahim. Elle s’exclama : « Mais tu as l’air instruit, qu’est-ce que tu fais à Dely Ibrahim, c’est un quartier de clandestins, tu ne peux pas rester là-bas ! » […]. Elle semblait un peu abattue : ce que je lui disais ne collait pas avec l’image qu’elle se faisait du migrant. Les étudiants ont très souvent un a priori négatif sur les migrant-e-s, qui sont forcément de pauvres hères sans instruction. La plupart de celles et ceux qui étudient à l’étranger sont issu-e-s de familles aisées ou même de familles proches du pouvoir » (pp. 93-94). Finalement, l’auteur trouve refuge auprès d’étudiants congolais d’Alger, avant de s’en aller au Maroc.
La traversée de l’Algérie au Maroc fut également difficile, puisqu’à un moment l’auteur se retrouve caché dans une zone semi-désertique en attendant un passeur : « Nous avions froids, soif et étions réduits à rester allongés par terre et à regarder tourner les hélicoptères » (p. 97). Après s’être rapproché de la frontière : « La douzaine de kilomètres qui séparent les deux villes [Oudja au Maroc, Maghnia en Algérie] est une zone pleine de dangers : les épines, les pierres, les trous et surtout les chiens de garde des fermiers, les agresseurs, les policiers. À trois reprises nous fûmes attaqués par des chiens qui arrivent à plusieurs, parfois même en meute […]. Cette fois-là, je sentis encore une fois la mort toute proche » (pp. 99-100).
L’auteur est une nouvelle fois racketté par son passeur d’Oudja jusqu’à Rabat, lui demandant 300 euros sous peine d’être tabassé. En attendant, il est parqué avec d’autres migrant-e-s dans une chambre d’où ils ne peuvent sortir, sans nourriture, sans couverture, sans matelas, intégralement dépendants de leurs « hôtes » pour l’achat de produits extérieurs (et escroqués au passage). Malgré un harcèlement policier (4 contrôles en un trajet de train) et des dangers supplémentaires liés au fait qu’il a aidé une migrante, l’auteur arrive finalement à Rabat en octobre 2004. Là-bas, il est entassé dans un appartement de trois pièces occupé par plus de 15 personnes, et est contraint de ne sortir qu’a minima pour éviter d’être arrêté.
Au Maroc. « Ou nous nous assumons, ou nous nous consumons »
La suite de cette note de lecture sous forme de note de lecture audio (en haut de l’article)
Vous aimerez aussi
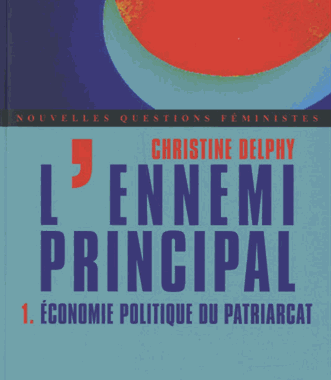
Christine Delphy – L’ennemi principal. Économie politique du patriarcat
8 mars 2017
Giuseppe Rensi – Contre le travail
14 mai 2017