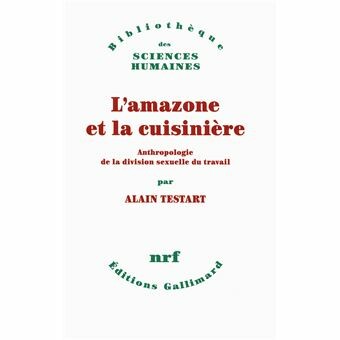Thomas Laqueur – La fabrique du sexe. Essai sur le corps et le genre en Occident
Thomas Laqueur, La fabrique du sexe. Essai sur le corps et le genre en Occident, Paris, Gallimard, 1992
La thèse centrale de ce brillant ouvrage de Thomas Laqueur, historien de l’Université de Californie et également auteur de Sexe en solitaire. Contribution à l’histoire culturelle de la sexualité (Gallimard, 2005), est saisissante : il n’y aurait pas eu d’affirmation d’une dissymétrie radicale des corps des hommes et des femmes jusqu’au 18ème siècle (qui est en réalité un mythe), et donc il n’y aurait eu qu’un sexe (avec de multiples déclinaisons) dans l’idéologie patriarcale pré-capitaliste. Celle-ci serait donc fondée non sur l’idée d’une discontinuité biologique justifiant une discontinuité sociale, donc une hiérarchie sociale, mais au contraire sur celle d’une discontinuité sociale entre des « genres » (« masculin » et « féminin », mais avec une multiplicité d’intermédiaires), laquelle justifierait une hiérarchie sociale malgré un continuum biologique. Et Laqueur d’affirmer que des Grecs jusqu’au 18ème siècle tout au moins, le genre et sa hiérarchie ne se fonde pas sur l’idée d’une dissymétrie biologique de sexe, qu’autrement dit celle-ci ne compte pas. De là à dire, comme Delphy, qu’il y a d’abord (historiquement et/ou dans l’optique d’une explication sociologique du patriarcat) une hiérarchisation sociale de genre, ensuite seulement l’attribution d’une pertinence sociale aux différences anatomiques entre « mâles » et « femelles » humain-e-s, et que donc « le genre précède le sexe », il n’y a qu’un pas.
Cette thèse véritablement révolutionnaire, qu’il nous faut désormais détailler, doit être d’emblée tempérée du fait des critiques sérieuses dont elle a fait l’objet depuis 1990. Il faut d’emblée restreindre cette thèse aux seules différences anatomico-reproductives entre « hommes » et « femmes » : s’il est vrai qu’on pense celles-ci comme faisant partie d’un même continuum biologique jusqu’au 18ème siècle, puisqu’on pense qu’il y a une symétrie entre l’anatomie « mâle » et l’anatomie « femelle » (vagin comme pénis intérieur, ovaires comme testicules intérieures, etc.), l’idéologie patriarcale pré-capitaliste postule néanmoins une discontinuité biologique au niveau des « tempéraments » (des « humeurs », de la chaleur – attribuée aux hommes – ou de la froideur – attribuée aux femmes – des corps, de leur caractère sain – attribuée aux hommes – ou malade – attribuée aux femmes –, etc.). Comme l’explique Elsa Dorlin dans un ouvrage remarquable (qu’il faut lire intégralement), La matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la Nation française (La Découverte, 2009) :
« Pour Laqueur, jusqu’au 17ème siècle, il n’y a qu’un seul sexe « en nature » : c’est l’ordre social qui différencie les corps en hommes et femmes. Or, si nous reprenons le texte de Galien, sur lequel s’appuie principalement Laqueur, il s’agit bien en effet des mêmes organes, mais se tenant en position inversée. Et cette inversion anatomique est précisément le fait de deux tempéraments radicalement différents. Autrement dit, cette inversion est bien physiologiquement fondée. […] [Le] texte de Galien en atteste. Après avoir affirmé que l’homme est plus parfait que la femme à cause de la « surabondance du chaud » et lui, il écrit à propos du corps féminin : « [Les parties] n’ayant pu, faute de la chaleur, descendre et faire saillie au-dehors, elles ont fait de l’animal [femelle] un être plus imparfait que l’être achevé de tous points ». […] C’est la physiologie humorale qui permet de penser la différence sexuelle et les spécificités organiques qui la caractérisent. Par conséquent, on ne peut pas s’appuyer sur l’isomorphisme galénique pour affirmer, comme le fait Thomas Laqueur, qu’avant le 18ème siècle la différence sexuelle n’est pas inscrite dans les corps mais qu’elle est socialement instituée. Comme l’écrivent Katharine Park et Robert A. Nye : « La myopie de Laqueur est ironique : il propose une critique sophistiquée du biologisme du 19ème siècle, mais il ne peut reconnaître comme réel aucun concept médical de la différence sexuelle antérieure à cette période qui ne soit pas exclusivement fondé sur l’anatomie et le monde matériel. »
Le concept de tempérament est donc le point aveugle de la recherche de Laqueur : or, c’est justement lui qui, à l’âge classique, a permis de conceptualiser, de naturaliser et d’inscrire au plus profonde de la chair des corps un rapport de pouvoir » (pp. 21-22). Le lointain héritier du concept de tempérament est sans doute celui d’ « hormones », qui a tout autant servi de justification au système patriarcal de genre.
Il n’en demeure pas moins que Thomas Laqueur, s’il généralise abusivement sa thèse en omettant toute une part de la médecine d’Ancien Régime (et donc de l’idéologie patriarcale de cette époque), montre bien que l’ordre patriarcal pré-capitaliste n’était pas fondé sur l’idée une dissymétrie radicale des anatomies « mâles » et « femelles », comme depuis plusieurs siècles. S’il faut sans doute repousser à des temps davantage anciens (l’Antiquité ?) l’émergence de théories justifiant par une discontinuité anatomico-reproductive radicale entre « mâles » et « femelles » humain-e-s l’existence d’une hiérarchie sociale de genre, en revanche Thomas Laqueur nous permet de voir qu’un pan important de l’idéologie patriarcale des derniers siècles, l’idée d’une discontinuité anatomico-reproductive radicale entre « mâles » et « femelles » comme justifiant une hiérarchie sociale de genre, est en réalité récent, et non pas un état de fait naturel. Après avoir discuté de cette thèse principale de l’ouvrage, venons-en aux différents développements de celui-ci.
Préface de l’édition française
« J’ai cru avoir perçu toute une série de changements radicaux entre la fin du 17ème siècle et l’aube du 18ème siècle dans la compréhension de la différence sexuelle […]. Je crus reconnaître une sorte de longue durée braudélienne dans la représentation corporelle qui remonte aux Grecs et où les signes, dans le corps, de différence sexuelle – génitoires, organes internes, processus physiologiques et orgasme – étaient bien moins distincts, bien moins critiques qu’ils n’allaient le devenir. Le sexe et la sexualité n’étaient pas encore des attributs définitifs du corps, tandis que les différences qui importaient figuraient sur un continuum : plus ou moins de chaleur vitale, plus ou moins de fermeté, plus ou moins de force pour changer de forme, si elles ne relevaient pas de la métaphysique, avec la distinction aristotélicienne entre causes formelles et matérielles. La grande chaîne de l’être s’exprimait dans la chair sans être enracinée en elle. Paradoxalement […] c’était le genre qui était fondateur, quand le sexe n’en était que la représentation. C’est à cette grille imaginaire du sexe que je donnai le nom de « modèle unisexe » avant d’en retracer la chute. À un moment ou un autre du 18ème siècle, tout cela parut changer. On cessa de voir dans les organes génitaux des deux sexes une reconfiguration topologique mutuelle pour les juger désormais radicalement distincts ; on cessa de prendre les ovaires pour des testicules femelles et la menstruation pour une simple manière d’évacuer la pléthore afin d’y voir un trait essentiel de la femme. D’aspect commun de la chair à l’instant de la génération, l’orgasme devint un élément contingent de la reproduction : nombre de commentateurs opinant que les femmes avaient moins de chance d’en faire l’expérience que les hommes. Autrement dit, le sexe, tel que nous le connaissons, devient fondateur, le genre social n’en étant plus que l’expression. D’où le « modèle des deux sexes » » (pp. 11-12).
Ainsi Laqueur introduit-il à son ouvrage. Peut-être faudrait-il préciser, ou même objecter, que « le sexe » biologique n’est jamais fondateur d’aucun rapport social, mais plutôt qu’il peut être dans l’idéologie patriarcale, justifiant une hiérarchie sociale de genre, posé comme « fondateur » de cette hiérarchie qui, soi-disant, viendrait simplement avaliser socialement une inégalité naturelle. En réalité, comme l’explique Christine Delphy, « le sexe » n’est jamais en soi porteur d’une signification sociale, et lorsqu’il devient porteur d’une signification sociale, c’est après l’essor d’une hiérarchisation sociale de genre ayant besoin d’un « marqueur » naturalisant une domination sociale (à l’instar de la couleur de peau, qui ne devient socialement pertinente qu’à partir du moment où elle permet de justifier un système de domination géopolitique et/ou esclavagiste). D’autre part, on peut se demander si, vraiment, le patriarcat pré-capitaliste ne se justifiait qu’à partir de considérations métaphysico-religieuses (de la « côte d’Adam » et du « péché originel » du côté du christianisme), ou s’il se justifiait également à partir de considérations « biologisantes ». C’est ce que Laqueur tente de réfuter, mais suite aux travaux d’Elsa Dorlin, nous savons qu’il n’a que partiellement raison.
En revanche, on suivra Thomas Laqueur sur un autre point :
« A la transgression temporaire des distinctions sexuelles à laquelle donna lieu la Révolution française dans la vie publique [avec ses manifestations de femmes, ses « tricoteuses », ses clubs…], mirent bon ordre diverses structures juridiques et idéologiques fondées sur des différences corporelles capitales entre les sexes. L’effondrement des ordres anciens […] se traduisit par la création d’une nouvelle sphère publique, exclusivement masculine, d’où leur essence corporelle même excluait les femmes » (p. 13).
C’est sans doute vrai que la Révolution française, avec son égalité abstraite des citoyens et son refus des privilèges sociaux, n’avait d’autre choix pour exclure les femmes de la politique que d’invoquer non pas un argumentaire en termes d’ordre social, comme sous l’Ancien Régime, mais un argumentaire en termes d’ordre naturel. Les femmes ne pouvant être exclues au nom du social, elles furent exclues au nom de la nature. L’idéologie naturaliste des Lumières fut ainsi une arme au service de la classe masculine, aux côtés des nouvelles doctrines médicales affirmant une dissymétrie radicale entre l’anatomie « mâle » et l’anatomie « femelle ». C’est précisément ces doctrines qu’étudie Laqueur ; cependant, le « tempérament féminin » fut sans doute également utilisé pour justifier l’exclusion des femmes de la politique, ce qu’omet de préciser Laqueur.
Ainsi, « les progrès des connaissances en anatomie et physiologie de la reproduction […] fournirent les données de base à de nouvelles définitions de la différence sexuelle. […] [Cependant], la ruine du modèle unisexe [relatif] et le triomphe des deux sexes résultèrent d’un enchaînement de développements en d’autres domaines […]. Les structures – économiques, intellectuelles et politiques – d’antan connurent des changements démontrables qui se soldèrent par un changement également démontrable touchant l’intelligence du corps sexuel » (pp. 14-15). Autrement dit, il ne faudrait pas faire une histoire isolée des représentations médicales du corps, sans mettre celle-ci en parallèle avec des transformations sociales : crise de l’Ancien Régime, essor du capitalisme, restructuration du patriarcat…
Pour Laqueur, enfin, même si on doutera de son « modèle unisexe » qu’on trouverait chez Freud (ou alors, comme modèle unisexe androcentrique), il n’y a pas d’histoire complètement linéaire, puisqu’on trouverait des modèles unisexes jusqu’à Freud (et au-delà), et des modèles de deux sexes de l’Antiquité jusqu’au 17ème siècle : « Le sexe unique et les deux sexes coexistent au fil des millénaires ». Le problème cependant d’une telle histoire, c’est que si elle permet de penser des continuités et des non-linéarités, elle est potentiellement porteuse d’une dissolution des ruptures historiques. S’ensuit, après cette préface, des nombreux dessins anatomiques illustrant ses propos.
Préface – Aux origines de La fabrique du sexe
Thomas Laqueur explique qu’à l’origine de ce livre, il y a sa découverte de manuels de sages-femmes du 17ème siècle où il était expliqué que « l’orgasme féminin était l’une des conditions d’une heureuse génération » (p. 21) et comment il était possible de l’atteindre. Et il découvrit que « l’oblitération du plaisir féminin dans les explications médicales de la conception intervient grosso modo au moment même où l’on cessa de comprendre le corps féminin comme un « moindre mâle » (une version inférieure du corps masculin suivant le modèle unisexe) pour y voir son opposé, incommensurable (le modèle des deux sexes). De bien commun, les orgasmes furent alors partagés » (p. 23).
Chapitre premier – Du langage et de la chair
Ainsi, au 18ème siècle, on n’envisageait pas de génération sans orgasme féminin, tandis qu’au 19ème siècle, « la science médicale et ceux qui s’en remettaient à elles cessèrent de voir dans l’orgasme un fait intéressant la génération. […] C’en était fini de l’antique sagesse, suivant laquelle « hors du plaisir, rien de mort ne voit le jour ». Jadis signe de la génération […], l’orgasme se trouva relégué au domaine de la simple sensation, à la périphérie de la physiologie humaine : prime accidentelle, sacrifiable et contingente de l’acte de reproduction » (pp. 28-29). Mais ce changement de paradigme eu des effets distincts en fonction du sexe :
« En principe, cette orientation nouvelle concernait le fonctionnement sexuel des hommes aussi bien que des femmes. Mais […] [personne] n’eut l’idée de prétendre que les passions et plaisirs masculins en général n’existaient point ou que l’orgasme n’accompagnait pas l’éjaculation lors du coït. Telle n’est pas le cas pour les femmes. La contingence nouvellement « découverte » du plaisir ouvrait la possibilité d’une passivité féminine […]. La prétendue indépendance de la génération et du plaisir créa l’espace permettant de redéfinir, de débattre, de nier ou de circonscrire la nature sexuelle des femmes. Ce que l’on ne manqua pas de faire, bien sûr. À n’en plus finir » (p. 29).
Thomas Laqueur montre donc l’émergence récente du « lieu commun d’une bonne partie de la psychologie contemporaine – que les hommes veulent du sexe quand les femmes désirent des relations sexuelles » (p. 29) : ainsi, « les femmes, dont les désirs ne connaissaient point de limites [physiologiques] dans l’ancien ordre des choses et dont la raison offrait si peu de résistance à la passion, devinrent dans certains tableaux des créatures dont toute la vie reproductive pouvait se dérouler insensible aux plaisirs de la chair » (pp. 29-30). La nouvelle idéologie de la sexualité patriarcale devait se révéler performative, produisant pathologiquement des femmes « frigides » puisque niées comme sujets de plaisir, et ce même s’il ne faudrait surtout pas idéaliser la sexualité des sociétés patriarcales pré-modernes. Il s’agit là d’une répression patriarcale du clitoris et de sa fonction érotique et d’un détournement mono-focal des relations génitales vers une pénétration vaginale, et ce en vue d’une satisfaction sexuelle des seuls hommes et d’une reproduction forcée de l’espèce humaine.
Mais cette
« nouvelle conceptualisation de l’orgasme féminin ne fut […] qu’une formulation d’une réinterprétation plus radicale du corps féminin par rapport au masculin. Pendant des millénaires s’était imposée comme un lieu commune l’idée que les femmes avaient les mêmes parties génitales que les hommes si ce n’est que, suivant les mots de Némésius, évêque d’Emèse au 4ème siècle, « les leurs sont à l’intérieur du corps, non pas à l’extérieur ». Galien […] s’attacha longuement que les femmes étaient au fond des hommes chez qui un défaut de chaleur vitale […] s’était soldée par la rétention, à l’intérieur, de structures qui chez le mâle sont visibles au-dehors. Dans cet univers, le vagin est imaginé comme un pénis intérieur, les lèvres sont l’équivalent du prépuce, et les ovaires des testicules » (pp. 30-31).
Au contraire, à partir des années 1800, « des auteurs de toutes sortes résolurent de fonder les différences qu’ils jugeaient capitales entre sexe masculin et sexe féminin […] sur des distinctions biologiques [anatomiques] […]. Au lieu de […] comprendre la différence sexuelle comme une affaire de degrés, de gradations d’un seul et unique type masculin de base, on vit s’élever un appel strident pour articuler des distinctions corporelles bien tranchées » (p. 32). Ainsi émerge un « nouveau modèle de dimorphisme radical, de divergence biologique. Une anatomie et une physiologie de l’incommensurabilité remplacèrent une métaphysique de la hiérarchie » (p. 33).
Ce dimorphisme radicale tranchait avec certaines porosités des patriarcats pré-modernes, qui malgré une domination masculine globale pensaient néanmoins qu’il existait des êtres « transgenres », « transexuels » ou « intersexes » (pour utiliser des anachronismes) : « on ne compte pas les histoires d’hommes allaitant et les images de l’enfant Jésus aux mamelles. Des filles pouvaient se changer en garçons et, à force de fréquenter trop assidûment les femmes, il arrivait que des hommes […] régresse[nt] dans l’effémination » (pp. 35-36). Mais Laqueur dit que cela veut tout simplement dire que dans l’ordre patriarcal pré-moderne, le genre était une catégorie encore plus importante que celle du sexe, malgré leurs correspondances globales. Autrement dit, on pouvait parfois tolérer des intersexes, des transexuels ou des transgenres (au sens restreint de transfuge d’un genre à un autre), mais à condition qu’ils acceptent un des deux genres ordonnant l’ensemble des rapports sociaux : « avant le 17ème siècle, le sexe était encore [avant tout] une catégorie sociologique et non ontologique » (p. 37), affirme même Thomas Laqueur.
Thomas Laqueur refuse de réduire ce changement de paradigme à un simple progrès des connaissances scientifiques, puisqu’effectivement « chez la femelle humaine et chez la plupart des autres mammifères – mais pas chez les lapins, les visons ni les furets –, l’ovulation est en fait indépendante des rapports sexuels, pour ne rien dire du plaisir » (p. 37). En réalité, cette découverte fut ultérieure à la régression des « droits des femmes au plaisir sexuel » : « les progrès scientifiques [du début du 19ème siècle] n’impliquent pas l’abaissement de l’orgasme féminin. Certes, dans les années 1840, il était désormais clair, tout au moins chez les chiens, que l’ovulation pouvait intervenir sans coït et donc, vraisemblablement, sans orgasme. […] Mais à l’appui de cette demi-vérité, on ne disposait que de preuves au mieux légères et fort ambigües » (p. 38). De plus,
« les progrès de l’anatomie du développement au 19ème siècle […] mirent en évidence les origines communes des deux sexes dans un embryon morphologiquement androgyne, et non pas leur différence intrinsèque. De fait, les années 1850 virent une réarticulation au niveau embryologique des isomorphismes galéniques des organes masculins et féminins, désormais conçus comme homologues : le pénis et le clitoris, les lèvres et le scrotum, l’ovaire et les testicules, ainsi que le découvrirent les hommes de science, avaient des origines communes dans la vie fœtale. Ainsi des données scientifiques seraient-elles venues confirmer l’idée ancienne, si celle-ci avait été culturellement pertinente » (pp. 40-41).
À l’inverse, d’ailleurs, « nul ne se préoccupa beaucoup de rechercher […] des différences physiologiques concrètes et anatomiques entre hommes et femmes, jusqu’au jour où ces différences prirent une importance politique. Ainsi fallut-il attendre 1759 pour que l’on se souciât de reproduire un squelette féminin détaillé dans un ouvrage d’anatomie afin d’illustrer la différence avec un squelette d’homme. Jusqu’alors, il n’y avait qu’une seule et même structure de base du corps humain, et cette structure était mâle » (p. 41). De même, les anatomistes de l’époque pré-capitaliste firent « abstraction de données empiriques – des preuves de la conception sans orgasme, par exemple – parce qu’elles ne cadraient avec aucune paradigme scientifique ni métaphysique » (p. 51).
Pour Laqueur, ce changement de paradigme provient d’une part de l’évolution politique (nous dirions, plus généralement, de l’émergence du capitalisme et de la valeur-dissociation de genre) et d’autre part d’une évolution « épistémologique », c’est-à-dire du passage – pour parler comme Descola – d’une ontologie analogiste (une vision du monde en termes de correspondances entre différents phénomènes) à une ontologie naturaliste (une vision du monde marquée par une différence radicale entre « Nature » et « Société », laquelle recoupe celle entre « Femme » et « Homme », comme l’explique Nicole-Claude Matthieu dans « Homme-culture et femme-nature ? »). Cette évolution « épistémologique » est consécutive, selon nous, au basculement vers une société capitaliste de valeur-dissociation de genre (on pourrait même parler, avec Rubin, de valeur-dissociation de sexe/genre, en raison de l’importance du sexe dans l’idéologie du genre contemporaine) en raison du et de valeur-dissociation naturaliste, même s’il faut prendre cette causalité comme une causalité faible, non-mécanique, et relative. D’ailleurs Laqueur affirme que « l’épistémologie seule ne produit pas deux sexes opposés ; elle ne le fait que dans certaines circonstances politiques » (p. 42). Ainsi,
« les explications antiques de la biologie de la reproduction, qui avaient encore cours à l’aube du 18ème siècle, rattachaient les qualités intimes et empiriques du plaisir sexuel à l’ordre social et cosmique. Plus généralement, la biologie et l’expérience sexuelle de l’homme reflétaient la réalité métaphysique sur laquelle, pensait-on, reposait l’ordre social. […] La nouvelle biologie apparut au moment précis où les fondements de l’ancien ordre social se trouvèrent définitivement ébranlés » (p. 42).
Pour autant, on doit bien se garder d’une causalité mécanique, absolue, déterministe :
« En eux-mêmes, les changements politiques et sociaux n’expliquent pas la réinterprétation des corps. […] La théorie politique des Lumières, […] les possibilités cataclysmiques de changement qu’entraîna la Révolution française, le conservatisme postrévolutionnaire, le féminisme postrévolutionnaire, le système des fabriques avec sa restructuration de la division sexuelle du travail, l’essor d’une économie de marché de services ou de marchandises, la naissance de classes, isolément ou de manière solidaire : rien de tout cela ne fut la cause [déterminante] de la formation d’un nouveau corps sexué. Le fait est plutôt que la reformation du corps se trouve intrinsèquement inscrite en chacune de ces évolutions » (pp. 42-43).
Au final, « ce livre porte donc sur la formation non pas du genre, mais du sexe ». Évidemment, son propos « n’est pas de nier la réalité du sexe ni du dimorphisme sexuel en tant que processus évolutif », mais il entend montrer, en s’appuyant sur des données historiques, « que presque tout ce que l’on peut vouloir dire sur le sexe […] contient déjà une affirmation sur le genre » (p. 43). Le corps ne doit donc pas disparaître, selon Laqueur, qui critique son oubli des analyses féministes et/ou post-structuralistes (critique qu’il faudrait nuancer, puisqu’il oublie Tabet et son article au sujet de la procréation), alors même qu’il est partie prenante du patriarcat et du genre au niveau idéologique comme au niveau des rapports sociaux.
Après un long développement, Laqueur présente ses différents chapitres (qu’on abordera rapidement). Le chapitre II, capital,
« porte sur un corps [pré-moderne] dont les fluides – sang, semence, lait et excréments divers – […] se métamorphosent l’un en l’autre et dont les processus – digestion et génération, menstruation et autres saignements – ne sont pas aussi facilement distingués ni aussi aisément assignables à l’un ou l’autre sexe qu’ils le sont devenus après le 18ème siècle. Cette « chair unique », la construction d’un corps unisexué avec ses différentes versions attribués à au moins deux genres, était [toutefois] encadrée dans l’Antiquité de manière à valoriser l’extraordinaire valorisation culturelle du patriarcat, du père » (p. 56).
Le chapitre V, lui, particulièrement intéressant, « brosse un tableau de l’effondrement du modèle unisexe et de l’instauration des deux sexes […] [et] soutient que ces constructions ne furent point la conséquence d’un changement scientifique mais plutôt d’une révolution épistémologique et socio-politique » (p. 57). Toutefois, son chapitre VI se distancie de l’approche de Michel Foucault, selon lequel une epistémè en remplaçait une autre de manière décisive, une fois pour toutes, en montrant les continuations jusqu’à nos jours du paradigme unisexe.
Thomas Laqueur reste pour autant prudent épistémologiquement :
« Que la recherche biologique sur les femmes souffre et ait souffert d’un fort travers misogyne, souvent ouvertement affiché, est un fait ; à l’évidence, la science a historiquement contribué à « rationaliser et légitimer » des distinctions, non seulement de sexe, mais aussi de race et de classe au détriment des démunis. Mais il ne s’ensuit pas qu’une science plus objective, plus riche, plus progressiste, ou même plus féministe produirait un tableau plus fidèle de la différence sexuelle » (pp. 59-60).
On peut critiquer ce « relativisme » épistémique de Thomas Laqueur, surtout à l’aune des découvertes résultant des recherches « féministes » en biologie (celle d’Ann Fausto-Sterling et de Pricille Touraille notamment), même s’il faut bien lui accorder qu’aucun discours n’atteindra jamais « la vérité » au sens absolu (puisqu’il n’y a une non-identité du discours et du réel) et qu’on ne peut que s’en approcher.
Thomas Laqueur termine son premier chapitre en affirmant que cet ouvrage a un but « libérateur » : « mon livre brise les fers anciens de la nécessité et ouvert de nouveaux mondes de vision, de politique et d’éros ». Il faut lire ce livre dans son intégralité, tant il est plus riche que ce modeste résumé que nous venons d’en faire, pour comprendre comment l’idéologie du sexe (et donc du genre) n’a pas toujours été identique et que donc l’idéologie contemporaine du sexe et du genre est dépassable – non seulement au niveau intellectuel mais surtout, espérons-le, réel, par un dépassement émancipateur du capitalisme et du patriarcat.
Armand Paris.

Voline - La révolution russe
Vous aimerez aussi
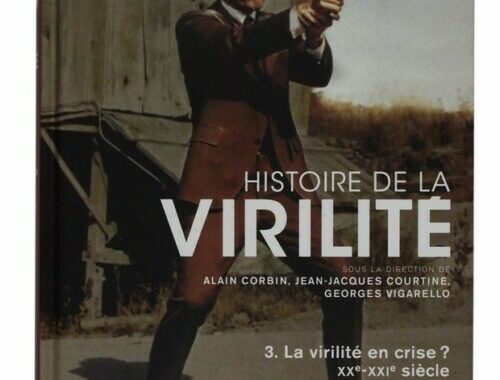
Georges Vigarello – Virilités sportives
21 janvier 2017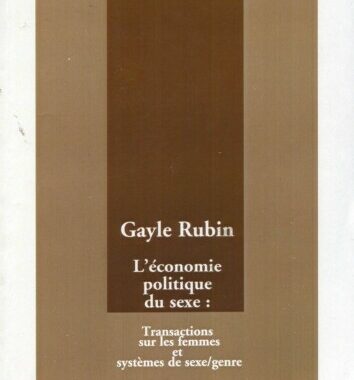
Gayle Rubin – L’économie politique du sexe
9 juillet 2017