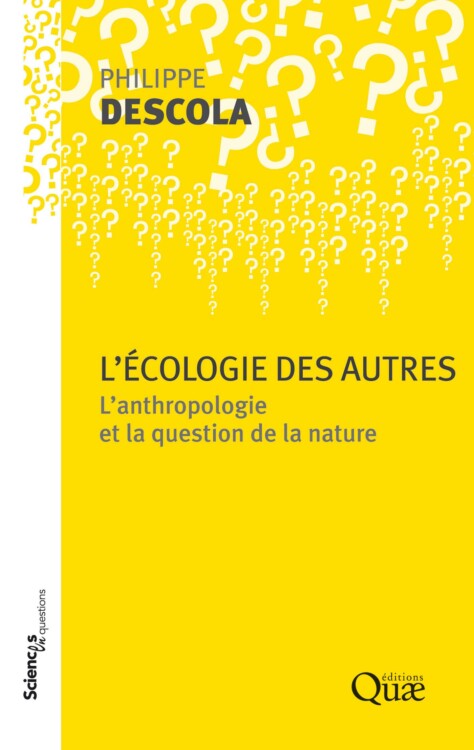
Philippe Descola – L’écologie des autres. L’anthropologie et la question de la nature
Philippe Descola, L’écologie des autres. L’anthropologie et la question de la nature, Paris, Quae, 2011
Philippe Descola est parmi les premier-e-s à avoir mis en évidence le grand partage, ou dualisme, entre la nature et la culture, propre aux sociétés modernes occidentales et qu’on ne retrouve pas chez les autres peuples, du passé ou ailleurs dans le monde. Le dualisme signifie que nous, en tant que modernes, effectuons une séparation entre la nature (les non-humains, tout ce qui est extérieur aux humains – et à Dieu pour les monothéismes) et la culture (ce qui relève des humains et des sociétés humaines). Historiquement, la modernité est datée comme émergeant à partir des XVII-XVIIIème siècle en Europe occidentale, avec des figures comme Descartes et Kant pour la philosophie métaphysique, Galilée, Bacon, Boyle et Newton pour les sciences de la nature, Hobbes et Locke pour la philosophie politique. Ce dualisme moderne aurait servi, selon différent-e-s auteur-e-s [1], d’arrière-fond idéologique, de condition nécessaire, ou de croyance sincère, rendant possible la séparation des humains de la nature, leur mise en surplomb, la maîtrise et la destruction de la nature, au point de parvenir à ce que l’on appelle aujourd’hui l’Anthropocène. L’Anthropocène désigne une nouvelle ère géologique dans laquelle les humains orientent de manière significative la trajectoire de la vie et des conditions de vie sur Terre, conduisant actuellement au changement climatique global et à une crise écologique sans précédent [2]. L’idée, formulée de manière schématique, est qu’à partir du moment où les humains se sont positionnés « comme maîtres et possesseurs de la nature » (Descartes), les conditions métaphysiques et idéologiques étaient réunies pour permettre la destruction de la nature, et que les discours écologiques, aussi fondés et diffusés soient-ils, ne pourront pas engendrer de nouvelles pratiques tant qu’on demeurera dans cette manière dualiste de concevoir le monde. Certain-e-s auteur-e-s ont toutefois montré les limites du concept d’Anthropocène (tous les êtres humains de manière indifférenciée seraient responsables des problèmes climatiques et écologiques) et ont proposé le concept de Capitalocène pour mettre en évidence la modification qualitative (et pas seulement quantitative) et sans précédent de l’exploitation de la nature à partir de l’émergence du capitalisme [3].
Descola qualifie la manière de concevoir le monde (le mode de composition du monde) comme une ontologie : notre ontologie est qualifiée de naturaliste (fondé sur le grand partage nature-culture), qu’il distingue des ontologies animiste, totémiste et analogiste. Le propos n’est pas de promouvoir les autres ontologies contre la nôtre, mais de nommer et faire exister ces autres conceptions du monde, et de montrer que notre mode de composition du monde n’est pas universel. Dans ce livre, L’écologie des autres, Descola veut montrer comment sa discipline (l’anthropologie) a eu beaucoup de difficultés à sortir de notre ontologie naturaliste (dualiste) pour étudier des peuples qui, eux, ne faisaient pas de séparation entre la nature et la culture, ce qui a donné lieu à des querelles pour déterminer si c’étaient plutôt la nature qui déterminait la culture ou l’inverse. Muni de ce retour critique sur l’anthropologie, Descola dessine un chemin pour l’analyse des relations entre humains et non-humains qui ne retombe pas dans le travers de la projection de notre manière de concevoir le monde sur l’écologie des autres.
L’impasse du grand partage nature-culture
L’anthropologie s’est trouvée tiraillée entre son objet d’étude (des ensembles d’humains ne concevant pas de séparation entre eux et les non-humains) et ses conceptions du monde et principes méthodologiques dualistes :
« La dualité du monde, son partage entre des régularités matérielles universelles et des systèmes de valeurs particularisés, est devenue la dimension constitutive de l’objet de l’anthropologie […]. Or, […] une telle tâche est impossible à mener à bien tant que l’on continue d’accepter les prémisses de départ, c’est-à-dire le fait que l’expérience humaine doit être appréhendée comme résultant de la coexistence de deux champs de phénomènes régis par des principes distincts. » (p. 12)
Voici la question que Descola développe, et qui, loin de se restreindre au champ de l’anthropologie, concerne de manière plus large la manière dont nous envisageons et réalisons notre existence avec la nature, et donc nécessairement aussi entre humains dans une perspective post-dualiste :
« Comment recomposer nature et société, humains et non-humains, individus et collectifs, dans un assemblage nouveau où ils ne se présenteraient plus à nous comme distribués entre des substances, des processus et des représentations, mais comme les expressions des relations entre des entités multiples dont le statut ontologique et la capacité d’action varient selon les positions qu’elles occupent les unes par rapport aux autres ? » (p. 13)
Afin d’illustrer l’impasse dans laquelle ce mode d’appréhension dualiste a conduit l’anthropologie, Descola prend l’exemple de la querelle des palourdes. Elle a lieu en 1976, entre Lévi-Strauss (célèbre anthropologue structuraliste) et des anthropologues nord-américains (selon qui les particularités culturelles s’expliquent par l’adaptation des sociétés aux contraintes environnementales locales), et porte sur « la dimension, la couleur et les vertus alimentaires » d’une grosse palourde d’Amérique du Nord. Le débat, sans rentrer dans les détails de cette histoire, peut se résumer par la question suivante :
« Faut-il considérer la culture comme un dispositif adaptatif aux contraintes naturelles, et donc explicable en dernière instance par des mécanismes asservis aux lois de la matière et de la vie, ou doit-on voir en elle un ordre de réalité entièrement distinct qui n’entretient que des rapports de type contingent avec le milieu écologique et les exigences du métabolisme humain ? » (p. 18)
Après avoir montré les limites de la méthodologie déterministe des anthropologues nord-américains (les particularités culturelles s’expliquent par les particularités naturelles locales), Descola veut réhabiliter Lévi-Strauss en montrant que sa pensée ne peut pas être réduite à un idéalisme où les rapports des humains à la nature s’expliqueraient par des structures mentales. Lévi-Strauss naturalise les opérations de l’esprit (c’est un physicalisme moniste) tout en adoptant un dualisme de méthode (les non-humains servent « d’aliments à la pensée » pour construire des mythes) :
« le lexique des natures non-humaines varie en fonction des environnements avec lesquels chaque culture doit composer, tandis que la grammaire naturelle de l’entendement qui organise ces éléments en énoncés demeure, quant à elle, invariante. » (p. 27)
Cependant, la source de cette querelle est bien le postulat d’une séparation entre la nature et la culture, car même chez Lévi-Strauss l’esprit, qui possède certes des structures « naturelles » invariantes, est séparé des non-humains. Le grand partage n’a pas été remis en cause pour résoudre la controverse.
« Mais les deux pôles de la controverses ont le mérite de donner à voir sous une forme particulièrement nette les contradictions dans lesquelles l’anthropologie s’est enfermée lorsqu’elle a posé que le monde pouvait être réparti en deux champs bien séparés de phénomènes dont il faut ensuite montrer l’interdépendance. À l’une des extrémités, on affirmera que la culture est un produit de la nature, terme générique pêle-mêle des universaux cognitifs, des déterminations génétiques, des besoins physiologiques ou des contraintes géographiques ; à l’autre extrémité, on maintiendra avec force que, livrée à elle-même, la nature est toujours muette, voire peut-être inconnaissable en soi, qu’elle n’advient à l’existence comme une réalité pertinente que traduite dans les signes et les symboles dont la culture l’affuble. » (p. 30)
Comprendre et dépasser le dualisme nature-culture
De nombreux-ses auteur-e-s (pas seulement des anthropologues) ont proposé des pistes pour dépasser dialectiquement ces deux pôles que la modernité a séparés : notamment Maurice Godelier avec le couplage « idéel et matériel », Augustin Berque avec la « trajectivité » des milieux, et Descola lui-même avec la « nature domestique ». Cependant, pour Descola, ces tentatives ne font que tenter de rapprocher les deux pôles tout en soulignant la séparation qui ne se défait pas de l’existence a priori de ces deux pôles.
Les deux manières de relier les deux pôles (nature et culture) se rapportent selon Descola, même si souvent indirectement, aux deux moments de l’œuvre de Marx : soit une nature plurielle transformée par des structures culturelles ou mentales universelles, ce qui se réfère au jeune Marx hégélien et dialecticien « qui s’intéresse à la nature humanisée et historicisée par la praxis » (p. 39) ; soit une nature homogène transformée de manière particulière par chaque société, en référence au Marx de la maturité pour qui la nature est « à la fois conditionnée par l’activité formatrice de l’homme et en partie différenciée de lui par ses déterminations propres » (p. 39).
Marshall Sahlins s’inscrit dans la continuité du jeune Marx sur cette question : « la nature est à la culture comme le constitué au constituant. La culture n’est pas seulement la nature exprimée sous une autre forme. C’est plutôt le contraire : l’action de la nature se déploie dans les termes de la culture ; c’est-à-dire non plus dans une forme propre mais incorporée comme signification » (Sahlins, Culture and practical reason, cité p. 39). La nature n’existe pas a priori, avant et de manière indépendante et séparée de la culture, après quoi elle serait transformée par les humains, c’est au contraire dans les interrelations entre humains et non-humains que la nature prend forme et signification :
« il récuse la possibilité d’appréhender la nature comme une chose en soi sur laquelle des valeurs sociales seraient projetées a posteriori et il concède à la seule fonction symbolique le pouvoir de faire advenir le monde physique à une réalité représentable et exploitable par les humains. […] Autrement dit, c’est la culture qui définit tout à la fois ce qu’est la nature pour les humains et la façon dont telle ou telle société en tire parti du fait des préférences que les usages locaux lui dictent. » (p. 40)
Cependant, si cette démarche ne part pas d’un pôle nature existant a priori, il convient également d’affirmer que le pôle culture n’existe pas non plus a priori, et conclure (comme le font Descola et Sahlins) que nous, modernes, sommes le seul-e-s à séparer nature et culture. Cette démarche ne doit donc pas conduire à expliquer les phénomènes naturels par des faits sociaux et culturels, car la culture comme pôle séparé a priori n’existe pas plus que la nature. Il convient donc d’être symétrique sur ce point (sur cette question, lire Latour, Nous n’avons jamais été modernes et Moore, Capitalism in the web of life [4]).
A l’opposé, une interprétation marxiste du Marx de la maturité considère la nature comme un simple substrat de l’économie et des rapports sociaux, selon une certaine acception du matérialisme historique.
La connaissance des natures-cultures
« Dans l’enquête ethnographique, le dualisme de la nature et de la culture que l’observateur transporte avec lui a ainsi pour effet de lui faire appréhender le système d’objectivation de la réalité qu’il étudie comme une variante plus ou moins appauvrie de celui qui nous est familier, le système local se révélant incapable d’objectiver complètement notre réalité à nous. » (p. 56)
La projection de notre ontologie (mode de composition du monde) dualiste sur les non modernes va de pair avec une dévalorisation des savoirs profanes ou ethno-scientifiques [5] locaux (considérés comme des croyances) par rapport au savoir moderne (considéré comme connaissance vraie). L’anthropologie a ainsi soit séparé la pratique des « représentations », la première étant considérée comme objective, les secondes comme idéologiques, soit considéré que les cosmologies constituaient une volonté de savoir réelle, mais un savoir erroné par rapport à celui des modernes, soit encore étudié les savoirs et croyances comme étant anthropocentriques et nous informant davantage sur les humains que sur les non-humains (c’est l’approche de Durkheim).
Le problème de toutes ces approches est qu’elles partent du postulat d’une nature uniforme qui serait la même pour tou-te-s, comme un environnement inerte et homogène, ce qui conduit à une démarche relevant du réalisme scientifique, c’est-à-dire que la nature obéirait à des lois déterministes en tout temps et en tout lieu, qu’elle est écrite en langage mathématique (Galilée) et que par conséquent le savoir des modernes est plus vrai que ceux des non modernes, qui ne comprendraient pas la réalité de la nature. Cela pose un problème supplémentaire : le fait que nous considérions comme universel notre mode de composition et de connaissance du monde nous empêche de prendre un recul critique sur nous-mêmes et sur la modernité.
La démarche phénoménologique a tenté d’aller au-delà du dualisme, en revenant aux choses mêmes. Descola en discute les apports et les limites :
« il s’agit de décrire les entrelacs de l’expérience du monde social et physique en se dégageant autant que possible des filtres objectivistes faisant obstacle à son appréhension immédiate comme environnement familier. Sont ainsi récusés la quête de principes transcendants, de nature sociologique, cognitive ou ontologique, qui réduiraient les interactions phénoménales à un statut purement expressif, de même que l’emploi de catégories culturelles trop particularisées ou trop historicisées – société, valeur, chose en soi ou représentation – pour rendre compte de la fluidité des relations entremêlant humains et non-humains dans un tissu continu de prises d’identités réciproques. Parce qu’elle tente de s’approcher au plus près de la manière dont les collectivités décrites vivent et perçoivent leur engagement dans le monde, une telle approche gagne sans doute en fidélité, ou en vraisemblance, par rapport à des modes de connaissance mettant l’accent sur le dévoilement de déterminations structurales ou causales. Mais force est d’admettre que l’avantage d’une saisie plus réaliste de la complexité locale s’acquiert aux dépens d’une moindre intelligibilité de la situation globale, c’est-à-dire de la multiplicité de formes de rapport aux existants » (pp. 63-64).
Cette approche phénoménologique s’inspire de Husserl (philosophe phénoménologue) et est notamment développée par Jakob von Uexküll, Augustin Berque et Tim Ingold [6]. Pour Uexküll, il faut opérer une distinction fondamentale entre ce qui relève de l’environnement (Umgebung), c’est-à-dire ce qui nous entoure de manière indifférenciée et non spécifique, et le milieu (Umwelt), à savoir ce qui fait notre milieu propre (par exemple le milieu propre des humains qui est différent et incommensurable par rapport aux milieux des non-humains). L’environnement est la nature des savants modernes, tandis que le milieu est propre à chaque espèce car chacune réalise un prélèvement dirigé dans l’environnement pour constituer son milieu. Le milieu des humains modernes n’est donc qu’un milieu parmi d’autres qui est fallacieusement érigé en tant qu’environnement universel. Pour une introduction et discussion de ces thèses, lire « Le vivant et son milieu » dans La connaissance de la vie de Georges Canguilhem [7]. Augustin Berque, quant à lui, met en relation les travaux du biologiste Uexküll avec ceux du géographe japonais Watsuji Tetsurô, dont il a traduit l’ouvrage Fûdo : Le milieu humain [8]. En effet, Watsuji a également développé des concepts pour distinguer l’environnement du milieu, à la différence près qu’il les applique uniquement aux humains. Berque a par la suite refondé la mésologie, qui était auparavant une science positiviste visant à expliquer les cultures humaines par les déterminations du milieu, et qui devient au contraire une étude des interrelations entre les humains et les non-humains avec leurs milieux, pour penser une éthique de l’habiter. Pour une introduction à ces thèses, lire La mésologie. Pourquoi et pour quoi faire ? d’Augustin Berque. Enfin, Tim Ingold, anthropologue, a notamment proposé le concept d’ « ontologie de l’habiter » pour caractériser les relations des chasseurs-cueilleurs qu’il étudie avec leurs milieux.
Descola critique ces approches car selon lui elles inversent le privilège de l’ontologie moderne énoncé plus haut, en affirmant une supériorité des ontologies non modernes comme étant capable d’aller aux choses mêmes sans avoir besoin pour connaitre, comme les modernes, de postuler une séparation entre le sujet (la culture) et l’objet (la nature). Selon Descola, aucune ontologie n’est « meilleure ou plus véridique qu’une autre » (p. 65) ; il ajoute que « la tâche de l’anthropologie n’est pas de légiférer sur la vérité des ontologies ; elle serait plutôt de comprendre comment, à partir d’une position d’engagement pratique que l’on peut supposer commune à l’humanité, toutes ces ontologies, dont la nôtre, ont pu être tenues pour évidentes en certains lieux et certaines époques » (p. 67). Cependant, nous pourrions objecter que si le processus de connaissance doit dans le mesure du possible s’exempter de tout jugement (et il faut rappeler qu’un savoir n’est jamais neutre), cela ne doit pas exclure la possibilité d’en tirer des conclusions pour mettre en exergue les problèmes notamment écologiques dont est au moins en partie responsable notre mode de composition du monde dualiste. Sans aller jusqu’à affirmer que nous devrions être plutôt animiste ou totémiste ou toute autre ontologie plutôt que naturaliste (i.e. dualiste) – ce qui ne serait pas sans causer d’autres problèmes, liés notamment à des dominations sociales présentes aussi chez les autres ontologies – nous ne pouvons pas faire l’économie d’une critique du dualisme moderne à partir notamment des apports de l’anthropologie. Quant à savoir s’il faut dépasser le dualisme moderne et comment, il s’agit là d’un débat ouvert que nous ne traiterons pas ici, mais dont les auteurs cités précédemment fournissent des pistes pertinentes.
Descola présente ensuite les travaux des sociologues de sciences Bruno Latour et Michel Callon. Nous pensons que si Latour propose un analyse novatrice du dualisme moderne dans Nous n’avons jamais été modernes [9] (dont il serait trop long d’exposer les thèses ici), son approche présente clairement des limites, particulièrement parce qu’elle est idéaliste, dans le sens où elle pose le primat de la conception du monde sur la matérialité de la vie et des rapports sociaux (d’où le titre du livre, selon lequel la modernité ne serait qu’une idée dont on pourrait se défaire sans remettre en question des processus matériels). La principale critique de Descola porte sur la théorie de l’acteur-réseau développée par ces sociologues des sciences, selon laquelle il faudrait étudier les objets hybrides (à la fois de nature et de culture) manipulés par des individus (acteurs) comme étant les nœuds d’un réseau (de scientifiques par exemple). Descola leur reproche d’avoir abandonné toute analyse structurelle :
« Tenter d’éliminer la dualité du sujet et du monde dans la description de la vie collective ne doit pas conduire à négliger la recherche des structures de cadrage à même de rendre compte de la cohérence et de la régularité des comportements des membres d’une communauté » (p. 72).
Conclusion
« Il n’y a donc guère de sens à opposer, comme le fait l’épistémologie moderniste, un monde unique et vrai, composé de tous les objets et phénomènes potentiellement connaissables, aux mondes multiples et relatifs que chacun de nous se forge dans l’expérience subjective du quotidien. Il est plus vraisemblable d’admettre que ce qui existe en dehors de notre corps et en interface avec lui se présente sous les espèces d’un ensemble fini de qualités et de relations qui peuvent ou non être actualisées par les humains selon les circonstances et selon les options ontologiques qui les guident, non comme une totalité complète et autonome en attente d’être représentée et expliquée selon divers points de vue. » (p. 77)
Cette citation de Descola résume bien l’enseignement qu’on peut tirer de son livre : la remise en question du grand partage nature-culture moderne, qui doit être faite pour toutes les raisons évoquées plus haut (ethnocentrisme, crise écologique, etc.), ne peut être faite ni dans l’ancienne approche structuraliste ni dans la théorie trop idéaliste et individualiste de l’acteur-réseau, et qu’on aura certainement besoin d’une pluralité d’approches pour penser cette question. On pourra s’inspirer des travaux de Descola, Ingold, Berque, Canguilhem, Uexküll, Latour, des écoféministes (par exemple Carolyn Merchant), etc. Toutefois, il demeure certain que le dépassement du (ou des problèmes liés au) dualisme moderne ne se fera pas (avant tout ou uniquement) sur le plan des idées et des théories mais dans les diversités d’expériences de vie cherchant à créer une poétique de l’habiter par-delà nature et culture, et au-delà du capitalisme.
Laura M.
[1] Par exemple, Carolyn Merchant, The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution (New York: HarperOne, 1990); Jason W. Moore, Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital (New York: Verso, 2015).
[2] Bonneuil Christophe and Jean-Baptiste Fressoz, L’événement anthropocène : La Terre, l’histoire et nous (Paris: Seuil, 2013).
[3] Andreas Malm, Fossil Capital: The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming (London ; New York: Verso, 2016); Moore, Capitalism in the Web of Life.
[4] Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes (Paris: La Découverte, 2005); Moore, Capitalism in the Web of Life.
[5] Sandra Harding, “La science moderne est-elle une ethnoscience ?,” in Les sciences hors d’Occident au 20ème siècle (Paris: ORSTOM, 1996), 239–61, http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010008921.
[6] Augustin Berque, La mésologie, pourquoi et pour quoi faire ? (Nanterre: Presses universitaires de Paris, 2014); Tim Ingold, Marcher avec les dragons, trans. Pierre Madelin (Zones Sensibles Editions, 2013).
[7] Georges Canguilhem, La connaissance de la vie, Reprint (Paris: Librairie Philosophique Vrin, 2000).
[8] Tetsurô Watsuji, Fûdo : Le milieu humain, trans. Augustin Berque (Paris: CNRS, 2011).
[9] Latour, Nous n’avons jamais été modernes.
Vous aimerez aussi
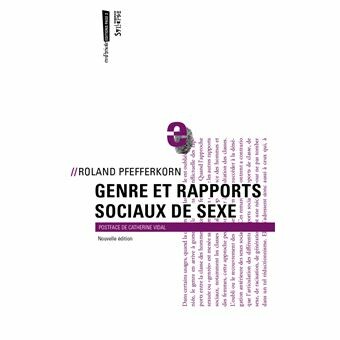
Roland Pfefferkorn – Genre et rapports sociaux de sexe
20 décembre 2016
Voline – La révolution russe
23 juillet 2017