
Michel Surya – Capitalisme et djihadisme. Une guerre de religion
Michel Surya, Capitalisme et djihadisme. Une guerre de religion, Paris, Lignes, 2016
Le titre de cet ouvrage de Michel Surya, philosophe, écrivain, directeur de l’intéressante revue Lignes, était, dès l’abord, prometteur. Tenter de penser ensemble capitalisme et djihadisme est une nécessité, même si l’on pouvait avoir des réserves vis-à-vis du sous-titre, qui semble réduire l’articulation du capitalisme et du djihadisme à une guerre de religion. Nous avons montré dans une émission qu’il fallait au contraire penser l’islamisme comme une idéologie capitaliste.
Michel Surya commence intelligemment par expliquer qu’on ne peut se contenter d’une interprétation sociologique du djihadisme en termes de racisme structurel, même si celui-ci est indéniablement effectif. D’autre part, contre certaines tentations trotskystes (ou autres) de voir dans l’islamisme et sa variante djihadiste une contestation du capitalisme, Surya rappelle avec justesse qu’il « n’est sans aucun doute pas moins hostile à l’anticapitalisme qu’au capitalisme lui-même » (p. 10). En revanche, analyser l’islamisme et sa variante djihadiste comme « déferlement d’un archaïsme historique qu’on ne voit pas à quoi comparer sinon à une variante du fascisme » est clairement réductrice, puisqu’il ne s’agit d’un archaïsme qu’en apparence (il s’agit de l’idéologisation moderne d’une religion archaïque, d’un religionnisme) et qu’il n’y a guère que des analogies troublantes (idéologies de crise, mouvements interclassistes de masse, altercapitalismes) entre djihadisme et fascisme.
Michel Surya fait l’hypothèse – très discutable – de l’opposition entre « deux représentations, ou deux systèmes […] : le capitalisme d’un côté, le djihadisme de l’autre » (p. 15), dont il fait « la première réelle opposition mondiale » depuis 1989. Cette vision est effectivement celle des acteurs eux-mêmes, Etats-Unis et ses alliés d’un côté, organisations djihadistes (Al Qaïda, Daech, etc.) de l’autre. Mais ce serait reprendre à notre compte, même dans une version davantage acceptable (sans l’assimilation de l’islam et de l’islamisme), l’idée d’un « choc des civilisations », des valeurs, etc. Et s’il s’agissait plutôt d’une « opposition spectaculaire » au sens de Debord ? Le djihadisme ne vise en effet nullement à un renversement du capitalisme, entendu comme société du travail, de l’argent, du Marché, du capital, du prolétariat et de l’État : il ne vise qu’à un renversement du capitalisme occidental (libéral, démocratique, mécréant), et à établir un capitalisme islamique et un Etat islamique, à l’instar (mais dans une version sunnite) de l’Iran. Le djihadisme ne s’oppose pas au capitalisme, donc, mais aux valeurs et aux normes du capitalisme occidental, qu’il veut remplacer par des valeurs et des normes islamiques : charia au lieu du droit laïc, rigorisme moral au lieu de libéralisation des mœurs, etc. Le Califat islamique de Daech a d’ailleurs été une société capitaliste.
Le problème de Michel Surya est qu’il fait du capitalisme une « idéologie » (p. 15), même si c’est pour rappeler qu’il se fait passer pour « un état de nature » : mais il s’agit-là plutôt de fétichisme, au sens cette fois-ci d’une naturalisation structurelle des rapports capitalistes. En revanche, il a complètement raison de dire qu’il s’agit, au sujet du capitalisme et du djihadisme, de phénomènes également « politiques » et « religieux » (catégories modernes) : l’un comme l’autre ont un « programme » politico-étatique, et l’un comme l’autre ont une dimension fétichiste au sens large (croyance qu’un « artefact » – feitiçao, en portugais -, Dieu ou des rapports sociaux spécifiques, est naturel, indépassable, positif). En revanche, faire naître de 1989 et de l’effondrement du « socialisme de caserne » (Kurz), c’est-à-dire du « capitalisme d’Etat » (Lénine) bolchévique, le capitalisme comme « radicalisme religieux », et dire que « c’est en tant que le capitalisme est ce radicalisme religieux qu’est né, de lui, contre lui […] ce radicalisme antagonique qu’est l’islam politique radical » (p. 17), est critiquable. En effet, le capitalisme a toujours eu une dimension « religieuse », fétichiste, et l’islamisme ne date pas de 1989, puisqu’il est au pouvoir en Iran depuis 1979 et en Arabie Saoudite depuis au moins 1932. En revanche, Michel Surya a raison de souligner que « « la fin de l’histoire (Francis Fukuyama) était un énoncé téléologique […], théologique […], apocalyptique » (p. 17), même si ce genre d’énoncé n’est pas une nouveauté dans l’histoire du capitalisme (et de l’islamisme).
Michel Surya propose ensuite une hypothèse intéressante : « capitalisme et djihadisme sont l’un et l’autre une variante du puritanisme ; mieux : ils sont l’un comme l’autre une variante violente d’un même puritanisme à son stade terminal » (p. 18). Puritanisme aboutissant à une destruction de tout ce qui n’est pas utile au capitalisme, d’une part, et de tout ce qui n’est pas « islamique » (y compris des éléments pré-islamiques faisant partie des sociétés musulmanes depuis 14 siècles !), d’autre part. Le djihadisme est bien une « passion ascétique » ; en revanche, le capitalisme ne peut être réduit à une « passion narcissique », au moins au sens du narcissisme comme volonté de toute-puissance des individus structurellement « faibles » au sein du capitalisme : il existe également une « passion ascétique » au sein du capitalisme, ne serait-ce que celle du travail ou encore du sacrifice pour un sujet collectif (nation, race, classe).
Michel Surya montre bien, en revanche, que loin d’être une société du plaisir, le capitalisme tardif est une société de frustration, même s’il relit de manière réductrice cette frustration à une distribution inégale de l’argent, et non au travail lui-même : « Nul ne jouit […] aux conditions du capital » (p. 19). Michel Surya fait ensuite du djihadisme une passion ascétique du sacrifice, mais oppose de manière trop radicale « Dieu d’un côté, de l’autre l’argent », puisqu’une partie des djihadistes peut accumuler des richesses capitalistes – même si une autre doit nécessairement se sacrifier. Michel Surya écrit néanmoins de manière décisive : « Le capitalisme [occidental] […] n’a jamais à promettre que d’épisodiques et petits saluts, quand le djihadisme n’en promet qu’un, mais entier, et éternel » (pp. 21-22). Une des raisons du succès du djihadisme, c’est qu’il promet « quelque chose de grand » (Himmler), à l’instar du nazisme. Et cette promesse explique un grand nombre de convertis (sans parler des « born again » de famille musulmane) au sein du milieu djihadiste, au-delà des explications simplistes faisant du djihadisme un phénomène limité aux « communautés musulmanes ».
Michel Surya fait une nouvelle fois une opposition abusive lorsqu’il prétend que « l’un [le djihadisme] s’entend à priver de toute jouissance (les femmes, les homosexuels) ; l’autre à rassasier de toutes (les femmes, les homosexuels – les transsexuels bientôt) » (p. 25). Le djihadisme est effectivement extrêmement misogyne, antiféministe, homophobe ; le capitalisme réellement existant n’en est pas moins réellement patriarcal, homophobe (juridiquement jusqu’il y a peu, socialement encore aujourd’hui), transphobe (non-reconnaissance juridique des transgenres, obligation de subir une mutilante « chirurgie de réassignation sexuelle » pour changer de genre au niveau des papiers d’identité). Là où Michel Surya fait preuve de davantage de finesse, c’est lorsqu’il explique qu’ « une tentation ascétique croissante […] travaille même le capitalisme. Et une tentation narcissique travaille pareillement la jeunesse cultivée des pays à dominante islamique » (p. 26) : il n’y a pas d’opposition absolue entre capitalisme libéral et djihadisme islamiste, puisqu’il y a une dimension ascétique indéniable au sein du capitalisme libéral (tout sacrifier à sa réussite) et une dimension narcissique forte pour ce qui est du djihadisme (tentative d’un devenir-vedette des djihadistes par une spectacularisation médiatique de leurs actes terroristes).
Michel Surya explique également avec raison qu’il n’y a pas de « passion narcissique » qu’au sein du capitalisme tardif et de « passion ascétique » qu’au sein du capitalisme « archaïque » (celui de l’éthique protestante de Max Weber) : le capitalisme produit des subjectivités narcissiques et en même temps ascétiques depuis son émergence historique (cf. notre émission à ce sujet), et ce pour des raisons structurelles et fonctionnelles (des individus narcissiques, c’est-à-dire faibles, sont davantage susceptibles de se sacrifier au travail et pour un sujet collectif, tout comme des sujets ascétiques – on peut d’ailleurs se demander s’il ne s’agit pas de deux faces d’une même pièce, celle du sujet capitaliste).
Michel Surya pointe également, de manière confuse, que l’attitude de sacrifice à une cause supérieure, qui est celle du djihadisme comme celle du révolutionnaire, peut expliquer une certaine fascination de certains révolutionnaires pour des actes djihadistes (même s’il ne s’agit certainement pas de cautionner l’incarcération de Jean-Marc Rouillan pour des propos douteux). Néanmoins, Surya pointe une différence essentielle entre djihadisme et anticapitalisme, l’anti-matérialisme puritain du premier, qui devrait suffire à lui rendre hostile l’anticapitalisme.
Michel Surya affine encore son analyse lorsqu’il affirme : « Nul ne sait d’ailleurs rien encore de l’opposition structurelle réelle du djihadisme et du capitalisme. Les pays (du Golfe par exemple) ne manquent pas déjà où la forme exacerbée de l’un s’accommode sans mal de la forme outrancière de l’autre (de même que le national-socialisme s’est accommodé sans mal du capitalisme qu’il promettait [sous une forme tronquée] pourtant d’abattre » (pp. 30-31). De même, « ces deux passions [narcissiques et ascétiques] qu’on pense s’opposer du tout au tout […] ne s’opposent à la fin qu’en tant qu’elles luttent pour la même domination » (pp. 31-32), celle du capitalisme, qu’il soit libéral ou islamique. Michel Surya rappelle alors l’analyse de Reich, qu’il faudrait actualiser dans l’optique d’une psychologie de masse du djihadisme.

Michel Surya appelle ensuite, de manière confuse, à un dépassement de l’alternative capitalisme ou barbarie, même s’il a pour seul exemple l’URSS qui était pourtant une forme de capitalisme particulièrement « barbare » (cf. nos émissions et nos notes de lecture à ce sujet). Il écrit néanmoins de manière pertinente que dans cette guerre du capitalisme libéral et du djihadisme, « les juifs » sont des victimes importantes, puisqu’ils sont assimilés du côté de l’idéologie djihadiste à des personnifications du « mauvais capital » mécréant, non-productif, immoral. Michel Surya appelle à raison l’anticapitalisme a tenir compte de cet antisémitisme virulent du djihadisme.
Michel Surya s’indigne ensuite contre « l’islamophobie » comme concept, puisqu’il considère qu’il s’agit d’une accusation du matérialisme athée comme responsable du racisme anti-musulmans. Le concept est effectivement fourre-tout, et il est utilisé par des organisations islamistes comme moyen de promotion de leurs idées en se faisant passer pour des victimes. On lui préférera un concept comme celui de « racisme anti-musulmans », désignant une variante du racisme s’attaquant particulièrement aux musulmans, même si des pseudo-musulmans, en réalité athées, agnostiques et/ou libres-penseurs, sont également victimes de ce racisme spécifique. Il faut néanmoins constater qu’il existe bel et bien une angoisse et une peur de l’islam (une phobie de l’islam) depuis 1979, phénomène « islamophobe » résultant pour une part de la crise du capitalisme et pour une autre part d’une offensive médiatique visant à une diabolisation des musulmans pour des buts divers. Il faut donc s’attaquer conjointement au racisme anti-musulmans, y compris dans sa dimension psycho-pathologique d’ « islamophobie », et aux assassinats d’athées au sein du monde à majorité musulmane, car en effet « les religions des opprimés sont-elles, par principe, moins méprisables que celles des oppresseurs ? » (p. 43). Les religions, comme institutions de pouvoir, sont en effet des structures d’oppressions (oppression des laïcs par un clergé), instituant des oppressions (celles des « mécréants ») et justifiant des oppressions (de classe, de genre, raciste, de l’État, du Capital, etc.). Cela n’empêche qu’il faille s’opposer aux discriminations vis-à-vis des musulmans. D’ailleurs, Michel Surya s’attaque à un « dualisme persistant qui voudrait qu’on puisse ne se connaître qu’un adversaire à la fois » (p. 47), même s’il pense plutôt au capitalisme et au djihadisme, et rappelle avec raisons qu’ « il ne fut tout de même pas impossible […] de n’être ni pro-soviétique ni pro-américain (ni stalinien ni capitaliste) » (p. 48). Il faut en effet se refuser à tout campisme.
Michel Surya avance ensuite de manière provocante : « Le terrorisme serait deux fois providentiel, qui permet à l’État de donner à ses réflexes antiterroristes l’étendue dont il rêve, et à l’anti-antiterrorisme une politique d’opposition à l’État, faute d’aucune autre politique réelle (a fortiori anticapitaliste) » (p. 48). Il est vrai qu’il ne faudrait pas se limiter à un anti-antiterrorisme qui nous place sur un terrain qui est celui de l’État. En revanche, on sera en désaccord avec Michel Surya lorsqu’il critique la « confusion involontaire ou entretenue, laquelle confusion mésestime que le premier ne dispose d’à peu près plus aucun moyen [sic] et la seconde de presque tous » (p. 48) : l’État est une structure de domination impersonnelle, et il dispose encore de moyens gigantesques au sein des centres capitalistes, d’un budget de dizaines ou de centaines de milliards, d’une armée, d’une police, d’une administration, etc. Michel Surya se permet même un renversement exagéré, critiquant l’idée du terrorisme d’État (qui n’est, effectivement, qu’une dimension de l’Etat) au profit de celle d’un Etat « terrorisé » par ses créanciers ! Le problème est que dans ce dernier cas, l’État se décharge de sa terreur sur sa population, aux moyens d’une terrifiante politique d’austérité. De manière plus intéressante, Michel Surya affirme ironiquement que « les mesures antiterroristes sont tout au plus faites pour maintenir l’illusion que des libertés existeraient encore » (p. 49), même si cela appelle à une analyse fine de la « sécurité » comme catégorie fondamentale du capitalisme (cf. notre émission avec Memphis Krickeberg).
Michel Surya s’attaque ensuite au « romantisme révolutionnaire » en ce qu’il présenterait des analogies avec ce « romantisme aussi, explicitement contre-révolutionnaire » (p. 52) qu’est l’islamisme. Il est vrai qu’un film comme Nocturama, et sa lecture appelliste, laisse songeur. Quoiqu’il en soit, Michel Surya termine en disant qu « la servitude que la domination est parvenue à imposer n’est qu’accessoirement de nature policière ou de contrôle. Le contrôle qui tend à s’exercer, sans reste en effet, est essentiellement de nature marchande » (p. 52) : cela renvoie à une problématique fondamentale, celle de la sécurité (cf. notre émission avec Memphis Krickeberg).
Au final, Michel Surya, grand spécialiste de George Bataille, nous livre dans ce court ouvrage des intuitions parfois éclairantes, parfois douteuses, mais qui donnent toujours matière à réfléchir, même si c’est à un prix excessif (10 euros pour un livre de 55 pages).
Armand Paris

Bhagat Singh - Pourquoi je suis athée
Vous aimerez aussi

Nouvelles Questions Féministes – La sexualité des femmes : le plaisir contraint
20 novembre 2016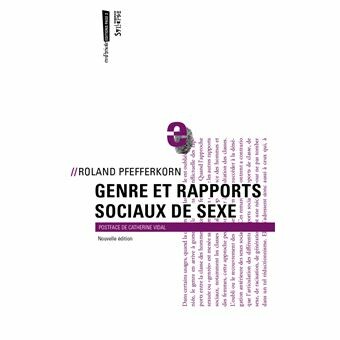
Roland Pfefferkorn – Genre et rapports sociaux de sexe
20 décembre 2016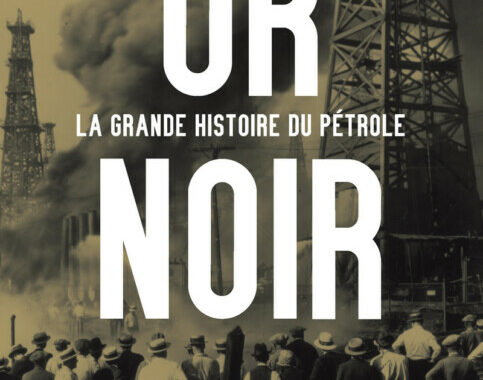
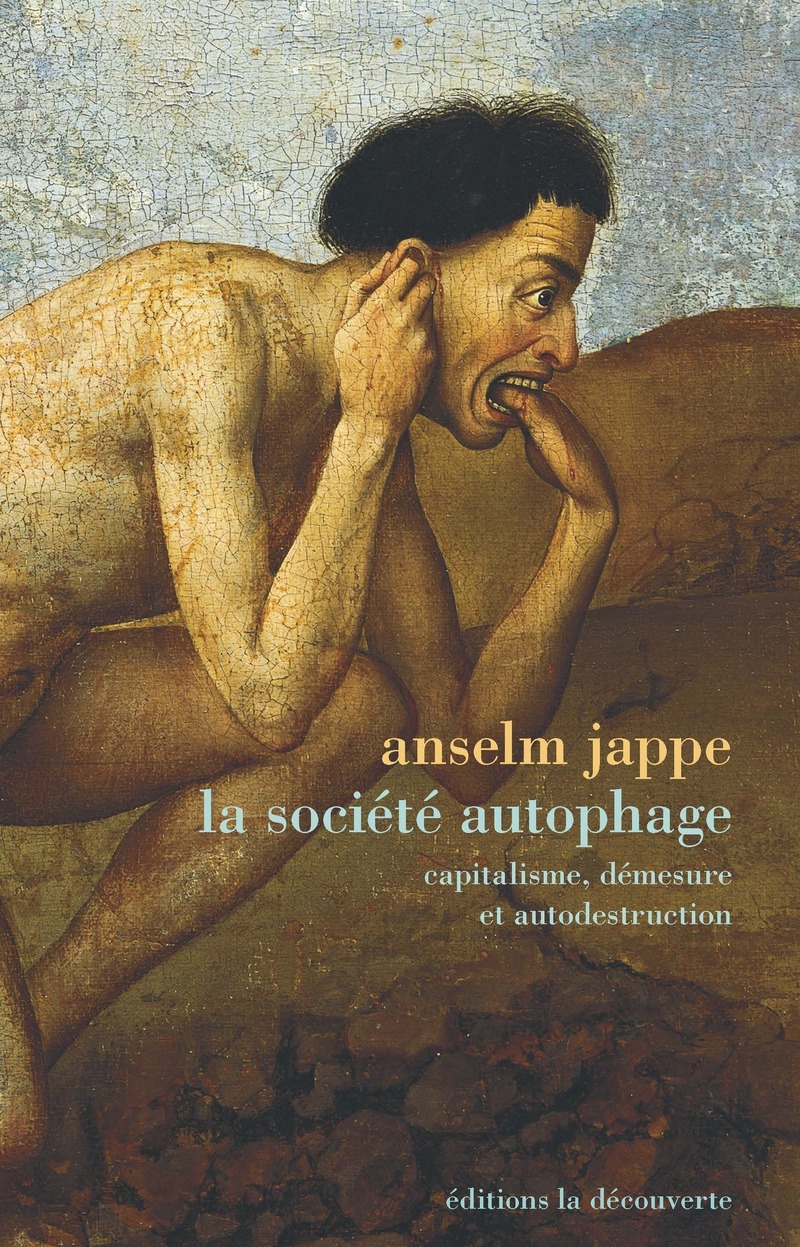

Un commentaire
Ping :