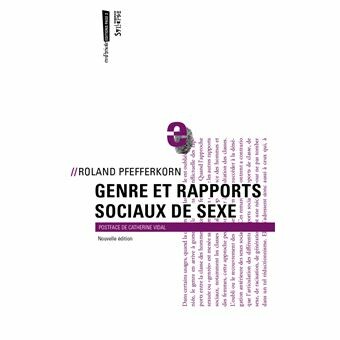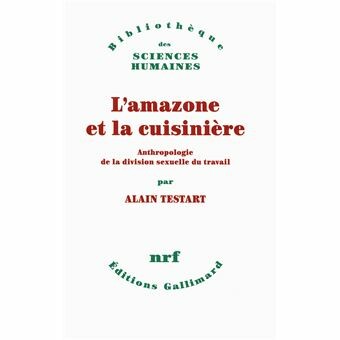
Alain Testart – L’amazone et la cuisinière. Anthropologie de la division sexuelle du travail
Alain Testart, L’amazone et la cuisinière. Anthropologie de la division sexuelle du travail, Paris, Gallimard, 2014
Alain Testart, anthropologue, nous explique dans L’amazone et la cuisinière. Anthropologie de la division sexuelle du travail (Gallimard, 2014) qu’il existe dans l’ensemble des sociétés premières une exclusion des femmes des activités impliquant un jaillissement de sang (même symbolique) ou des perturbations conçues comme analogues à leurs menstruations (perturbations de la mer, perturbations géologiques du sous-sol, etc.) : elles sont ainsi exclues universellement des chasses impliquant un jaillissement de sang, des navires de haute mer (analogie entre leurs perturbations menstruelles et celles des mers et des océans), de la prêtrise (parce qu’il y a le « sang » du Christ ou celui des animaux sacrifiés), etc. L’ouvrage d’Alain Testart est une enquête anthropologique assez intéressante sur cette division-exclusion (même si on parlera plutôt de « division sexuée du labeur », pour éviter toute naturalisation du « sexe » et du « travail »), et qui mérite qu’on s’y attarde.
La faillite des explications naturalistes
La division sexuée du labeur semble être une constante au sein des sociétés premières comme pré-modernes., remarque Testart [Chapitre 1]. Les thèses naturalistes (thèse de la mobilité : femmes exclues de la chasse parce qu’inaptes lorsqu’elles sont enceintes ou avec des jeunes enfants) ou rationalisatrices (thèse de la spécialisation : puisqu’elles sont exclues lorsqu’elles sont enceintes ou avec des jeunes enfants, il est plus « logique » de les spécialiser ailleurs) échouent dans leurs explications [Chapitre 2, « Faillite des explications naturalistes »] : les femmes pré-pubères ou ménoposées sont exclues de la chasse (enfin, précise Testart, des formes de chasses impliquant un jaillissement de sang uniquement, puisque les femmes participent aux autres formes de chasses) également, dans certaines formes de chasses immobiles comme chez les Inuit les femmes sont néanmoins exclues de la chasse, lorsque les femmes participent à la chasse elles sont mobiles comme « rabatteuses » alors que les hommes sont immobiles, la cueillette implique également des grandes distances, etc. Il faut donc une autre explication. Alain Testart explique cette exclusion par des croyances sociales faisant l’analogie entre menstruations féminines comme « perturbations » et un tas de phénomènes impliquant des « perturbations » (tempêtes maritimes, activités sismiques au sein des zones minières, etc.), et rendant tabou un mélange de ces phénomènes considérés comme analogues (ce qui rappelle l’idée d’une « ontologie analogique » chez Descola dans Par-delà nature et culture).
Du sang des animaux et du sang des femmes
« Ce n’est pas la physiologie, ni les grossesses, ni l’allaitement, qui expliquent ce fait premier et massif d’une division du travail entre les sexes […]. Ce sont bien plutôt des faits de croyances, des faits sociaux, qui expliquent un tel fait. Eux seuls peuvent rendre compte de ce que l’on n’a pas seulement écarté les femmes de la chasse, on leur a interdit tout autant le maniement des armes. Or il n’est nul interdit dans la nature (qui connaît des impossibilités, mais pas des prohibitions) ; un interdit est une chose sociale. Cette même explication vers laquelle nous nous orientons se distingue tout aussi radicalement des explications en termes de rationalité économique. Car quoi de plus irrationnel que des femmes chassant […] sans armes ? […] Chaque fois que les femmes font la chasse, elles la font sans les armes typiques de la chasse, sans harpons, ni arcs, ni flèches, ni sagaies. Mais lorsque ces femmes sont indispensables, les femmes sont exclues de la chasse. […] Les armes que n’utilisent pas les femmes sont celles qui font couler le sang des animaux […] La femme ne fait pas la chasse dans la mesure où la chasse fait couler le sang animal et au contraire elle la fait dans la mesure où la chasse ne fait pas couler le sang animal. » (pp. 24-26).
Ce tabou du sang menstruel [Chapitre 3] entraîne une relégation des femmes durant leurs menstruations dans une « hutte menstruelle », à l’écart de tous (elles sont chassées des édifices religieux durant ces périodes dans plusieurs religions). Inversement, une déesse vierge comme Artémis pouvait être déesse grecque de la chasse sanglante puisqu’elle ne saignait pas (p. 28). De même, Jeanne d’Arc pouvait combattre, puisqu’elle était vierge et atteinte d’aménorrhée (p. 36) : « Quand, en la femme, le sang ne coule pas, elle peut, comme les hommes, faire couler le sang ». Le tabou du sang menstruel a donc été un motif d’exclusion sociale des femmes, et en fin de compte de domination masculine, puisqu’il a entres autres permis un monopole des armes et de la guerre, donc une dépendance des femmes en termes de protection.
Une exclusion des femmes de nombreuses activités
Alain Testart passe ensuite en revue l’ensemble des activités dont sont exclues les femmes du fait de ce tabou du « sang dans son jaillissement » (p. 31) : abatage sanglant des animaux (du cochon, par exemple), de la chasse sanglante (encore aujourd’hui), des armes (jusqu’à récemment), de la prêtrise sacrificielle – qu’il y ait sacrifice réel (sacrifice païen) ou symbolique (sang du Christ, d’où l’interdiction des prêtres femmes au sein du catholicisme jusqu’à aujourd’hui), . Les femmes sont accusées (contrairement aux hommes) de toutes sortes de choses, de faire tourner la mayonnaise ou le vin [Chapitre 8], de provoquer des tempêtes [Chapitre 10] ou des tremblements de terre [Chapitre 11], tout cela à cause de ce fétichisme analogiste, et sont ainsi notamment exclues de la marine (jusqu’à récemment) [Chapitre 10]. Elles sont même exclues de la sidérurgie pré-industrielle, du fait de l’analogie entre le four et leur corps [Chapitre 9]. Les femmes peuvent s’occuper d’animaux ensanglantés (dépeçage des animaux, fabrication du boudin), mais elles ne peuvent faire jaillir le sang. Elles ne peuvent, du même couper, pas trancher des plantes ou d’autres matières végétales (pas de défrichage féminin) [Chapitre 12]. Elles ne peuvent labourer profondément [Chapitre 14]. Alain Testart résume : « (1) La femme ne peut faire jaillir le sang parce qu’il est question d’un tel jaillissement en son corps […] (2) La femme ne peut couper les corps parce qu’il semble être question de coupure en son corps […] (3) La femme ne peut perturber de façon soudaine les corps en leurs intérieurs parce qu’elle est sujette à de telles perturbations en son intérieur » (p. 80). Cette folie fétichiste androcentrique, responsable de tant d’exclusion sociale, de souffrances des femmes et de domination masculine, devrait nous enlever toute aspiration primitiviste (cf. également là-dessus Jean-Loup Amselle dans Les nouveaux-rouges bruns), qu’elle soit néo-païenne d’extrême-droite, anarcho-primitiviste ou même éco-féministe. La Nouvelle Droite d’Alain de Benoist ou de Francis Cousin (qui invoque l’anticapitalisme pour appeler à une interdiction de l’avortement !) peuvent fantasmer sur les sociétés païennes, au sein de celles-ci, les femmes sont exclues des armes (donc dépendantes, soumises militairement), de la prêtrise sacrificielle (au sommet de la hiérarchie « religieuse ») et d’un grand nombre d’activités : elles sont seules victimes d’interdits et de tabous, et elles sont soumises militairement comme physiquement (tabassage ou viol en cas d’insubordination).
Une division sexuée des gestes
Testart précise au fil de l’ouvrage cette division sexuée du labeur, et écrit ainsi : « Les outils masculins sont souvent projetés, et on parlera de percussion lancée au contraire d’une percussion posée [caractéristique des outils assignés aux femmes]. […] On peut parler de division des gestes entre les sexes » (pp. 83-85), et cette division est une construction sociale, même quasi-universelle. La logique, au final, est que « la femme étant sujette à de graves perturbations qui l’affectent en l’intérieur de son corps, elle évitera de produire de telles perturbations dans l’intérieur des corps qu’elle travaille » (p. 92).
Des conclusions partiellement contestables
En fin d’ouvrage, Alain Testart nous livre ses conclusions : « Pendant des millénaires, et probablement depuis la préhistoire, la division sexuelle du travail provient de ce que la femme a été écartée de tâches qui évoquaient trop la blessure secrète et inquiétante qu’elle porte en elle. La femme s’est vue écartée de la chasse sanglante parce qu’elle-même saigne périodiquement, écartée de l’abatage du bétail et de la boucherie pour la même raison, écartée de la guerre et de la prêtrise dans toutes les religions qui mettent en jeu un sacrifice sanglante, écartée du four de fonderie parce que celui-ci semble être une femme qui laisse échapper sous son ventre une masse rougeoyante analogue à des menstrues ou à du placenta, écartée de la marine, des navires qui voguent sur les océans et de la pêche en haute mer parce que la mer est susceptible de violentes perturbations tout comme l’est le corps de la femme, écartée de tous les travaux et outils qui, par des chocs répétés, font éclater la matière travaillée et révèlent son intérieur parce qu’il est question de l’intérieur lors de ses indispositions périodiques, etc. La liste de tout ce dont la femme a été écartée est impressionnante. Elle n’en a pas moins travaillé, et travaillé dur, dans toutes les sociétés […] Le plus flagrant dans cette répartition des tâches est que les interdits ou les tabous pèsent sur les femmes seules, pas sur les hommes » (pp. 133-134). Pourtant, les hommes ont également des « perturbations » (l’érection), et celles-ni n’ont pas fait l’objet d’un tabou, même mineur (l’interdiction de s’approcher d’animaux domestiques de sexe féminin, par exemple) : on peut supposer, au contraire d’Alain Testart, que l’absence de tabous masculins est liée à une domination masculine pré-existante (une domination sociale ne se réduisant pas à une plus grande force physique des hommes), même si celle-ci a été amplement renforcée grâce aux tabous des « perturbations ». On peut supposer qu’au moment de l’instauration (même inconsciente) de ces tabous, il y a eu des résistances des femmes, mais que celles-ci ont été vaincues d’une manière ou d’une autre (même brutale : il existe des sociétés pratiquant des viols collectifs, des meurtres de femmes indociles, etc.), et qu’ensuite elles ont été d’autant moins remises en cause qu’ils apparaissaient comme « naturels » (à l’instar des structures du capitalisme au sein de notre société).
Testart poursuit : « Partout […], la femme a été subordonnée à l’homme. Sans doute, les croyances dont j’ai fait état dans ce livre ont contribué à renforcer cette subordination. Car les interdits et les évitements ne concernent que les femmes. Ils les empêchent de faire maints travaux, ils les écartent de façon plus décisive encore de fonctions souvent valorisées dans les sociétés d’autrefois : celle du guerrier, celle du prêtre. » (p. 136). Pourtant, même s’il a raison probablement de dire que « toutes ces croyances que nous avons vues à la base de la division sexuelle du travail » n’ont pas été inventées consciemment dans un but de domination masculine, nous pensons qu’il a tort de ne pas voir c’est justement parce qu’il y avait une domination masculine pré-existante que de telles croyances se sont imposées d’elles-mêmes aux hommes, sans qu’ils aient besoin de les inventer consciemment, et qu’ils ont ensuite imposées aux femmes – étant entendu que ces croyances ne sont évidemment pas apparues de manière universelle et en même temps. Alain Testart pourtant affirme : « L’idée […] a été inventée que les interdits sur les armes, en faisant que les hommes aient le monopole de la violence, sont à la source de la domination masculine. Je pense pareille thèse insoutenable. Aucun homme ne domine une femme parce qu’il possède un arc ou un fusil […]. Lorsqu’une femme est insubordonnée, […] un tabassage suffit en général. Au pire, on prend une ceinture, une lame de rasoir, du vitriol, pas des femmes. Si ces objectifs ne suffisaient pas, il y a encore celle-ci : les évitements relatifs au sang ne concernent pas seulement les femmes. […] Les prêtres catholiques ne doivent pas davantage faire la guerre que les femmes, ni la guerre. Chez les Aborigènes australiens, les jeunes initiés circoncis dont les plaies ne sont pas encore cicatrisées ne peuvent chasser ; chez les Amérindiens, les guerriers qui ont tué un ennemi ne participent pas aux expéditions de chasse, quelques fois même pas pendant un certain temps à de nouvelles expéditions guerrières » (p. 137). Certes, mais sans armes tranchantes, sans une initiation guerrière, des femmes seules ne peuvent se défendre contre des groupes ennemis, fait remarquer Christophe Darmangeat : le monopole masculin des armes et de la guerre place dont les femmes sous la dépendance des hommes, ce qui constitue inévitablement un facteur de domination masculine et de soumission féminine. Et comme Testart affirme implicitement que la domination masculine n’a pas besoin du tabou du sang pour s’imposer brutalement, pour violer, pour réprimer des insubordinations, cela signifie que la domination masculine peut être antérieure aux tabous des « perturbations », qu’elle lui a probablement pré-existée et qu’elle lui a permise de s’imposer. D’autre part, les exemples des prêtres, des jeunes initiés circoncis aborigènes ou des Amérindiens ne nous convainquent pas : certains hommes ne peuvent à certains moments pas faire la guerre, mais ils ont globalement un monopole des armes sanglantes et de la guerre, alors que les femmes sont toujours et partout exclues des armes sanglantes et de la guerre. Certes, « ces croyances et la division sexuelle qui en résulte naissent dans la lointaine préhistoire » (p. 138) avec une grande probabilité, mais cela ne fait que renforcer l’hypothèse d’une domination masculine très ancienne, basée sur une domination violente, renforcée d’un monopole (lui-même, sous une forme peut-être davantage relative, probablement antérieur aux tabous des « perturbations ») sur les armes sanglantes et de la guerre.
Au final, l’approche de Testart (en dépit de sa naïveté concernant notre société contemporaine) nous permet de ne pas considérer le patriarcat ou la domination masculine au sein des sociétés pré-modernes uniquement comme une domination matérielle, brute, physique des hommes, mais également comme un système de croyances fétichistes faite de « tabous ». Testart reconnaît d’ailleurs que ces interdictions « aient contribué à maintenir les femmes dans une société subordonnée, c’est une évidence » (p. 144). Cependant, il refuse d’admettre que l’interdiction du port des armes par les femmes (qu’elle s’explique totalement ou partiellement par l’interdiction du jaillissement du sang) explique un tant soit peu la domination masculine, alors qu’à l’évidence sans armes les femmes deviennent dépendantes des hommes pour se protéger des autres groupes humains hostiles. Il a certes raison de dire qu’une grande partie de la domination masculine passe par une violence non-armée, faite de viols individuels ou collectifs et de tabassages. Le monopole des armes et de l’activité guerrière n’est pourtant pas, semble-t-il, quelque chose d’anecdotique.
Armand Paris
Addentum. Les autres éléments structuraux originels de la domination masculine (Christophe Darmangeat)
On pourra également regretter qu’Alain Testart, focalisé sur la division sexuée du labeur (ou des gestes), omet un certain nombre d’éléments de la domination masculine (cf. la recension critique de Christophe Darmangeat, découverte après avoir écrit cette note de lecture, et qu’on lira avec intérêt en complément), évoquées longuement dans Le communisme primitif n’est plus ce qu’il était. Aux origines de l’oppression des femmes (2012) de Christophe Darmangeat, qui rappelle entres autres qu’il y a un grand nombre de sociétés « premières » ayant des religions initiatiques réservées aux hommes, et impliquant une ségrégation des femmes et des hommes et une domination absolue de ces derniers (cas de Baruya de Nouvelle-Guinée, cf. Maurice Godelier, La production des grands hommes : Pouvoir et domination masculine chez les Baruya de Nouvelle-Guinée, Flammarion, 2009) ; de nombreuses sociétés « premières » pratiquant des viols collectifs ou individuels considérés comme normaux (Inuits notamment), échangeant des femmes avec d’autres tribus en guise de liens d’amitiés, offrant leurs femmes en guise d’hospitalité (Inuits notamment), battant violemment ou liquidant physiquement les femmes récalcitrantes… : au nord de l’Alaska, « après la puberté, une fille est tout bonnement considérée comme un objet sexuel pour tout homme qui la désire. Il l’attrape par la ceinture comme marque de ses intentions. Si elle résiste, il peut découper son pantalon avec un couteau et entreprendre de l’obliger à avoir un rapport. Que la fille soit consentante ou non, leurs relations sexuelles de passage sont vues comme un sujet sans importance particulière parmi les Inuits. Elles ne constituent pas un motif de vendetta de la part de sa parenté (…) L’agression physique et verbale entre les hommes est réprouvée, mais l’agression sexuelle » (cité dans Christophe Darmageat, L’oppression des femmes).
De même : « Les Selk’Nam, une tribu de chasseurs-cueilleurs qui vivait en Terre de Feu, possédaient une religion à initiation ouverte aux seuls adultes masculins. Ceux-ci se grimaient afin d’incarner des esprits qui, lors des cérémonies, venaient terroriser femmes et enfants. À un marin britannique qui s’étonnait que les Selk’Nam ne connaissent aucune espèce de chefs, l’un d’eux, qui parlait quelques mots d’anglais, répondit : « Nous sommes tous des capitaines. » Avant d’ajouter : « Et nos femmes sont toutes des matelots . » » (Darmangeat, L’oppression des femmes, op. cit.). Les Selk’Nam nous montrent ainsi que dans de nombreuses sociétés « premières », on peut assez logiquement parler de « classe » (au sens très large, transhistorique, du Manifeste du parti communiste d’Engels et de Marx) des femmes et de « classe » des hommes.
De plus, « comme chez les Selk’Nam, la religion australienne réservait ses secrets les plus intimes aux hommes adultes, punissant de mort la femme ou l’enfant qui aurait porté la vue sur les objets sacrés. Mais dans bien des tribus, et plus encore que chez les Selk’Nam, les femmes étaient victimes de violences physiques de la part des hommes, que ce soit dans le cadre familial ou lors de captures opérées par la force dans les groupes voisins. Il n’était pas non plus rare que les hommes australiens se prêtent mutuellement leurs femmes pour sceller leurs amitiés, ou qu’ils les violent collectivement, à titre rituel ou pénal. » (Darmangeat, L’oppression des femmes, op. cit.).
En outre, « en ce qui concerne des peuples ayant connu la révolution néolithique et tirant donc, au moins en partie, leur subsistance de l’agriculture et de l’élevage, on trouve là aussi des exemples flagrants de domination masculine – même, et il faut le souligner, chez ceux où les inégalités matérielles entre individus ne se sont pas encore développées. Un des exemples les plus célèbres est celui des Baruya de Nouvelle-Guinée, étudiés par l’anthropologue Maurice Godelier. Ce peuple offre l’image d’une organisation minutieuse de la domination d’un sexe par l’autre au travers d’un ensemble de croyances magico-religieuses. Les hommes entretenaient de mille manières une idéologie de supériorité sur les femmes. L’initiation religieuse des jeunes mâles exigeait qu’ils soient soigneusement séparés des filles et des femmes durant toute leur adolescence. Jusqu’à leur mariage, ils vivaient ainsi entre eux dans une maison spéciale, apprenant à redouter la gent féminine et à se prémunir de ses effets maléfiques. Dans la société baruya, la supériorité des hommes était marquée de toutes parts : dans les dénominations de parenté comme dans la géographie, dans la valorisation des activités économiques comme dans les secrets religieux. Ainsi un jeune garçon était-il automatiquement considéré comme l’aîné de toutes ses sœurs, même de celles nées avant lui. Dans le même esprit, tous les chemins qui serpentaient dans les villages étaient dédoublés, l’un se situant quelques mètres en contrebas de l’autre ; naturellement, le plus élevé était réservé aux hommes. Lorsqu’il arrivait malgré tout à des femmes de croiser la route des hommes, elles détournaient le regard et se cachaient le visage sous leur cape, tandis qu’ils passaient en les ignorant. Les femmes n’avaient – entre autres – pas le droit d’hériter la terre, de porter les armes, de fabriquer les barres de sel. Les outils servant à défricher la forêt leur étaient également interdits, de même que leur était interdite la fabrication de leurs propres bâtons à fouir. Quant aux objets sacrés, flûtes et rhombes, ils étaient protégés du regard des non initiés, enfants et femmes par la peine capitale. Et si l’homme pouvait à tout moment répudier son épouse ou la donner à qui bon lui semblait, celle-ci ne pouvait quitter son mari sans s’exposer aux châtiments les plus sévères. » (Darmangeat, L’oppression des femmes, op. cit.).
Enfin, « le bassin amazonien présente bien des points communs avec la Nouvelle-Guinée. Là aussi, qu’il s’agisse de sociétés de purs chasseurs-cueilleurs égalitaires ou de peuples se livrant à une agriculture itinérante, les femmes étaient globalement dominées par des hommes. Et là encore, souvent, ceux-ci pratiquaient une religion dont eux seuls détenaient les secrets, et ils usaient régulièrement et de manière légitime de violences sexuelles et physiques contre les femmes. C’est ainsi qu’un guerrier Mundurucú, croyant sans doute faire de l’humour, fit un jour allusion aux viols collectifs par lesquels les hommes de son peuple sanctionnaient les femmes récalcitrantes : « Nous domptons nos femmes avec la banane. » (Darmangeat, L’oppression des femmes, op. cit.)
Vous aimerez aussi
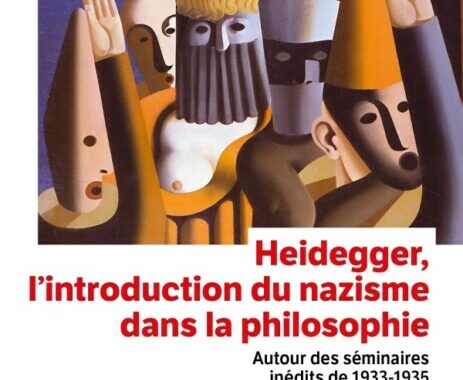
Emmanuel Faye – Heidegger, l’introduction du nazisme dans la philosophie
30 septembre 2016
Emmanuel Mbolela – Réfugié
28 avril 2017