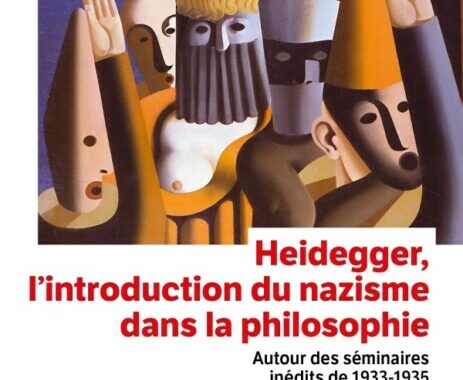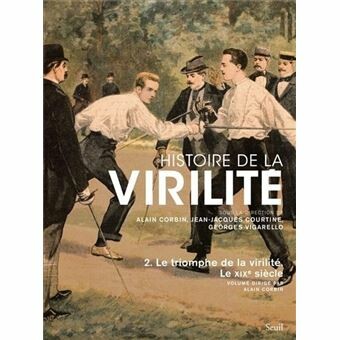
Histoire de la virilité – Le triomphe de la virilité. Le XIXème siècle
Alain Corbin (dir.), Histoire de la virilité. Le triomphe de la virilité. Le XIXème siècle, Paris, Seuil 2011
Introduction générale
Après l’Histoire des femmes en Occident en 5 volumes, une Histoire de la virilité en trois tomes : L’invention de la virilité. De l’Antiquité aux Lumières (sous direction de Georges Vigarello), Le triomphe de la virilité. Le XIXème siècle (sous direction d’Alain Corbin) et La virilité en crise ? Le XXème-XXIème siècles (sous direction de Jean-Jacques Courtine). Une sorte d’histoire (critique, même s’il est possible d’aller beaucoup plus loin) de la domination patriarcale, mais avec comme sujets les dominants eux-mêmes, leurs idéologies et leurs pratiques. Même si on pourra regretter une histoire parfois trop idéelle de la virilité, c’est-à-dire sans analyse des structures réelles du patriarcat « viriliste » (au sens d’idéologie de la virilité, de la domination patriarcale-masculine) [Delphy], surtout au sujet des époques anciennes (d’où l’intérêt particulier des deux derniers tomes), il s’agit d’une bonne introduction aux différentes configurations historiques de la virilité et, par-là, de la domination patriarcale, laquelle prend un caractère spécifique au sein de chaque société historique (grecque, romaine, « germanique », médiévale, d’Ancien Régime, capitaliste [Scholz]) mais non sans quelques continuités (monopole masculin des armes, exploitation domestique, etc.) [Delphy, Testart]. Et cette histoire est écrite « en lettres de sang et de feu indélébiles » (même si l’ouvrage n’en donne qu’un aperçu [Federici]), pour paraphraser Marx au sujet de celle du capitalisme.
Le triomphe de la virilité. Le XIXème siècle
« La période concernée par ce deuxième volume correspond à l’emprise maximale de la vertu de la virilité. Le système de représentations, de valeurs et de normes qui la constitue s’impose alors avec une telle force qu’il ne saurait être véritablement contesté. […] Les physiologistes contribuent […] à l’affermissement de cet ensemble de valeurs. Ils signifient à l’homme que tout le destine à l’action énergique, à l’expansion, à l’engagement dans la mêlée sociale, à la domination. Ils prônent la vigueur des ébats conjugaux. Le couard, le pusillanime, le lâche, l’impuissant, le sodomite sont plus que jamais objets de mépris. La multiplication des lieux de l’entre-soi masculin […] constitue autant de théâtres de l’inculcation et de l’épanouissement des traits qui dessinent la figure de l’homme viril. […] À la fin du XVIIIème siècle, les savants naturalistes imposent explicitement à l’homme de se sentir membre de l’espèce qui domine la Création. « Sois un homme, mon fils ! » » (pp. 7-9). Le deuxième tome d’Histoire de la virilité peut se lire comme une histoire de l’expansion et de l’affermissement du patriarcat capitaliste « classique », avec un changement non seulement idéologique mais surtout social d’avec le patriarcat d’Ancien Régime : naissance de la famille moderne avec sa femme au foyer au sein des classes petite-bourgeoises [Delphy], exploitation patriarcale-capitalistes des femmes dans l’industrie, etc. Certains articles sont plus « anecdotiques » ou plus « idéalistes » (c’est-à-dire font une simple histoire des idées), mais certains sont extrêmement intéressants.
La virilité reconsidérée au prisme du naturalisme
D’emblée, Alain Corbin explique : « La notion de virilité se trouve solidement ancrée dans l’univers mental des Occidentaux bien avant le milieu du XVIIIème siècle. […] Il n’en reste pas moins qu’un approfondissement s’opère alors que Buffon termine son Histoire naturelle de l’homme (1749). Ce texte manifeste et symbolise une emprise du naturalisme, qui conduit à reconsidérer le concept de virilité. Alors s’accentue et se justifie le dimorphisme sexuel qui se trouve désormais inscrit dans l’ « ordre de la Nature » […]. La différence anatomique et physiologique entre l’homme et la femme, répète-t-on, gouverne non seulement la « vie sexuelle » mais toutes les composantes de l’être » (p. 15). Ainsi justifie-t-on aux moyens de la « nature », c’est-à-dire de différences anatomico-biologiques hypostasiées, un ordre patriarcal qui ne se contente plus de postuler que la femme est un « mâle imparfait » (Aristote), inférieur, soumis, mais qu’en plus elle est une sorte d’espèce distincte devant être ségréguée au maximum : ségrégation scolaire, ségrégation professionnelle, et même pour de nombreuses femmes de la petite-bourgeoisie et de l’encadrement (au sens d’Alain Bihr) cantonnement à un espace domestique extrêmement restreint, celui de la « famille » et du « mariage », c’est-à-dire réclusion et surlabeur ménager [Delphy].
Et l’idéologie naturaliste vient justifier cette ségrégation dans l’inégalité avec une théorie du dimorphisme sexuel, puisqu’en effet « en cette fin du XVIIIème siècle achève de s’effacer la croyance en la similitude des organes génitaux de l’homme et de la femme » (p. 17), similitude pourtant réhabilitée aujourd’hui [CNRS]. Et les organes et actes génitaux du mâle sont survalorisés (p. 20), de même que la brutalité de la pénétration sexuelle, qu’on voit notamment chez Sade (p. 22) [Jappe, Kurz]. Mais hors de question pour les femmes de se révolter contre cette brutalité, puisque « selon le Code civil […] l’épouse […] est tenue d’obéir à son mari » en toutes circonstances (p. 26). D’ailleurs, « l’inégalité du traitement juridique de l’adultère se traduit de la manière suivante : selon le code pénal, le mari n’est reconnu coupable que s’il entretient une concubine dans la maison commune. Dans ce cas seulement, la femme peut demander le divorce […]. Le mari (art. 234) est excusable en cas de meurtre de l’épouse et de son complice, lorsque ceux-ci sont pris en flagrant délit, à l’intérieur du domicile conjugal » (p. 27). En cas d’absence d’épouse, les prostituées servent d’ « égoût séminal » (Docteur Fiaux) (p. 29). Mais on valorise plutôt « l’image d’un couple harmonieux, fusionnelle, qui s’accorde à l’ascension du schème du ménage amoureux et d’une idéologie de la famille recentrée sur la densification des sentiments. Cette construction a [pourtant] incontestablement justifié la domination de l’homme » (p. 29).
Le code de la virilité : instances et procédures de l’inculcation
Dans un premier article « L’enfance ou le « voyage vers la virilité » », Ivan Jablonka parle de l’enfance mâle comme d’un enseignement des codes de la virilité : dès un âge précoce, « on doit conformer le garçonnet aux principaux stéréotypes masculins – la bravoure, l’honneur, la loyauté, la volonté de domination, le complexe de supériorité vis-à-vis des femmes. L’âge viril se prépare dès l’enfance » (p. 34). Pourtant, « les enfants semble être, dans leurs premières années, en deçà du genre. Jusqu’à l’âge de 2 ans, garçons et filles portent robes longues, brassières et bonnets ; Les manuels de catéchisme s’adressent aux « petits enfants » indistinctement et les fables peuvent être récitées par tous ; un nombre incalculable de contes, de récits, d’encyclopédies et de manuels sont destinés aux enfants « des deux sexes ». Mais cette généralité est trompeuse : en fait, l’apprentissage de la différence sexuelle et l’imprégnation de commandements virils commencent très tôt » (p. 34). Dès l’enfance, « l’apprentissage des rôles se fait […] à l’aide de jouets – sabres, tambours et billes pour les uns, poupées, paniers et chiffons pour les autres – qui permettent de mimer les occupations des adultes » (p. 35). Les enfants mâles jouent aux petits soldats et à la guerre, contrairement aux petites filles (pp. 36-37). Leurs tenues sont également différenciées, sans que cela soit justifié par la « nature » (p. 38). Le dressage à la virilité a pour but d’inculquer au petit mâle que « son devoir consiste avant tout à aimer Dieu, ses parents, ses frères et sœurs, sa patrie et son travail » (p. 39). Bref, travail, famille, patrie !
Les manuels « tours de France » de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème siècle ne parlent que de « trois femmes – Jeanne d’Arc, Jeanne Hachette et Thérèse de Lisieux » (p. 41) contre des centaines d’hommes – et sans parler du racisme de la littérature enfantine (p. 59). Mais l’éducation des futurs dominants n’est pas pour autant un long fleuve tranquille : « Comme la famille, l’école et le collège sont un univers de violence physique. On y corrige les garçons avec la main, la férule, les verges et, parfois, le martinet et le fouet » (p. 43). Maxime du Camp écrivait ainsi : « Je comprends la haine des écoliers pour ces prisons dans lesquelles on enferme leur enfance sous prétexte d’instruction » (cité p. 43). La violence exerce une fonction disciplinaire [Foucault], tout comme le sport : « En janvier 1880, la gymnastique devient obligatoire à l’école. La grande loi Ferry du 28 mars 1882 précise que, pour les garçons, l’enseignement primaire public comprend la gymnastique et les exercices militaires » (p. 45). Car, pour l’État français comme pour Pierre de Coubertin [Brohm], le sport est une éducation à la guerre (p. 47). Et cette éducation à la guerre peut même être plus directe encore : « En 1881, le ministère de la Guerre a cédé gratuitement à l’Instruction publique « 120 000 fusils hors modèles existant dans les arsenaux de la guerre pour les approprier à l’usage des écoles publiques. Dépourvus de cartouches mais dotés d’authentiques mécanismes et de baïonnettes à pointe arrondie, ils permettent d’initier les garçons de 11 ans au tir, ainsi qu’au montage et au démontage de l’arme » (p. 45).
On élève donc les mâles comme des « êtres-pour-la-mort », des futures victimes de la grande boucherie de 1914-1918. La hantise de la dégénérescence de la race conduit à une éducation « virile », dure, notamment au sein de colonies agricoles pénitentiaires (pp. 49-51) et du scoutisme (p. 60). La masturbation ou toute autre activité sexuelle est condamnée, tout comme un caractère jugé « efféminé » : il faut être mâle au bon moment, pas de manière trop précoce, mais l’être tout de même (p. 54). Bref, l’enfance est transformée en dressage permanent pour conformer l’individu de sexe masculin en un mâle viril, dominant en même temps qu’obéissant.
Dans « L’armée et le brevet de virilité », Jean-Paul Bertaud rappelle lui ce moment central dans la virilisation des mâles qu’est la conscription militaire, introduite au moment de la Révolution française : « L’identité masculine s’acquiert désormais à la caserne » (p. 63). Le conscrit, intégralement privé de ses cheveux, de sa barbe et de sa moustache, subit tout d’abord une « pédagogie de la violence », « faite de brimades qui, débutant par la foire aux bestiaux, ravalent les bleus au rang d’animaux. Puis le conscrit subit la couverte, son corps étant projeté en l’air dans une couverture pleine d’objets coupants. Le lit en bascule ou l’obligation d’exposer à l’air libre ses organes génitaux sont d’autres vexations brutales et humiliantes. Elles sont faites pour détruire l’état social antérieur de la recrue et le construire soldat » (p. 69). Ce virilisme n’est pas incompatible avec des pratiques sexuelles entre mâles, surtout aux colonies où il n’y a pas ou peu de prostituées (pp. 78-79).
Occasions privilégiées de l’exhibition de la virilité
Le duel, auquel François Guillet consacre un long article, en est une. Mais c’est aussi au sein des relations sexuelles que s’exerce la domination patriarcale-viriliste, conclusion qu’on peut tirer de l’article d’Alain Corbin. Dans celui-ci, Alain Corbin part du Dictionnaire érotique d’Alfred Delvau de 1864 et des journaux intimes d’écrivains comme Stendhal, Musset ou Vigny pour montrer « l’affirmation de la supériorité et de la domination masculines » (p. 127) au sein des relations sexuelles. Ainsi, « paradoxalement, compte tendu de l’omniprésence du thème de l’amour romantique dans la poésie et le roman, le code auquel l’homme doit, selon les sources citées précédemment, impérativement se plier implique avant tout le refus du sentiment tendre » (pp. 127-128). Ainsi, selon Alfred Delvau dans son Dictionnaire érotique, « quand un homme dit à une femme « je vous aime », il veut dire […] « je bande comme un carme, j’ai un litre de sperme dans les couilles, et je brûle de l’envie de te le décharger dans le con’ » » (p. 128). Peu romantique, mais qui révèle que les romans d’amour sont en grande partie des manières pour la phallocratie viriliste de duper les femmes : ainsi peut-on voir un décalage entre le roman Le Rouge et le Noir de Stendhal, complètement « romantique », et ses propres pratiques sexuelles. Comme chez Sade, chez Alfred Delvau, « l’homme viril se doit d’ « avoir » des femmes, de les « posséder », dans le sens plein du terme […]. La femme, lit-on encore dans le dictionnaire d’Alfred Delvau, « appartient en effet à l’homme durant tout le temps qu’il l’a tient sous lui, fichée au lit par son clou spermatique » » (p. 128).
Les médecins sont d’accord là-dessus : « La vigueur, l’énergie exigées de l’homme s’accordent alors aux injonctions des médecins. Une certaine violence, la rapidité de l’acte […] sont attendues de l’individu en pleine possession de ses qualités viriles. La chanson gauloise exacerbe, à ce propre, les phantasmes. Il y est question de « crever la cloison », « péter le cylindre », de « foutre tout en sang » la partenaire […]. Delvau résume en une formule lapidaire ce qu’il convient de faire : « baiser avec énergie, sans se soucier d’autre chose que de bien jouir » » (pp. 128-129). On croirait du Sade, d’ailleurs relativement absent de ces tomes d’Histoire de la virilité, et sa négation du statut de sujet des femmes, instrumentalisées, réifiées, réduites à des orifices dont les phallocrates peuvent abuser comme ils souhaitent. « Dominée et soumise », la femme n’est pas prise en compte, son désir et son plaisir semblent ne pas compter, sauf pour renforcer l’ego du mâle phallocrate : du coup, pas besoin non plus de « préliminaires » (p. 129).
D’ailleurs, « ce discours de la virilité démonstrative se justifie par la conviction, sans cesse répétée, selon laquelle la femme jouit automatiquement sous les coups du mâle plein d’ardeur ; ce qui, assez curieusement, implique la certitude et même le primat du plaisir vaginal, alors que les médecins soulignes, de leur côté, l’importance des jouissances clitoridiennes » (p. 129). La phallocratie justifie donc sa violence par une idéologie du plaisir mécanique (et vaginal) des femmes subissant ses assauts, de quoi se donner bonne conscience. « Quoiqu’il en soit, la femme est présentée, dans notre corpus, […] comme dotée d’une lascivité radicale » (p. 129) : réduite à un objet passif. Au contraire, le phallus est l’objet d’une vénération (d’où l’idéologie « phallocratique » et sa sexualité phallocentrique), et plus de cent cinquante termes le désignent dans le seul dictionnaire de Delvau (p. 130).
La phallocratie est d’ailleurs une véritable guerre de domination viriliste : « La métaphore guerrière, qui s’était affaissée dans le discours érotique du XVIIIème siècle, fait retour. Désormais, elle tend à envahir le champ des représentations […]. Bien entendu, ces métaphores s’associent étroitement au schème de la domination, de la défaite, de la blessure que subit la femme. Se trouver en érection, c’est, dans cette perspective, « être au port d’arme ». Dépuceler, c’est « forcer la barricade, la baïonnette en avant ». « Tirer », « carabiner » une femme, c’est la baiser. On donne l’assaut, on assaille sa partenaire. On la fout « à la dragonne » ; ce qui équivaut à « monter sur elle brutalement sans préliminaire d’aucune sorte » » (pp. 130-131). Mais cet assaut phallocratique brutal sans égard pour sa propre sexualité, la femme l’apprécie-t-elle ? On en doute. Et d’ailleurs, « ce système de représentations […] tendent à justifier la violence […]. Ils pèsent sur l’appréciation du viol, alors censé se terminer en plaisir ; la violence faite à la femme est parfois qualifiée dans la chanson gauloise d’ « outrage bienheureux » » (p. 131). C’est un peu aussi ce que dit Alain Soral dans Sociologie du dragueur. Il est d’ailleurs « une autre métaphore qui ne contredit pas radicalement cet imaginaire : celle qui assimile le coït à un labeur, [au travail] […]. En cette perspective, le membre viril est identifié ou comparé à un outil, à un manche […], à un clou, à un aiguillon que la femme « se fait mettre ». […] On parle d’emmancher, de fourrer, d’embrocher, d’enfiler une femme ; il est surtout question de la façonner et de la labourer » (p. 131). Un vocabulaire hautement érotique, sans doute. Et le discours phallocratique de croire que « la seule vue du pénis en érection l’enflamme », trouve-t-on dans un article du Dictionnaire universel de Pierre Larousse (p. 132). Pourtant les phallocrates savent bien que cela ne suffit pas, et dans un texte « Stendhal explique, avec luxe de détails, la manière de violenter une femme » (p. 136) pour qu’elle se livre sexuellement.
Les phallocrates, surtout aristocrates comme Stendhal ou Musset, n’hésite pas à recourir à la violence envers des femmes des classes populaires, et trouvent cela parfaitement normal puisque « au sein des élites, l’enfant, le garçon puis le jeune homme ont eu pour habitude de voir leurs besoins somatiques satisfaits par l’entremise de femmes du peuple » (p. 140). Et Mérimée de raconter fièrement qu’à Valence, « un piastre vous procure une fille de 15 ans très jolie […]. Pour un doublon [42 francs] on avait un pucelage garanti » (cité p. 141). La soumission des femmes n’est pas cependant celles des seules prostituées : l’idéologie phallocratique est tellement hégémonique que la soumission au phallus « est reconnu et admis des femmes elles-mêmes » (p. 149). Elle ne sera battu en brèche, mais de manière minoritaire, qu’avec le mouvement féministe des années 1970, et leur critique de la dictature du coït et ses conséquences non-assumées [Delphy].

Modulations sociales des figures de la virilité
Cette 4ème partie aborde différentes formes de virilités, « militaires », « sportives », « ecclésiastiques » mais aussi « ouvrières ». Nous allons nous concentrer sur cette dernière forme, avec l’article de Michel Pigenet. Le mouvement ouvrier n’est en effet pas exempt de virilisme, et ce dès le 19ème siècle, sans attendre le stakhanovisme stalinien : « Toute une tradition esthétique associe, depuis deux siècles, la figure du travailleur aux attributs les plus manifestes de la virilité » (p. 208). Sans tomber dans un racisme de classe attribuant aux seuls ouvriers un phallocentrisme brutal (on sait qu’il est également celui des aristocrates et des bourgeois), l’article nous permet de voir qu’à côté d’une minorité de puritains réactionnaires dominant une seule femme, à l’instar d’un Proudhon – qui réclame d’ailleurs des « lourdes peines contre les homosexuels » (p. 213) –, de quelques militants pré-féministes (heureusement) et de syndicalistes homophobes (hélas), une large partie des prolétaires, s’ils brandissent également leur virilité ouvrière contre le capital, la brandissent également contre les femmes.
Tout d’abord, nombreux sont ceux qui aux motifs de « s’opposer à un « instrument » patronal de baisse des salaires » (p. 230) s’oppose au travail des femmes, pourtant seul moyen pour elles de ne pas dépendre complètement d’un mâle. C’est un discours analogue à celui anti-immigrés et/ou anti-migrants aujourd’hui… Les femmes mariées d’ailleurs sont soumises à un Code civil qui les empêchent de percevoir elles-mêmes leurs salaires jusqu’en 1907 et de pouvoir exercer une profession sans l’autorisation de leurs maris jusqu’en 1938 (p. 230), et ce sans que le mouvement ouvrier ait fait une priorité de la lutte contre cette inégalité flagrante. La mécanisation en réalité « ébranle les positions masculines les mieux enracinées et attise toutes les craintes » (p. 231), poussant de nombreux hommes à s’opposer à l’intégration des femmes « dans les ateliers de longue date réservés aux hommes ».
Toutefois, la mixité au sein des ateliers pousse progressivement à des changements de mentalité, mais qui restent faiblards (p. 232). Alors qu’en 1832 pour L’écho de la fabrique, « il faut qu’un père puisse par son travail subvenir aux besoins de sa famille », convaincu que les femmes « sont faites pour être épouses et mère », leur « sainte destination » (pp. 232-233), des fédérations continuent de les refuser en 1910 (celle des livres et celle des ports et des docks) sous prétexte qu’elles seraient trop pleurnichardes, trop stupides ou trop vénales (p. 233), et les expériences communautaires continuent de leur attribuer l’éducation des enfants et le (sur)labeur domestique.
Les syndicalistes révolutionnaires comme Pouget et Pataud vont jusqu’à dispenser les femmes des travaux domestiques dans leur utopie révolutionnaire, mais celles-ci restent cantonnées à des « activités sociales éducatives et de soins aux malades » (p. 234), tandis que « la Fédération des métaux prévoit une redistribution des rôles familiaux : lorsque « la maman arrangera les mioches », le papa rangera « un peu la carrée » » (pp. 234-235), ce qui n’est guère révolutionnaire.
Quoiqu’il en soit, au quotidien, les violences patriarcales existent : « On sait ce qu’il en est du dressage des enfants. Si les femmes battues appartiennent à tous les milieux, leur proportion serait légèrement plus élevée dans le monde ouvrier. « Esclaves » des règlements de fabrique, observe Jules Simon, les ouvriers estimeraient « juste [d’être] maîtres chez eux » (pp. 239-240). La violence de la domination capitaliste de classe attise la violence de la domination patriarcale, mais sans l’excuser pour autant.
Toutefois, « la montée de l’intolérance envers les violences, conjugales et autres, est […] perceptible en France » au cours du dernier tiers du 19ème siècle (p. 240). Il semblerait d’ailleurs que « le sport canalise maintes tensions et pulsions, codifie les manières de se battre, circonscrit et exacerbe à la fois les enjeux en termes de prestige territorial, corporatif ou autre, voire entraîne de nouvelles passions propices aux débordements entre pratiquants ou spectateurs. […] Au début du 20ème siècle, les compétitions de gymnastique, de vélo, de rugby et de football dégénèrent assez régulièrement en rixes » (p. 240). Le sport, c’est la guerre virile, en effet [Brohm], mais au moins compte-t-elle peu de victimes femmes, contrairement aux violences conjugales : c’est un exutoire viriliste mais moins patriarcal.
Il n’y en a pas moins des viols, parfois collectifs (p. 240), mais ceux-ci sont d’autant plus mal vus que leurs auteurs sont d’une classe exploitée [NQF]. Ceux-ci peuvent d’ailleurs aller jusqu’à prostituer leurs épouses et leurs filles, du fait de leur grande misère (p. 242) – mais à leur profit, ce qui est éminemment critiquable d’un point de vue féministe. Il y a également des artisans qui abusent sexuellement de leurs apprentis (p. 242) : comme dans l’Antiquité grecque ou romaine, n’est stigmatisé que le partenaire « passif », donc dominé (on l’insulte d’ « enculé »), et non pas « l’homosexualité » (concept émergeant à cette époque) en tant que telle (p. 242). La domination patriarcale s’accentue encore lorsqu’elle se conjugue à la domination de classe, celle de l’encadrement comme du patronat, qui s’accorde plus ou moins régulièrement un « droit de cuissage » [M. V. Louis, Le Droit de cuissage. France, 1860-1930, Paris, Editions de l’Atelier/Éditions ouvrières, 1994] qui n’est rien d’autre que du viol. Ce « droit de cuissage » est régulièrement combattu par les militants ouvriers (p. 244). Mais quelques syndicalistes sont également parfois mis en cause dans des affaires de viol (p. 244), preuve que la domination patriarcale traverse toutes les classes et qu’il ne faut pas idéaliser l’ouvrier de cette époque. Mais la conception de la sexualité devient toutefois moins brutale (p. 245).
D’un autre côté, comme le montre Anne-Marie Sohn dans « Sois un homme » ! La construction de la masculinité au XIXème siècle (Seuil, 2009), la situation n’est guère meilleure hors du monde ouvrier : chez les lycéens du 19ème siècle, « être un homme, c’est à la fois être “bon pour le service” et “bon pour les filles”. Cette majorité sexuelle, toutefois, n’est atteinte qu’après une longue période qui, de l’enfance à l’adolescence, “conduit de l’ignorance à la connaissance”. […] Cet apprentissage s’effectue dans un entre soi masculin, le plus souvent entre camarades. Il repose, sans surprise, sur la transgression, le défi, la violence même. […] Il inculque le vocabulaire et les représentations de la sexualité qui forgent une masculinité dominatrice. Il conduit également les jeunes hommes à intérioriser l’idée qu’ils ont le droit d’accéder aux femmes et à la sexualité au gré de leurs désirs. […] L’apprentissage de la masculinité passe […] par l’obsession de la sexualité et des pratiques qui survalorisent le “membre viril” […] Les lycéens jettent leur dévolu sur des jeunes filles modestes, proies toutes désignées en raison d’un statut social [inférieur] […] Dans ce cadre, les filles sont des pions et les garçons qui leur imposent leurs faveurs font fi de leur libre arbitre […] “Un adolescent doit prouver par son langage comme par ses gestes qu’il peut réifier le deuxième sexe et réduire les relations sexuelles à un exercice génital” (pp. 137-180).

Les théâtres lointains de l’exercice de la virilité
Pour cette cinquième partie, nous allons nous concentrer sur « La virilité en situation coloniale, de la fin du 18ème siècle à la Grande Guerre » de Christelle Taraud. Christelle Taraud rapproche l’idéologie viriliste de l’idéologie colonialiste, ce qui est bien vu étant donné qu’il s’agit de deux idéologies de domination. Comme l’affirme Paul Leroy-Beaulieu, théoricien du colonialisme français de la fin du 19ème siècle : « Une société colonise quand, parvenue elle-même à un haut degré de maturité et de force, elle procrée, elle protège, elle place dans de bonnes conditions de développement et elle mène à la virilité une société nouvelle sortie de ses entrailles » (cité p. 337). La conquête coloniale est d’ailleurs supposer comme visant à « lutter contre la décadence et la dégénérescence, pensées dès le début du 19ème siècle […] dans le sens d’une mollesse et d’un efféminement, supposés en voie de généralisation chez les hommes […]. Alfred Rambaud – professeur d’histoire à la Sorbonne – estime d’ailleurs, en 1885, que lutter contre la féminisation des caractères engendrée par la paix (en Europe) et les facilités de la vie moderne, il est indispensable de faire un grand effort pour reconstituer l’empire et lancer le peuple français (entendons les hommes) dans la course à l’Afrique. Ainsi échappera-t-il à la corruption (du bien-être et de l’avancée des droits des femmes) en même temps qu’il retrouvera ses vertus viriles et ses instincts guerriers » (p. 338).
La conquête coloniale est intrinsèquement virile : « C’est en effet le droit du plus fort – et à mon sens du plus viril – qui a primé pendant toute la durée des installations européennes en Afrique, Asie et Océanie. La conquête de nouveaux espaces – a fortiori par la guerre – étant l’un des lieux majeurs de l’affirmation ou de la réaffirmation d’une puissance virile […]. Véhiculée dans les années qui suivent l’immédiat d’après-guerre [1870], cette idée de la colonisation comme « fabrique » d’hommes véritables et comme espace de régénération virile et nationale – […] « la colonie va revigorer les corps meurtris par la défaite de 1870. Elle va restituer une virilité à des hommes émasculés, épuisés » – était cependant présente dès le début du 19ème siècle dans de nombreux ouvrages traitant de la question nationale et coloniale. Ainsi, Paul Leroy-Beaulieu ne craint-il pas d’affirmer, en 1874, sans risquer de choquer ses contemporains : « L’empire ou la mort ». On constate d’ailleurs une homogénéité des discours, dans l’ensemble de l’Europe, sur cette question de l’espace colonial comme « espace vital ». […] Tous s’accordent […] sur le fait que l’expansion coloniale est devenue essentielle à l’Europe et que les Européens sont, darwinisme social oblige, engagés dans une « lutte pour la vie » d’où émergeront « naturellement » les peuples les plus forts. Ce qui fait dire à Maurice Rondet-Saint dans son livre Dans notre Empire jaune, publié en 1917 : « Sachons être forts, confiants en nous, virils. Et l’Indochine restera à jamais terre française » » (pp. 338-339).
Le virilisme colonial opère dès la conquête de l’Algérie, « marquée par une brutalisation extrême. Incapables de tenir l’intérieur du pays, les Français sont à cette époque réduits à une occupation restreinte qui se traduit par des actes de cruauté et de barbarie […] qui se traduisent, du côté des colonisés, par leur commune bestialisation. Ainsi, dans les récits de conquête […] les « indigènes » sont des « bêtes » fauves, des « animaux » féroces contre qui on peut et on doit employer des moyens exceptionnels. Ces moyens […] se composent de séquestres de terres, d’internement administratif, de responsabilité collective, d’enfumades, de mutilations, d’exécutions sommaires… […]. On peut ainsi répertorier, dans les conquêtes coloniales françaises, […] le nombre de têtes coupées arborées fièrement en trophées par les soldats français ou leurs alliés locaux. […] Il s’agit là, ne nous y trompons pas, au travers de la dégradation et de la mutilation des corps « indigènes », d’une prise de possession qui marque la puissance virile des conquérants. Car, bestialisés, les colonisés sont aussi souvent féminisés. […] Désarmés, les Algériens sont aussi contraints de faire acte d’allégeance dans des procédures de reddition qui s’apparentent souvent à des « unions » où l’Européen est l’homme – puissant, viril et conquérant – et le colonisé la femme – faible, passive et vaincue. » (pp. 339-340).
Ainsi, « brutalité, force et virilité forment donc un trypique fondateur de la guerre de conquête. Ici, d’ailleurs, la France ne possède aucune spécificité […] Ainsi, pendant la révolte des Cipayes entre 1857 et 1858, la répression britannique aux Indes conduit non seulement au pillage et à la ruine de la ville de Delhi mais aussi aux viols des femmes et à l’exécution systématique des hommes » (p. 342). Le « régime du sabre » est partout, et ce même lorsqu’il est représenté par une femme (« Marianne »). La colonisation de l’Algérie une fois achevée, « l’administration coloniale […] prône un modèle de colonisation militaire organisé autour du soldat-colon […]. Les valeurs liées à ce modèle sont claires […] : la terre, le travail, la famille patriarcale et la patrie » (p. 345). La terre une fois appropriée, la colonisation s’approprie également les femmes vaincues : « Elles sont d’abord, du fait de leur statut de femmes conquises, sous le joug d’une forme de « droit au coït » qui est la rançon du vainqueur. […] Avoir des relations sexuelles, consenties ou non, avec les femmes des autres – les « posséder » au sens premier du terme – a en effet toujours été un moyen d’affirmer la puissance sexuelle du dominant, elle-même outil de l’hégémonie coloniale. » (p. 347). Appropriation coloniale des femmes, viols généralisés lors de la conquête de l’Algérie, qu’on retrouve d’ailleurs dans l’ensemble des cas de domination géopolitique depuis l’Antiquité, mais aussi dévalorisation des mâles colonisés : « Réduire les « indigènes », les désarmer, les déviriliser et les domestiquer devient dès lors l’un des ressorts évidents d’une domination qui prend aussi racine dans leur commune efféminisation » (p. 349). Mais si le colonialisme et le virilisme procèdent d’une commune dévalorisation des dominé-e-s, n’est-il pas absurde de revendiquer la virilité lorsqu’on est un colonisé ? Ne faut-il pas plutôt en finir avec le virilisme et son corrélatif, la dévalorisation des dominé-e-s ? Quoiqu’il en soit, le virilisme colonial génère une image du mâle colonisé qui est dialectiquement celle du « pédéraste plus ou moins efféminé » et celui du « prédateur sexuel » (p. 350).
Le colonialisme dévalorise les pratiques sexuelles des colonisés, même s’il ne faut pas oublier que ceux-ci sont également des dominants patriarcaux (vis-à-vis des seules femmes colonisés, en revanche) et qu’à l’époque coloniale on constate des cas de viols inter-colonisés (p. 351). Il faut donc en finir avec le colonialisme et avec la domination patriarcale.
Le fardeau de la virilité
La virilité n’est pas qu’un privilège de dominant, c’est aussi un fardeau : l’interdiction de toute sensibilité, de toute pensée anti-autoritaire, de toute révolte contre ses supérieurs hiérarchiques, etc. C’est pourquoi une pensée émancipatrice et révolutionnaire doit être anti-viriliste, parce qu’elle veut briser cette « cage d’acier » subjective qu’est la virilité, qui enjoint aux mâles de dominer les femmes et en même temps d’obéir à leurs supérieurs hiérarchiques : la virilité est, pour une majorité d’hommes, une idéologie de soumission à un « patriarche » supérieur, alors que l’anti-autoritarisme est un anti-virilisme insoumis. Le virilisme est donc une pensée de la domination patriarcale et de la soumission hiérarchique, et c’est pourquoi il faut s’en débarrasser.
Il faut s’en débarrasser aussi parce qu’à une époque, elle a servi de justification à des lois homophobes, comme l’explique Régis Revenin dans son article « Homosexualité et virilité ». Si la virilité peut s’exercer au sein même d’une relation entre mâles, du dominant « actif » vers le dominé « passif », elle s’exerce aussi de « l’hétérosexuel » vers « l’homosexuel », catégories crées au cours du dernier tiers du 19ème siècle (p. 375). « Au 18ème siècle, la « sodomie » […] est un crime puni de la peine de mort : pendaison en Angleterre, noyade aux Pays-Bas, mise au bûcher dans le reste de l’Europe… » (p. 377). Mais après une relative tolérance de la fin du 18ème siècle et au cours du 19ème siècle, « en échange de la discrétion des homosexuels, c’est-à-dire de leur invisibilité, de leur non-appartient dans la sphère publique » (p. 377), « l’homosexuel » devient une figure de l’ennemi de la race en fin de 19ème siècle, comme on verra au sein du prochain volume d’Histoire de la virilité.
Conclusion. La Grande Guerre et l’histoire de la virilité
Point d’orgue du siècle de la virilité et du patriarcat capitaliste « classique », la Grande Guerre de 1914-1918 prépare en même temps le backlash viriliste du fascisme et du nazisme. Comme l’écrit Stéphane Audoin-Rouzeau, « il semble que, dans un premier temps, la mobilisation massive d’août 1914 soit venue couronner la lente affirmation d’une « image de l’homme » qui, au 19ème siècle, avait rattaché de manière de plus en plus étroite le référent viril à l’ethos guerrier des sociétés occidentales. Une militarisation des jeunes hommes de plus en plus large, jusqu’à ne plus laisser aucun d’eux en dehors de l’obligation militaire dans certains pays (ainsi en France après la loi de 1905), associée en parallèle à un dressage militaire de plus en plus valorisé socialement » tout comme « la mort pour la patrie », tout ceci a fait que « lors de l’été 1914 […] l’acquittement de l’impôt du sang ne fut pas discuté [en fait, si, par une minorité de syndicalistes révolutionnaires et d’ouvriers anti-militaristes], parce qu’il était devenu, tout simplement, indiscutable. » (pp. 409-410).
Le virilisme est ainsi une idéologie qui permet d’envoyer facilement les prolétaires à l’abattoir, et ce d’autant plus qu’il s’agit d’une idéologie de l’obéissance et du sacrifice : le virilisme est une idéologie certes au service de tous les dominants mâles, mais surtout de la bourgeoisie belliqueuse et des généraux. La guerre devait permettre la revirilisation de la « race », ce qui montre bien l’inanité de cette idée de revilirisation, au prix de millions de morts. « Pour autant, la guerre moderne portait dans ses flancs bien des remises en cause de ce modèle militaro-viril, dont l’été 1914 signait en quelque sorte l’apogée. Tout un ethos guerrier, étroitement lié à ce dernier, se trouva bousculé en profondeur par l’efficacité nouvelle du feu et par la terreur prolongé que son déploiement occasionna. Un siècle plus tôt en effet, les soldats occidentaux combattaient « corps redressé » sur le champ de bataille, dans une position verticale imposée au soldat […] mais qui était aussi hautement valorisée et valorisante aux yeux des acteurs eux-mêmes. Ainsi l’habitus viril, soigneusement inculqué au sein du groupe, venait-il stigmatiser toute attitude de protection face aux projectiles […]. C’est cette mise en scène de la virilité guerrière que les combats de la Grande Guerre détruisent en quelques semaines de combat, et définitivement. Au tropisme du corps redressé succède celui du corps couché », impuissant face aux obus, rapidement mutilé ou anéanti (p. 410).
La Grande Guerre est l’aboutissement d’un demi-siècle de virilisme exacerbé en France comme en Allemagne, mais sous la forme paradoxale de la mutilation des corps virils, défigurés, estropiés et/ou invalides (p. 412). La virilité triomphante de l’été 1914 s’était transformée en cauchemar : « Jamais dans l’histoire de la guerre moderne elles n’eurent de conséquences somatiques aussi spectaculaires qu’en 1914-1918 : des soldats devenus mutiques, ou bien sourds, ou bien aveugles ; certains affectés de tremblements ininterrompus de tout le corps […]. D’autres encore dans l’incapacité de se redresser, et se déplaçant désormais le corps plié en deux. D’autres enfin tout simplement paralysés » (p. 413). L’idéologie viriliste-belliciste aura donc comme résultat principal une mutilation physique et/ou psychologique des combattants, preuve s’il en est du caractère mortifère de cette idéologie, même pour ses « bénéficiaires » en temps de paix et dans leur foyer. Et c’est d’ailleurs d’une réaction hyper-viriliste vis-à-vis de cette humiliation virile de la Grande Guerre que va naître quelque chose d’encore plus terrible, d’encore plus asservissant et d’encore plus meurtrier : le fascisme, et son « « homme de fer » forgé dans la fournaise des grandes batailles de matérielle de l’année 1916, et qui a su y survivre ; non plus un homme, mais un homme transformé, un surhomme ou presque, portant le mythe de la virilité guerrière à un sommet encore jamais atteint avec la Grande Guerre. L’ « homme nouveau » des fascismes » (p. 415).
Ainsi, la virilité n’est pas qu’une cristallisation idéologique de la domination masculine ou même de la domination des « actifs » sur les « passifs » : c’est une idéologie de la soumission hiérarchique aux « patriarches » supérieurs comme Hitler, Staline ou Soral (c’est donc un point d’articulation entre domination patriarcale et domination de classes), c’est une idéologie du suicide de masse et de la destruction, et c’est enfin une idéologie fascisante. Voilà pourquoi une émancipation libertaire doit être une (auto)abolition du virilisme, au-delà de la virilité dominatrice-obéissante et de la féminité soumise, un anti-virilisme/contre-virilisme non pas fait de soumission aux mâles virils, de « féminisation », mais d’insurrection des « hommes » et des « femmes » contre l’ordre hiérarchique patriarcal-viriliste et ses sbires fascisants [Incendo]. Et c’est sans doute une des faiblesses de cet ouvrage de ne pas avoir souligné qu’il y a eu des luttes et des pensées anti-patriarcales au 19ème siècle (celles des féministes marxiennes, anarchistes ou même bourgeoises, celles des femmes révolutionnaires dès 1789, et sans parler des résistances quotidiennes des femmes elles-mêmes), et qu’il y a eu des résistances au virilisme militaire, hiérarchique, étatico-capitaliste [Davranche]. Il offre néanmoins un aperçu intéressant du patriarcat capitaliste viriliste au 19ème siècle.
A. Paris
Vous aimerez aussi

Paola Tabet – La grande arnaque. Sexualité des femmes et échange économico-sexuel
23 août 2017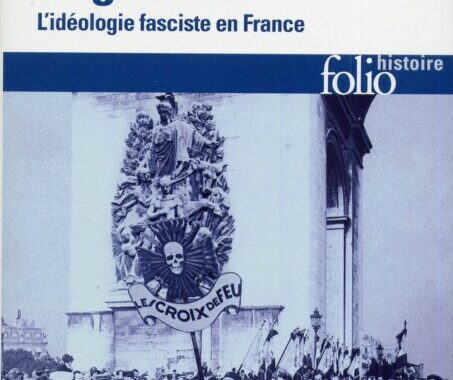
Rouges-bruns [dossier]
9 octobre 2018