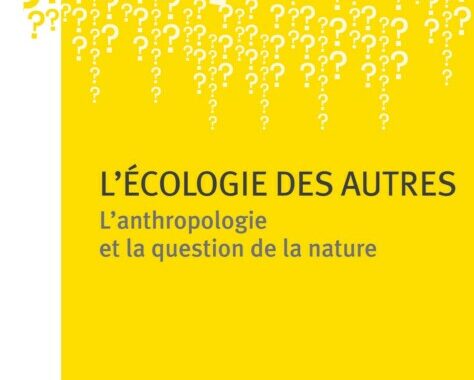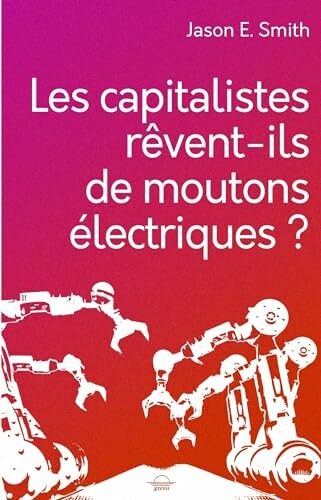
Jason E. Smith. Les capitalistes rêvent-ils de moutons électriques ? L’automation à l’âge de la stagnation.
Nous revenons dans cette note de lecture 1 sur l’ouvrage de Jason E. Smith, « Les capitalistes rêvent-ils de moutons électriques ? L’automation à l’âge de la stagnation », traduit et paru aux Editions Grevis en 2021, et excellemment préfacé par Daria Saburova. Si Smith n’aborde pas frontalement la question désormais omniprésente de l’intelligence artificielle générative (nous y reviendrons sommairement en conclusion), il nous semble néanmoins défendre un point de vue contemporain et original sur la question de l’automation au début du XIXème siècle.
Ce livre s’inscrit d’abord dans un contexte anglophone où les discours sur l’avènement d’un âge des machines caractérisé par une automation totale du travail fleurissent, nourrissant ainsi une ribambelle de projections de droite comme de gauche, autour de thèmes tels que la fin du travail, l’oisiveté heureuse dans une société post-capitaliste d’abondance, mais aussi la croissance du chômage et l’augmentation des désordres sociaux. Jason E. Smith prend à contre-pied toutes ces analyses en s’efforçant de démontrer que notre époque se caractérise avant tout — comme l’indique le sous-titre du livre — par une stagnation économique.
Avant de pousser plus en avant cette notion de stagnation, suivons Smith sur sa définition de l’automation :
« Les facteurs décisifs dans la définition de ce qu’est l’automation, par contraste avec la mécanisation et la rationalisation, sont doubles : d’une part, le type de travail humain substitué (le remplacement non seulement d’opérations simples, mais aussi de la prise de décision et de la supervision) ; d’autre part, et c’est l’aspect le plus important, l’intégration d’opérations de manufacture auparavant discontinus afin que le processus de travail soit transformé en un flux continu, interrompu » (p.47)
La mise en œuvre de l’automation est donc indissociable des technologies informatiques et de contrôle (boucles feedback). On comprend néanmoins à la lecture de cette définition que l’automation totale, c’est-à-dire la disparition de toute intervention humaine dans le procès de travail, est loin d’être réalisée. De plus, toute analyse qui se concentrerait uniquement sur les secteurs productifs les plus automatisés risque de négliger la part importante de secteurs intensifs en travail et peu automatisés : l’automation n’est pas uniforme, elle est intrinsèquement hétérogène et inégale.
L’automation se déploie donc dans un environnement économique caractérisé par une stagnation qui, depuis environ la moitié des années 1970, prend diverses formes discutées par Smith. Tout d’abord, Smith remarque que plus la stagnation devient évidente, plus les discours sur les supposées vertus miraculeuses de la technologie contemporaine sont audibles. Concernant les indicateurs macro-économiques, Smith souligne une baisse des investissements des entreprises 2, engendrant une inertie technologique, des phénomènes de rentes et des stratégies financières (rachat d’action) qui ne favorisent pas l’innovation. Il observe aussi une stagnation des salaires réels, sans hausse significative des chiffres du chômage, en contradiction avec ce que supposerait la loi de l’offre et de la demande sur le marché du travail. Smith passe plusieurs facteurs explicatifs en revue, notamment les artefacts statistiques (non-inscription en tant que demandeur d’emploi) ou l’érosion des rapports de forces favorables aux travailleurs. Selon lui cependant, le facteur majoritaire réside dans la chute de la productivité du travail. Smith nous rappelle que, si les salaires ont augmenté durant les Trente Glorieuses, c’est grâce à des gains significatifs de productivité du travail qui ont permis à la fois d’augmenter les salaires et de préserver les marges du capital (ce qui a pu être appelé compromis fordiste). En l’absence de gains de productivité, « même les organisations de travailleurs les plus vaillantes ne peuvent rien contre les conditions et limites matérielles » (p. 109). Cette chute de la productivité du travail, a notamment été décrite dans le cadre du paradoxe connu sous le nom de paradoxe de Solow depuis 1987 :
« [l’informatique, ] que tout le monde considère comme une révolution technologique a partout été accompagné d’un ralentissement de la croissance de la productivité, et non par une augmentation. L’âge de l’ordinateur est retentissant partout sauf dans les statistiques de la productivité » (p. 61).
Contre ce paradoxe, certains économistes défendent l’idée d’un déphasage technologique, lié au temps de diffusion de la technologie dans l’ensemble des strates de la société. Néanmoins, Smith indique que la « reprise » ou l’émergence d’un nouveau « régime technologique » (Mandel, Kondratieff) se fait encore (trop) attendre.
Pour expliquer cette chute de la productivité, Smith mobilise de manière critique la théorie de William Baumol. Cette théorie postule qu’une fois atteint un certain stade de développement économique, on peut identifier deux pôles, d’une part un secteur évolutif et dynamique technologiquement, d’autre part un secteur stagnant. Les gains de productivité déplacent la main d’œuvre du premier vers le second secteur. Par ailleurs, ces mêmes gains de productivité permettent de baisser le coût unitaire de certaines marchandises. A salaire constant, la part de salaire nécessaire pour acheter ces marchandises diminue, ce qui permet de reporter la consommation vers des biens produits par le second secteur (et donc de faire augmenter la demande en main d’œuvre de ce secteur). L’ensemble décrit un « processus harmonieux » (p. 115) avec néanmoins des différentiels de productivité croissants entre les deux secteurs, ce qui a pour conséquence une chute globale de la productivité :
« la croissance globale de la productivité pour la main d’œuvre prise dans sa entièreté ne peut qu’être en baisse, puisque tout hausse supplémentaire dans l’output d’une économie dont la croissance de la productivité est ralentie demandera la mobilisation de plus en plus de main d’œuvre pour la réaliser » (p. 115)
De manière implicite, ces deux secteurs correspondent d’une part à l’industrie, d’autre part aux services. L’analyse de Baumol décrit donc le phénomène de désindustrialisation (baisse de la part d’emplois industriels), observé de diverses manières aux Etats-Unis, en Europe et même partiellement en Chine. Ici, on renverra à l’ouvrage d’Aaron Benanav, « L’automatisation et le futur du travail » (Ed. Divergences), qui contient de nombreuses statistiques intéressantes. Smith est néanmoins très critique de la notion de service qui « englobe tout [ce qui n’est pas l’industrie] et apparaît finalement comme opaque » (p. 123). D’un point de vue macro-économique, la classification de service se fait d’abord à l’échelle des entreprises, indépendamment des emplois et postes réellement occupés. L’externalisation de certaines tâches et la sous-traitance peuvent ainsi faire apparaître comme service ce qui était auparavant interne à une industrie (et aurait donc été catégorisé comme industriel). La division croissante du travail rend aussi particulièrement complexe la distinction entre les tâches qui participent directement à la production et celles qui n’y participent pas. Dans cette catégorie fourre-tout, il est possible de repérer des emplois susceptibles de résister d’avantage à une certaine rationalisation et automatisation. C’est le cas par exemple des emplois, souvent moins délocalisables, dont la production est consommée immédiatement ou proche du lieu de production ; des emplois à bas salaire (compétitifs face à de l’investissement en machine) ; ou encore trop complexe à automatiser, par exemple tous les services à la personne requérant des compétences humaines et culturelles parfois implicites et difficiles à acquérir. Néanmoins, ce n’est pas une généralité : certains services se prêtent bien à l’automatisation, à l’image des fast-foods ou des caisses automatiques.
La notion de productivité est également très ambiguë. La productivité est un ratio entre un input et un output, mais son évaluation en termes monétaires ou en termes concrets mène à des interprétations différentes. Smith nous donne un exemple éclairant :
« Imaginons une entreprise capable de baisser de moitié le prix de ses chaussures (de 100 à 50 dollars américains), tout en doublant le nombre de paires de chaussures qu’elle produit et vend (de 50 000 à 100 000 unités). En termes d’argent, le résultat (output) généré est le même, soit 5 millions de dollars. Une telle entreprise n’aurait donc pas fait montre, en termes d’argent, d’une augmentation de la productivité du travail, même si les changements technologiques dans les processus du travail (…) doublent le nombre de paires de chaussures produites. Cette distorsion existe aussi dans l’autre sens. Si une entreprise (…) génère le même volume de production (output) et que le prix de vente unitaire augmente, alors l’output en termes d’argent augmente lui aussi. (…) Dans le cas du secteur évolutif, les gains de productivité sont cachés ; dans le cas du secteur stagnant, les gains sont attribués là où il n’y en a pas » (p.128)
On voit bien ici les limites d’une analyse qui ne serait basée que sur le sens commun de la productivité (passer moins de temps à produire une même marchandise, donc être plus efficace). Par ailleurs, si l’exemple précédent s’intéresse à l’évaluation monétaire ou concrète de l’output (le numérateur du ratio définissant la productivité), Smith s’intéresse également à l’input. C’est là que l’on retrouve les stratégies d’intensification du travail (productivité horaire améliorée) ou de compression salariale (baisse du coût du travail), qui peuvent être déployées sans aucune modification technologique du procès de travail.
Du point de vue d’un investisseur, seule l’évaluation en termes monétaires permet de comparer la productivité entre différentes entreprises ou différents secteurs. Cela a néanmoins pour conséquence d’exclure de l’analyse toutes les activités qui n’ont pas de prix (travail n’ayant pas de valeur d’échange mais une valeur d’usage), comme par exemple le travail reproductif non rémunéré. Et, au contraire, cela inclut dans l’analyse des activités vendues sur le marché (donc des emplois salariés) dont on peine à identifier ce qu’elles produisent vraiment (travail n’ayant pas de valeur d’usage mais une valeur d’échange), et pour lesquelles assigner une productivité est faisable mais douteux. Tel est le cas par exemple des banquiers, enseignant-e-s, ou agents de sécurité.
Si donc, la notion de service est trop englobante et celle de productivité discutable suivant les emplois considérés, que faire ? Smith propose alors de revenir à la théorie marxienne à travers trois notions : la baisse tendancielle du taux de profit, le travail productif et le travail improductif.
« Quand les marges de profits sont réduites, la somme de capital disponible pour l’investissement, au-delà des coûts nécessaires à faire perdurer les opérations en cours, se réduit elle aussi. Le taux de profit peut donc être compris comme ayant un rôle crucial de régulation dans la performance des économies capitalistes, puisqu’il détermine (c’est-à-dire qu’il pose les limites) le taux d’investissement et, par conséquent, tous les indicateurs précédemment mentionnés : le chômage, la productivité, la rémunération des travailleurs » (p. 143)
Si la définition du taux de profit n’est pas consensuelle dans l’économie majoritaire, l’analyse marxienne est bien plus claire. Le cœur de l’analyse repose sur deux aspects. D’une part, la composition organique du capital, c’est à dire la part du « capital « constant » (l’infrastructure, le matériel, les matières premières, l’informatique etc.) » et la part du « capital « variable » (le coût de la force de travail, ou la masse salariale) ». D’autre part, « le fait que (…) seule la consommation de la force de travail dans le processus de travail génère de la survaleur » (p. 145) – nous renvoyons également ici à la note de lecture que nous avons consacré à George Caffentzis, qui traite notamment du fait que les machines ne créent pas de valeur. Marx a ainsi formulé une « loi générale (…) selon laquelle l’investissement dans les technologies économes en main d’œuvre signifie que le stock de capital augmente plus rapidement que l’investissement dans la main d’œuvre » (p. 146), menant ainsi à une baisse tendancielle des taux de profits. Cette baisse tendancielle peut néanmoins être contrecarrée par plusieurs facteurs : l’« abaissement du coût du capital constant » grâce aux gains de productivité ; la « compression des salaires » ; l’« intensification » du travail. Pendant de nombreuses décennies après la mort de Marx, la baisse tendancielle du taux de profit n’a pas été observée dans les statistiques économiques ; cela pourrait néanmoins être le cas depuis le milieu des années 1970, et ce malgré la mobilisation de l’ensemble de ces leviers de compensation par les capitalistes.
Pour Smith, l’explication réside dans l’apparition d’un phénomène supplémentaire, c’est-à-dire la « réallocation » de travailleurs entre travail productif de valeur et travail improductif de valeur. Suivant Marx, Smith inclut deux grands types de travaux dans la catégorie de travail improductif. D’une part le travail de supervision qui « ne participe pas directement au processus de travail, mais se contente de l’organiser ou de le surveiller, ne génère pas lui même de la valeur ou de la sur-valeur (…) Il s’agit d’un coût nécessaire mais « accidentel » pour mener à bien les opérations capitalistes et qui doit être payé grâce aux profits réalisés ailleurs »(p. 148-149). L’extension de ce travail du supervision est directement lié à l’intensification du travail, et donc au besoin de discipline accrue sur les lieux de travail. D’autre part, le travail de circulation « exécute une large palette d’activités requises pour la « réalisation » de la valeur, sa conversion formelle du statut du commodité à celui d’argent. [Il] comprend (…) les activités de « service » nécessaire à la vente et à l’achat de biens (…) la comptabilité et le conseil juridique, l’encaissement et le stockage en entrepôt, la sécurité et les services d’assurance » (p. 149). Ce travail s’accroît en raison de la quantité toujours plus grande de marchandises produites.
Cette partition entre travail productif et improductif ne recoupe pas le schéma explicatif de Baumol qui sépare industrie dynamique et services stagnants. Il s’agit plutôt, dans l’industrie comme dans les services, d’identifier quel type de travail est productif. Ceci n’est pas aisé. Il y a eu de nombreux débats dans les milieux marxiens, car le travail productif « n’a pas de connexion essentielle avec le processus de travail physique que ces activités demandent (…) [mais] dépend plutôt du rôle qu’il joue dans le circuit total du capital » (p. 152). Bien que relativement abstraite, cette distinction entre travail productif et improductif permet de rendre compte des difficultés qui sont posées au capital :
« La hausse de la productivité du travail, en tant que hausse du taux d’exploitation au sens de Marx, doit alors compenser non seulement la réduction dans la demande totale en travail relativement au capital mobilisé, mais aussi des coûts de plus en plus élevés de circulation et de supervision, alors que de plus en plus de travail est alloué à des activités improductives » (p. 151)
On comprend alors que la solution résiderait d’une part dans un accroissement toujours plus fou de la productivité du travail productif, d’autre part dans la réduction des coûts du travail improductif, y compris si nécessaire en le remplaçant par des machines (qui, elles aussi, ne produisent pas de valeur…).
Smith discute des balbutiements d’automation du travail improductif, par exemple avec le cas du management algorithmique (travail de supervision automatisé) mais aussi, voire surtout, des obstacles qui s’opposent à cette automation. Un premier obstacle est la baisse des taux de profits elle-même, qui obère les capacités d’investissement des entreprises. Un second obstacle réside dans la complexité des tâches puisque, comme nous le rappelle Smith, « l’automation remplace des tâches, pas des professions » (p. 174). On suivra néanmoins George Caffentzis dans l’idée qu’il n’y a pas, en principe, de tâche qui ne serait remplaçable par une machine, bien que cela puisse être parfois complexe. Dans le cas des tâches associées à la circulation, Smith pointe l’importance des relations de personne à personne dans l’acte d’achat et de vente. Même lorsqu’un nombre massif de transaction s’effectue de façon très impersonnelle en ligne (comme en Chine par exemple), cela s’accompagne (un peu comme un effet rebond) d’une myriade de tâches, souvent disséminées spatialement et moins propices aux économies d’échelle, « liées au transport, au stockage, au triage à et la livraison (…) sans parler des frais (…) que constituent le parc de camion de livraison (…) ou encore le grand nombre de personnes supplémentaires nécessaires à la maintenance de ce parc » (p. 160)
Smith s’intéresse aussi tout particulièrement aux emplois du type de services à la personne (on peut vraisemblablement les considérer comme des emplois productifs de valeur). Nous avons déjà expliqué lors de la description du modèle de Baumol comment les gains de pouvoir d’achat pouvait, à salaire constant, augmenter la demande pour ce type de services. Ces services sont caractérisés par une faible productivité et semblent présenter une forte résistance à l’automation. Pour Smith, cela s’explique d’abord par le faible coût de ce type de travail, généralement peu qualifié. Les tâches associées à ces emplois peuvent cependant être extraordinairement complexes, notamment parce qu’ils impliquent de nombreuses « interactions humaines directes ».
« Le travail peu qualifié s’apparente à des décisions et des activités imprévisibles, hautement intuitives, qui sont perçues comme « humaine » ou « naturelle », instinctives ou innées, même si elles ont tendance à demande des compétences subtiles et acquises, développées dans le contexte privé ou familial plutôt qu’à l’école ou au travail » (p.179)
C’est le faible coût d’acquisition de ces compétences (« naturelles ») qui explique la faible valeur de la force de travail (son coût de reproduction est petit), d’ailleurs souvent féminine, mais on perçoit par ailleurs la difficulté potentielle (sans prétendre que cela soit impossible) à automatiser ce type de tâche.
« L’automatisation a un impact sur des secteurs spécifiques de l’économie, et non sur l’économie tout entière ; si elle favorise la hausse de la productivité dans un secteur, elle peut [la] faire baisser (…) dans un autre. (…) l’application uniforme de l’automatisation dans tous les secteurs, avec pour conséquences le remplacement de tous ou presque tous les employés par des machines, est impossible dans une formation sociale fondée sur le travail salarié. Ici la résistance à l’automation émane moins de la nature du processus de travail que du fait que dans un monde où le travail mal payé est abondant rien ne pousse à économiser la main-d’œuvre ».(p. 177-178)
Nous nous souvenons ici aussi de l’analyse de Caffentzis, qui montre bien que le perfectionnement technologique le plus avancé dans certains secteurs s’accompagne nécessairement d’un travail misérable ailleurs.
Il ressort donc de cet ouvrage que, bien évidemment, l’automation capitaliste n’est pas là pour simplifier la vie des travailleurs et travailleuses. Dans bien des cas, il est même possible que le capital choisisse de ne pas avoir recours à l’automation, si tant est que la compression des salaires ou l’intensification du travail soit plus efficace et satisfaisante. Est-ce que cela revient à dire que l’automation n’est pas une menace ? A l’évidence, non. Se profile un monde du travail toujours moins bien payé, pressurisé, fragmenté, paupérisé, surnuméraire. Par ailleurs, certains secteurs, peut-être parmi les plus qualifiés au sein des emplois de supervision et de circulation, pourraient bien être particulièrement bouleversés par de nouvelles machines, telles que l’intelligence artificielle générative. Le livre de Smith nous suggère que toute analyse sérieuse de la situation devrait vraisemblablement réinsérer les récits autour de l’intelligence artificielle générative dans un cadre plus général abordant notamment : la stagnation économique actuelle, la nature des investissements à l’œuvre et leur impact sur la composition organique du capital (hausse du capital constant, impact sur les salaires ou le nombre de travailleurs…), les secteurs et les tâches productives ou improductives ciblées, l’impact sur la division technique et sociale du travail (ce qui inclut la dégradation du travail, la réallocation de travailleurs ou l’émergence de nouveaux emplois).
Tom
- Nous avons longtemps souhaité y consacrer une émission mais, faute de camarades disposé-e-s à prendre place derrière un micro, nous avons fini par opter pour cette forme écrite moins favorable aux échanges mais permettant au moins de présenter le contenu du livre. ↩︎
- Cela nécessiterait sans doute d’être rediscuté précisément considérant les investissements massifs et récents dans les infrastructures supportant le développement de l’intelligence artificielle générative. A ce sujet, certains parlent de pure bulle spéculative. Dans une note de bloc récente, Michael Roberts suggère que l’explosion de la bulle ne veut pas dire que les infrastructures et la technologie disparaissent. Au contraire, cela permettrait de dévaloriser significativement le coût des infrastructures, donc de baisser les barrières l’entrée pour de futurs acteurs de l’IA. ↩︎
Vous aimerez aussi
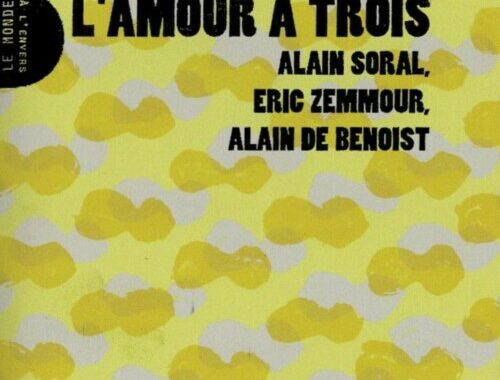
Nicolas Bonanni – L’amour à trois. Alain Soral, Eric Zemmour, Alain de Benoist
19 février 2017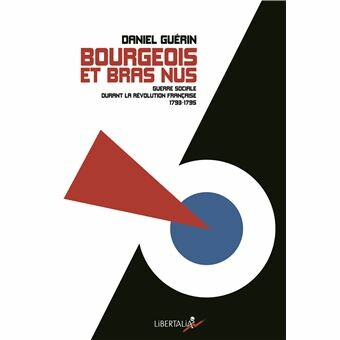
Daniel Guérin – Bourgeois et bras nus. Guerre sociale durant la Révolution française 1793-1795
16 septembre 2016