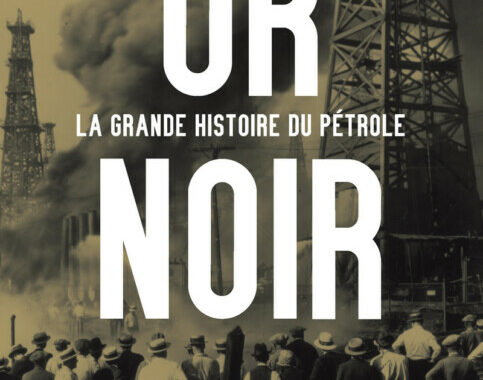Voline – La révolution russe
Voline, La révolution russe, Paris, Libertalia, 2017
À l’occasion du centenaire de 1917, c’est-à-dire de la révolution russe, Libertalia a judicieusement réédité deux textes de Voline[1], protagoniste central des événements, et notamment une synthèse de son grand ouvrage La révolution inconnue[2] (Entremonde, trois volumes, 2009-2010), paru comme article dans L’Encyclopédie anarchiste de Sébastien Faure. Ce texte constitue l’essentiel de l’ouvrage, et nous nous concentrerons donc sur celui-ci, d’autant plus qu’il ne nous semble pas nécessaire, pour faire une critique radicale du bolchévisme, de parler de « fascisme rouge », malgré des proximités évidentes sur certains points (pouvoir total de l’État-parti, dictature d’une minorité au nom du peuple, pseudo-anticapitalisme), des accointances historiques (traité de Rapallo en 1922, ambiguïtés du KPD vis-à-vis du nazisme jusqu’en 1933[3], traité germano-soviétique de 1939) et une même répression des révolutionnaires.
Le texte principal du livre est donc un article de L’Encyclopédie anarchiste de Sébastien Faure, ensuite repris dans un ouvrage collectif de 1934 intitulé La Véritable Révolution sociale. Voline a écrit d’autres articles dans cette Encyclopédie (antiÉtatisme, antisémitisme, autorité, lutte de classe, matérialiste historique, nihilisme, pogrome, soviet, synthèse anarchiste…), notamment un sur l’État où il écrit magistralement :
« L’État est une forme passagère de la société humaine, destinée à disparaître tôt ou tard. […] L’État étant un instrument d’exploitation, il ne peut jamais, en aucun cas, […] devenir instrument de libération […]. L’État ne pourra jamais disparaître par la voie d’une évolution. […] Il faut lutter à fond, immédiatement, contre l’État, en même temps que contre le capitalisme. Car ce sont les deux têtes du même monstre, qui doivent être abattues toutes les deux simultanément. En n’en abattant qu’une seule, le monstre reste vivant, et l’autre tête renaît inévitablement […]. La lutte contre le capital et l’État est une lutte simultanée, lutte unique, qui doit être menée sans relâche, jusqu’à la démolition simultanée et complète de ces deux institutions jumelles » (cité dans Voline 2017, pp. 11-12).
Il s’agit pour lui d’une véritable « leçon de l’histoire », celle de la (contre)révolution bolchévique, dont l’unique intérêt résiderait justement en ce qu’elle a démontré de manière éclatante qu’une révolution sociale doit se faire contre l’État.
Comme l’indique Charles Jacquier, ce texte est une « première ébauche de La Révolution inconnue », mais « plus accessible par sa taille et plus pédagogique dans son propos », d’où l’intérêt de ce texte par rapport à La Révolution inconnue : on peut dire qu’il s’agit d’une bonne introduction à la révolution russe, à conseiller aux novices et aux lecteurs du dimanche, notamment en raison de son caractère littéraire, rhétorique, avec un rythme et un souffle et des intuitions fondamentales au sujet de la révolution russe et du bolchévisme. En revanche, d’un point de vue historique comme théorique, on pourra déplorer un manque de théorisation et de rigueur dans l’analyse et des erreurs factuelles (là-dessus, on préférera Alexandre Skirda et ses nombreux ouvrages) : il s’agit d’un témoignage important accompagné de sources de seconde main, non d’un ouvrage d’historien et/ou de théoricien. C’est cela qui en fait tout l’intérêt littéraire, d’ailleurs.
Néanmoins, une qualité historique de l’ouvrage est de faire une histoire de longue durée de la révolution russe, depuis 1825, même si cette date est un peu arbitraire (c’est une tentative de coup d’État par des officiers « progressistes »), et témoigne d’un dédain vis-à-vis des classes populaires et de leur action jusqu’à 1905. Nous nous concentrerons surtout dans notre note de lecture sur ce qui précède 1917, étant donné que nous abordons déjà dans d’autres notes de lecture l’histoire de la révolution russe de 1917.
La révolution russe. Histoire critique et vécue
La Russie du début du XIXème siècle
La Russie tsariste du début du 19ème siècle nous est décrite comme une monarchie absolue s’appuyant sur une aristocratie foncière et une puissante Église exploitant de concert plus de 100 millions de paysans mystifiés. Ainsi,
« la terre n’appartenait pas aux producteurs directs : les paysans ; elle était la propriété soit de l’État, soit de gros propriétaires fonciers, les « pomestchiks ». Les paysans, obligatoirement attachés à la terre et à la personne du propriétaire, étaient les serfs de celui-ci. Les plus gros agrariens possédaient de vrais fiefs hérités de leurs aïeux qui, eux-mêmes, les reçurent du souverain, premier propriétaire, en reconnaissance des services rendus […]. Le « seigneur » avait le droit de vie et de mort sur ses serfs. Non seulement il les faisait travailler en esclaves, mais il pouvait les vendre, punir, martyriser (et même tuer, presque sans inconvénient pour lui). Ce servage, cet esclavage de 100 millions d’hommes [et de femmes], formait le fondement économique de « l’État ». […] En haut, les maîtres absolus : le tsar, toute sa parenté, sa cour, la haute bureaucratie, la caste militaire, le haut clergé, la noblesse foncière ou autre, etc. En bas, les esclaves : paysans-serfs de la campagne et de la campagne et le bas peuple des villes, n’ayant […] aucun droit, aucune liberté. Entre les deux, quelques couches intermédiaires (marchands, fonctionnaires, employés, artisans, etc.) […] insignifiantes » (p. 23).
Contre cet ordre inégalitaire, « les paysans se révoltaient de plus en plus fréquemment […]. À part les nombreuses révoltes locales […], les masses paysannes esquissèrent même, au XVIIème siècle (révolte de Razine)[4] et au XVIIIème siècle (révolte de Pougatchev), deux mouvements révolutionnaires qui, tout en ayant échoué, causèrent de forts ennuis au gouvernement tsariste et faillirent ébranler tout le système. Il faut dire, cependant, que ces deux mouvements […] furent dirigés surtout contre l’ennemi immédiat : la noblesse foncière, l’aristocratie urbaine et les administrations vénales » (pp. 24-25), et non contre le tsarisme lui-même. La tentative de coup de force d’une minorité d’officiers en décembre 1825 avait au contraire comme objectif une fin de l’absolutisme et du servage, mais il échoua, « et le nouvel empereur Nicolas I, apeuré, poussa à l’extrême le régime despotique, bureaucratique et policier de l’État russe » (p. 27). Voline développe dans cette partie un certain culte des avant-gardes et une forte défiance vis-à-vis des masses, et cette opposition est sans doute exagérée. En revanche, il est exact que
« les mouvements paysans se dirigeaient toujours contre leurs oppresseurs immédiats : les propriétaires (« pomestchiks »), les nobles, les fonctionnaires, la police. L’idée de chercher le fond du mal plus loin, dans le régime tsariste lui-même personnifié par le tsar, l’idée de voir en ce dernier l’ennemi principal, le grand protecteur des nobles et des privilégiés, premier noble et privilégié lui-même, ne venait jamais à l’esprit des paysans. Au contraire, ils considéraient le tsar comme une sorte d’idole, d’être supérieur placé au-dessus des simples mortels […]. Ils étaient inébranlablement convaincus que le tsar ne leur voulait – à eux, ses « enfants » – que du bien, mais que les couches intermédiaires privilégiée, intéressées à conserver leurs droits et avantages, s’interposaient entre le monarque et son peuple, afin d’empêcher le premier de connaître exactement les misères du second, afin – surtout – de les empêcher tous les deux de venir l’un à l’autre. Ils étaient persuadés que si le peuple et le tsar parvenaient à s’aboucher directement, ce dernier, momentanément trompé par les privilégiés, se pencherait sur les misères des paysans, les libérerait et leur donnerait la terre. Aussi, tout en se révoltant parfois […] contre leurs maîtres immédiats les plus cruels, les paysans attendaient, avec espoir et résignation, le jour où le mur dressé entre eux et le tsar serait tombé et la justice sociale rétablie par ce dernier » (pp. 27-28).
On retrouve une situation analogue en France jusqu’à la Révolution française.
Les années 1825-1860
Les années 1825-1860 marquent un « renforcement progressif du régime absolutiste, de l’État bureaucratique et policier, sous Nicolas I (1825-1855) », un « mécontentement grandissant des masses paysannes » et un « essor assez rapide et considérable de l’industrie » (p. 29), et surtout la pénétration d’idées « progressistes » au sein de la jeunesse éduquée de classe moyenne, que ce soit par l’étude du monde occidental ou par une littérature russe « humaniste » en plein essor, qui pouvait mener ceux-ci jusqu’au nihilisme (volonté de destruction de l’ordre social, même s’il n’y avait pas forcément de projet de société derrière). Mais
« le gouvernement de Nicolas 1, réactionnaire à outrance, se refusait à tenir compte des réalités et de l’effervescence des esprits. Au contraire, il lança un défi à la société. En effet, c’est à cette époque que furent créés la police politique, le corps spécial de gendarmerie, etc., afin de mater le mouvement. Les persécutions politiques prirent libre cours ; la censure sévissait. (Rappelons-nous qu’à cette époque, le jeune Dostoïevski faillit être exécuté – et alla au bagne – pour avoir adhéré au groupe d’études sociales, absolument inoffensif, de Petrachevski […]) […] Sur ces entrefaites, la Russie fut entraînée dans la guerre de Crimée. Les péripéties de cette guerre ont démontré avec évidence la faillite du régime. […] Nicolas I mourut en 1855, parfaitement conscient de cette faillite, mais impuissant à y faire face » (pp. 30-31).
Les années 1860-1881
« Ce fut son fils et successeur, l’empereur Alexandre II, qui dû faire face à la situation. Le mécontentement général, la pression des couches intellectuelles […], la peur d’un soulèvement des masses paysannes et, enfin, les désavantages économiques du régime du servage, l’obligèrent, malgré une résistance acharnée des milieux réactionnaires, à prendre résolument la voie des réformes. Il se décida à mettre fin au régime purement bureaucratique et à l’arbitraire absolu des pouvoirs administratifs. Il entreprit une modification sérieuse de tout le système judiciaire. À partir de l’année 1860, les réformes se succédèrent d’une façon ininterrompue. Les plus importantes furent l’abolition totale du servage (1861) et la création […] des unités d’auto-administration locale » (p. 32).
Mais « tout en étant importantes au regard de la situation de la veille, les réformes d’Alexandre II restèrent néanmoins bien timides et très incomplètes […]. En effet, la presse sera muselée comme auparavant ; aucune liberté civique ne fut octroyée ; la classe ouvrière naissante n’avait aucun droit civil ; la noblesse et la bourgeoisie restèrent les classes nettement dominantes ; et, surtout, l’absolutisme politique resta intact » (pp. 32-33). Mais surtout, le servage avait été aboli comme l’esclavage aux États-Unis quelques années plus tard, de manière incomplète : « Les paysans obtinrent leur liberté individuelle, mais ils durent la payer cher. Ils reçurent des lots de terrain tout à fait insuffisants. De plus, ils furent astreints à payer, pendant plusieurs dizaines d’années, en plus des contributions d’État, une forte redevance aux anciens seigneurs pour les terres aliénées. (Il est à noter que les 100 millions de paysans reçurent en tout à peu près le tiers du sol. L’autre tiers fut gardé par l’État. Et un tiers environ resta entre les mains des propriétaires fonciers. Une telle proportion condamnait la masse paysanne à une existence de famine et la maintenait, au fond, à la merci des « pomestchiks ») » (p. 33). De telles conditions expliquent l’ampleur de la révolution paysanne de 1917.
En réaction à ce maintien de l’absolutisme, des groupes clandestins de jeunes éduqués des classes moyennes se formèrent, avec comme « tâche de porter la lumière aux masses travailleuses » : ce fut le « populisme »[5] russe. Mais « le mouvement aboutit à une catastrophe. Presque tous les propagandistes furent repérés par la police, arrêtés et envoyés en prison, en exil ou au bagne. Le résultat pratique de l’entreprise fut nul » (p. 35). Pour cette raison, l’assassinat du tsar fut programmé, dans l’optique de dévoiler l’ampleur de la supercherie des réformes et même de montrer le caractère fragile du tsarisme, en vue peut-être d’une insurrection généralisée contre celui-ci : « Le groupement prit le nom de Narodnaïa Volia (« Volonté du peuple »). Après une minutieuse préparation, il exécuta son projet : le 1 mars 1881, le tsar Alexandre II fut assassiné » (p. 36). Mais
« le geste resta incompris. Les paysans […] accusèrent [la noblesse] d’avoir assassiné le tsar pour venger l’abolition du servage. Le tsar fut assassiné. Non pas la légende. […] D’autre part, la cour ne manifesta pas tant de désarroi. Le jeune héritier Alexandre (fils aîné de l’empereur assassiné) prit immédiatement le pouvoir. Les chefs du parti Narodnaïa Volia furent exécutés. Des mesures de répression très sévères réduisirent le parti entier à une impuissance complète. Le nouvel empereur, Alexandre III, vivement impressionné par l’attentat, reprit le chemin de la réaction violente. Les réformes – déjà si insuffisantes – de son prédécesseur lui parurent, au contraire, plus qu’osées : il les jugea déplacées, dangereuses. Il mit à profit le meurtre de son père pour les combattre. Il s’employa à […] contrecarrer leurs effets par une série de lois réactionnaires. L’État bureaucratique et policier reprit ses droits. Tout mouvement libéral fut étouffé » (pp. 36-37).
La fin du XIXème siècle (1881-1900)
Le mouvement révolutionnaire russe, suite à cet échec, fut profondément transformé sous l’influence du marxisme. Le développement du capitalisme industriel eut également comme effet l’essor de la classe ouvrière. Pour cette raison, il fallait une classe d’encadrement toujours plus nombreuse, d’où une augmentation de la population éduquée, dont une partie allait former en 1898 le Parti ouvrier social-démocrate russe (avec ses tendances « bolcheviks » et « mendcheviks » à partir de 1903). Face à cette montée des idées révolutionnaires, le nouveau tsar Nicolas II était résolument réactionnaire.
Les débuts du XXème siècle (1900-1905)
L’absolutisme refusant de se réformer, il « eut recours, entre autres, à une forte propagation antisémit[e] et, ensuite, à l’instigation – et même à l’organisation – des pogromes juifs », comme moyen de détourner de lui un mécontentement croissant des classes populaires (déjà antisémites, au demeurant). Le régime tsariste est notamment l’auteur à cette époque du Protocole des Sages de Sion, pamphlet faisant de l’antisémitisme une vision conspirationniste du monde.
Le développement industriel, d’autre part, entraîna une croissance de la classe ouvrière, qui compte environ 3 millions de membres en 1905, exploitée de manière intense et sans « aucun droit de se concerter, de s’organiser, de se mettre en grève » (p. 45). En parallèle, a lieu un « vaste mouvement d’éducation, de culture et de préparation révolutionnaire » (p. 45) des jeunes éduqué-e-s de Russie. Enfin, « dans la campagne, l’appauvrissement des masses paysannes à la suite du morcellement grandissant de leurs parcelles de terres, déjà insuffisantes, et partant leur mécontentement, augmentaient rapidement » (p. 45). Tout cela formait un cocktail explosif et un milieu étudiant et ouvrier toujours plus favorable aux idées révolutionnaires. En dépit d’une forte répression des partis politiques,
« à partir de l’année 1900, le mouvement révolutionnaire […] avança à grands pas. Des troubles universitaires et ouvriers devinrent bientôt des faits divers. D’ailleurs, les universités restaient souvent fermées pendant des mois, en raison justement des troubles politiques. Mais alors, à la première occasion, les étudiants, appuyés par des ouvriers, organisaient des manifestations bruyantes sur les places publiques. À Saint-Pétersbourg, la place devant la cathédrale de Kazan devint l’endroit classique des manifestations populaires auxquelles les étudiants, et aussi les ouvriers, se rendaient en entonnant des chants révolutionnaires, et, parfois, porteurs de drapeaux rouges déployés. Le gouvernement y envoyait des détachements de police et de cosaques à cheval qui nettoyaient la place à coups de sabres et de fouets » (p. 46).
Voline exagère en revanche sans doute lorsqu’il dit au sujet des étudiants que « l’égalité des races, celle des sexes, l’union libre, etc., devinrent pour eux des vérités acquises » (p. 47).
Participant de cette effervescence croissante, à côté du Parti ouvrier social-démocrate s’adressant surtout aux étudiants et aux ouvriers, un nouveau parti s’adressant également (avec un succès rapide) aux paysans naquit, le Parti socialiste-révolutionnaire[6] :
« Trois points essentiels constituaient la différence entre les deux partis : 1) philosophiquement […], le Parti socialiste-révolutionnaire était antimarxiste [et se réclamait du populisme russe de Narodnaïa Volia] ; 2) en raison de son antimarxisme, ce parti apportait au problème paysan une solution différente de celle du Parti social-démocrate. Tandis que ce dernier, se basant uniquement sur la classe ouvrière, ne comptait guère sur le gros de la masse paysanne (dont il escomptait, d’ailleurs, la prolétarisation rapide) et, partant, négligeait la propagande rurale, le Parti socialiste-révolutionnaire croyait pouvoir gagner les masses paysannes russes à la cause révolutionnaire et socialiste. […] Il déployait, en conséquence, une forte propagande dans la campagne. Pratiquement, le Parti social-démocrate n’envisageait […] qu’une augmentation des lots de terre appartenant aux paysans, tandis que le Parti socialiste-révolutionnaire comprenait dans son programme minimum la socialisation immédiate et complète du sol entier ; 3) en parfaite conformité avec sa doctrine, le Parti social-démocrate (qui comptait essentiellement sur l’action des masses) repoussait toute action de terrorisme, tout attentat politique, comme socialement inutile […] [au contraire du Parti socialiste-démocrate] […]. À part ces différences, le programme politique immédiat des deux partis était sensiblement le même : une république démocratique (bourgeoise) qui ouvrirait la route à une évolution vers le socialisme » (pp. 48-49).
Enfin, « à part ces deux partis politiques, il existait aussi, à cette époque déjà, un certain mouvement anarchiste » (p. 50), fait de petits groupes diffusant notamment des brochures de Kropotkine.
Comme on devait s’y attendre,
« le succès croissant de la propagande révolutionnaire à partir de l’année 1900 inquiéta fortement le gouvernement. Ce qui le troublait surtout, c’étaient les sympathies que cette propagande gagnait de plus en plus dans la population ouvrière. Malgré leur existence illégale, donc difficile, les partis socialistes possédaient dans toutes les grandes villes des comités, des cercles de propagande, des imprimeries clandestines et des groupements ouvriers. Le Parti socialiste-révolutionnaire réussit à réaliser des attentats politiques. Le gouvernement jugea donc ses moyens de défense – la prison, la surveillance, la provocation, les pogromes – insuffisants. Afin de soustraire les masses ouvrières à l’emprise des partis socialistes et à toute activité révolutionnaire, il conçut un plan machiavélique qui, logiquement, devait le rendre maître du mouvement ouvrier. Il se décida à mettre sur pied des organisations ouvrières légales, autorisées, dont il tiendrait lui-même les commandes. En cas de réussite, il aurait fait d’une pierre deux coups : d’une part, il aurait attiré vers lui les sympathies de la classe ouvrière, en l’arrachant ainsi aux mains des partis révolutionnaires ; d’autre part, il pourrait guider le mouvement ouvrier là où il voudrait, le surveillant de près. Sans doute, la tâche était délicate. Il fallait attirer les ouvriers dans ces organismes d’État ; il fallait tromper leur méfiance, les intéresser, les flatter, les séduire, les duper ; il fallait feindre d’aller à la rencontre de leurs aspirations… Pour réussir, le gouvernement serait même obligé d’aller jusqu’à certaines concessions d’ordre économique ou social, tout en maintenant les ouvriers à sa merci, tout en les maniant à son idée. L’exécution d’un tel programme exigeait, à la tête de l’entreprise, des hommes de confiance absolue, des hommes habiles et éprouvés […]. Le choix du gouvernement s’arrêta sur deux hommes, agents de la police secrète (l’Okhrana), qui reçurent la mission d’exécuter le projet. L’un fut Zoubatov, pour Moscou ; l’autre, l’aumônier d’une des prisons de Saint-Pétersbourg, le pope Gapone. Ainsi, le gouvernement du tsar voulut jouer avec le feu. Il ne tarda pas à s’y brûler » (pp. 50-52).
La révolution de 1905
Le tsarisme va en effet initier un mouvement qui va in fine détruire son rempart idéologique et donc permettre l’insurrection de février 1917 :
« Zoubatov, à Moscou, fut démasqué assez vite. […] Mais, à Saint-Pétersbourg, les affaires marchèrent mieux. Gapone, très adroit, […] sachant gagner la confiance et même l’affection des milieux ouvriers, doué d’un certain talent d’agitateur et d’organisateur, réussit à mettre sur pied les soi-disant « sections ouvrières » qu’il guidait en personne (en contact étroit avec ses maîtres) et qu’il animait de son activité énergétiques. Vers la fin de 1904, ces sections étaient au nombre de 11 […] avec quelques milliers de membres. […] Les militants révolutionnaires ne pouvaient y pénétrer […]. Les ouvriers de Saint-Pétersbourg prirent leurs sections très au sérieux. Ils avaient entière confiance en Gapone […]. Gapone […] savait […] feindre son approbation et ses vives sympathies au mouvement ouvrier. Telle était aussi, à peu près, sa mission officielle. La thèse que le gouvernement entreprit d’imposer aux ouvriers dans leurs sections fut celle-ci : « Ouvriers, vous pouvez arriver à améliorer votre situation […] dans les formes légales, au sein de vos sections. Pour aboutir, vous n’avez aucun besoin de faire de la politique. Occupez-vous de vos intérêts personnels et immédiats, et vous arriverez bientôt à une existence plus heureuse. Les partis et les luttes politiques, les recettes proposées par les mauvais bergers […] ne vous mèneront à rien de bon […] ». Les ouvriers mirent l’invitation tout de suite en pratique. Ils commencèrent à préparer une action économique pour appuyer, le cas échéant, leurs revendications élaborées et formulées d’accord avec Gapone […]. Dans son double jeu, Gapone […] fait mine de soutenir entièrement leur cause, tout en espérant pouvoir […] garder la maîtrise du mouvement […]. Ce fut le contraire qui se produisit. Le mouvement prit rapidement de l’ampleur. Bientôt, il se transforma en une véritable tempête qui déborda et emporta Gapone lui-même » (pp. 52-54).
Ce sera la révolution russe de 1905 :
« En décembre 1904, les ouvriers de l’usine Poutilov, l’une des plus importantes de Saint-Pétersbourg, […] décidèrent de commencer l’action. D’accord avec Gapone, ils élaborèrent une liste de revendications d’ordre économique, très modérées d’ailleurs. Vers la fin du mois, ils apprirent que la direction ne croyait pas possible d’y faire suite, et que le gouvernement était impuissant à l’y obliger. L’indignation, la colère des ouvriers étaient sans borne […]. Ils se sentirent « roulés ». Naturellement, leurs regards se tournèrent vers Gapone. Pour sauvegarder son prestige et son rôle, ce dernier feignit d’être indigné plus que tout autre et poussa les ouvriers de l’usine Poutilov à réagir vigoureusement. C’est ce qu’ils ne tardèrent pas à faire. […] Ils décidèrent, au cours de plusieurs réunions tumultueuses, de soutenir leur cause par une grève […]. Et c’est ainsi que la grève des usines Poutilov, la première grève ouvrière importante en Russie, fut déclenchée en décembre 1904 » (p. 55).
Ce fut cette grève qui déclencha la révolution de 1905 :
« Toutes les sections ouvrières s’émurent et se mirent en branle pour défendre l’action de ceux de Poutilov. Elles apprécièrent très justement l’échec de ces derniers comme leur échec général […]. Les ateliers se vidaient spontanément. Sans mot d’ordre précis, sans préparation ni direction, la grève de Poutilov devenait une grève quasi générale de Saint-Pétersbourg. Ce fut alors la tempête. Les masses de grévistes se précipitèrent vers les sections […], réclamant une action immédiate. […] C’est alors que surgit […] la fantastique idée de rédiger, au nom des ouvriers et paysans malheureux de toutes les Russies, une pétition au tsar, de se rendre, pour l’appuyer, en grandes masses devant le palais d’Hiver, de remettre la pétition par l’intermédiaire d’une délégation, Gapone en tête, au tsar lui-même, et de demander à ce dernier de prêter l’oreille aux misères de son peuple. Toute naïve […] qu’elle fût, cette idée se répandit comme une trainée de poudre […]. Gapone fut chargé de rédiger la pétition […]. Dans les premiers jours du mois de janvier 1905, la pétition était prête. […] Les misères du peuple y étaient exposées avec beaucoup de sentiment et de sincérité. Ensuite, elle demandait au tsar de consentir et de faire exécuter certaines réformes. […] Des révolutionnaires appartenant aux partis politiques […] intervinrent [même] auprès de Gapone. Ils cherchèrent […] à l’obliger de donner à […] sa pétition […] une allure […] plus révolutionnaire. Les milieux ouvriers avancés exercèrent sur lui la même pression. Gapone s’y prêta d’assez bonne grâce. […] Sous sa forme définitive, la pétition fut le plus grand paradoxe historique qui ait jamais existé. On s’y adressait très loyalement au tsar, et on lui demandait ni plus ni moins que […] d’accomplir […] une révolution fondamentale qui, en fin de compte, supprimerait son pouvoir. En effet, tout le programme minimum des partis révolutionnaires y figurait. On y exigeait […] la liberté entière de la presse, de la parole, de la conscience, etc. ; la liberté absolue de toutes sortes d’associations, d’organisations, etc. ; le droit aux ouvriers de se syndiquer, de recourir à la grève, etc. ; des lois agraires tendant à l’expropriation des gros propriétaires au profit des communautés paysannes ; et surtout, la convocation immédiate d’une assemblée constituante, élue sur la base d’une loi électorale démocratique. […] L’idée de la démarche collective auprès du tsar, avec la pétition, ne fut au fond que l’expression très naturelle de la foi naïve des masses populaires en la bonne volonté du tsar (ce que nous avons appelé […] « la légende du tsar »). […] Tout en espérant […] obtenir un succès au moins partiel, ils voulaient surtout en avoir le cœur net. […] Gapone […] d’abord simple comédien, agent à la solde de la police, […] fut […] de plus en plus entraîné par la formidable vague du mouvement populaire […]. Il finit par en être emporté. […] Il voyait déjà le pays entier en révolution, le trône en péril, et lui, Gapone, chef suprême du mouvement, idole du peuple, porté aux sommets de la gloire des siècles. […] Il se donna finalement, corps et âme, au mouvement déclenché. Son rôle de policier ne l’intéressait plus » (pp. 56-60).
D’abord surpris, trahi par son agent, le tsarisme
« prit finalement le parti d’attendre le moment favorable pour écraser le mouvement d’un seul coup. […] La marche vers le palais d’Hiver fut fixée au dimanche matin, le 9 janvier […] Ce qui apporte une note tragique […] [aux] derniers préparatifs, ce fut, chaque fois, l’appel suprême de l’orateur et le serment solennel, farouche, de la foule, en réponse à cet appel : « Camarades ouvriers, paysans et autres ! – disait à peu près l’orateur – Frères de misère ! Soyez tous fidèles à la cause générale et au rendez-vous. […] Venez calmes, pacifiques, dignes de l’heure solennelle qui sonne. Le père Gapone a déjà prévenu le tsar et lui a garanti […] la sécurité absolue […]. Nous demandons des choses justes. Nous ne pouvons plus continuer cette existence misérable. Nous allons donc chez le tsar les bras ouverts, les cœurs remplis d’amour et d’espoir. Il n’a qu’à nous recevoir de même et à prêter l’oreille à notre demande. […] Mais si, mes frères, le tsar, au lieu de nous accueillir, au lieu de nous écouter, nous reçoit à coups de fusils et de sabres […] alors, mes frères, malheur à lui ! Alors, nous n’avons plus de tsar ! Alors, qu’ils soient maudits à jamais, lui et toute sa dynastie ! […] Jurez […] » Et l’assemblée toute entière, emportée par un élan extraordinaire, répondait en levant le bras : « Nous le jurons ! » Le 8 janvier au soir, tout était prêt » (pp. 60-62).
Mais « tout était prêt aussi du côté gouvernemental […]. La capitale était entre les mains des troupes armées jusqu’aux dents. […] Le 9 janvier, dimanche, dès le matin, une foule immense composée surtout d’ouvriers (souvent avec leurs familles) […], se mit en mouvement vers la place du palais d’Hiver. […] Partout ils se heurtèrent à des barrages de troupes et de police qui ouvrirent un feu nourri contre cette mer humaine. […] Des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants furent tués ce jour-là dans les rues de la capitale. » (p. 63).
Gapone échappa au massacre, mais une fois exilé, il tenta de revenir en Russie, et en échange fut sommé de donner des informations précises au sujet du Parti socialiste-révolutionnaire. Il fut néanmoins éliminé dès son retour par des ouvriers ayant appris sa trahison grâce à un membre de ce parti. Mais surtout, « les événements du 9 janvier eurent une résonance formidable dans le pays entier. […] La population [partout] apprenait avec une stupéfaction indignée qu’au lieu de prêter l’oreille au peuple venu paisiblement devant le palais pour conter au tsar ses misères, ce dernier donna froidement l’ordre de tirer dessus. […] C’est à ce moment que la « légende du tsar » cessa de vivre. […] C’est le tsar lui-même qui la tua. Moralement, le tsarisme fut détrôné le 9 janvier 1905 » (p. 67).
En réaction, à Saint-Pétersbourg, « les événements du 9 janvier y eurent pour effet immédiat la généralisation de la grève ouvrière. Celle-ci devint complète. Le 10 janvier au matin, pas une seule usine, pas un seul chantier […] ne s’anima. […] La première grande grève révolutionnaire des travailleurs russes – celle des ouvriers de Saint-Pétersbourg – devint un fait accompli […]. Elle ne fut déclenchée par aucun parti politique, voire par aucun comité de grève. De leur propre chef, et dans un élan tout à fait libre, les masses ouvrières abandonnèrent les usines et les chantiers. […] Dans une petite réunion privée à laquelle assistaient une quarantaine d’ouvriers de différentes usines, l’auteur de ces lignes […] et un avocat, Georges Nossar […], on parla de la nécessité d’organiser un comité – ou plutôt un « conseil » (soviet) – qui serait composé d’ouvriers délégués par différentes usines, et qui prendrait en main la direction de la grève que celle de la suite du mouvement. On exprima même l’idée de nommer ce comité Conseil (soviet) des délégués ouvriers. Les ouvriers décidèrent de mettre cette idée tout de suite en pratique » (pp. 68-69). Voline refusa ensuite l’offre des ouvriers de se mettre à la tête du soviet, pour des raisons nobles (« l’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes », et il n’en était pas un) mais finalement contre-productives puisque c’est Nossar, un avocat, qui fut nommé à la tête du soviet, avant d’être remplacé par un social-démocrate d’origine bourgeoise, Trotski.
« Pendant un certain laps de temps, le gouvernement ne toucha pas au soviet. Celui-ci siégea assez régulièrement. D’ailleurs, la grève s’étant éteinte d’elle-même, à défaut d’un mouvement de plus vaste envergure, l’activité de ce premier soviet dut se borner bientôt à une œuvre de pure propagande. Le gouvernement […] était forcé d’agir avec la plus grande prudence. La raison principale de cette situation difficile fut l’échec cuisant que l’impérialisme japonais fit subir à l’impérialisme russe. La guerre, commencée en janvier 1904 avec beaucoup d’orgueil […], était irrémédiablement perdue. L’opinion publique imputait la défaite ouvertement à l’incapacité, à la pourriture du régime. Non seulement les masses ouvrières, mais tous les milieux de la société furent rapidement gagnés par une colère et un esprit de révolte qui s’aggravaient de jour en jour. L’effet des défaites qui se suivaient sans arrêt fut foudroyant […] Étant dans son tort, le gouvernement n’avait qu’à se taire. Les milieux libéraux et révolutionnaires en profitèrent pour commencer une campagne violente contre le régime. Sans en demander l’autorisation, la presse et la parole devinrent libres. Ce fut une véritable prise d’assaut des libertés politiques. Les journaux de toute tendances, même révolutionnaires, paraissaient et se vendaient sans censure, ni contrôle. Le gouvernement, le système entier, y étaient vigoureusement critiqués. Les autorités furent contraintes de tolérer tout ceci […]. De plus, vers cette époque, quelques démonstrations et même quelques émeutes eurent lieu dans différentes villes, et quelques barricades firent leur apparition à Saint-Pétersbourg et à Moscou. […] L’été 1905 apporta, de plus, des troubles assez graves dans l’armée et la flotte. […] En plus de sa mauvaise situation morale et de sa défaite dans la guerre russo-japonaise, il manquait au gouvernement le facteur le plus important pour pouvoir combattre ce mouvement : l’argent. L’inactivité, l’impuissance avouée du gouvernement enhardirent les forces de l’opposition. Dès le début d’octobre, on parla d’une grève générale de tout le pays, comme début d’une révolution décisive. Cette grève du pays entier […] eut lieu vers la mi-octobre. Elle fut moins spontanée que celle de janvier. Envisagée de longue date, préparée d’avance, elle fut organisée par le soviet et surtout de nombreux comités de grèves. […] Tout, absolument tout, s’arrêta net. La vie du pays fut suspendue. Le gouvernement perdit pied et céda. Le 17 octobre (1905), le tsar lança un manifeste […] où il disait avoir pris la décision d’octroyer à ses chers sujets toutes les libertés politiques et, de plus, de convoquer le plus rapidement possible la Douma de l’État (genre d’États généraux) pour l’aider dans ses fonctions gouvernementales. Ce fut, enfin, une promesse de Constitution. […] Le but immédiat du manifeste fut atteint : la grève cessa, l’élan révolutionnaire fut brisé. Mais il va de soi que les partis révolutionnaires n’eurent aucune confiance dans les promesses. Ils ne virent dans le manifeste qu’une manœuvre politique. Ils commencèrent aussitôt à l’expliquer aux masses ouvrières. D’ailleurs, ces dernières restèrent assez indifférentes. Dix jours après le manifeste eut lieu la première grande émeute des matelots de Cronstadt […] qui faillit devenir très grave » (pp. 71-74).
Le régime tsariste avait toutefois retrouvé l’initiative : « Les libertés, prises d’assaut et promises post factum par le manifeste d’octobre, furent supprimées le jour où le gouvernement trouva de l’argent (emprunt français) et aussi la possibilité de terminer la malheureuse guerre d’une façon pas trop humiliante. Ce jour-là, le gouvernement reprit pied. Fin 1905, il réinterdit toute la presse révolutionnaire, rétablit la censure, procéda à des arrestations de masse, liquida toutes les organisations ouvrières ou révolutionnaires qui lui tombèrent sous la main, supprima le soviet, jeta en prison Nossar et Trotski, et dépêcha des troupes, à l’effet de châtiments sévères, dans toutes les régions où des troubles sérieux avaient eu lieu. Il ne resta d’une chose à laquelle le gouvernement n’osa pas toucher : la Douma, dont la convocation était proche. Ainsi, vers la fin de 1905, la révolution fut définitivement enrayée » (p. 74). Mais elle laissa des traces ineffaçables dans l’esprit des ouvriers, des soldats et des paysans, lesquelles allaient resurgir en 1917.
Ce qu’il restait dans l’immédiat, c’est la Douma : « Le peuple tout entier mettait dans cette institution les plus grands espoirs. Les élections, fixées au printemps de 1906, suscitèrent […] une activité préparatoire fébrile. Tous les partis politiques y prirent part. La situation était assez paradoxale ; car, tandis que les partis de gauche déployaient leur activité ouvertement, légalement, les prisons regorgeaient des membres des mêmes partis […]. Ce paradoxe apparent s’explique facilement. En dépit d’une certaine liberté que le gouvernement tsariste dut accorder à ses sujets en vue des élections, […] selon lui, la Douma ne devait être qu’un organe purement consultatif […]. Tout en étant obligé de tolérer l’agitation électorale des partis de gauche, le gouvernement était décidé d’avance à réagir sans tarder contre toute tentative de la Douma de prendre une attitude frondeuse » (pp. 74-75).
De nombreux partis politiques en-dehors du Parti socialiste-révolutionnaire et du Parti ouvrier social-démocrate se créèrent :
« Les monarchistes créèrent l’Union du peuple russe. Les éléments moins farouchement réactionnaires – hauts fonctionnaires, gros industriels, propriétaires, commerçants, agrariens, etc. – se groupèrent autour du Parti octobriste […]. Le poids politique de ces deux partis de la droite était insignifiant. Tous les deux, ils faisaient plutôt l’amusement du pays. La grande majorité des classes aisées et moyennes ainsi que des intellectuels de marque, s’organisèrent en un grand parti politique du centre dont la droite se rapprochait des octobristes et la gauche accusait des tendances républicaines. Le gros du parti élabora le programme d’un système constitutionnel qui, tout en conservant le monarque, mettrait fin à l’absolutisme en limitant sérieusement son pouvoir. Le parti prit le nom de Parti constitutionnel-démocrate (en abrégé : parti Ca-Det). […] Très influent et bien placé, ce parti déploya, dès son origine, une activité vaste et énergique. À l’extrême-gauche se trouvaient le Parti social-démocrate […] et, enfin, le Parti socialiste-révolutionnaire, dont les candidats, afin de pouvoir agir sans entraves, formèrent un parti à part, sous le nom de Parti travailliste » (p. 76).
Les partis proposaient des solutions différentes au problème central du manque de terres paysannes :
« 1) le Parti constitutionnel-démocrate proposait l’augmentation des lots par une aliénation d’une bonne partie des grandes propriétés privées ou d’État, aliénation devant être dédommagée graduellement par les paysans, avec l’aide de l’État, conformément à une estimation officielle et « juste » ; 2) le Parti social-démocrate préconisation une aliénation pure et simple des terres indispensables aux paysans, lesquelles terres constitueraient ainsi un fonds national distribuable aux paysans au fur et à mesure des besoins (nationalisation ou municipalisation des terres) ; et 3) le Parti socialiste-révolutionnaire offrait la solution la plus radicale, à savoir : la confiscation totale de toutes les terres faisant l’objet de propriété privée, la suppression immédiate et complète de toute propriété foncière, la mise à la disposition des collectivités paysannes de toutes les terres (socialisation des terres) » (pp. 77-78).
Voline ajoute à ce tableau des partis et de leurs programmes l’émergence d’une aile gauche dans chacun des deux partis de gauche :
« Les partisans de ce[s] courant[s], dans les deux partis, insistaient […] sur la nécessité d’abandonner le programme minimum en cours et de le remplacer par un autre, plus révolutionnaire, plus socialiste. Dans le Parti social-démocrate, ce courant aboutit, déjà en 1903, à la naissance du bolchevisme […]. Et quant au Parti socialiste-révolutionnaire, il se divisa finalement aussi en deux partis distincts : celui des socialistes-révolutionnaires de droite, qui défendait la nécessité de passer, avant tout, par une république démocratique bourgeoise, et celui des socialistes-révolutionnaires de gauche, qui prétendait […] que la prochaine révolution devrait être poussée le plus loin possible, notamment jusqu’à la suppression immédiate de l’État capitaliste [bourgeois] et l’instauration d’une République sociale. […] Le Parti socialiste-révolutionnaire donna [même] naissance, vers la même époque, à un troisième credo social, qui alla jusqu’à l’idée de devoir supprimer, dans la prochaine révolution, non seulement l’État bourgeois, mais tout État en général […]. Ce courant d’idées se rapprochait donc sensiblement de la conception anarchiste, sans toutefois l’adopter en entier. Il est connu en Russie sous le nom de maximalisme. Quant aux conceptions anarchistes et syndicalistes, elles étaient, à cette époque, très peu répandues en Russie. […] Cependant, un groupe anarchiste de Moscou participa très activement aux événements d’octobre et se fit remarquer dans des manifestations révolutionnaires » (pp. 78-79).
Le décor de 1917 était planté dès 1905-1906 : « L’absolutisme fut moralement détrôné […] [et] les masses populaires se tournèrent vers les éléments qui, depuis longtemps déjà, combattaient cet absolutisme » (p. 79).
Vers la grande explosion (1905-1917)
Voline termine cette histoire des suites de 1905 par un récit de l’échec de la Douma :
« La Douma commença à siéger en avril 1906. Un enthousiasme populaire débordant l’accueillit à sa naissance. Malgré toutes les machinations du gouvernement, elle s’avéra nettement en opposition. Le Parti constitutionnel-démocrate la domina […]. Les députés de gauche […] y formaient également un bloc imposant. […] On en attendait au moins des réformes larges, justes, efficaces. Mais, dès le premier contact, une hostilité […] s’établit entre le « Parlement » et le gouvernement. Ce dernier entendait traiter la Douma du haut en bas, avec un dédain qu’il ne masquait même pas. Il la tolérait à peine. […] La Douma, elle, cherchait, au contraire, à s’imposer comme une institution législative, constitutionnelle. Les rapports entre l’un et l’autre devenaient de plus en plus tendus. […] La situation du gouvernement devenait ridicule et dangereuse. Toutefois, une révolution immédiate n’était pas à craindre. Et puis le gouvernement comptait sur ses troupes. Il se décida donc bientôt à une mesure énergique. […] La Douma […] fut dissoute (à l’État 1906). À part quelques émeutes, dont la plus importante fut celle de Cronstadt (plus sérieuse encore que celle d’octobre 1905), le pays resta tranquille. Quant aux députés eux-mêmes, ils n’osèrent pas résister efficacement. […] Aussitôt après la dissolution de la « première Douma », le gouvernement modifia sensiblement la loi électorale et convoqua la « deuxième Douma ». Incomparablement plus modérée et plus médiocre que la première, celle-ci parut, tout de même, encore trop révolutionnaire au gouvernement. Elle fut dissoute à son tour. La loi électorale fut à nouveau remaniée. On arriva à une troisième et, enfin, à une quatrième Douma, laquelle – instrument docile entre les mains du gouvernement – put traîner une existence morne et stérile jusqu’à la révolution de 1917 » (pp. 81-83).
Celle-ci n’allait pas avoir lieu au Parlement, mais dans les rues de Saint-Pétersbourg, comme en janvier 1905.
Comme on a pu voir au sein des extraits précédents, Voline n’est pas un historien extrêmement rigoureux (mais plutôt un ex-protagoniste plus ou moins bien informé), mais c’est un narrateur de talent, et son histoire de 1917 et ses suites est véritablement captivante. On en conseillera donc la lecture. Son analyse du bolchévisme n’est pas non plus inintéressante, même s’il lui manque une analyse de classe et une analyse structurelle du capitalisme d’État. On terminera cette note de lecture sur ces quelques phrases de Voline :
« Le bolchévisme n’est qu’une variété du capitalisme. […] Le seul sens historique du bolchévisme est de démontrer aux masses laborieuses de tous les pays, une fois pour toutes et d’une façon palpable, incontestable, le péril du principe politique, Étatiste, gouvernemental, pour la révolution sociale. Nous considérons que la seule « utilité » du bolchevisme est d’avoir donnée aux masses de tous les pays […] cette leçon pratique, indispensable […] : comment il ne faut pas faire la révolution […]. Non, Lénine et ses camarades ne furent jamais des révolutionnaires. Ils ne furent que des réformistes quelque peu brutaux qui, en vrais réformistes, recourent toujours à de vieilles méthodes bourgeoises (pp. 148, 153, 168).
Armand Paris
[1] Comme l’explique Charles Jacquier dans son excellente préface, Voline est un révolutionnaire juif ayant rompu avec son milieu d’origine, ancien participant à la révolution russe de 1905-1906, ancien déporté du tsarisme. Après être devenu anarchiste suite à son séjour en France, et un bref séjour aux États-Unis, Voline retourne en Russie en 1917, s’occupant à cette période du journal anarcho-syndicaliste Golos Trouda, avant de combattre aux côtés de Makhno l’armée réactionnaire de Denikine (1918-1920). Après un séjour au sein du système carcéral bolchévique (1920-1921), il est libéré grâce à des délégués syndicaux étrangers (notamment Leval), et est expulsé d’URSS. Il gagne rapidement l’Hexagone, après un court séjour à Berlin où il co-rédige « La répression de l’anarchisme en Russie soviétique » (1922), et devient un des principaux protagonistes du débat autour de la « plateforme » d’Archinov et de Makhno, et salue Vers l’autre flamme de Panaït Istrati et sa critique du bolchévisme. Il dénonce lucidement dès 1936 la politique de collaboration de la CNT-FAI en Espagne, et meurt en 1945 après des années de clandestinité sous Vichy et sous l’Occupation allemande (il est recherché comme anarchiste, juif, et franc-maçon), laissant un manuscrit – La révolution inconnue – finalement publié en 1947 à titre posthume par des amis.
[2] Comme l’explique Charles Jacquier, ce n’est qu’à partir des années 1960 que La révolution inconnue connaîtra un début de diffusion, avec une publication d’extraits de celui-ci dans Ni dieu ni maître, une anthologie de l’anarchisme de Daniel Guérin. L’ouvrage est enfin réédité en 1972 aux éditions Belfond dans une collection codirigé par Daniel Guérin, mais n’a pas encore connu une large diffusion.
[3] À partir de 1930, le KPD tente de (re)conquérir une partie de l’électorat ouvrier des nazis, et fait front commun avec ceux-ci pour abattre la République de Weimar. Mi-septembre 1930, un député du KPD lance au Parlement allemand : « Le parti national-socialiste a une tâche historique, la tâche de désagréger les milieux que nous ne touchons pas encore et qui nous ne nous sont pas encore passés à l’armée révolutionnaire. Ces gens chez lesquels il a détruit la foi en la capacité de survie du système capitaliste, en sa nécessité et en sa légitimité, ces gens ne viendront jamais à vous (NB : au SPD), ils viendront à nous. La stratégie du KPD donne quelques fruits, avec des ralliements de plusieurs milliers de militants nazis « de gauche », et notamment de Richard Scheringer, héros nazi et futur dirigeant du KPD de l’Allemagne de l’Ouest après 1945. Fin 1932, l’organe du KPD publie même une « Lettre ouverte aux électeurs ouvriers du NSDAP », où il est écrit « les membres prolétariens du NSDAP sont entrés dans les rangs du front uni du prolétariat » et surtout « nous avons même constitué un front unique de classe avec les prolétaires nazis. ». Là-dessus, on lira Louis Dupeux, Le national-bolchévisme dans l’Allemagne de Weimar 1919-1933, Librairie Honoré Champion, Paris, 1979.
[4] Soulèvement de paysans de la Volga (1667-1671), cf. Roland Mousnier, Fureurs paysannes. Les paysans dans les révoltes du 17ème siècle – France, Russie, Chine, Calmann-Lévy, 1967.
[5] Cf. Franco Venturi, Les Intellectuels, le peuple et la révolution. Histoire du populisme russe au XIXème siècle, Paris, Gallimard, 1972.
[6] Cf. Jacques Baynac, Les Socialistes-Révolutionnaires (mars 1881-mars 1917), Robert Laffont, 1979.
Vous aimerez aussi
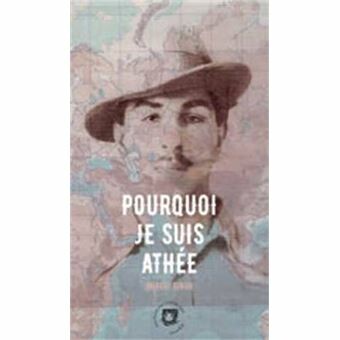
Bhagat Singh – Pourquoi je suis athée
6 septembre 2017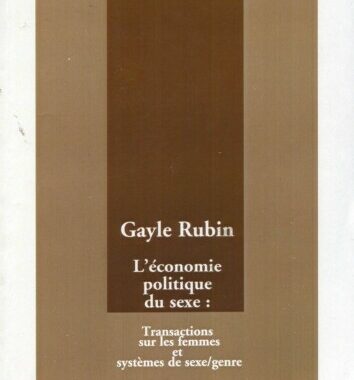
Gayle Rubin – L’économie politique du sexe
9 juillet 2017