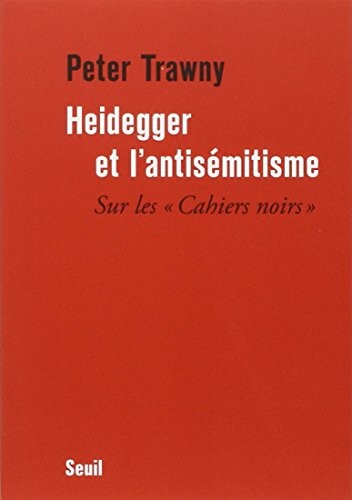
Peter Trawny – Heidegger et l’antisémitisme
Peter Trawny, Heidegger et l’antisémitisme, Paris, Seuil, 2014
« Heidegger et le mythe de la conspiration juive mondiale » : tel est le titre de l’ouvrage en allemand, traduit aux éditions du Seuil en 2014 avec comme titre Heidegger et l’antisémitisme. L’ouvrage ne pouvait donc que nous intéresser au plus haut point, puisqu’au fondement de l’anticapitalisme tronqué antisémite contemporain, il y a ce mythe d’une conspiration juive mondiale [Postone]. Et l’auteur de l’ouvrage n’est autre que Peter Trawny, un heideggerien un minimum critique, directeur de l’Institut Heidegger.
D’emblée, les traducteurs expliquent qu’ils ont traduit “Weltjudentum”, présent à plusieurs reprises dans des passages des Cahiers noirs, par “juiverie mondiale”, ce qui annonce déjà un peu sa teneur : “Erich Ludendorff, le généralissime allemand, auteur de La Guerre totale, qui participe avec Hitler au putsch de la brasserie de Munich, écrit en 1921 que la « juiverie mondiale » [das Weltjudentum] est responsable de la défaite de l’Allemagne. Dans Mein Kampf, Hitler évoque à plusieurs reprises le « Juif mondial » [Weltjude], la « juiverie mondiale » [Weltjudentum] et la « juiverie mondiale internationale » [internationales Weltjudentum] pour désigner une « conspiration juive » visant la « domination totale du monde ». Il emploie le terme dans le fameux discours au Reichstag du 30 janvier 1939 dans lequel il « prophétise » que si « la juiverie financière internationale réussit encore à jeter les peuples dans la guerre mondiale », celle-ci aboutira non pas à « la bolchevisation de la terre », mais à « l’anéantissement de la race juive », en ajoutant : « La juiverie mondiale [das Weltjudentum] a très mal évalué les forces qui sont à sa disposition dans le déchaînement de cette guerre, et elle subit un processus progressif d’anéantissement. Le terme de Weltjudentum est devenu un des vecteurs de la propagande nazie dans les années 1920 et sous le 3ème Reich à travers sa presse, ses brochures, etc. » (pp. 11-12).
Pourtant, les traducteurs affirment plus haut que si “l’expression « juiverie mondiale » n’a guère été employée en France que dans le cadre de la presse et de la « littérature » antisémites, puis sous le régime de Vichy, généralement assortie de qualifications injurieuses et animalisantes des Juifs. Or tel n’est pas le registre des remarques de Heidegger dans les Cahiers noirs, même dans les passages que Peter Trawny estime, à juste titre, antisémites. L’antisémitisme dégagé par l’auteur n’est précisément pas un « antisémitisme vulgaire » (pp. 13-14) dont Heidegger entendait se tenir à distance.” On attend donc d’en savoir davantage, un peu perplexes. Les traducteurs expliquent néanmoins : “Dans les remarques des Cahiers noirs où apparaît cette expression, il n’est nullement question du « judaïsme » en tant que religion […]. C’est bien en tant que « puissance partout présente et partout insaisissable », capable de « lever des armées », « race » dotée d’un « don particulièrement prononcé pour le calcul », etc., que Heidegger évoque et attaque le Weltjudentum – soit en suivant les caractéristiques qu’ont données de la « juiverie mondiale » les stéréotypes antisémites, et nullement à partir de quelque analyse « théologique » que ce soit” (p. 14). On se demandera, avec Emmanuel Faye, en quoi est-ce qu’Heidegger n’opère pas simplement une sophistication métaphysique de l’antisémitisme “vulgaire”, mais au moins les traducteurs n’ont-ils pas procédé à un choix de traduction fallacieux pour masquer l’antisémitisme de Heidegger.
Dans sa préface, l’auteur explique avec quelques regrets que “durant les cinquante dernières années, la réception philosophique de Heidegger s’est déroulée de façon différente en Allemagne et en France. Tandis qu’en France, à côté du maintien d’une apologie monolithique, une explication critique de haut niveau s’est également développée, en Allemagne, à côté d’une référence affirmative dont s’est préoccupé avant tout Gadamer, un rejet invétéré s’est réalisé institutionnellement du côté de l’École de Francfort.” (p. 17). Pourtant, l’École de Francfort est relativement marginale dans le champ académique, et elle avait d’excellentes raisons de prendre ses distances avec un penseur qu’elle considérait justement comme contre-révolutionnaire, anti-marxien, mystique, nazifiant et idéaliste, puisqu’elle avait perdu plusieurs de ses membres (Benjamin notamment) – et d’autres avaient été contraints à un exil pénible – à cause du NSDAP dont Heidegger a été membre dès 1933 et jusqu’en 1945. L’auteur ne craint pas de se poser en modéré, un “moyen-terme” aristotélicien, entre des “positions extrêmes [qui] se sont durcies, la position apologétique comme la position hostile” : “d’un autre côté, une interprétation prudente et pondérée des Cahiers a commencé à prendre la parole. Seule cette troisième voix est philosophique. Elle se pense capable de nommer clairement « l’erreur » de Heidegger et en même temps de souligner l’esprit abyssalement philosophique des Cahiers noirs.” (p. 18).
L’esprit philosophique des Cahiers noirs… Cette façon de renvoyer dos-à-dos critiques comme Faye et apologètes comme Hermann Heidegger est assez commode, puisqu’elle permet de poser comme seule légitime une position dont l’objectif est clairement de sauver Heidegger en lavant un peu son linge sale – qui pourtant à déteint sur son œuvre entière. On saluera néanmoins que l’auteur a proposé comme concept celui d’« antisémitisme inscrit dans l’histoire de l’être » [« seinsgeschichtliche(r) Antisemitismus »] (p. 18), ce qui a le mérite de rattacher l’antisémitisme avec la métaphysique heideggerienne de l’être – en même temps, comment pouvait-il en être autrement, puisqu’Heidegger parle des Juifs dans ses Cahiers noirs comme des “étant hors de l’être” ? Toujours est-il qu’il admet que “dans une phase de sa pensée, Heidegger a transformé au sein de son récit de l’histoire de l’être des stéréotypes antisémites alors très répandus” (p. 19). Le problème est que cette phase semble longue, puisqu’Heidegger est déjà antisémite en 1916 comme l’a montré Emmanuel Faye, et qu’il semble l’être resté jusqu’au bout, même si cet antisémitisme est plus discret avant 1928 (il lui faut obtenir le poste d’Edmund Husserl, son maître, d’origine juive) et après 1945 (il lui faut échapper à la dénazification intellectuelle pour continuer de diffuser son œuvre).
Peter Trawny poursuit lucidement : “Il n’est au demeurant pas inhabituel, dans la philosophie allemande, qu’un philosophe laisse entrer dans sa pensée les images et les voix de l’antisémitisme. Par exemple, une des mauvaises revendications de l’interprétation de Nietzsche prétend que le philosophe était protégé contre l’antisémitisme, puisque après tout il a voulu, dans un délire, fusiller tous les antisémites. Une des thèses importantes de la Généalogie de la morale est pourtant que les Juifs ont dû être les inventeurs de la « morale des esclaves ». Ce n’est peut-être pas un hasard si l’on trouve trace de l’influence de Nietzsche dans les Cahiers noirs.” (p. 20). Peter Trawny écorne justement Nietzsche, qui n’a pas été nazi évidemment mais qui n’en a pas moins été un anti-judaïque néo-païen virulent, même s’il n’a pas été jusqu’à croire à une domination mondiale de la “juiverie internationale” comme Heidegger. Certes, “il a produit ses « Réflexions » à un moment où tout le monde pouvait brandir des discours antisémites. L’antisémitisme était une carrière. Pour cette raison, il importe de faire valoir une justice herméneutique. Mais précisément cette justice doit constater que Heidegger a consigné ses notations sur « la juiverie mondiale » alors qu’en Allemagne les synagogues brûlaient. Et elle doit observer que même dans les Cahiers noirs, ces manuscrits ésotériques, on trouve beaucoup d’expressions de deuil sur la souffrance des Allemands, mais aucune sur celle des Juifs. Un silence domine, qui résonnera encore longtemps dans nos oreilles.” (p. 21).
En revanche, il n’est pas vrai de dire que ce que “nous savons, Heidegger, entre les années 1938 et 1941, ne le savait pas.” : il avait lui-même exclu les étudiants et les professeurs juifs de son Université lorsqu’il en était recteur, il avait présidé un autodafé de livres “judéo-bolchéviques”, il connaissait les lois de Nuremberg de 1935, etc. Et le dernier paragraphe de la préface nous paraît complètement déplacé : “Et pourtant ce silence même ne peut pas être le dernier mot. La philosophie, quand elle advient, est libre. À la liberté appartient le danger de l’échec” (p. 21). La liberté de faire l’apologie du 3ème Reich et son Führer, et de diffuser l’antisémitisme dans ses cours et dans son œuvre à des futurs soldats, des ex-soldats ou à un idéologue islamiste, quel dommage que cela se soit soldé par un “échec” ! Les descendants des victimes du régime nazi apprécieront.
Nous ne commenterons pas ici l’affinité personnelle entre Heidegger et certains Juifs, se bornant constater qu’il a par exemple rejeté Husserl (d’origine juive) après qu’il l’ait remplacé en 1928, que d’autres personnes d’origine juive comme Gunther Anders lui en ont particulièrement voulu, ou qu’il a toujours trouvé qu’il manquait “quelque chose” à son assistant brillant… d’origine juive. Il critique en revanche avec justesse le mot de Jonas selon lequel Heidegger était “apologique” dans les années 1920 “Ce dernier jugement, sur le caractère « apolitique » de Heidegger, est tout bonnement faux. Sous le IIIème Reich, Heidegger pensait plus « politiquement » que la plupart des professeurs.” (p. 23). L’auteur poursuit : “Notre vision de Heidegger comporte maintenant une facette nouvelle, inconnue jusqu’ici : à un certain moment de son cheminement, le philosophe a ouvert sa pensée à un antisémitisme qui peut être désigné plus précisément comme un antisémitisme inscrit dans l’histoire de l’être” (p. 26), même s’il s’inquiète du fait que “le soupçon d’antisémitisme pourrait profondément ébranler la philosophie heideggérienne” (p. 26). Évidemment, l’auteur écarte ce soupçon en disant qu’il ne s’agit pas d’une “philosophie antisémite”. Certes, pas exclusivement, mais il n’empêche qu’Heidegger a lié ses principaux concepts à des expressions antisémites. “Tous les chemins de l’antisémitisme conduisaient-ils à Auschwitz ? Non. […] Néanmoins, même si rien n’indique que Heidegger ait soutenu le « meurtre de masse administratif » (Hannah Arendt), même s’il n’y a aucun signe que Heidegger ait su ce qui se passait dans les camps d’extermination, il ne pourra jamais être tout à fait exclu qu’il ait pu tenir pour nécessaire la violence contre les Juifs.” (pp. 27-28). Tous les chemins de l’antisémitisme ne conduisent pas au génocide, mais lorsqu’un chemin antisémite va particulièrement loin, comme tout chemin raciste, il va vers l’extermination. Et Heidegger n’est pas bien clair là-dessus [cf. Faye].
Les Cahiers noirs
Les Cahiers noirs sont des cahiers des années 1930 aux années 1970, baptisés comme tels par Heidegger lui-même, et dans lequel il développe une philosophie ésotérique : “Il s’agit d’écrits philosophiques élaborés” (p. 29). Sans savoir s’il s’agit de textes fondamentaux ou non de Heidegger – l’auteur ne tranche pas –, en tout cas ils évoquent beaucoup “les Juifs” entre 1938 et 1941, soit plus de 5 ans après l’arrivée au pouvoir d’Hitler – date à laquelle Heidegger savait ce qu’était le nazisme “en action”. Le fait qu’il ait tenu ces écrits antisémites secrets, même aux nazis, serait selon l’auteur le reflet d’une culture du secret et d’une méfiance vis-à-vis de la “publicité” (pp. 31-32).
Le paysage de l’histoire de l’être
L’auteur va ensuite développer de longues réflexions au sujet des écrits d’Heidegger (qu’il faut lire, que nous aborderons uniquement lorsqu’il traite de contenus antisémites. “Déjà dans Être et Temps, le philosophe avait expliqué ce qu’il entendait par « destin » [Geschick]. Le « destin » consisterait dans « l’avènement de la communauté du peuple ». Dans « l’être-ensemble dans le même monde et dans la résolution pour des possibilités déterminées », les parcours de la vie individuelle seraient « déjà orientés d’avance ». C’est seulement « dans la communication et le combat » que la « puissance du destin se [libérerait] ». Celui-ci serait « l’unique autorité qu’une existence libre » pourrait reconnaître.” (pp. 34-35). Force est de constater qu’une telle pensée est assez proche de l’idéologie nazie du destin du Volk (peuple-race) allemand, de la soumission de l’individu à la communauté du peuple-race, et d’un destin guerrier, et ce dès Être et temps (1927) donc – rappelons qu’à cette date, sa femme est une fervente nazie [cf. Faye].
Heidegger se demande, en outre, dès 1932 “est-ce qu’aujourd’hui nous devons abandonner le philosopher – parce que peuple et race ne sont plus à sa hauteur”, d’une manière typiquement “décadentiste”, laquelle est un signe de la pensée d’extrême-droite selon Alain Bihr dans L’actualité d’un archaïsme. Certes, “vers l’année 1941, Heidegger estime que « tout impérialisme », c’est‐à-dire la dynamique politique de tous les protagonistes de la guerre, conduit « à un suprême accomplissement de la technique » (p. 40) qu’il condamne, mais n’a-t-il pas fait de la motorisation de l’armée allemande un “événement métaphysique” [cf. Faye] ? Trawny parle d’un récit d’Heidegger où « l’Allemand seul peut poétiser et dire à nouveau l’être de façon originelle. » Le récit a, au début, deux acteurs principaux : « les Grecs » et « les Allemands »” (p. 43). On est ici dans une pensée clairement néo-païenne raciste, avec deux “races”, une actuelle, une historique, seules capables de “dire l’être”. L’usage de tels concepts collectifs, comme “les Juifs”, ne semble pas vraiment problématique aux yeux de l’auteur, alors même qu’il s’agit-là d’une réification et d’une homogénéisation des subjectivités vivantes [cf. Joseph Gabel, La fausse conscience, Paris, Editions de Minuit, 1962].
Plus loin, Trawny affirme que “Heidegger a salué la « révolution nationale » et s’est mis à son service. Il rattachait à cette révolution un « national-socialisme spirituel » qu’il distingua assez tôt d’un « national-socialisme vulgaire ». C’est aussi à elle qu’il est resté loyal jusqu’à la toute fin, jusqu’à la « capitulation », malgré toutes les prises de distance philosophiques.” (pp. 46-47).
Certes, le nazisme de Heidegger ne pouvait être le même que celui d’un SA, comme l’islamisme d’un Ahmad Fardid (héritier philosophique de Martin Heidegger, ancien étudiant de la Sorbonne, idéologue de l’islamisme iranien) est plus sophistiqué que celui d’un simple gardien de la révolution : ils n’en demeurent pas moins tous deux des antisémites. Heidegger, empêtré dans sa métaphysique, ne pouvait évidemment pas adhérer à tous les aspects bassement “matérialistes” du nazisme : pour autant, dire qu’à “la fin des années 1930, la critique dirigée contre celui-ci [le régime nazi] devint toujours plus vive : critique de l’absolutisation du concept de race, du biologisme en général, de la technicisation du pays, de l’impérialisme, et même, pour finir, du nationalisme” (p. 47), c’est aller un peu vite en besogne, et c’est surtout se dispenser de preuves écrites. Heidegger parle d’ailleurs dans L’introduction à la métaphysique de “la vérité et la grandeur interne de ce mouvement [national-socialiste]” (cité dans Trawny, p. 48).

Types de l’antisémitisme relevant de l’histoire de l’être
Dans ce chapitre, Trawny aborde frontalement l’antisémitisme d’Heidegger. L’auteur fait cette judicieuse remarque : “Le concept d’un « antisémitisme inscrit dans l’histoire de l’être » ne veut aucunement dire que nous aurions affaire à un antisémitisme particulièrement élaboré ou raffiné. Heidegger a repris pour l’essentiel certaines formes universellement connues. Cependant, il les a philosophiquement interprétées, i.e. intégrées à l’histoire de l’être” (p. 51). C’est exactement cela, un antisémitisme vulgaire intégré à une métaphysique de l’être, un antisémitisme reformulé philosophiquement. Il en donne trois exemples extraits des Cahiers noirs.
Le premier : « L’accroissement temporaire de la puissance de la judéité a son fondement dans le fait que la métaphysique de l’Occident, surtout dans son déploiement moderne, a offert le lieu de départ pour la propagation d’une rationalité et d’une capacité de calcul qui seraient entièrement vides si elles n’avaient pas réussi à se ménager un abri dans “l’esprit”, sans pour autant jamais pouvoir saisir à partir d’elles-mêmes les domaines de décision cachés. Plus originelles et inaugurales deviennent les décisions et les questions à venir, plus inaccessibles à cette “race” elles demeurent.” (pp. 51-52). Heidegger montre ici qu’il considère le rationalisme comme une forme “vide” de philosophie (typique de l’anti-Aülfkarung réactionnaire des nazis), et affirme que la “race” des Juifs est incapable d’autre chose que de cette sous-pensée superficielle (mais s’est néanmoins infiltrée dans l’Université, dont Heidegger les a chassés).
Le second : « Par leur don particulièrement accentué pour le calcul, les Juifs “vivent” depuis le plus longtemps déjà d’après le principe racial, raison pour laquelle ils se défendent aussi violemment contre son application illimitée. La mise en place de l’élevage racial ne provient pas de la “vie” elle-même, mais de la subjugation de la vie par la machination. Ce que celle-ci manigance à travers une telle planification est une déracialisation complète des peuples, à travers la fixation dans l’installation uniformément bâtie et découpée de tout étant. Avec la déracialisation va de pair une auto-aliénation des peuples – la perte de l’histoire –, i.e. des domaines de décision en direction de l’estre. » On aura remarqué d’emblée le “vivent”, qui montre qu’Heidegger n’accorde pas de capacité à “vivre” véritablement aux Juifs – on comprend donc que dans ses conférences négationnistes de Brême de 1949, il ne leur accorde pas non plus la capacité de “mourir” (“Meurent-ils ?”) véritablement. Ensuite, outre le stéréotype du “Juif calculateur” (financier, marchand [Schacherjude], usurier), et une pseudo-justification des lois racistes par le fait que les Juifs fonctionneraient de base selon un principe racial, Heidegger critique la « déracialisation complète des peuples », une « auto-aliénation des peuples » au travers de l’industrialisation (il ne critique pas le capitalisme, simplement ses formes techniques, d’où coup il naturalise le capitalisme, le travail particulièrement, à l’instar des nazis [cf. Postone]), une pensée qui est une forme d’anticapitalisme tronqué de type réactionnaire (contrairement à un anticapitalisme émancipateur défendu ici), essentialisant racialement des « peuples », alors même qu’il n’y a pas de « peuples » fixes historiquement, anhistoriques, mais des groupes d’individus en perpétuelle recomposition.
Enfin, il affirme que « même l’idée d’une entente avec l’Angleterre, au sens d’un partage entre impérialismes “légitimes”, ne touche pas à l’essence du processus historique que maintenant porte à sa fin l’Angleterre, au sein de l’américanisme et du bolchevisme, c’est‐à-dire de la juiverie mondiale. La question du rôle de la juiverie mondiale n’est pas raciale, c’est la question métaphysique portant sur la facture du type d’humanité qui, de façon absolument déliée de toute attache, peut assumer comme “tâche”, au niveau de l’histoire mondiale, le déracinement de tout étant hors de l’être. » (p. 53). Outre que cela montre qu’Heidegger, comme les nazis d’ailleurs, considère l’impérialisme, la conquête militaire, comme potentiellement « légitime », met dans le même sac l’Angleterre, « l’américanisme » et le « bolchevisme », puisque supposément sous la coupe de la « juiverie mondiale ».
Il ne s’agit-là que d’une reformulation pseudo-métaphysique du nazisme vulgaire. D’autre part, la « juiverie mondiale » est considérée comme un type d’humanité « absolument déliée de toute attache » ayant comme but machiavélique « le déracinement de tout étant hors de l’être » : autrement dit, la « juiverie mondiale » serait cette conspiration cosmopolite-apatride qui aurait comme but de « déraciner » les Aryens et les autres peuples-race, de les transformer en « étant hors de l’être », c’est-à-dire en de simples animaux « pauvres-en-monde ». On comprend que face à de tels enjeux, face à un complot d’une telle ampleur, tous les moyens soient permis. Et « plus l’Allemagne, et avec elle la conception propre d’une mission particulière des Allemands au sein de l’Occident, entre dans une crise politico-militaire, plus fréquemment Heidegger met le cap vers des mouvements de pensée antisémites. » (p. 54).
Trawny explique de manière intéressante : « Heidegger n’affirme pas que « l’absence de monde » serait un caractère en somme naturel de la judéité. Il pense plutôt qu’elle ne serait fondée que sur « l’aptitude pour le calcul ». Mais cette « aptitude » serait une « des formes les plus dissimulées du gigantesque », c’est‐à-dire de la « machination ». L’origine de « l’absence de monde propre à la judéité » est donc – la « machination », qui porte au pouvoir « le calcul » comme activité déterminant le monde. L’idée que la « machination » exige et fonde « l’absence de monde » de l’homme est une pensée bien connue qui relève du répertoire de la critique de la technique. Qu’elle fonde « l’absence de monde propre à la judéité » est une accentuation problématique. » (pp. 55-56).
Argument intéressant, non pas parce qu’il euphémise l’affirmation d’Heidegger d’une « absence de monde » chez les « Juifs » – en cela, c’est une affirmation critiquable -, mais plutôt parce qu’il montre que cet antisémitisme prend racine à partir d’une critique tronquée du capitalisme industriel, du seul côté « impersonnel » et « machinique » d’une dynamique qui prend également appui sur des groupes (exhortés chez Heidegger comme « peuple-race ») constitués d’individus vivants qui peuvent être, à l’instar des nazis, aussi destructeurs que la « machination ». C’est également une critique tronquée parce qu’idéaliste : le capitalisme, ce n’est pas « le calcul », la logique, la rationalisation comme pensait également Weber (qu’on ne taxera pas cependant d’antisémitisme), mais c’est une société structurée autour de la marchandise, de la valorisation, du capital, avec comme autofinalité l’accroissement de la valeur, laquelle nécessite effectivement du calcul, de la logique et de la machination.
Heidegger, en critiquant le calcul, la logique et la machination, fait implicitement l’apologie d’un capitalisme anti-industriel (c’est en ça qu’il se différencie assez franchement des nazis, plus pragmatiques), fondé sur une exploitation des « individus vivants » au service d’un but fantasmatique – même s’il n’est pas exempt de contradiction, notamment lorsqu’il loue la motorisation de l’armée allemande [cf. Faye]. Autrement dit, les « Juifs » sont chez Heidegger non seulement la personnification du côté abstrait, impersonnel, mondial du capital (comme chez les nazis [cf. Postone]), mais également la personnification du calcul et de la machination, c’est-à-dire de la rationalisation machinique permanente du procès capitaliste de production : Heidegger révèle ici le fantasme d’un capitalisme non-industriel « enraciné » de paysans producteurs de marchandises et d’un État s’occupant de réaliser un fantasmatique « destin national » (donc racial).
Les Juifs doivent donc être « éliminés » (métaphysiquement, sinon physiquement) pour Heidegger pour deux raisons : d’une part parce qu’ils sont une personnification du côté abstrait, insaisissable, impersonnel, mondial du capitalisme, et d’autre part parce qu’ils sont une personnification du calcul et de la rationalisation instrumentale du monde au travers des machines. Heidegger se fait ainsi le défenseur d’un capitalisme autarcique, paysan, idéaliste (qu’il personnifie en « Allemands » ou en « Grecs »), contre un capitalisme mondial, industriel-financier, « matérialiste » (qu’il personnifie en « Juifs »). Mais c’est notre interprétation.
Trawny poursuit : « Heidegger semble ici convertir au plan de l’histoire de l’être une attribution antisémite plutôt banale (un « don particulièrement accentué pour le calcul »), et son antisémitisme est ancré dans cette figure de pensée. C’est le Juif-marchandeur [Schacherjude], qui, dans tout antisémitisme, représente une des figures les plus familières du « caractère juif » » (p. 56). Comme confirmant notre précédente analyse sur l’idéalisation d’un capitalisme paysan, non-machinique, autarcique, Trawny écrit : « L’association entre monde juif et argent s’établit déjà sociologiquement là où, dans un mode de vie provincial et rural – comme dans le foyer d’origine de Heidegger, Messkirch –, les paysans et artisans gagnent leur argent « à la sueur de leur front », tandis que les Juifs réalisent autrement leur revenu » (p. 57) parce qu’ils ont été exclus de l’activité agricole depuis des siècles.
Cette apologie du petit capitalisme paysan et artisanal est effectivement contradictoire avec la pratique et même en partie avec l’idéologie nazie, qui exhorte l’industrie en même temps que la paysannerie (et, en réalité, industrialise l’agriculture), et qui montre que Heidegger appartient à une frange complètement passéiste (qui rêve de paysans vendant leurs produits sur le marché local et gouverné par des Führer héroïques) de l’extrême-droite allemande, alors que le nazisme avait des côtés bien plus modernistes (apologie de l’industrie, de la grandeur « matérielle » et pas simplement métaphysique, etc.). Ainsi, « dans une lettre de Martin à Elfride Heidegger, Heidegger écrit, en 1920 : « ici on parle beaucoup du fait que les Juifs achètent en ce moment dans les villages d’énormes quantités de bétail […]. Ici en altitude les paysans commencent eux aussi à devenir sans scrupule et tout est submergé de Juifs et de margoulins » (p. 56). L’idéal d’un capitalisme paysan, non-industriel, idéaliste, familial (donc patriarcal), aristocratique (comme Nietzsche [cf. avec des réserves concernant son stalinisme, Domenico Losurdo, Nietzsche, le rebelle aristocratique]), tel est celui d’Heidegger, en accord avec une grande partie de l’idéologie nazie mais en désaccord avec une partie de sa pratique industrialiste.
Quoiqu’il en soit, Trawny poursuit en parlant de la représentation d’Heidegger « d’une « juiverie mondiale » qui parvient à la domination du monde par le contrôle des économies nationales et par d’autres instruments (cela concerne lesdits Protocoles des Sages de Sion, sur lesquels il nous faudra revenir plus précisément, parce que Heidegger se rapporte très vraisemblablement à eux). Une autre association concerne l’attitude métaphysique-religieuse, imputée aux Juifs, du « mammonisme », un concept de Georg Simmel, caricature critique de l’idolâtrie de l’argent. Une variante supplémentaire vise le calcul tout court. » (p. 58). On est ici dans un anticapitalisme tronqué conspirationniste-antisémite typique, ressuscité aujourd’hui avec les fantasmes sur l’argent-dette [cf. Léon de Mattis pour une contre-argumentation marxienne], la souveraineté monétaire, les « secrets de la Réserve fédérale », l’apologie du franc ou de l’or, et quelques autres balivernes (puisqu’il s’agit toujours de perpétuer le capitalisme) en provenance historique de l’extrême-droite. D’autre part, la critique du « mammonisme » est une critique davantage archaïque, venant de l’anti-judaïsme du Moyen Âge, mais qui fait également partie de la gamme de l’antisémitisme moderne.
Trawny continue de répondre à la première citation de Heidegger : « De manière générale, le calcul est rattaché par Heidegger à la rationalité. Ainsi peut-il inclure son ancien maître, Edmund Husserl, dans une histoire dans laquelle un « accroissement temporaire de la puissance de la judéité » condamne la « métaphysique de l’Occident, en particulier dans son déploiement moderne », à l’absence de décision. […] Husserl est inscrit dans l’histoire d’une « rationalité et d’une capacité de calcul vides » pour le motif de son appartenance à une « race ». On ne doit certes pas négliger le fait que Heidegger met ce concept entre guillemets, mais de quelque façon que l’on interprète ce fait, cela ne peut atténuer en rien l’orientation générale des idées de Heidegger.
Le point problématique, dans ces formules de Heidegger, n’est pas seulement l’idée que le fait que Husserl soit d’origine juive serait responsable de l’incapacité de sa phénoménologie à atteindre « jamais les domaines des décisions essentielles ». Outre cela, sa critique, souvent exposée également après la guerre, d’une « pensée calculante », qui se voit distinguer d’une « pensée méditante » et qui, à la différence de celle-ci, ne peut jamais trouver son « attachement au sol », prend un arrière-goût sinistre. Car un des contre-concepts à « l’attachement au sol » dans la « patrie » est « l’absence de monde », qui, en tant que conséquence de la « machination », caractérise la judéité selon Heidegger. » (pp. 58-60). Et c’est précisément le fondement de son négationnisme ontologique [cf. Faye]…
Trawny poursuit : « La rationalité comme telle devrait-elle alors être considérée comme une invention des Juifs dans l’histoire de l’être – ou bien Heidegger appréhende-t-il plutôt la judéité comme une forme dans laquelle la « machination » se réalise ? De quelque façon que l’on réponde à cette question, il est aberrant de rapporter « l’aptitude pour le calcul » seulement à la philosophie des Temps modernes. […] La mathesis, y compris au sens mathématique du terme, a son origine dans la pensée grecque. Cela affecte le récit de Heidegger concernant la relation qu’entretiennent les Grecs et les Allemands au plan de l’histoire de l’être. Dans sa construction, les pythagoriciens, le rapport de Platon à ces derniers et l’introduction des mathématiques en particulier dans le Timée, Euclide et ses Éléments, n’ont pas de place, pour ne rien dire des Égyptiens, par qui les Grecs ont été instruits des mathématiques. […] Un type d’antisémitisme chez Heidegger consiste à attribuer aux Juifs une « aptitude pour le calcul, le trafic et la confusion », à laquelle il donne une interprétation philosophique épouvantablement poussée. Le Juif apparaît comme le sujet calculant, dépourvu de monde, dominé par la « machination » » (pp. 60-61). On est là dans un néo-paganisme métaphysique, dans un refus de toute pensée « mathématique » ou simplement logique, prélude à un mysticisme dont on sait qu’il peut provoquer des « pestes émotionnelles » (Reich) dévastatrices.
Dans son commentaire de la deuxième citation, Trawny explique : « Heidegger explique la phénoménologie de Husserl, indirectement, à partir du caractère d’une « race » » (p. 62). Trawny explique ensuite (même si on pourra avoir certaines réserves là-dessus) qu’Heidegger rejette la « pensée de la race » nazie, qu’il condamne comme « moderne » (on voit-là son passéisme acharné), mais « cela ne signifie aucunement qu’il aurait des doutes sur la réalité de la« race ». La « race » serait « une condition nécessaire et s’exprimant médiatement du Dasein historique (être-jeté) ». Cette condition serait « falsifiée […] dans la “pensée de la race” en condition unique et suffisante ». « Une condition » serait « élevée au rang d’inconditionné ». La distance de Heidegger par rapport à la « pensée de la race » touche par conséquent l’absolutisation théorique d’un moment de « l’être-jeté » parmi d’autres moments, mais elle ne concerne pas l’idée que la « race » appartient au Dasein. » (pp. 62-63).
Heidegger considère donc que la race est une composante nécessaire mais non suffisante du Dasein, ce qui n’en reste pas moins racialiste. Et Trawny d’admettre « une proximité avec l’idéologie du national-socialisme peut malgré tout être reconstruite. » (p. 64). Trawny poursuit : « D’un côté, le philosophe déclare que la « pensée de la race » est une « conséquence de la machination ». D’un autre côté, il avance que « les Juifs […] par leur don particulièrement accentué pour le calcul, “vivent” depuis le plus longtemps déjà d’après le principe racial ». Comment se concilient ces affirmations ? Est-ce que la conclusion à tirer n’est pas que la « machination » et le « don pour le calcul » s’entre-appartiennent ? Il semble en être ainsi. » (p. 64).
La suite est extrêmement intéressante : « La « mise en place de l’élevage racial » ne proviendrait « pas de la “vie” elle-même », estime Heidegger. La « vie » se déroule sans s’orienter vers la culture et l’anoblissement des races. Par cette pensée, Heidegger ne veut pas s’immiscer dans les intérêts de la biologie. Il semble plutôt vouloir dire que le commerce quotidien des hommes ne se préoccupe pas de la « préservation de la pureté » d’une « race ». Il faut donc l’intervention d’une « mise en place » et par là de l’origine de toute « mise en place », c’est‐à-dire de la « machination », pour organiser la « vie » de cette manière. D’un côté, Heidegger a trouvé une telle organisation chez les nationaux-socialistes. D’un autre côté, il la voyait chez les Juifs, qui « depuis le plus longtemps déjà “vivent” d’après le principe racial », ce qui ne peut signifier qu’une chose : qu’ils ont réalisé les premiers une « caractéristique » de la « machination » – la « mise en place de l’élevage racial ».
D’après Heidegger, telle avait été la mission des Juifs : assumer un rôle pionnier dans « la mise en place de l’élevage racial », c’est‐à-dire dans l’organisation « de la race en fonction de la machination ». Entre autres choses, les lois de Nuremberg, qui ont été adoptées à l’unanimité le 15 septembre 1935 par le Reichstag, constituent l’arrière-plan de l’énoncé de Heidegger. […] [Elles] discriminaient à maints égards Juifs, Tsiganes, Noirs et métis (et du reste également les femmes en général, y compris les femmes allemandes). Tout cela était censé réaliser en profondeur une séparation des races, grâce à laquelle le « sang allemand » pourrait rester pur, c’est‐à-dire non mélangé. […] La pensée que les Juifs auraient été les premiers à avoir vécu « selon le principe racial » apparaîtrait alors sous un jour particulier. Les nationaux-socialistes appliqueraient « de façon illimitée » ce que les Juifs pratiquaient déjà depuis longtemps avant eux. Plus encore : l’explicitation dans le titre des « lois de Nuremberg » selon laquelle celles-ci serviraient à « protéger le sang allemand » présuppose un danger, une maladie contagieuse, ou un attaquant qui agit de façon stratégique. « L’application illimitée » du « principe racial » serait alors une simple mesure de protection dans un conflit. » (pp. 64-67).
Heidegger euphémise donc l’horreur des lois de Nuremberg en disant qu’il ne s’agit, au fond, que d’un approfondissement de lois raciales qu’auraient eux-mêmes mis en place les Juifs, raisonnement particulièrement abject. Ainsi, « Heidegger inscrit la « pensée de la race » des Juifs et des nationaux-socialistes dans l’histoire de l’être, dans l’histoire de la « machination ». L’hostilité entre les Juifs et les nationaux-socialistes (Heidegger se garde ici de parler des Allemands) résulte d’une concurrence onto-historique – et il est particulièrement problématique que la provocation de cette concurrence inévitable soit visiblement plutôt attribuée aux Juifs. » (p. 68). D’un autre côté, sans doute est-il vrai qu’Heidegger critique « la machination » des nazis comme des Juifs, mais c’est après avoir soutenu inconditionnellement le nazisme durant plusieurs années et au nom d’un idéal passéiste-réactionnaire – sans compter que jusqu’en 1945, « la machination » des nazis va être de temps en temps louée, notamment lorsqu’il fait de la motorisation de la Werhmacht victorieuse un « événement métaphysique ».
Trawny continue : « Mais ce que la « machination » manigance à travers cette concurrence cachée est, secrètement, selon Heidegger, une « déracialisation complète des peuples ». En même temps qu’elle se produirait « une auto-aliénation des peuples – la perte de l’histoire – i.e. des domaines de décision en direction de l’estre ». Nous avons souligné plus haut que Heidegger ne rejetait nullement la pensée de la race en soi, mais seulement son absolutisation : ce passage en est la plus forte confirmation. Car si la race est selon Heidegger un moment de « l’être-jeté », mais que celui-ci est, en tant que finitude du Dasein, quelque chose comme la condition de l’historicité, alors une « déracialisation complète des peuples » est « la perte de l’histoire » (pp. 69-70). Heidegger critique donc le nazisme et sa « pensée de la race », mais au nom de la race comme condition de l’histoire et du Dasein : on pourrait dire qu’Heidegger fait une critique interne du nazisme, comme accélérant un capitalisme industriel sous couvert d’une idéologie raciste, laquelle industrialisation in fine entraînera une « déracialisation complète des peuples », un déracinement.
Concernant enfin la troisième citation d’Heidegger, Trawny écrit : « Dans son Autobiographie philosophique, à propos de Heidegger, Karl Jaspers écrit : « Je lui parlais de la question juive, du non-sens stupide sur les sages de Sion, à quoi il me répondit : “il y a pourtant bien une dangereuse association internationale des Juifs”. » [cf. pour plus de détails, notre note de lecture sur Faye]. Ainsi, Trawny suggère que Heidegger a cru aux Protocoles des Sages de Sion, une fiction antisémite de la police tsariste mettant en scène une organisation juive internationale complotant en vue d’une domination mondiale (pp. 70-71). On apprend que « pour Arendt, […] la méthode des nationaux-socialistes était claire : « La fiction d’une domination juive mondiale qui existait déjà formait la base de l’illusion d’une domination allemande mondiale à venir. » Les Protocoles sont le témoignage de la concurrence évoquée entre les Juifs et les nationaux-socialistes, que Heidegger a manifestement prise pour point de départ. » (p. 72).
Trawny enchaîne : « Dans les Protocoles des Sages de Sion se trouvent de nombreux types de fantasmagories antisémites. La première fantasmagorie est celle d’une organisation secrète qui tire les fils, sur la terre entière, des décisions globales. Pour cela tous les moyens concevables sont employés : la politique, la finance, la culture, le communisme, la presse, tout est infiltré et tout est rendu instable. La philosophie elle-même est utilisée. » (p. 72).
Les Protocoles des Sages de Sion forment ainsi la référence fondatrice de tout le conspirationnisme du 20ème et du 21ème siècle. Une autre affirmation pourrait avoir eu un effet sur Heidegger, plus que cette remarque étrange. Sous le titre « L’écrasement de la résistance des non-Juifs au moyen des guerres et de la guerre mondiale généralisée », on lit : « Aussitôt qu’un État non juif ose nous opposer une résistance, nous devons être en mesure de pousser ses voisins à lui faire la guerre. Mais si ses voisins veulent faire cause commune avec lui et contre nous, alors nous devons déchaîner la guerre mondiale. » Cela recouvre précisément la concurrence postulée par Heidegger. Les nationaux-socialistes n’avaient-ils pas osé se dresser contre la « juiverie mondiale » ? Et celle-ci n’avait-elle pas trouvé la riposte parfaite ? Différents discours témoignent du fait que Hitler a entendu utiliser les Protocoles à des fins de propagande et montrent la façon dont il l’a fait. Dans un discours qu’il tient à la cité des ouvriers de Siemens de Berlin, le 10 novembre 1933, il parle de « la lutte des peuples et de la haine des uns envers les autres » qui serait « attisée » par des « intérêts très déterminés » [ce qui est un moyen de retourner contre eux l’internationalisme des ouvriers allemands]. Ce serait « une petite clique internationale sans racine qui [exciterait] les peuples les uns contre les autres ». […] Ou encore dans ce discours au Reichstag du 30 janvier 1939, dans lequel il « prophétise » : « Si la juiverie financière internationale, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Europe, devait précipiter encore une fois les peuples dans une guerre mondiale, alors le résultat ne serait pas la bolchevisation de la terre et avec elle la victoire de la juiverie, mais l’extermination de la race juive en Europe. » On reconnaît là les stéréotypes antisémites des Protocoles. » (pp. 73-74).
Pire, « Heidegger avait une oreille pour les discours de Hitler. En tout cas, il se demande jusqu’à quel point les « Anglais », dans « leur américanisme et bolchevisme » même, reprennent le rôle de la « juiverie mondiale ». Voilà ce qu’il aimerait comprendre non comme un phénomène « racial » mais comme un phénomène « métaphysique ». Il s’agirait du « type d’humanité qui [pourrait] assumer comme “tâche”, de façon absolument libre de toute attache, au plan de l’histoire mondiale, le déracinement de tout étant hors de l’être ». S’il est vrai que Heidegger suppose une concurrence suscitée et conduite par la « machination » entre les nationaux-socialistes et les Juifs, alors apparaît maintenant plus clairement quel caractère la judéité représente dans ce combat. La « machination » peut réaliser « la déracialisation complète des peuples » parce que les Juifs aspirent « de façon absolument libre de toute attache au déracinement de tout étant » » (pp. 74-75).
Trawny cite encore Heidegger : « « La juiverie mondiale, excitée par les émigrants qu’on a laissés partir d’Allemagne, est partout insaisissable, et malgré tout ce déploiement de puissance elle n’a nulle part besoin de participer aux actions militaires, face à quoi il ne nous reste qu’à sacrifier le meilleur sang des meilleurs de notre propre peuple ». Et l’auteur de s’interroger : « Une remarque d’un terrible poids est celle qui affirme que la « juiverie mondiale » serait excitée « par les émigrants que l’on a laissés partir d’Allemagne » […] Heidegger ne dit certes pas explicitement qu’on n’aurait pas dû les « laisser partir », mais cette pensée n’est assurément pas loin. » (pp. 76-77).
Trawny poursuit dans l’horreur : « Certes, la « juiverie mondiale » ne domine pas l’histoire – celle-ci est absolument contrôlée par la « machination » [dont elle est assurément la personnification] – mais elle semble être la première puissance parmi celles qui sont dominées par la technique. Ainsi, les « modes de pensée impérialistes-guerriers et pacifistes-humanitaires », c’est‐à-dire les « modes de pensée » des États totalitaires (Reich allemand, Italie et Union soviétique) aussi bien que des démocraties occidentales, seraient des « pousses dérivées de la “métaphysique” ». Comme telles, ils semblent être noyautés par la « juiverie mondiale ».
Car Heidegger poursuit : « De là vient que la “juiverie mondiale” puisse également se servir de l’un et de l’autre mode de pensée, proclamer l’un comme étant un moyen pour l’autre et le mettre en œuvre – ce faire-“histoire” propre à la machination empêtre tous les participants du jeu, de la même façon, dans ses filets. La « juiverie mondiale » aurait donc le pouvoir de monter les uns contre les autres les États engagés dans la guerre, en se « servant » de leurs « modes de pensée ». » » (pp. 77-78). On est là dans un discours qui rappelle furieusement non seulement l’idéologie nazie, mais également les discours sur le complot « américano-sioniste », qui fait de l’État d’Israël une puissance hégémonique tirant les ficelles (même s’il s’agit en réalité d’un État comparable à la Turquie en termes de puissance et de nuisance).
Trawny poursuit ses interrogations : « Il faudrait se demander sur quoi est fondée la prédestination particulière de la communauté juive pour la criminalité planétaire ». On est d’abord immédiatement tenté de comprendre cette phrase ainsi : Heidegger voudrait interroger ce qui a placé les Juifs dans la « prédestination propre » à devoir devenir les victimes des « plus grands criminels planétaires ». Toutefois, la formule n’exclut pas que Heidegger ait eu en vue non pas la « prédestination particulière de la communauté juive » à être la victime de ces criminels, mais être elle-même ces criminels . Cette interprétation s’accorderait avec les affirmations de Heidegger sur la puissance de la « juiverie mondiale ». Staline et Hitler comptaient certainement pour Heidegger au nombre des « plus grands criminels planétaires ». Cependant il ne faut pas exclure que cette caractérisation n’ait compris, à côté de Hitler et de Staline, la « communauté juive » » (p. 79).
Sans reprendre l’idée de Trawny concernant Hitler, puisque celui-ci a été longtemps encensé par Heidegger, il est clair qu’il s’agit d’une vision particulièrement conspirationniste antisémite. Et celle-ci se poursuivra jusqu’à tard : « Le cours de l’été 1942 sur l’hymne « Ister » de Hölderlin le montre. Heidegger voit alors les Allemands toujours davantage menacés par « l’américanisme » […] Est-ce que ce n’est pas la « juiverie mondiale », « partout insaisissable », qui se tenait derrière « l’américanisme » ? D’une manière générale, il semble qu’on puisse transférer sur la « juiverie mondiale » le contraire de tout ce que Heidegger cherchait à sauver – l’« attachement au sol », la « patrie », le « propre », la « terre », les « dieux », la « poésie », etc. » (p. 80). Repoussoir absolu, puissance hégémonique tirant les ficelles, Heidegger était bien antisémite.
Trawny va trop loin en revanche lorsqu’il écrit : « Il faut préciser que le fait d’identifier les Juifs à un style de vie international n’est pas antisémite en soi. Arendt elle-même concède que les « mensonges sur la conspiration juive mondiale » avaient « leurs fondements dans les liens internationaux d’interdépendance du peuple juif dispersé sur la terre », c’est‐à-dire dans la Diaspora. Il n’est pas antisémite de voir dans ce mode de vie un « déracinement ». Mais il est antisémite d’attribuer à ce mode de vie une hostilité concrète contre l’« attachement au sol » caractéristique des Allemands. Quand Heidegger a parlé, face à Jaspers, d’une « association internationale des Juifs » (et il n’y a pas de motif de penser que Jaspers se serait trompé ou ne se souvenait pas avec exactitude), il pouvait le faire en pensant à la Diaspora. La désigner comme « dangereuse » trahit l’arrière-plan antisémite. » (p. 81).
Le problème est qu’entre l’inter-dépendance d’un soi-disant « peuple juif » [cf. Shlomo Sand] créé de toutes pièces par les antisémites puis par les idéologues nationalistes israéliens et une organisation secrète visant à une domination mondiale, il y a un énorme fossé.
Trawny complexifie encore l’analyse en disant : « Heidegger paraît cependant échapper à ce reproche lorsqu’il situe le conflit avec la « juiverie mondiale » au sein de la « machination ». […] Car on ne peut nullement dire que dans le « combat » entre la « juiverie mondiale » et les nationaux-socialistes il aurait salué une « victoire » des seconds. Au contraire – dans ce « combat », il ne peut y aller, selon Heidegger, que de « la pure et simple absence de but ». La « véritable victoire », à l’inverse, réside pour lui là « où l’absence de sol elle-même » s’exclut, parce qu’elle « ne se risque pas à l’estre, mais [compte] toujours seulement avec l’étant » et pose « ses calculs comme l’effectif ». Dans cet énoncé, on ne perçoit pas du tout clairement si, en plus d’être un caractère propre à la judéité, « l’absence de sol » ne peut être également le caractère de la « machination » en général. » (pp. 81-82). Le « Juif » se révèle alors chez Heidegger comme une véritable personnification de « la machination », c’est-à-dire du capitalisme industriel, mondial, etc. Cela confirme l’analyse de Postone.
Mais Trawny continue : « Finalement, la difficulté d’une telle construction onto-historique vient elle-même au jour. Dans le « combat » des nationaux-socialistes avec les Juifs, en tant que « conséquence de la machination », domine une asymétrie qui doit inspirer réflexion. Certes, Heidegger remarque dans de nombreux passages que les nationaux-socialistes ont brutalement réalisé la technicisation et à ce titre la modernisation du pays. Cependant le caractère de la technique, le « machinique », était « l’absence de sol », « l’absence de monde », que le philosophe attribuait à la judéité. Les nationaux-socialistes étaient-ils ainsi à proprement parler des Allemands égarés par la « machination », c’est‐à-dire par les Juifs ? À la lumière de cette question, les nationaux-socialistes deviennent des marionnettes de la puissance « partout insaisissable » des Juifs. Les Protocoles n’inspirent-ils pas l’idée que le national-socialisme aurait pu être la plus maléfique invention des Juifs ? L’« auto-exclusion » de « l’absence de sol », en tout cas, que Heidegger désigne comme la « victoire à proprement parler », coïnciderait avec l’effondrement commun de la « machination » et de la judéité. » (pp. 82-83). Les nationaux-socialistes auraient donc comme seul crime d’avoir poursuivi une « machination » (l’industrialisation capitaliste) qui est pourtant propre au « Juif » et qui aboutirait à des Allemands… des Juifs, c’est-à-dire des « déracinés », des « déracialisés », des « sans sol » et donc « sans monde ».
Trawny poursuit : « Le concept de « machination » pourrait contenir des moments idéologiques, qui ne sont pas loin de ce qui est idéologiquement attribué à la « juiverie mondiale » – sans pour autant se confondre entièrement avec ces moments [puisqu’il y a d’autres « machinateurs »]. […] Il sera [néanmoins] inévitable d’inclure dans la genèse de la pensée de la technique de Heidegger un ressentiment antisémite. » (pp. 83-84). Pis, « l’idée que la « machination » réaliserait un conflit guerrier entre Juifs et nationaux-socialistes, qui de toute façon tourne seulement autour d’une « absence de but », ne peut atténuer l’impression qu’il y a sur ce point une influence antisémite des Protocoles sur la pensée de Heidegger. » (p. 84). C’est presque l’idée que les nazis ont eux-mêmes, dans une affirmation de la « machination » (puissance industrielle) caractéristique des « Juifs », cédés à la « guerre juive » (entre « machinations ») et pour des motifs « Juifs » (c’est-à-dire avec une « absence de but », sinon l’affirmation de la « machination » allemande, « machination » elle-même conçue comme « juive »).
On retrouve là le négationnisme ontologique [Faye] des conférences de Brême de 1949, en pire : non seulement les Juifs n’ont pas de sol, donc pas de monde, pas d’être, et ne peuvent donc pas vraiment mourir (« Meurent-ils ? »), mais en plus c’est leur propre projet, celui de la « machination », qui, appliqué par les nazis (qui deviennent du coup de simples « bons élèves » du judaïsme comme « machination »), les aurait exterminés massivement. On est là dans un raisonnement monstrueux.
Heidegger critique également « l’américanisme » qui n’aurait comme objectif que « la mise en place de la non-essence qu’est la machination », et si donc « tout ce qui est monstrueux » (Heidegger) doit résider « dans l’américanisme » (Heidegger), « précisément parce que l’« américanisme » est foncièrement inapte au « commencement », parce qu’il ne connaît pas « l’origine », parce qu’il est une poursuite du « commerce gigantesque » promu par l’Angleterre (voir n. 3, p. 74), alors est-ce que l’histoire de l’être comme telle n’est pas antisémite ? » (pp. 84-85). La figure de « l’américanisme » et de « l’Angleterre » sont évidemment des figures antisémites, comme on l’a vu plus haut, puisqu’on leur attribue des caractéristiques « juives », le « commerce », la « machination », etc. On comprend qu’Heidegger puisse inspirer encore aujourd’hui, où l’on parle d’oligarchie « américano-sioniste ».
Conclusion
La suite de l’ouvrage, qu’il nous est impossible de résumer exhaustivement, est composé du chapitre « Un concept de « race » relevant de l’histoire de l’être », où Trawny montre une intégration « métaphysique » (et antisémite) du concept de « race » chez Heidegger, et d’autres chapitres également très intéressants. Le chapitre « Après la Shoah » mérite particulièrement l’attention, sans que nous n’ayons des réserves concernant certaines tentatives de minimiser l’horreur de l’antisémitisme (et du « négationnisme ontologique ») d’Heidegger. Le dernier chapitre, « Tentatives de réponse », tente une réhabilitation malgré tout de Heidegger, ce avec quoi nous sommes farouchement en désaccord. Cependant, on louera une certaine lucidité critique chez quelqu’un qui est tout de même directeur de l’Institut Heidegger, et qui nous permet de nous rendre compte de l’antisémitisme virulent de Heidegger, fondateur d’une « métaphysique » antisémite qui persiste jusqu’à nos jours, jusqu’à Francis Cousin. Lucidité critique qui fait, au contraire, complètement défaut à de nombreux zélateurs de Heidegger en France[1].
Armand Paris
[1] http://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20151117.OBS9683/heidegger-et-les-juifs-un-drole-de-colloque.html
Vous aimerez aussi

Histoire de la virilité – L’invention de la virilité. De l’Antiquité aux Lumières
5 novembre 2016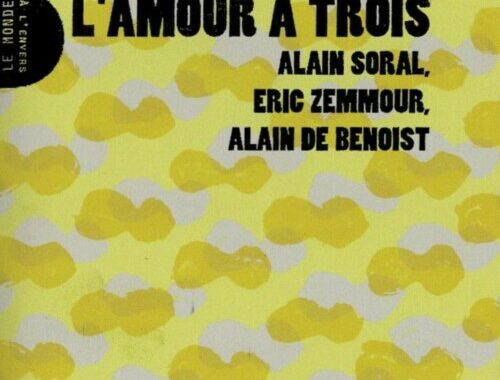
Nicolas Bonanni – L’amour à trois. Alain Soral, Eric Zemmour, Alain de Benoist
19 février 2017
