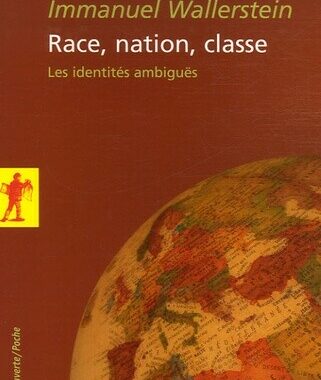Otto Rühle – La révolution n’est pas une affaire de parti
Otto Rühle, La révolution n’est pas une affaire de parti, Genève, Entremonde, 2010
La révolution n’est pas une affaire de parti est un recueil de textes d’Otto Rühle, grande figure du marxisme conseilliste (en référence aux conseils ouvriers) et de ce qui a été appelé la « révolution allemande » des années 1918-1923, précédé d’une excellente préface (choix judicieux des éditeurs d’Entremonde, dont on salue au passage l’œuvre remarquable) d’un participant à cette révolution, devenu un grand critique de l’économie politique, Paul Mattick.
Ce n’est pas par une crise de nostalgie révolutionnaire qu’il faut lire cet ouvrage, mais bien parce qu’il constitue une « critique sans ménagement » (Marx) des partis « ouvriers », bolchéviques comme socio-démocrates, avec même une bonne dose d’auto-critique du KAPD, parti « communiste de conseils » héritier du spartakisme de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht s’opposant tant au bolchévisme du KPD qu’aux socio-démocrates du SPD. À l’heure où ces partis « ouvriers » et leurs héritiers ne sont plus que des cadavres (Lutte ouvrière, NPA) ou des farces (France insoumise, Parti communiste, Parti socialiste), il pourrait sembler qu’une telle réflexion n’a qu’un intérêt historique. L’histoire certes ne se répète jamais deux fois, mais on n’est pas pour autant à l’abri d’une résurgence de partis pseudo-révolutionnaires, susceptibles de récupérer et de faire mourir des mouvements pré-révolutionnaires, à l’instar de Syriza en Grèce suite aux événements de 2008-2011.
Dans cette note de lecture, nous laisserons de côté une grande partie des développements au sujet de l’engagement politique d’Otto Rühle et de l’histoire de la « révolution allemande » de 1918-1923 (nous renvoyons au livre, très intéressant, pour ces éléments historiques), et ce pour nous concentrer sur une critique des partis « ouvriers », en réalité dirigés par une bureaucratie autoritaire composée d’intellectuels bourgeois et de membres de l’encadrement capitaliste.
La préface de Paul Mattick, intitulée « Otto Rühle et le mouvement ouvrier allemand », est intéressante non seulement parce qu’il discute de l’engagement politique d’Otto Rühle et de sa vision critique vis-à-vis de l’ensemble des organisations politiques auxquels il a participé (« il ne put jamais s’identifier complètement à une organisation […] il ne pouvait considérer les organisations comme une fin en soi mais simplement comme des moyens pour établir des relations sociales réels et pour le développement plus complet de l’individu »), mais surtout parce qu’il effectue une critique radicale des partis « ouvriers », en allant même parfois plus loin qu’Otto Rühle. Pour lui, les programmes des partis « ouvriers » n’ont aucun sens, et « cette situation est simplement l’aboutissement d’une longue évolution commencée par le mouvement ouvrier lui-même » (pp. 3-4). Sa critique est sans concessions :
« Les chefs ouvriers d’hier et d’aujourd’hui n’ont pas représenté et ne représentent pas un mouvement d’ouvriers, mais un mouvement capitaliste d’ouvriers. […] Le mouvement ouvrier officiel ne fonctionnait ni en accord avec son idéologie primitive [abolition du salariat et des classes], ni en accord avec ses intérêts immédiats réels. Pendant un certain temps, il servit d’instrument de contrôle pour les classes dirigeantes. Perdant d’abord son indépendance, il dut bientôt perdre son existence même » (p. 4).
Cette dernière affirmation est d’autant plus remarquable qu’elle date de 1945 : 70 ans plus tard, Le Monde Diplomatique pleurnichait au sujet de l’effondrement électorat du PCF…
Paul Mattick fait alors un bilan théorique du « mouvement ouvrier » (au sens des partis et des organisations « ouvrières ») :
« Dans son essence, l’histoire de l’ancien mouvement ouvrier est l’histoire du marché capitaliste abordé d’un point de vue prolétarien. Les lois du marché devaient être utilisées en faveur de la force du travail en tant que marchandise. Les actions collectives devraient aboutir aux salaires les plus élevés. Le pouvoir économique ainsi obtenu devait être consolidé par voie de réforme sociale. Pour obtenir les plus hauts profits possibles, les capitalistes renforçaient la direction organisée du marché. Mais cette opposition entre le capital et le travail exprimait en même temps une identité d’intérêts. L’un et l’autre encourageaient la réorganisation monopoliste de la société capitaliste, bien qu’assurément, derrière leurs activités consciemment dirigées, il n’y ait finalement rien d’autre que le besoin d’expansion du capital même. Leur politique et leurs aspirations, quoique tenant compte de faits et de besoins particuliers, étaient cependant déterminées par le caractère fétichiste de leur système de production » (p. 5).
Paul Mattick dénonce ainsi toute prétention à une amélioration durable des conditions de vie des prolétaires au sein du capitalisme :
« Les lois du marché […] en aucun cas […] ne peuvent être utilisées en faveur de la classe ouvrière prise comme un tout. […] Les conditions du marché, quelles qu’elles soient, favorisent toujours le Capital. […] Pour vaincre le capitalisme, l’action en dehors des rapports du marché capital/travail est nécessaire, action qui en finit à la fois avec le marché et les rapports de classe. Limité à l’action à l’intérieur de la structure capitaliste, l’ancien mouvement ouvrier menait la lutte dès ses premiers instants dans des conditions inégales. Il était voué à se détruire lui-même ou à être détruit de l’extérieur. Il était destiné à être brisé de l’intérieur par sa propre opposition révolutionnaire […] ou condamné à être anéanti [par le capital] […]. Dans les faits, ce fut la seconde éventualité qui se réalisa, car l’opposition révolutionnaire à l’intérieur du mouvement ouvrier ne réussit pas à se développer. Elle avait une voix mais pas la force et pas d’avenir immédiat, alors que la classe ouvrière venait de passer un demi-siècle à construire une forteresse à son ennemi capitaliste et une immense prison pour elle-même, sous la forme du mouvement ouvrier » (pp. 5-6).
La contradiction du marxisme conseilliste fut d’ailleurs d’être née comme opposition interne au parti social-démocrate : après avoir passé 40 ans à co-construire (de même de manière oppositionnelle) un parti contre-révolutionnaire (le SPD, comme fusion de deux organisations antérieures, est né en 1875), comment convaincre en quelques mois un mouvement ouvrier allemand formaté aux idées du SPD de s’en séparer, de lutter contre lui comme une force contre-révolutionnaire et d’entamer un mouvement insurrectionnel ?
Paul Mattick poursuit son implacable critique des partis « ouvriers », jusqu’à sa fraction oppositionnelle :
« La première guerre mondiale et la réaction positive [c’est un peu exagéré] du mouvement ouvrier devant le carnage ne surprirent que ceux qui n’avaient pas compris la société capitaliste et les succès du mouvement ouvrier à l’intérieur des limites de cette société. […] Il est tout à fait révélateur que l’attitude d’opposition à la guerre [celle de Rosa Luxembourg, de Karl Liebknecht ou encore d’Otto Rühle], pour être un tant soit peu efficace, dut d’abord se procurer une autorisation parlementaire. Elle dut être mise en scène sur les tréteaux d’une institution bourgeoise, montrant ainsi ses limites dès son apparition. En fait, elle ne servit que de prémice au mouvement bourgeois libéral pour la paix qui aboutit en fin de compte à mettre fin à la guerre, sans bouleverser le statu quo capitaliste. […] Les mots d’ordre contre la guerre, quoique lancés par les révolutionnaires, firent simplement office de gardes-fous au service de la politique bourgeoise et finirent là où ils étaient nés : dans le parlement démocratique bourgeois » (pp. 7-8).
Pour autant, Paul Mattick ne nie pas l’existence d’une opposition révolutionnaire à la guerre en-dehors du Parlement : « L’opposition véritable à la guerre et à l’impérialisme fit son apparition sous la forme des désertions de l’armée et de l’usine et dans la prise de conscience grandissante, de la part de beaucoup d’ouvriers, de ce que leur lutte contre la guerre et l’exploitation devait englober la lutte contre l’ancien mouvement ouvrier et toutes ses conceptions » (p. 8) : c’est précisément cette prise de conscience qui mena au conseillisme et aux différents épisodes de ladite révolution allemande.
Paul Mattick revient alors sur l’attitude du SPD et de sa minorité oppositionnelle (dont Rühle, peint ci-dessous) au moment de l’entrée en guerre en août 1914, comme illustration du fétichisme du parti :
« La première guerre mondiale révéla, plus que toute autre chose, que le mouvement était une partie et une parcelle de la société bourgeoise. Les différentes organisations de tous les pays prouvèrent qu’elles n’avaient ni l’intention ni les moyens de combattre le capitalisme, qu’elles ne s’intéressaient qu’à garantir leur propre existence à l’intérieur de la structure capitaliste. […] Pour ne pas renoncer à ce qui avait été construit depuis les lois anti-socialistes de Bismarck, l’opposition minoritaire à l’intérieur du parti socialiste fit preuve d’une contrainte volontaire sur elle-même à un point inconnu dans les autres pays […] et son attitude à l’éclatement de la guerre fut […] particulièrement décevante. Mises à part les conditions psychologiques individuelles, cette attitude fut le résultat du fétichisme de l’organisation qui régnait dans ce mouvement. Ce fétichisme exigeait la discipline et l’attachement strict aux formules démocratiques, la minorité [révolutionnaire] devant se soumettre à la volonté de la majorité [réformiste]. […] L’opposition ne réussit pas à saisir que la démocratie intérieur du mouvement ouvrier n’était pas différente de la démocratie bourgeoise en général. Une minorité [conservatrice] possédait et dirigeait les organisations, tout comme la minorité capitaliste possède et dirige les moyens de production et l’appareil de l’Etat. Dans les deux cas, les minorités [conservatrices], par la vertu de la direction, déterminent le comportement des majorités. Mais, par la force des procédures traditionnelles, au nom de la discipline et de l’unité, gênée mais allant à l’encontre de son intime conviction, cette minorité opposée à la guerre soutint le chauvinisme social-démocrate. […] Au printemps 1915, Liebknecht et Rühle furent les premiers à voter contre les crédits de guerre. Ils restèrent seuls au bon moment et ne trouvèrent de nouveaux compagnons qu’au moment où les chances d’une paix victorieuse disparurent du jeu d’échecs militaires. Après 1916, l’opposition radicale à la guerre fut soutenue et bientôt engloutie par un mouvement bourgeois en quête d’une paix négociée, mouvement qui, finalement, devait hériter du fonds de faillite de l’impérialisme allemand » (pp. 9-10).
Cette opposition radicale « spartakiste » devait encore hésiter en 1917-1918 à rompre avec l’ancien mouvement ouvrier organisé, en s’unissant au Parti Social-Démocrate Indépendant d’Allemagne (USPD) en 1917 (scission centriste anti-belliciste du SPD) et ne quitta celui-ci qu’à la fin de 1918. Paul Mattick pointe que « cette position semblait basée sur l’illusion que le Parti Social-Démocrate pouvait être réformé. Avec le changement de circonstances, espérait-on, les masses cesseraient de suivre leurs chefs conservateurs pour soutenir l’aile gauche du parti » (pp. 11-12). Pourtant, cette croyance n’explique pas l’opposition des spartakistes au modèle bolchévique, et elle était contrainte par une situation compliquée : « En ne rompant pas au bon moment avec la social-démocratie, ils avaient manqué de constituer une organisation forte, capable de jouer un rôle décisif dans les soulèvements sociaux attendus. Cependant, en considérant la situation réelle en Allemagne, en considérant l’histoire du mouvement ouvrier allemand, il était très difficile de croire à la possibilité de former rapidement un contre-parti opposé aux organisations ouvrières dominantes. Naturellement, il aurait été possible de former un parti à la façon de Lénine : un parti de révolutionnaires professionnels ayant pour but d’usurper le pouvoir, si nécessaire contre la majorité de la classe ouvrière. Mais c’est ce à quoi, précisément, les gens autour de Rosa Luxembourg n’aspiraient pas » (p. 12). Et Paul Mattick de souligner l’ampleur du fossé entre spartakistes et bolchéviques : « Rosa Luxembourg avait indiqué clairement le fait que les conceptions de Lénine était de nature jacobine et inapplicables en Europe occidentale où ce n’était pas une révolution bourgeoise qui était à l’ordre du jour mais une révolution prolétarienne. Bien qu’elle aussi parlât de la dictature du prolétariat, cette dictature signifiait pour elle, « la manière d’appliquer la démocratie – non pas son abolition – devant être l’œuvre de la classe, et non celle d’une petite minorité au nom de la classe », ce qui la distinguait de Lénine ».
Paul Mattick, pourtant participant à ces événements, fait alors un bilan très critique de ladite révolution allemande :
« Au lieu d’évoluer vers la gauche, les masses suivaient leurs vieilles organisations et s’alignaient sur la bourgeoisie libérale. Les soulèvements dans la marine allemande et enfin la révolte de novembre furent menés dans l’esprit de la social-démocratie, c’est-à-dire dans l’esprit de la bourgeoisie allemande vaincue. La révolution allemande est apparue comme ayant plus de portée qu’elle n’en a réellement eu. L’enthousiasme spontané des ouvriers tendait bien plus à finir la guerre qu’à changer les relations sociales existantes. Les revendications exprimées dans les conseils d’ouvriers et de soldats ne dépassaient pas les possibilités de la société bourgeoise. Même la minorité révolutionnaire, et particulièrement le Spartakusbund [les spartakistes comme Rosa Luxembourg], ne réussit pas à développer un programme révolutionnaire cohérent. Ses revendications politiques et économiques étaient de nature ambivalente. Elles étaient établies pour un double usage, comme revendications destinées à être acceptées par la bourgeoisie et ses alliés sociaux-démocrates, et comme mots d’ordre d’une révolution qui devait en finir avec la société bourgeoise et ses défenseurs. […] « Tout le pouvoir aux conseils d’ouvriers et de soldats ». Bien qu’attirant, ce mot d’ordre laissait toutes les questions essentielles ouvertes. Ainsi, les luttes révolutionnaires qui suivirent novembre 1918 ne furent pas déterminés par les plans consciemment élaborés par la minorité révolutionnaire, mais lui furent imposées par la contre-révolution qui se développait lentement et s’appuyait sur la majorité du peuple. Le fait est que les larges masses allemandes, à l’intérieur et à l’extérieur du mouvement ouvrier, ne regardaient pas en avant, vers l’établissement d’une nouvelle société, mais en arrière, vers la restauration du capitalisme libéral, sans ses mauvais aspects, ses inégalités politiques, son militarisme et son impérialisme. Elles désiraient simplement qu’on complète les réformes commencées avant la guerre, destinées à l’accomplissement d’un système capitaliste bienveillant » (pp. 13-15).
Paul Mattick estime que de toute façon, les chances d’une révolution allemande victorieuse et encore plus d’une révolution mondiale triomphant du capitalisme étaient très faibles :
« L’effet de la révolution russe sur l’Allemagne avait été à peine perceptible. Il n’y avait pas non plus de raisons d’espérer qu’un tournant radical en Allemagne puisse avoir des répercussions supérieures en France, en Angleterre et en Amérique. S’il avait été difficile pour les Alliés d’intervenir en Russie de façon décisive, ils rencontreraient des difficultés moins grandes pour écraser le mouvement communiste allemand. Au sortir de ses victoires militaires, le capitalisme de ces nations s’était considérablement renforcé ; rien n’indiquait réellement que leurs masses patriotes refuseraient de combattre une Allemagne révolutionnaire plus faible. […] La révolution allemande radicale était ainsi battue avant même de pouvoir survenir ; battue par le capitalisme allemand et le capitalisme mondial » (pp. 15-17).
Si Mattick fait peut-être preuve d’un pessimisme excessif, bien compréhensible lorsqu’on écrit en 1945, force est de constater qu’une révolution mondiale triomphante aux lendemains de la Première guerre mondiale était largement improbable, même si on pourrait remarquer une forte agitation pré-révolutionnaire dans l’ensemble des centres capitalistes à cette époque (grèves de 1919-1920 en France, grèves de 1919-1922 en Italie, etc.).
Paul Mattick indique d’ailleurs que même Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht ne croyaient pas à une victoire rapide de la révolution allemande : « La gauche allemande n’eut jamais besoin de considérer sérieusement les rapports internationaux. Ce fut, peut-être, la plus nette indication de son peu d’importance. La question de savoir que faire du pouvoir politique une fois conquis ne fut pas non plus concrètement soulevée. […] Liebknecht et Luxembourg étaient persuadés qu’une longue période de lutte de classes se dressait devant le prolétariat allemand sans aucun signe de victoire rapide. Ils voulaient en tirer le meilleur parti et préconisaient le retour au travail parlementaire et syndical » (17). Mais, lancés dans un mouvement révolutionnaire sans aucun retour possible, Liebknecht et Luxembourg devaient y périr :
« Cependant, […] ils avaient déjà outrepassé les frontières de la politique bourgeoise […]. Ils avaient rallié autour d’eux la part la plus radicale du prolétariat allemand, qui était résolue maintenant à considérer tout combat comme la lutte finale contre le capitalisme. […] Il n’y avait que deux voies ouvertes aux révolutionnaires : ou bien tomber avec les forces dont la cause était perdue d’avance, ou bien retourner au troupeau de la démocratie bourgeoise et accomplir le travail social au service des classes dominantes. Pour le vrai révolutionnaire, il n’y avait évidemment qu’une seule voie : tomber avec les ouvriers combattants. […] C’est par pur accident qu’Otto Rühle et beaucoup d’autres de la gauche résolue restèrent vivants » (pp. 17-18).
Au final, Paul Mattick juge sévèrement ces années : « Rétrospectivement, les luttes du prolétariat allemand de 1919 à 1923 apparaissent comme des frictions secondaires qui accompagnèrent le processus de réorganisation capitaliste qui suivit la crise de la guerre. […] Il y a toujours eu tendance à considérer les sous-produits des bouleversements violents dans la structure capitaliste comme des expressions de la volonté révolutionnaire du prolétariat. Les optimistes radicaux toutefois ne faisaient que siffler dans la nuit. La nuit est une réalité et le bruit est encourageant, mais à cette heure tardive, il est inutile de prendre trop cela sérieux » (pp. 18-19). Malgré cela, l’espoir révolutionnaire perdura au cours des années 1920 : « L’émotion suscitée par les soulèvements fournissait un stimulant illimité. La révolution qui pendant si longtemps avait été une simple théorie et un vague espoir était apparue un moment comme une possibilité pratique. On avait manqué l’occasion, sans doute, mais la chance reviendrait et on la saisirait mieux cette fois. Si les gens n’étaient pas révolutionnaires, du moins « l’époque » l’était, et les conditions de crise qui régnaient révolutionneraient tôt ou tard l’esprit des ouvriers ; si le feu des escouades de la police social-démocrate avait mis fin à la lutte, si l’initiative des ouvriers était une fois de plus détruite par l’émasculation de leurs conseils au moyen de la législation, si leurs chefs agissaient de nouveau non pas avec la classe mais « pour le bien de la classe » dans les différentes organisations capitalistes, la guerre avait révélé que les contradictions fondamentales du capitalisme étaient insolubles et que l’état de crise était l’état « normal » du capitalisme. De nouvelles actions révolutionnaires étaient probables et trouveraient les révolutionnaires mieux préparés » (pp. 19-20). Hélas, cet espoir révolutionnaire fut en partie confisqué par un nouveau venu, le KPD.
Le KPD, fondé en décembre 1919, avait d’abord fait face à une forte opposition anti-bolchévique à l’intérieur du parti, avant d’expulser celle-ci, aboutissant à la création du KAPD (avril 1920). Le KAPD, après avoir brièvement adhéré à la Troisième Internationale, s’en retira pour combattre celle-ci en raison de l’hégémonie bolchévique en son sein et des 21 conditions d’entrée (lesquelles « assuraient à l’exécutif de l’Internationale, c’est-à-dire aux chefs du parti russe, un contrôle complet et une autorité totale sur toutes les sections nationales »), d’où l’infâme pamphlet réactionnaire de Lénine Le gauchisme, maladie infantile du communisme. Rühle cru d’abord cependant « que derrière l’attitude dictatoriale de Lénine, il y avait simplement l’arrogance du vainqueur essayant d’imposer au monde les méthodes de combat et le type d’organisation qui avaient apporté le pouvoir aux bolcheviks. Cette attitude […] apparaissait comme une erreur, une faute politique, un manque de compréhension des particularités du capitalisme occidental et le résultat du souci fanatiquement exclusif qu’avait Lénine des problèmes russes. La politique de Lénine semblait être déterminée par le retard du développement capitaliste russe, et bien qu’il fallût la combattre dans l’Europe occidentale puisqu’elle tendait à soutenir la restauration capitaliste, on ne pouvait y voir une force carrément contre-révolutionnaire » (pp. 23-24). Mais toutefois « cette attitude bienveillante à l’égard de la révolution bolchévique devait être bientôt anéantie par les activités des bolcheviks eux-mêmes » (p. 24).
La « révolution mondiale » organisée de Russie avait un caractère impérialiste, en réalité :
« La Russie qui, de toutes les nations, était celle qui avait le plus grand besoin de se stabiliser, fut le premier pays à détruire son mouvement ouvrier au moyen de la dictature du parti bolchévique. Dans les conditions de l’impérialisme, la stabilisation intérieure n’est possible que par une politique extérieur de puissance. […] L’impérialisme moderne ne se contente plus de s’imposer simplement au moyen d’une pression militaire et d’une action militaire effective. La « cinquième colonne » est l’arme reconnue de toutes les nations. […] Il n’y avait rien de contradictoire dans la politique bolchévique qui consistait à enlever tout le pouvoir aux ouvriers russes et à essayer en même temps de construire de fortes organisations ouvrières [menées par une dictature bolchévique d’intellectuels bourgeois] dans les autres pays. Précisément, c’est dans la mesure où ces organisations ouvrières devaient être souples afin de se plier aux besoins politiques changeants de la Russie que leur direction par en haut devait être rigide » (pp. 25-26).
On a vu cette souplesse dans une émission au sujet du Front populaire de 1936, revirement complet du PCF lié à un changement de stratégie de Staline.
Mais Paul Mattick va plus loin, en faisant du bolchévisme un pionnier du capitalisme d’Etat à une échelle mondiale :
« Les bolcheviks […] croyaient que ce qui aidait la Russie devait aussi servir le progrès ailleurs. Ils croyaient avec raison que la révolution russe avait été le début d’un mouvement général à l’échelle mondiale du capitalisme de monopole au capitalisme d’Etat, et considéraient que ce nouvel état de choses était un progrès dans le sens du socialisme. Autrement dit […], ils étaient encore sociaux-démocrates et, de leur point de vue, les chefs sociaux-démocrates étaient des traîtres à leur propre cause quand ils avaient aidé à maintenir le capitalisme de « laisser faire » d’hier […] Ce qu’ils pensaient d’eux-mêmes et ce qu’ils étaient réellement sont deux choses différentes. Dans la mesure où ils continuaient à méconnaître leur mission historique, ils provoquaient continuellement la défaite de leur propre cause ; dans la mesure où ils étaient obligés de s’élever au niveau des besoins objectifs de « leur révolution », ils devenaient la force contre-révolutionnaire la plus importante du capitalisme moderne. En se battant comme de véritables sociaux-démocrates pour la prépondérance dans le mouvement socialiste mondial, en identifiant les intérêts nationalistes étroits de la Russie capitaliste d’État avec les intérêts du prolétariat mondial, et en essayant de se maintenir à tout prix sur les positions du pouvoir qu’ils avaient conquis en 1917, ils préparaient simplement leur propre chute, qui se transforma en drame dans de nombreuses luttes de factions, atteignit son point culminant aux procès de Moscou, aboutit à la Russie stalinienne » (pp. 26-27, je souligne).
Paul Mattick encore plus loin dans son analyse du bolchévisme comme social-démocratie pseudo-révolutionnaire :
« Ce qu’un mouvement conservateur social-démocrate était capable de faire et de ne pas faire, les partis d’Allemagne, de France et d’Angleterre ne l’avaient révélé que trop clairement. Les bolcheviks montrèrent ce qu’ils auraient fait s’ils avaient encore été un mouvement subversif. Ils auraient essayé d’organisé le capitalisme inorganisé et de remplacer les entrepreneurs individuels par des bureaucrates. Ils n’avaient pas d’autres plans et même ceux-ci n’étaient que des extensions du processus de cartellisation, de trustification et de centralisation qui se poursuivait à travers le monde capitaliste tout entier » (p. 28).
Paul Mattick discute ensuite des thèses d’Otto Rühle faisant du bolchévisme un fascisme et des groupes conseillistes d’ « ultra-gauche » les premiers groupes antifascistes. S’il y a indéniablement des rapprochements à faire entre ces deux formes de mouvements politiques autoritaires, dictatoriaux, totalitaires (au sens d’un pouvoir total de l’État-parti), des accointances (comme en témoigne la non-interdiction de Le gauchisme, maladie infantile du communisme dans l’Allemagne nazie, l’antisémitisme structurel des deux[1], et les ambiguïtés du KPD vis-à-vis du nazisme jusqu’en 1933[2]) et même des fusions contemporaines (parti national-bolchévique d’Alexandre Douguine[3], Alain Soral qui vient du PCF et a réédite Mein Kampf, etc.) et qu’assurément « la lutte contre le fascisme commence par la lutte contre le bolchévisme », à cette époque (au moins jusqu’à Staline) ces deux mouvements avaient des caractéristiques et des origines distinctes, l’un venant du marxisme et du mouvement ouvrier dont il est une forme ultra-autoritaire, l’autre venant du nationalisme d’extrême-droite et du mouvement des anciens combattants. Cela n’empêcha pas Otto Rühle de faire une critique brillante du bolchévisme, critique qu’on développe dans notre émission avec René Berthier autour de son livre Octobre 1917, le Thermidor de la Révolution russe.
Paul Mattick poursuit avec une analyse de l’échec des soviets et des conseils en Allemagne et en Russie, « réprimés par des moyens militaires et judiciaires », non sans toutefois une dose d’auto-critique :
« Ce qui restait des soviets russes après la solide fortification de la dictature du parti bolchévique, ce fut simplement la version russe de ce que serait le front du travail nazi. En Allemagne, le mouvement légalisé des conseils se changea en appendice des syndicats et bientôt en instrument du gouvernement capitaliste. Même les conseils formés spontanément en 1918 étaient en majorité bien loin d’être révolutionnaires. Leur forme d’organisation, basée sur les besoins de classe […], était tout ce qu’il y avait en eux de radical. Mais quelles que soient leurs défaillances, il faut dire qu’il n’y avait pas autre chose sur quoi baser les espoirs révolutionnaires. […] On espérait […] les besoins objectifs de ce mouvement le mettraient inévitablement en conflit avec les pouvoirs traditionnels » (pp. 32-33). Et précisément, en « se plaçant sur le terrain de la continuation de la révolution allemande [des conseils], l’ultra-gauche fut engagée dans un combat à mort contre les syndicats et contre les partis parlementaires existants, en un mot contre toutes les formes d’opportunisme et de compromis » (p. 33).
Paul Mattick s’attaque ensuite à la stratégie léniniste de noyautage des organisations des « masses », qu’il s’agisse des syndicats ou de conseils d’usine. En Russie, ce noyautage conduit à une bolchévisation des syndicats et des conseils d’usine (avec une direction centralisée), et ce non en raison d’une quelconque affinité des bolchéviques avec ces organisations mais tout simplement par opportunisme. Ailleurs, l’opportunisme bolchévique fut encore plus flagrant, aboutissant au Front populaire ou encore au pacte germano-soviétique de 1939.
Paul Mattick poursuit son analyse en discutant de « l’anti-fascisme » de l’URSS, « puissance capitaliste et impérialiste […] s’opposant […] à la révolution prolétarienne », au cours des années 1930-1940 : « Il favorisa en fait le maintien de la démocratie bourgeoise pour utiliser plus pleinement sa propre structure fasciste. De même que l’Allemagne avait très peu d’intérêts à étendre le fascisme au-delà de ses frontières et de celles de ses alliés puisqu’elle n’avait pas l’intention de renforcer ses rivaux impérialistes, de même la Russie s’intéresse à sauvegarder la démocratie partout sauf sur son propre territoire. Son amitié avec la démocratie bourgeoise est une véritable amitié ; le fascisme n’est pas un article d’exportation, car il cesse d’être un avantage dès qu’il est généralisé. En dépit du pacte Staline-Hitler, il n’y a pas plus grands « anti-fascistes » que les bolcheviks, pour le bien de leur propre fascisme indigène » (pp. 36-37). Pour Mattick comme pour Rühle, « le stalinisme d’aujourd’hui est simplement le léninisme d’hier » (p. 37), une sorte de stade suprême du bolchévisme.
Paul Mattick revient alors à Rühle, créditant celui-ci d’une critique de tout parti, même révolutionnaire, et appelant à un mouvement de conseils révolutionnaire et « pencha[nt] vers le syndicalisme et les mouvements anarchistes, sans renoncer cependant à sa vision du monde marxienne » (p. 38). Ainsi, « selon l’opinion de Rühle, une révolution prolétarienne n’était possible qu’avec la participation consciente et active de larges masses prolétariennes. Ceci présupposait une forme d’organisation qui ne pourrait être gouvernée d’en haut, mais serait déterminée par la volonté de ses membres […] ; cela préviendrait la naissance d’une puissante bureaucratie servie par l’organisation au lieu de la servir. Cela préparait en fin de compter les ouvriers à s’emparer des industries et à les gérer en accord avec leurs propres besoins » (p. 39). La critique de Rühle n’allait toutefois pas, semble-t-il, jusqu’à une critique de l’autogestion marchande. Paul Mattick détaille ensuite les divergences entre l’Union Ouvrière Générale des Travailleurs (AAUD) de Rühle et le KAPD, avant de dire que de toute façon l’histoire n’a permis à aucun des deux de vérifier sa théorie, et qu’en pratique les deux avaient une action analogue. En effet, « après 1923, le mouvement d’ultra-gauche cessa d’être un facteur politique sérieux dans le mouvement ouvrier allemand » (p. 41), et jusqu’en 1933 les groupes d’ultra-gauche virent « leur activité […] réduite à celle de groupes de discussion essayant de comprendre leurs propres échecs et ceux de la révolution allemande » (p. 42).
Après avoir rappelé que « le fascisme et le bolchévisme, produits des conditions de crise, furent, comme la crise elle-même, les moyens d’une nouvelle prospérité, d’une nouvelle expansion du capital et de la reprise des luttes impérialistes de concurrence » (p. 42), aboutissant à la Seconde guerre mondiale (1939-1945), Paul Mattick critique l’explication en termes de « viol des foules » ou de manque de conscience de classe de l’avènement du nazisme, mais sans proposer d’explication alternative (on renvoie au livre pour ces développements).
Paul Mattick souligne ensuite la singularité d’Otto Rühle au cours de la Seconde guerre mondiale, refusant « l’anti-impérialisme » bolchévique de 1917 comme l’alliance de l’URSS et des démocraties bourgeoises à partir de 1941 (que Kurz renvoie dos-à-dos dans ses articles) : « Rühle […] maintint son opposition de 1914. Pour lui, « l’ennemi était encore chez soi », dans les démocraties comme dans les Etats fascistes ; le prolétariat ne pouvait, ou plutôt ne devait, prendre parti pour aucun d’eux, mais s’opposer aux deux avec une ardeur égale » (p. 49). Ainsi, l’alliance de 1941 « permit à la seconde guerre mondiale de se déguiser en une lutte entre la démocratie et le fascisme et procura aux socialistes chauvins de meilleures excuses. Les chefs ouvriers exilés purent signaler les différences politiques entre ces deux formes de systèmes capitalistes bien qu’ils fussent incapables de nier la nature capitaliste de leur nouvelle patrie » (p. 49).
On peut critiquer néanmoins la réduction d’Otto Rühle de la Seconde guerre mondiale à une simple « lutte pour le profit entre les rivaux capitalistes » (pp. 49-50), et sa thèse selon laquelle « fascisme et capitalisme d’Etat n’étaient pas des inventions de politiciens corrompus, mais la conséquence du processus capitaliste de la concentration de la centralisation et de la centralisation au travers desquelles se manifeste l’accumulation du capital » (p. 50) : c’est là un réductionnisme économiciste pouvant conduire à de fortes erreurs d’analyse (en oubliant « la part subjective de l’histoire ») voire même à une forme de relativisation proto-négationniste de l’Holocauste.
On sera toutefois d’accord avec Paul Mattick, au niveau logique, lorsqu’il affirme :
« Pendant les dépressions, le Capital se réorganise pour permettre une nouvelle période d’expansion du Capital. Si nationalement la crise implique la destruction du capital le plus faible et la concentration du capital par les moyens ordinaires des affaires, internationalement, cette réorganisation exige finalement la guerre. Cela signifie la destruction des nations capitalistes les plus faibles en faveur des impérialistes victorieux pour opérer une nouvelle expansion du capital et sa concentration […] plus poussée. Chaque crise capitaliste – à ce niveau de l’accumulation du capital – englobe le monde ; de la même façon, chaque guerre est immédiatement d’une envergure mondiale. Ce ne sont pas des nations particulières mais la totalité du mouvement capitaliste qui est responsable de la guerre et de la crise. C’est lui, comme l’a vu Rühle, qui est l’ennemi, et il est partout » (pp. 50-51).
Pour autant, Rühle se tombe bien de tomber dans un relativisme politique complet, sans être néanmoins trop conciliant vis-à-vis des démocraties bourgeoises : « Assurément, Rühle ne doutait pas que le totalitarisme était pire pour les ouvriers que la démocratie bourgeoise. Il avait lutté contre le totalitarisme russe depuis son commencement. Il luttait contre le fascisme allemand, mais il ne pouvait pas lutter au nom de la démocratie bourgeoise, parce qu’il savait que les lois particulières de développement de la production capitaliste transformeraient tôt ou tard la démocratie bourgeoise en fascisme et en capitalisme d’Etat. Combattre le totalitarisme revenait à s’opposer au capitalisme sous toutes ses formes […] La démocratie d’aujourd’hui sera le fascisme de demain » (pp. 51-52).
Rühle n’imaginait pas qu’un soulèvement prolétarien puisse succéder à la Seconde guerre mondiale, mais il pensait selon Mattick que « tout comme la réorganisation du capital pendant la crise est en même temps la préparation de crises plus profondes, de même la guerre ne peut engendrer que des guerres plus larges et plus dévastatrices. […] Des partis toujours plus grandes du monde capitaliste seront détruites seront détruites, de sorte que les groupes capitalistes les plus fortes poursuivent l’accumulation. La misère des masses ira en augmentant jusqu’à ce que soit atteint un point de rupture. Et alors, des soulèvements sociaux détruiront le système meurtrier de la production capitaliste » (p. 53). Ce scénario ne s’est pas produit au cours du 20ème siècle : peut-être sera-t-il en partie celui du 21ème siècle ? Il faudrait cependant repenser intégralement un tel scénario à l’aune des dynamiques de la société de classes et du capitalisme du 21ème siècle, car, conclut Mattick, « reconnaître la révolution qui vient dans les réalités d’aujourd’hui, sera la tâche de ceux qui continuent à avancer dans l’esprit d’Otto Rühle » (p. 55).
Le reste de l’ouvrage, composé de deux textes d’Otto Rühle (« La lutte contre le fascisme commence par la lutte contre le bolchévisme » et « La révolution n’est pas une affaire du parti »), dont nous lisons certains extraits dans notre émission avec René Berthier au sujet de la contre-révolution bolchévique, se lit extrêmement bien, encore mieux que cette préface (assez théorique) de Paul Mattick. Au final, cet ouvrage remarquable concentre les apports d’Otto Rühle et de Paul Mattick à la réflexion critique sur les partis « ouvriers » et autres formes d’organisation pseudo-révolutionnaires, question qui est d’une actualité brûlante.
Armand Paris
[1] Sous une forme bien trop généreuse vis-à-vis du bolchévisme, cf. également http://revueperiode.net/auto-organisation-des-juifs-et-bolchevisme-lantisemitisme-dans-la-revolution-russe/.
[2] À partir de 1930, le KPD tente de (re)conquérir une partie de l’électorat ouvrier des nazis, et fait front commun avec ceux-ci pour abattre la République de Weimar (référendum commun contre le gouvernement social-démocrate de Prusse en août 1931, motion de censure commune contre ce même gouvernement en mars 1932, motion commune provoquant la dissolution du Parlement allemand en juillet 1932, grève commune des transports berlinois en novembre 1932). Mi-septembre 1930, un député du KPD lance au Parlement allemand : « Le parti national-socialiste a une tâche historique, la tâche de désagréger les milieux que nous ne touchons pas encore et qui nous ne nous sont pas encore passés à l’armée révolutionnaire. Ces gens chez lesquels il a détruit la foi en la capacité de survie du système capitaliste, en sa nécessité et en sa légitimité, ces gens ne viendront jamais à vous (NB : au SPD), ils viendront à nous. ». La stratégie du KPD donne quelques fruits, avec des ralliements de plusieurs milliers de militants nazis « de gauche », et notamment de Richard Scheringer, héros nazi et futur dirigeant du KPD de l’Allemagne de l’Ouest après 1945. Fin 1932, l’organe du KPD publie même une « Lettre ouverte aux électeurs ouvriers du NSDAP », où il est écrit « les membres prolétariens du NSDAP sont entrés dans les rangs du front uni du prolétariat » et surtout « nous avons même constitué un front unique de classe avec les prolétaires nazis. ».
[.]Là-dessus, on lira Louis Dupeux, Le national-bolchévisme dans l’Allemagne de Weimar 1919-1933, Librairie Honoré Champion, Paris, 1979.
[3] Marlène Laruelle, Le Rouge et le Noir, extrême droite et nationalisme en Russie, Paris, CNRS éditions, 2007.
Vous aimerez aussi
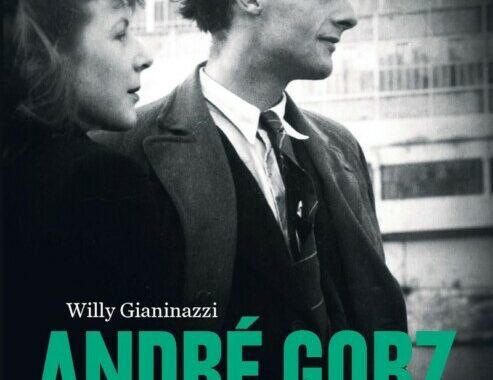
Willy Gianinazzi – André Gorz, une vie
29 janvier 2017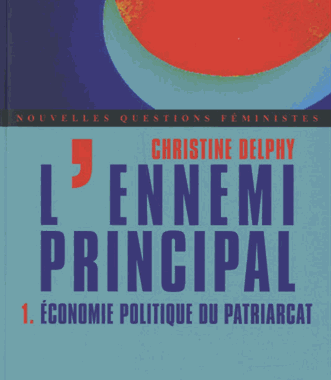
Christine Delphy – L’ennemi principal. Économie politique du patriarcat
8 mars 2017