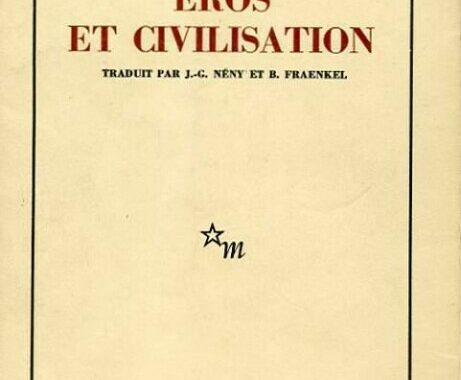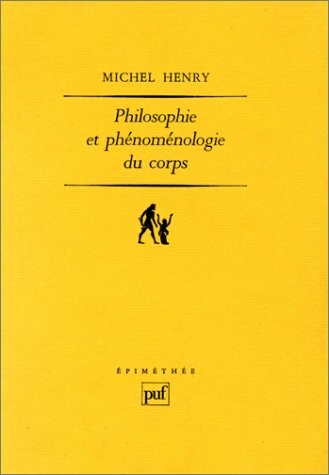
Michel Henry – Philosophie et phénoménologie du corps
Michel Henry, Philosophie et phénoménologie du corps, Paris, PUF, 2011 [1965]
« La philosophie est essentiellement irrésumable. Sinon elle serait superflue ; le fait que la plupart du temps elle se laisse résumer parle contre elle. » (Adorno[1])
Le lecteur de cette fiche ne trouvera pas ici un résumé de l’ouvrage, seulement le développement de quelques points qui me semblaient fondamentaux durant la lecture de l’œuvre. Fondamentaux car ils prennent en considération une réalité qui n’a pas finie de provoquer des polémiques dans notre société capitaliste. En effet, cette réalité est écrasée chaque jour, elle est mutilée, dominée, niée. Le corps, du sport jusqu’au domaine du travail, ou encore, en passant par la sexualité, n’est aujourd’hui rien d’autre qu’une chose qu’il faudrait mater. Ainsi, le travailleur, appendice du processus de production et de la technique, doit suivre le rythme de la « croissance » en accélérant toujours plus ses mouvements quitte à souffrir de certains « troubles musculo-squelettiques » tandis que le sportif doit modéliser son corps-machine afin de créer toujours plus de records, afin d’être plus performant. L’homme moderne doit garder la forme, rester productif afin de ne pas devenir obsolète, superflu. Un impératif de rendement, une course à l’abstraction que l’on retrouve également dans la sexualité où il est nécessaire, afin d’être « un bon coup », de ne pas jouir avant au moins une dizaine de minutes de coups de boutoirs. Michel Henry, avec cet ouvrage, nous permet de comprendre ce que signifie cette négation systématique du corps dans la modernité.
Cet ouvrage de Michel Henry prend donc pour thématique le corps. Son objectif est de sortir le corps de l’idée de contingence, de ce qui apparaît dans le domaine du monde pour disparaître aussitôt. Pour cela, le philosophe effectue une analyse ontologique du corps afin de retrouver l’« être originaire du corps » en se posant, entre autres, les questions suivantes : le corps fait-il partie de la subjectivité absolue ? Ou bien n’est-il qu’un étant ? Un être transcendant ? Le fait pour la conscience d’avoir un corps n’est-il pas contingent ?
À la lumière de ces quelques interrogations, on peut selon Henry tout d’abord se demander quel est le sens de cette étude si l’on considère la subjectivité, à la manière de Kant, comme une chose abstraite pure. Si la subjectivité est bien cet esprit abstrait, le corps peut il être autre chose qu’un objet permettant de survoler le monde ? Contre les présupposés de la philosophie occidentale qui font du corps une entité surajoutée, Henry souhaite développer sa pensée de la « vie » à partir de quelques thèses fondamentales : « Mais l’homme, nous le savons, est un sujet incarné, sa connaissance est située dans l’univers, les choses lui sont données sous des perspectives qui s’orientent à partir de son propre corps. » (p. 11 [NDLR : références aux pages de l’édition 1965]) En tant que l’homme est sujet incarné, « le corps, dans sa nature originaire appartient à la sphère d’existence qui est celle de la subjectivité elle-même. » (p. 11.) Lire Henry, c’est aussi lire un penseur éminemment critique. Sa lecture phénoménologique du corps se veut l’introduction à un projet de « phénoménologie radicale », se constituant notamment contre celle d’Husserl, opposant sa réflexion transcendantale du corps à la pensée qui souhaite déterminer l’être du corps au travers de l’intentionnalité et qui, tombant dans le piège de la philosophie traditionnelle, ne peut concevoir que ce qui apparaît dans le monde, ne peut penser ce « corps qui est un Je » (p. 11.), animé par une subjectivité transcendantale, c’est-à-dire « acosmique, invisible, individuelle. »
La pensée critique d’Henry ne l’empêche pas de reconnaître chez certains auteurs des intuitions géniales. Maine de Biran est pour lui l’un d’entre eux. Celui qu’il nomme « le prince de la pensée » sert de fil conducteur pour la constitution d’une ontologie du corps, d’une philosophie première. En effet, pour Maine de Biran, le corps est « un corps qui est subjectif et qui est l’ego lui-même » (p. 15.)
Les présupposés phénoménologiques de l’ontologie biranienne
La première partie de l’ouvrage développe les présupposés de toute la phénoménologie henryenne. Discutant de la philosophie de Maine de Biran, Henry en retiendra une intuition fondatrice qui sera donc à la base de toute son œuvre. À l’encontre du « monisme ontologique », les présupposés phénoménologiques de l’ontologie biranienne posent comme principe fondamental un « dualisme ontologique ». Ainsi pour Biran, comme pour Henry, il existe deux sortes de connaissances donc deux sortes d’êtres : « dans la première forme de connaissance, l’être nous est donné par la médiation d’une distance phénoménologique, c’est l’être transcendant. Biran appelle cette connaissance “ la connaissance extérieure ”. » (p. 17.) Tandis que « dans la deuxième forme de connaissance, l’être nous est donné immédiatement, en l’absence de toute distance, et cet être n’est plus n’importe quel être, c’est le moi, dont l’être est ainsi déterminé uniquement d’après la manière dont il nous est donné. » (p. 17.) Cette deuxième forme de connaissance prend le nom de « réflexion » ou encore d’« aperception interne » dans l’œuvre biranienne. Elle provient de l’« expérience transcendantale », processus ontologique d’auto-affection. Une ontologie du corps, corps pensé comme la subjectivité elle-même (ontologie que Maine de Biran nomme « idéologie subjective ») passe nécessairement par une phénoménologie transcendantale, via le sens interne transcendantal. Citant Biran, Michel Henry écrit alors : « l’exercice de ce sens est à ce qui se passe en nous-même ce que la vue extérieure est aux objets ; mais, différente de celle-ci, la vue intérieure porte avec elle-même son flambeau et s’éclaire elle-même de la lumière qu’elle communique » (p. 23.) (Essai sur les fondements de la psychologie et sur ses rapports avec l’étude de la nature, Œuvres de Maine de Biran, édition de Tisserant, Alcan, Paris, 1932, VIII)
La distinction biranienne, reprise par Henry, peut notamment se comprendre dans l’exemple suivant : la vue d’un objet s’opère au travers d’une distance, celui-ci est comme posé-là devant moi. Mais le voir en tant que faculté ne peut être vue. La conscience du voir, de notre faculté de voir provient de ce sens interne. On se sent voir. Il n’y a pas de distance entre le fait de voir, l’action de voir et le fait de se sentir voir. Mouvement et sentiment du mouvement ne font qu’un. Sentiment et action se confondent. Le sens interne transcendantal est donc ce qu’une machine n’a pas, il est à la source de toutes nos idées de facultés : percevoir, vouloir, réfléchir etc.
Ainsi c’est via une rupture fondamentale avec la tradition philosophique que le corps est pensé et à partir de ce fondement radical, du « corps absolu » considéré comme « une sphère de certitude absolue », l’expérience devient pour Henry science positive. On retrouve notamment dans ce premier chapitre un développement autour de la « déduction transcendantale des catégories et des facultés ». Comment penser par exemple la causalité, ou encore l’identité ? En réduisant cette catégorie à sa sphère d’existence fondamentale, c’est-à-dire en passant d’une catégorie « de la chose », de l’être transcendant, à celle de l’être transcendantal, en enracinant la catégorie dans notre expérience concrète. Prenant l’exemple de la causalité, Michel Henry écrit : « le monde est un monde vécu par l’ego et non pas séparé de lui, de sorte qu’il n’est pas non plus un monde mort, mais qu’il a une vie, celle-là même que l’ego. La vie du monde est celle de l’ego et, dès lors, le monde est un monde où s’entrecroisent des causes, des forces, il est un monde avec des zones qui sont des centres d’intérêt, d’attrait ou de répulsion, des points forts ou faibles, qui ont une unité d’action ou de réaction, un pouvoir, une puissance que je ne puis ni méconnaître, ni toujours défier. Le monde est un monde que pénètre ma causalité, qui le domine jusque dans les refus qu’il lui adresse, jusque dans la résistance qu’il lui oppose. Les choses ont leur catégorie, leur manière d’agir, c’est-à-dire de se donner à nous, leur manière d’être pour l’ego. C’est parce que l’ego est causalité, force, unité, identité, liberté, que les choses sont comme des réalités, des individualités, et qu’elles ont comme un pouvoir autonome qui leur appartient en propre et qui les définit à nos yeux. Le monde est le même parce que je suis le même. L’être magique du monde est finalement irréductible, parce que le monde est un monde humain. Le monde de la science, un monde qui serait sans causes, n’est qu’un monde abstrait. Il n’y a pas de monde purement scientifique, car un tel monde ne serait à la limite rien d’autre que le néant. Le monde du positivisme est un monde en surface, un défilé d’images qui ne pourraient jamais affecter l’homme, ni lui faire le monde mal, c’est un monde sans rapport avec l’homme. » (p. 43.) On comprend par là que « le monde est traversé par une vie qui est la mienne : je suis la vie du monde. » (p. 44.) Le monde comme posé-là, séparé de ce qui lui donne vie n’existe pas pour l’homme. Le monde est ce qu’il signifie pour la vie, pour l’ego. De l’existence de cet ego, Michel Henry en développe également une théorie au travers des présupposés de Maine de Biran.
Le corps subjectif
Après avoir présenté « les présupposés philosophiques de l’analyse biranienne du corps », Michel Henry continu son analyse sur le corps subjectif via la théorie biranienne afin d’en extraire le mode d’être de l’ego, la manière dont il apparaît à soi. Celui-ci est effort. Il est l’action par laquelle je modifie incessamment le monde. « L’ego est un pouvoir, le cogito ne signifie pas un “ je pense ”, mais un “ je peux ”. » (p. 73.) Ainsi la philosophie première permet de déterminer l’être de l’ego comme mouvement. « Je suis mouvement ! » La pensée n’est qu’une conséquence du mouvement de l’expérience interne transcendantale, elle est comme nos membres, tournée vers l’extérieur lors même que ce qui la détermine revient toujours vers soi, vers le Soi transcendantal. Le corps est alors cet être transcendantal, connu au travers du sentiment du mouvement transcendantal, du sentiment de l’effort, et non pas du mouvement transcendant, du monde des images. Selon l’auteur, « le mouvement originel et réel est un mouvement subjectif. » (p. 82.) Ce qui par exemple permet au mouvement objectif de ma main d’être reconnu comme un mouvement prenant sa cause en moi, est bien le fait que le mouvement nous est donné avant tout comme caractère subjectif originel, qu’il est vécu par l’ego. Sans cela, la chute de la pluie et le déplacement de ma main paraitraient aussi étrangers à moi. Dans le mouvement même de l’effort, le moi se reconnait, sans aucune distance entre le mouvement et la connaissance de ce mouvement.
Que l’ego puisse se reconnaître comme identique à lui-même dans le processus d’altération, cela signifie qu’il a également la possibilité de reconnaître ce qui lui est étranger, à savoir le monde comme extériorité. Dans le langage d’Henry, cela se traduit de la manière suivante : « Notre vie concrète qui fait l’expérience interne et transcendantale d’elle-même comme mouvement subjectif fait, par cela même et en même temps, l’expérience du monde comme terme transcendant de ce mouvement, comme continu résistant. » (p. 103.) C’est parce que l’être de l’ego est mouvement, que l’ego se sent ainsi en tout point comme tel, qu’il peut distinguer ce qu’il est, ce « je », de ce qui lui est extérieur, le monde. Ce monde qu’il ne peut pas immédiatement mettre en mouvement, lui résiste comme une extériorité sur lequel l’ego n’a pas de prise directe. « C’est dans l’intérieur de l’homme qu’habite la vérité et, dans le cas qui nous occupe, nous devons dire que c’est l’être subjectif du mouvement qui porte en lui la certitude que nous avons de la réalité du monde. » (p. 105.)
Le mouvement et le sentir
La troisième partie de l’ouvrage approfondie la problématique du « mouvement et du sentir ». Michel Henry met en place la distinction entre la sensation et le sentir, l’ego ne s’identifiant pas avec la sensation. C’est justement le mouvement de l’ego se sentant lui-même comme tel qui détermine la sensation, c’est « l’aperception interne » qui détermine la perception, ou encore, comme dirait Marx, « c’est la vie qui détermine la conscience » et non l’inverse. Sans ce mouvement originaire, à la racine de la sensation, la sensation d’être-là dans l’espace serait indéterminée. Il faut par exemple un moi qui se sent lui-même « vivant », c’est-à-dire en mouvement, pour distinguer le noir du bleu, pour dire que le bleu est plus foncé que le bleu ciel etc. Les sens sont donc donnés à une action motrice plus originelle. Le sentiment du mouvement, l’action motrice de l’ego et la sensation, apparaissant en parallèle. Cependant seule l’action motrice donne sa réalité à la sensation. Prenant comme thème l’odorat, Michel Henry note que « la décomposition de l’odorat […] met en lumière, d’une part, un acte subjectif qui est précisément celui par lequel nous sentons les odeurs, et, d’autre part, ces odeurs elles-mêmes comme termes transcendants de nos mouvements d’inspiration » (p. 110.) À partir de cette réflexion, que peut bien être le monde, ce continu résistant séparé de l’ego, trouvant sa réalité à partir de l’ego lui même ? « Le monde sensible en général est le monde réel. […] Il est vrai aussi et il est nécessaire d’affirmer que nos impressions sont toutes constituées par l’être originaire du mouvement subjectif qui, dans ce mouvement de constitution qui les projette pour ainsi dire sur le fond du continu résistant, leur confère cette signification transcendante, immanente par conséquent à la signification du sensible en général, d’être une manifestation immédiate de l’être réel lui-même. » (p. 114-115.)
Continuant sa démonstration sur les sensations, Henry décrit le principe de ces dernières toujours à partir de l’ego. Ainsi, chaque mode sensoriel apparaît autonome et hétérogène, mais il est réel du fait même qu’à l’origine de chacun de ces sens se cache l’ego qui détermine la sensation comme faisant partie du continu résistant. La vue des images nous permet de déterminer le monde comme réel, de même que le toucher. Le monde se donne à nous dans une pluralité de sensations grâce à nos sens, une pluralité qui ne prend son unité qu’à partir de ce qui est immanent à tous ces sens, l’ego. L’ego constitue la pluralité des sens en étant immanent à chacun d’entre eux et par-là même constitue leur unité. Dans le même temps il constitue le monde comme extériorité, comme continu résistant. C’est par exemple ce principe qui permet à l’individu de dessiner, l’unité originaire subjective permettant l’entente entre la vision et le mouvement de la main lors du dessin, l’ego s’exprimant de la même manière au travers de sens hétérogènes, cela se manifeste dans le monde de manières différentes. L’unité de la vie constitue alors l’uni-pluralité des « sentirs », l’ego reste toujours « un » dans la pluralité. On retrouvera notamment un développement de cette réflexion sur l’uni-pluralité des sens dans dans un article d’Henry sur l’œuvre d’August Von Briesen. La question qui y est posée est la suivante : comment est-il possible pour cet artiste de dessiner la musique ? (Cf. Michel Henry, Phénoménologie de la vie, Tome III, De l’art et du politique, Paris, PUF, 2004)
L’unité des sens est donc celle d’un savoir, celui de l’être originaire du corps qui se donne à soi sans aucune distance. Le corps originaire se confond avec l’expérience immédiate, l’expérience interne transcendantale, là où le « corps réel » prend sa source dans l’expérience interne transcendante. La première expérience constitue finalement la seconde et on peut alors dire que « l’expérience transcendante est, en elle-même, une expérience interne transcendantale, l’expérience originaire est une expérience dans laquelle nous sont présents l’être du monde aussi bien que l’être du corps, bien que le mode selon lequel cette présence s’effectue soit radicalement différent dans les deux cas : le corps nous est présent dans l’immanence absolue de la subjectivité, le monde dans l’élément de l’être transcendant. » (p. 130.) En tant que le corps est à la fois hors du monde et du monde, il est un pouvoir de connaitre le monde. Comme il a été dit, cette possibilité nous est donnée par le mouvement : « comme ce mouvement, d’autre part, est une possibilité propre, irréductible, inaliénable et, pour tout dire, ontologique de mon corps, il s’ensuit que l’être du monde est ce que je puis toujours atteindre, ce qui m’est accessible par principe. Chaque fois qu’un objet est donné à mon corps, il ne se donne pas tant à lui comme l’objet d’une expérience présente que comme quelque chose que mon corps peut atteindre, comme quelque chose qui est soumis à un pouvoir que le corps a sur lui. Lorsqu’il nous semble qu’il en va autrement, lorsque, par exemple, nous voyons un paysage ou un visage que nous ne reverrons plus, cette signification nouvelle qui s’attache à notre expérience n’est qu’une détermination négative de la signification générale sous laquelle le monde se donne à notre corps, et cette détermination négative, loin d’exclure la signification selon laquelle le terme de mon expérience corporelle m’est principiellement accessible, trouve au contraire dans cette signification générale son fondement et n’en est précisément qu’une détermination. » (p. 133.) Alors, « le monde est ainsi la totalité des contenus de toutes les expériences de mon corps, il est le terme de tous mes mouvement réels ou possibles. » (p. 133.)
De cette relation fondamentale entre le mouvement et le sentir, établissant l’identité de l’ego comme un « je peux fondamental », Henry opère quelques détours autours des concepts de mémoire, d’habitude et d’individu. Le concept de mémoire prend sa substance dans la réalité et la désigne en retour. Cette réalité qu’Henry souhaite désigner prend son essence encore une fois dans cette action motrice originelle qui se connaît elle-même, ce « je peux fondamental ». À partir de ce fondement est rendu par exemple possible la mémorisation du son comme « pathos » et ainsi sa reproduction à partir de ce même pathos, reproduisant le son lui-même. Quant à l’habitude, elle est la possibilité qu’a le corps de connaître, sa possibilité de mémoire. « L’habitude est le fondement de la mémoire et, comme elle définit la structure ontologique du corps, il est juste de voir dans l’être de celui-ci le principe de nos actes de mémoration et de rappel. C’est en effet parce que l’être originaire du corps subjectif est l’être réel de la connaissance ontologique, c’est parce qu’il est une possibilité de connaissance en général, un savoir du monde en son absence, qu’il est aussi, et pour cette raison, souvenir du monde, mémoire de ses formes, connaissance a priori de son être et de ses déterminations. » (p. 137-138.) Le monde est le terme de ces habitudes. Habiter le monde, c’est répandre les possibilités de l’ego en transformant le monde, ce continu résistant, par nos habitudes afin de rendre possible le renouvellement incessant du « je-peux » fondamental. « Quant au monde, il est le terme de toutes nos habitudes, et c’est en ce sens que nous en sommes véritablement les habitants. Habiter, fréquenter le monde, c’est là le fait de la réalité humaine et ce caractère d’habitation est un caractère ontologique qui sert aussi bien à définir le monde que le corps qui en est l’habitant. » (p. 134.) L’habitude qui est cette pure possibilité de connaître le monde dans le présent ontologique continuel fonde donc la mémoire. C’est parce que je suis dans le maintenant présent à moi même que m’est donné la possibilité de mémoire. Cette mémoire ne prend sa consistance que dans la possibilité qu’offre le « soi » dans le maintenant. Le rappel de la mémoire est permis parce que ce qui est rappelé est dans le présent connu de la subjectivité absolue. « La mémoire originaire de notre corps est l’habitude, notre corps est, avons-nous dit, l’ensemble de toutes nos habitudes. » (p. 140.)
Enfin, de ce mouvement originaire nous est également donné notre individualité. « Parce que l’être du mouvement qui est immanent à tous nos pouvoirs de sentir est un être subjectif, la vie de notre puissance de sentir est une vie individuelle, elle est la vie même de l’individualité. » (p. 145.)
Le double emploi des signes et le problème de la constitution du corps propre
Dans ce chapitre Henry se pose la question suivante : pourquoi a-t-on toujours considéré le corps comme un être empirique et jamais dans son être originaire ? « Tout se passe en effet, dans une telle conception, comme si notre corps n’était rien d’autre que cet objet que nous voyons, et comme si l’être originaire du corps dont nous avons donné l’analyse ontologique, n’était qu’une chimère dont on chercherait vainement la trace dans notre expérience réelle. Il y a comme une absorption de l’être originairement subjectif du corps dans ce corps qui se manifeste à nous parmi les choses, le premier devient comme intérieur au second, tout l’être de notre corps se ramène à son être constitué et, en dehors de ce phénomène transcendant, il n’y a rien, sinon la conscience qui le pense, l’esprit ou l’âme qui le survole. » (p. 150.) Or donner au corps transcendant les capacités du corps considéré comme être transcendantal ne peut être qu’une illusion. L’oreille n’entend pas plus qu’un magnétophone. Tout au plus peut-on dire qu’ils accueillent les déterminations objectives du son, mais ce qui seul entend est ce qui a la capacité de se sentir entendre.
Cette illusion, Maine de Biran la nomme « le double emploi des signes ». Lorsque je dis « je vois », je pense la vision au travers de l’intentionnalité, je ne pense pas de manière direct l’expérience interne transcendantale mais je me re-présente cette expérience. « Celle-ci, dès lors cesse d’être un contenu immanent pour devenir l’objet d’une nouvelle expérience qui est précisément ma réflexion. Le terme de cette réflexion, mon expérience primitive de la vision, est devenu maintenant une réalité transcendante, et c’est ici que l’analyse ontologique doit se faire plus rigoureuse. » (p. 153.) À partir de là, il est alors possible de faire de l’expérience de la vision une expérience de la nature, du monde. Mais à aucun moment la réflexion ne crée son objet, qui serait l’expérience de la vision. Celui-ci est véritablement puisque la vision est originaire, fait partie de la sphère de l’immanence. « La réflexion ne crée jamais son objet, mais seulement la manière dont elle se le donne. C’est parce que je vois que je puis réfléchir sur la vision, c’est parce que celle-ci est originairement la mienne, dans une sphère d’immanence absolue, que je puis me la représenter » (p. 153.) « Si donc le mot “ voit ” se réfère, dans le langage réflexif, à la vision sur laquelle je réfléchis, c’est-à-dire à un corrélat intentionnel, le caractère transcendant de celui-ci ne peut nous induire en erreur. Le thème de ma réflexion est bien une manifestation transcendante, mais le contenu de cette manifestation, la substance de ce qu’elle représente, est emprunté à la vie subjective de notre corps absolu. » (p. 153.) Ou encore, plus loin dans le texte : « c’est au sein de cette vie sensible et motrice qui se connaît originairement elle-même, et non pas dans la représentation de nos organes ou de leurs propriétés, que les signes par lesquels nous exprimons ses diverses modalités trouvent contenu et sens. » (p. 155.) De cette réflexion naissent les racines d’une critique fondamentale de la science, du physiologiste lui-même empêtré dans ce que l’on nomme ici le « double emploi des signes » : « Le rapport de l’être originaire du corps au système d’organes qu’étudie la physiologie ne peut être, selon Biran, qu’un rapport symbolique au terme duquel la division physiologique apparaît comme un symbole ou un signe de la division transcendantale. Si l’on considère, par exemple, le mouvement, la physiologie pensera en rendre compte en imaginant dans le cerveau un centre d’action qui sera comme l’origine à partir de laquelle ce mouvement se déploiera. “ Mais est-ce là autre chose qu’un symbole ? Le moi individuel peut il s’identifier avec un centre organique quelconque ? L’action que nous rapportons objectivement à un tel centre est-elle la même que celle que nous nous attribuons dans la conscience intime d’un effort ? Ne sont-ce pas là deux idées, deux faits d’un ordre tout différent ? Comment l’esprit pourra-t-il passer de l’un à l’autre ? ” ». (p. 157.)
Mais alors comment le corps objet, considéré comme étant absolument hétérogène au corps absolu peut-il devenir le signifiant de l’autre ? Parce que « Le dualisme ontologique est le fondement du double emploi des signes. C’est parce qu’il existe, comme le dit Maine de Biran, “ deux sources d’évidence ” que notre corps se donne à nous d’une façon telle que chacun de ses pouvoirs originaires, dont nous avons une connaissance immédiate dans l’expérience subjective du mouvement qui constitue son essence, se manifeste aussi à nous sous la forme d’un organe ou d’une détermination physiologique ou spatiale quelconque. La différence entre l’être originaire de ce pouvoir et l’organe qui nous semble, par ailleurs, en être l’instrument, ne se situe en aucune façon sur un plan ontique, ce n’est pas une différence entre quelque chose et quelque chose d’autre, c’est une différence ontologique, une différence non pas dans l’individualité, mais dans la manière d’être, c’est-à-dire relative à la région au sein de laquelle l’être se manifeste et existe. » (p. 160.) Henry précise qu’au travers du concept de « dualisme ontologique », ce qu’il veut signifier, « c’est seulement la nécessité de l’existence de cette sphère de la subjectivité absolue, sans laquelle notre expérience du monde ne serait pas possible. » (p. 162.) Ce dualisme signifie que le « double corps » retrouve son unité en tant que le corps absolu substantialise le corps objectif, ainsi « l’être originairement subjectif de notre corps et le corps transcendant, le pouvoir et l’organe, ne sont pas, pour parler comme Maine de Biran, “ deux faits ”, mais “ deux ordres de faits ”, dont la dualité n’est, comme expression particulière du dualisme ontologique, qu’une détermination de la structure ontologique fondamentale sur laquelle reposent l’unité et la possibilité de notre expérience. » (p. 163.) L’être du corps étant double, son paradoxe amène à énormément de contresens, mais ces contresens se résolvent de la manière suivante : « Je ne vois jamais mon corps de l’extérieur parce que je ne suis jamais à l’extérieur de mon corps, voilà ce que nous devons affirmer si nous voulons donner un sens aux mots et à la théorie selon laquelle l’être de mon corps appartient à une sphère d’immanence absolue. […] L’unité et l’appartenance à l’ego du corps transcendant sont constituées sur le fondement de l’être originaire du corps subjectif, sur le fondement de son unité et de son appartenance à l’ego, c’est-à-dire de déterminations ontologiques qui sont originairement le privilège exclusif d’une région ontologique déterminée, qui est une région d’immanence absolue. » (p. 167.)
Dans cette première partie de l’ouvrage, on constate que Michel Henry met en place une première réduction qui l’amène à une dissociation radicale entre le corps absolu et le corps objet. Il met également en avant le fait que la subjectivité absolue trouve dans le monde le terme qui résiste à l’effort, monde qu’il nomme alors « continu résistant ». Le corps objet faisant partie du continu résistant n’échappe pas pour autant à la réduction opérée car il joue un rôle singulier dans la subjectivité absolue par rapport aux autres éléments du monde. Si effectivement le corps-objet fait bien partie du monde, trouvant sa substance et son unité à partir de ce qui diffère radicalement de lui, il n’est finalement pas homogène à tous les éléments de l’univers. Cette différence, nous pouvons la décrire comme tel : « Le pouvoir immédiat de l’ego ne s’étend en réalité que sur un corps particulier qui est le sien, et ce n’est que d’une façon médiate qu’il agit sur l’univers, ce qui revient à dire qu’à l’intérieur du monde notre corps transcendant se distingue des autres corps et s’y oppose en vertu de propriétés distinctives dont il faut rendre compte – étant bien entendu qu’il ne s’agit pas d’une différence représentée, ou plutôt d’une différence entre la représentation de notre corps et celle des corps extérieurs, mais d’une différence entre ces corps tels qu’ils sont originairement vécus par nous, tels qu’ils se donnent au mouvement subjectif qui en fait l’expérience. » (p. 168.) Quelle est cette différence de vécu dont nous parle Henry ? C’est celle que nous expérimentons tous les jours et qu’Henry, reprenant la théorie de Maine de Biran, décrit comme suit : « La différenciation dont il s’agit ici repose dans le biranisme sur le fait que le mouvement se heurte dans un cas à une résistance absolue – et c’est là le fondement phénoménologique de l’être du corps étranger –, tandis que cette résistance cède à l’effort, lorsqu’il s’agit de l’être transcendant du corps propre. […] Maine de Biran appelle “ étendue intérieure ” le milieu transcendant qui cède ainsi à l’effort de notre mouvement. Dans cette manière sui generis de se donner réside, aux yeux d’une ontologie phénoménologique, tout l’être de notre corps transcendant dont la solidarité immédiate avec l’être originaire de notre corps n’est que l’expression du rapport fondamental de transcendance du mouvement. C’est ainsi qu’à l’être originaire de notre corps est lié une sorte de corps organique, dont l’âme n’est, selon un mot de Leibniz qui cite Maine de Biran, jamais séparée. » (p. 169.) Cette « étendue intérieure » selon les termes Maine de Biran, corps organique selon les termes de Michel Henry, « est un terme qui résiste, c’est un être réel, une masse que meut l’effort et qui, même dans l’état de repos, est toujours comme soulevée et retenue hors du néant par une sorte de tension latente qui est la vie même de la subjectivité absolue, en tant que cette vie est ici celle du corps originaire. » (p. 169.) Cette masse est tenue en mouvement par la subjectivité absolue, une masse qui « laisse paraître en elle des structures auxquelles nous ferons correspondre les noms des différentes parties de notre corps, qui seront pour nous nos membres, notre torse, notre cou, nos muscles, etc., mais qui, originairement, ne sont rien de tel, et se donnent seulement à nous comme des systèmes phénoménologiques qui expriment les différentes manières dont il est cédé à notre effort. » Le moi connaît donc le corps transcendant de manière immédiate, par le sens interne transcendantale au travers de son corps organique, sans représentation. Mais il connaît également le corps objectif comme représentation par la médiation de la conscience qui se représente le corps comme une image, comme posé-là. « Le corps-objet-du-monde de la perception objective ou de la science implique, on l’a vu, un autre corps qui le connaît, et, d’une manière générale, la réalité sensible de l’apparence objective est toujours saisie à l’intérieur d’un pouvoir de connaître qui n’est rien d’autre que l’être originaire du corps subjectif. » (p. 178.)
Il faut donc selon Michel Henry distinguer trois corps : « I° L’être originaire du corps subjectif, c’est-à-dire le corps absolu révélé dans l’expérience interne transcendantale du mouvement. La vie de ce corps originaire est la vie absolue de la subjectivité ; c’est en elle que nous vivons, que nous nous mouvons et que nous sentons, elle est l’a et l’w de notre expérience du monde, c’est par elle que l’être advient au monde, c’est dans la résistance qu’elle expérimente que se manifeste à nous l’essence du réel et que toute chose acquiert consistance, forme et valeur. Cette résistance, toutefois, n’est pas homogène, elle n’est parfois qu’une résistance relative qui cède au mouvement subjectif et qui lui cède en quelque sorte selon des lignes permanentes qui dessinent des structures fixes : ces structures sont nos organes, et le milieu général de cette résistance relative est le corps organique.
2° Le corps organique est le terme immédiat et mouvant du mouvement absolu du corps subjectif, ou plutôt l’ensemble des termes sur lesquels le mouvement a prise. Parce qu’il y a une structuration de ce corps organique, il est divisé en différentes masses transcendantes dont la diversité est toutefois retenue dans l’unité de la vie absolue du corps originaire. » (p. 179.) Ce corps organique est l’étendu intérieur sur laquelle le corps subjectif a tout pouvoir, son effort se manifeste par la mise en mouvement du corps organique, sa mise en branle dans lequel émane les sensations. Le corps organique est le terme de mon mouvement, l’univers est lui touché de manière médiate. Les sensations internes de mon corps organique sont perçues et localisées de manière immédiate en tant que la subjectivité absolue est ce qui le détermine. « L’expérience sensible interne est inséparable de la constitution originaire du corps organique, c’est-à-dire de la connaissance immédiate de notre corps propre. Celle-ci est une connaissance complète par elle-même, elle a autonomie et suffisance, tout le savoir primordial de notre corps est contenu en elle et, naturellement, dans la connaissance originaire du corps subjectif qu’elle implique et dont elle est inséparable. Le système formé par le mouvement subjectif et le corps organique est un système clos, qui s’achève et se ferme sur lui-même, et qui serait ce qu’il est en l’absence de toute connaissance représentative du corps transcendant comme être objectif appartenant à l’espace extérieur.
3° Le corps objectif qui est l’objet d’une perception extérieure et qui peut faire le thème d’une recherche scientifique, est le seul corps que connaît la tradition philosophique, et c’est cette conception objective exclusive qui est à l’origine de tant de faux problèmes – notamment du fameux problème de l’union de l’âme et du corps – comme de tant de théories qui s’efforçaient, bien en vain d’ailleurs, de les résoudre. » (p. 182.) Notre corps objectif est une représentation de notre corps originaire. « À l’identité réelle du corps originaire et de notre corps organique, ou plutôt à l’identité de la vie absolue qui est l’être du corps originaire et qui retient dans son unité le corps organique dont elle est aussi, pour cette raison, la vie, s’oppose ainsi l’identité représentée de notre corps transcendant objectif avec notre corps absolu, identité qui repose naturellement sur l’identité originaire de l’être du corps subjectif, c’est-à-dire de l’ego. » (p. 185.)
Pour conclure sur cette partie centrale de sa théorie du corps, de l’être de l’Individu, Henry résume sa pensée pour mieux préparer sa critique de Descartes : « le dualisme de l’âme et du corps, c’est-à-dire de l’être originaire du corps subjectif et du corps transcendant, n’est qu’un cas particulier du dualisme ontologique. L’acte par lequel le mouvement subjectif déploie la main comme masse organique qu’il connaît intérieurement, comme terme vers lequel se transcende sa connaissance non pas intellectuelle mais motrice, n’est ni plus ni moins mystérieux que l’acte par lequel mon regard vise et atteint l’arbre qui se tient là-bas, debout sur la colline. Le dualisme que la description de ces phénomènes met à jour n’est pas un dualisme ontique, c’est un dualisme qui n’est pas différent de celui que nous avons reconnu entre la vérité originaire et la vérité de l’être transcendant, et qui exprime la relation fondatrice de l’unité de ces deux vérités, de l’unité de l’expérience, — c’est un dualisme qui n’a rien à voir avec le dualisme cartésien. » (p. 188.)
Le dualisme cartésien
Ce chapitre est l’occasion d’une critique fondamentale de la réflexion sur le corps chez Descartes, une réflexion qui mène ce dernier à considérer le corps comme une étendue, comme un étant pas tout à fait différent d’une table, ou d’une cuvette. Mais alors qu’est-ce que l’étendue pour Descartes ? « L’étendue est le milieu où s’accomplissent les mouvements, lesquels sont purement mécaniques et se ramènent dans tous les cas à un déplacement des différentes parties de l’étendue, l’une poussant l’autre ; cette dernière opération s’accomplit dans l’instant. » (p. 189.) On connaît tous le mouvement fondateur de la pensée cartésienne. Celle-ci souhaite se constituer à partir d’une sphère de certitude absolu qui est le cogito. « Cogito ergo sum », cela signifie que le cogito est cette sphère d’où provient la subjectivité absolue, une certitude absolue car j’ai beau douter de cela, ça n’est qu’en tant que je suis, que je puis douter de moi-même. De ce cogito apparaissent les Erlebnisse désignant chez Descartes l’expérience interne transcendantale. On y retrouve par exemple les Erlebnisse relatifs à la connaissance sensible, à la vie imaginative, aux passions et aux sentiments. Mais à côté du cogito, Descartes élève une autre région de l’être destinée à recevoir la nature « primitive » de la pensée, ces Erlebnisse qui ne font pas partie de la « pure » pensée. Ces Erlebnisse reçu par le Permixtio proviennent selon Descartes de l’affectivité et préexistent le cogito. « Ce caractère spécifique qui marque de son empreinte propre une catégorie déterminée d’Erlebnisse, Descartes pense en rendre compte en le faisant apparaître comme l’effet de l’union, comme un trouble qui résulte de l’intervention du corps dans le domaine de la pensée pure, intervention qui n’est rien d’autre qu’une action du corps sur l’âme, action qui présuppose à son tour l’union comme condition de sa propre possibilité. » Ces Erlebnisse, d’après la théorie d’Henry sont des Erlebnisse corporels, d’une corporéité coïncidant avec la subjectivité absolue. Or « il n’en va pas de même dans le cartésianisme, ou plutôt, et c’est là toute son ambiguïté, il s’agit tantôt effectivement d’un corps subjectif dont Descartes a eu certes le pressentiment génial, et tantôt, et ceci précisément dans la théorie de l’union substantielle, de l’union de l’âme avec un corps qui est bel et bien le corps en troisième personne de la nature physique et mécanique, un corps dont l’essence est l’étendue et qui est toujours soumis, sinon actuellement, du moins virtuellement, à la catégorie du partes extra partes qui rend inintelligible son prétendu mélange avec l’essence de la pensée. […] D’où vient cependant aux Erlebnisse corporels ce caractère qui fait d’eux ce qu’ils sont, ce caractère par lequel ils se donnent phénoménologiquement à nous comme des déterminations de la subjectivité transcendantale dont ils tiennent précisément leur nature de faits absolus, certains et irrécusables ? C’est toujours la même ambiguïté qui fait que Descartes, après avoir pris ces Erlebnisse là où ils existent effectivement, dans la sphère absolue du cogito, les transporte ensuite dans une région qui n’a plus aucun caractère ontologique authentique, car elle se trouve privée de toute assise phénoménologique et n’est qu’une construction transcendante que son caractère inintelligible rend irrecevable même pour une philosophie qui se nourrirait de théories et d’hypothèses. » (p. 194-195.) Mais alors pourquoi cette contradiction chez Descartes ? Pourquoi ne donne-t-il pas aux Erlebnisse corporels, plutôt qu’à une autre nature primitive, la place qui est la leur dans le cogito ? Parce que « l’idéal de Descartes est, en effet, celui de la connaissance théorique et intellectuelle qui est comme une appréhension impassible de l’être mathématique et dans laquelle il n’y a place ni pour les sentiments ni pour les passions. D’où cette idée, propre d’ailleurs à tout intellectualisme, que l’affectivité en général est quelque chose d’inférieur et ne saurait appartenir, en tant que telle, à la pure essence de la pensée. D’où, enfin, l’hypothèse que la dégradation de la pensée pure en affectivité, en pouvant avoir son principe dans l’essence de cette pensée, relève nécessairement de l’ingérence en elle d’un élément étranger, à savoir le corps. Ce corps, toutefois, n’est plus le corps subjectif, il ne se confond pas d’avantage avec la tonalité affective propre aux Erlebnisse corporels, il est le corps-étendue tel que l’a livré l’analyse essentielle du morceau de cire. » (p. 195-196.) Descartes n’arrive donc pas « à comprendre que l’affectivité puisse appartenir à l’essence de la pure pensée. » (p. 197.) Seulement la pensée est elle même affective, déterminée par l’affectivité, tout comme le sentiment de haine est déterminé par l’affectivité. Mais ces affectivités apparaissent à nous différemment, or Descartes à pour objectif de nier ce fait. Pourquoi ? Car chez Descartes, « la pure pensée, l’essence de la pensée, est ensuite identifiée avec la pensée de type mathématique, avec la connaissance intellectuelle et théorique, toute pensée affective ou sensible étant déclarée inférieure et, d’une certaine façon, hétérogène par rapport à la pensée pure. » (p. 198.) La critique ne s’arrête pas là et il faut alors se demander « quelle est l’origine de cette dévalorisation de l’affectivité, ou de cette surestimation de la pure connaissance théorique ? Cette origine réside dans la tonalité affective de la connaissance intellectuelle, dans le pathos particulier de sa certitude propre. » (p. 199.) La pensée est effectivement affective, mais avec sa tonalité propre. « Les différentes formes de la vie affective ne sont assurément ni semblables ni équivalentes. L’établissement d’une hiérarchie entre ces différentes formes est parfaitement légitime, pourvu qu’on reconnaisse le caractère purement axiologique ou existentiel de celle-ci. » (p. 199.) Pour autant l’essence est la même, tout comme l’amour et la haine ont la même essence, même si l’on considère pour certains mieux l’amour que la haine. « On peut, de la même manière, placer la vie doxique de la conscience au-dessus de sa vie passionnelle. Ce n’est pas celle de la pensée en général. Si Descartes affirme cependant la supériorité de la connaissance intellectuelle, c’est qu’il a trouvé dans celle-ci un mode d’existence particulier, une expérience affective qui était précisément celle qu’il cherchait, à savoir l’expérience d’une certitude élevée au dessus de tous les doutes. » (p. 199.) Le triangle, ne pouvant être autre chose qu’un triangle, s’imposant à nous comme tel « donne ainsi à l’objet mathématique, un repos, une assurance, et comme une sorte d’extase à l’intérieur de cette assurance que Descartes avait tant cherchée. » (p. 200.)
Si la pensée prend sa substance dans ce qu’Henry nommera la vie, dans l’affectivité, « il n’y a pas lieu de distinguer certains Erlebnisse affectifs et d’autres qui ne le seraient pas, mais toutes nos expériences, en tant qu’elles sont nos différentes façons de vivre, portent en elles ce qui est précisément le caractère premier de toute vie et de toute expérience et que nous appelons ici, faute de mieux, une tonalité affective. » (p. 200.) Alors finalement, chez Descartes, « ce n’était pas, tout compte fait, la vie affective en général qui était dépréciée, mais seulement certains de ses modes, tandis que d’autres, ceux que nous vivons dans notre vie théorique, étaient revêtus d’une valeur positive pour des raisons qui sont précisément d’ordre affectif et qui résident dans le contenu affectif particulier de ces expériences. […] Il apparaît alors que si d’autres états affectifs sont dévalorisés et conçus comme résultant de l’ingérence du corps dans la sphère de la pensée, ce ne peut plus être en vertu de leur caractère affectif. Quelle est donc la raison qui amène Descartes à scinder, non plus le cogito en général, mais bien le cogito affectif lui-même en Erlebnisse affectifs purs, en quelque sorte, et en Erlebnisse affectifs qui relèvent de l’union ? C’est le sentiment emprunté au propre contenu affectif de ces Erlebnisse, que notre vie affective est tantôt comme l’expansion et l’épanouissement même de notre existence propre, et tantôt, au contraire, comme l’expérience de notre dépendance, de notre finitude et de notre misère. La théorie cartésienne de la passion concerne le problème de l’aliénation existentielle. » (p. 200-201.) Le mouvement de pensée de Descartes semble donc souhaiter fonder l’aliénation existentielle sur une aliénation ontologique qui en serait la cause, comme si le corps étendu rendu ontologiquement étranger au cogito viendrait par une union mystérieuse modifier les Erlebnisse du cogito, tel un parasite. Or c’est bien de l’existence humaine que provient le centre du problème de l’aliénation. « L’aliénation ontologique ne saurait constituer le fondement d’une théorie de l’aliénation existentielle, elle n’en est pas l’explication mais seulement une projection, accomplie par une imagination grossièrement réaliste, dans le ciel obscur du mythe. » (p. 203.)
Quelle est la genèse du faux problème de l’action de l’âme sur le corps et de sa pseudo-solution cartésienne ? Le rapport entre le mouvement subjectif et son terme organique vers lequel le mouvement subjectif se transcende est un rapport transcendantal. Or chez Descartes le corps organique dans lequel se forme le rapport transcendantal n’est qu’une étendue, il devient un terme transcendant. « D’autre part, la subjectivité absolue à laquelle l’être originaire du mouvement est immanent, s’est dégradée, elle est devenue la substance-pensée, elle a perdu son caractère ontologique authentique pour venir prendre place, purement et simplement, dans le milieu général de l’être transcendant, à l’intérieur duquel elle apparaît maintenant à côté de l’étendue intelligible ou substance étendue. La relation entre ces deux substances ne peut plus être qu’une relation en troisième personne, analogue à celles que nous découvrons dans un monde elle ne peut plus être qu’une relation causale. » (p. 206.) Descartes confond corps étendu et corps organique (premier, représentation du second) ainsi que mouvement subjectif et représentation de ce mouvement comme déplacement dans l’étendue. « Il s’est finalement demandé comment concevoir une relation et une action entre cette pure représentation et, d’autre part, un corps ou un mouvement étendu. » (p. 207.) Descartes a abstrait la réalité. « La dégradation qui permet à une telle contradiction de se faire jour est le résultat immédiat de l’abandon du point de vue de l’immanence absolue, qui est un point de vue absolu, qui est celui de l’ego, à partir duquel tout s’éclaire et se comprend. Le dualisme cartésien est le produit d’une telle dégradation. » (p. 208.)
Critique de la pensée de Maine de Biran : Le problème de la passivité
La problématique de l’aliénation apparaît également chez Maine de Biran, elle sera à la base de ses contresens sur le phénomène de la passivité de l’ego. En effet, « l’expérience personnelle de Maine de Biran est celle d’une aliénation. C’est l’expérience d’une vie affective sans cesse changeante, d’une humeur tantôt gaie, tantôt triste, et dont les modifications semblent indépendantes de la volonté du moi qui les éprouve. Cette servitude est doublement douloureuse, en raison même de la tonalité affective prédominante des Erlebnisse considérés (lassitude, ennui, malaise, découragement), en raison aussi du fait que ces Erlebnisse s’imposent à nous dans une expérience qui est identiquement celle de notre impuissance à l’égard du cours de notre histoire et de ses modalités. » (p. 214.) Du problème de la passivité de l’ego, Maine de Biran va alors s’inspirer des théories de ceux avec qui il s’oppose, Condillac et les sensualistes. « C’est ainsi que naît un dualisme qui oppose l’effort volontaire et moteur à la passivité de la vie sensible tout en conservant de cette dernière une notion absolument incompatible avec la théorie biranienne de la subjectivité qui fait le ressort de l’analyse ontologique du corps. » (p. 217.) Le phénomène de perception par exemple serait pour Biran un phénomène vécu en 3ème personne. De même pour toutes les Erlebnisse, affections plus obscures, ayant un rapport avec l’intériorité comme l’intuition ou l’imagination. Elles seraient données à une cause infraconsciente et finalement « cogito et ego ne coïncident plus. » (p. 218.) Pour Michel Henry, cette distinction entre la passivité et l’activité chez Biran provient, comme pour la problématique de l’affectivité chez Descartes, des différents Erlebnisse particuliers : « sans doute l’expérience de la passion est une expérience subjective qui se situe sur le plan du cogito. On peut, par suite, ranger nos différents Erlebnisse sous les deux rubriques opposées de la liberté et de la servitude. » p. 219. Une préférence est donc donnée à la liberté face à la servitude, à l’autonomie face à l’aliénation, à l’activité face à la passivité. Ainsi « parce que, pour s’opposer au sensualisme de Condillac et des idéologues, Biran s’est cru obligé de définir l’être véritable du moi comme effort et comme volonté, il tendra à conférer un privilège exclusif au modes actifs du sujet, comme Descartes l’avait fait pour ceux de la pensée du type mathématique. » (p. 219.) Il manque alors à Maine de Biran une théorie ontologique de la passivité. « La limitation de l’ego cogito au sujet qui fait effort a profondément faussé la signification ontologique du biranisme. » (p. 220.)
Alors pourquoi avoir oublié la passivité ? Car chez les sensualistes comme chez Biran, « la conscience étant identifiée à l’action, l’expérience de la passivité doit s’expliquer à partir d’un principe extérieur à cette conscience. » (p. 220.) L’ego pour Biran est seulement force motrice. Contrairement à Biran, Henry considère que l’être sentant ne peut être séparé de l’ego lui-même, car c’est toujours dans cette sphère du cogito que la passivité est ressentie. L’affectivité est une intentionnalité, un acte du cogito. « Celle-ci, dès lors, comporte un élément pur, véritablement transcendantal, qui fait d’elle une modalité de la vie de la subjectivité absolue, une opération passive qui s’accomplit dans une sphère d’immanence radicale et qui nous permet de dire que sentir c’est encore penser. » (p. 224.) C’est parce qu’elle est intentionnelle, trouvant sa source dans la subjectivité absolue, que la subjectivité absolue peut se remémorer ce qu’elle a vécu de manière passive. C’est parce que le moi accueil passivement les sensations qu’il est capable de dire « je sens », qu’il est également capable de se remémorer ce qu’il a sentit. Que la passivité et l’action, l’aliénation existentielle et la liberté, puissent prendre leur essence dans l’ego cela signifie également que l’acte du corps absolu se retrouve à la fois dans le mouvement et dans l’immobile. Du fait de ses modes d’existences différents : « notre corps est un acte, mais c’est souvent un acte qui n’agit pas, notre corps est essentiellement mouvement, mais il s’agit aussi bien d’un mouvement immobile. La racine commune de notre agir et de notre sentir est un pouvoir plus profond, qui les fonde l’un et l’autre, c’est l’habitude sur laquelle s’appuie l’unité de notre vie corporelle à travers toutes les modalités par lesquelles celle-ci se déploie, c’est l’être originaire du corps, enfin, c’est-à-dire l’ego. » (p. 227.) Il y a donc une unité qui fonde cette dialectique immanente : « l’unité de l’être originaire de notre corps. » (p. 228.) Dans cette unité de la subjectivité absolue « il n’y a pas de différence ontologique essentielle : activité et passivité sont bien plutôt deux modalités différentes d’un seul et même pouvoir fondamental qui n’est rien d’autre que l’être originaire du corps subjectif. » (p. 226.) Dévoiler qu’il n’y a pas de différence radicale entre l’activité et la passivité « c’est dire, alors, que l’unité ontologique est aussi, d’une certaine manière une unité existentielle, que, malgré les différences qui séparent nos expériences (du parler, de l’audition, par exemple) quant à leur contenu phénoménologique transcendantal, ce contenu est cependant le même à bien des égards. » (p. 229) L’ego est donc un unité phénoménologique constituant une diversité phénoménologique d’expériences. C’est parce qu’il y a homogénéité ontologique de l’activité et de la passivité que leur opposition est possible. C’est parce que tous deux sont une expérience, qu’ils peuvent être éprouvé et ainsi comparé dans leur opposition. Ainsi, la Barbarie Daeshiste par exemple est rendue possible car l’autonégation de l’ego nécessaire à l’accroissement permanent du capital, pousse à la négation de l’expérience du « pouvoir-être-affecté » (p. 230.) et du pouvoir-agir en tant que ces deux pouvoirs prennent leur racine dans une unité ontologique qui est l’ego lui-même. Cet ego est en état de veille permanent, une tension latente caractérisant la vie, faisant d’elle un pouvoir-être permanent.
Conclusion. La théorie ontologique du corps et le problème de l’incarnation : la chair et l’esprit
Les conclusions d’Henry sont les suivantes : la subjectivité absolue a un caractère concret. Elle n’est pas abstraite, vide et indéterminée comme le prétend l’intellectualisme. La vie a son propre contenu, en face du contenu transcendant à laquelle se rapport l’expérience. C’est parce que la vie a son propre contenu immanent, transcendantal qu’elle peut se rapporter à elle-même, à cette connaissance absolue du Soi vis-à-vis de soi. Une réflexion qui s’impose l’encontre du monisme ontologique pour qui le corps ne peut apparaître que dans cette région de l’être admis par ce dernier, à savoir dans « un milieu d’extériorité radicale » (p. 261.) Ainsi disparaît le corps subjectif. Le corps n’est pas contingent, n’apparaît pas dans un domaine qui est plus grand que lui, au contraire « l’immanence d’une détermination transcendantale signifie […] que la subjectivité s’épuise en elle, parce qu’une telle détermination n’appartient pas à un monde, parce qu’elle n’est pas entourée par un élément qui la dépasse. » (p. 263.) Le dualisme ontologique permet donc de penser le corps absolu comme fondement de la détermination de l’être avec le monde, ainsi « être-en-situation signifie bien, pour le corps absolu, être dans un certain rapport avec l’être transcendant, mais il s’agit cette fois d’un rapport transcendantal. Dire que notre corps est situé, c’est dire qu’il se rapporte au monde et, à l’intérieur du monde, à telle ou telle détermination de l’être transcendant. Soutenir avec le monde un tel rapport, toutefois, ce n’est pas lui appartenir, comme une chose appartient à son élément. Bien au contraire, notre corps ne peut être au monde qu’à la condition de n’être rien du monde. C’est parce qu’il est subjectif que notre corps est situé. Le fait d’être en situation trouve ainsi sa possibilité dans la structure ontologique du corps originaire. Comme cette structure est celle de la subjectivité absolue, on peut se persuader ici encore que, loin de conduire à un idéalisme abstrait qui laisserait flotter, en quelque sorte, l’être humain sans pouvoir rendre compte de son insertion dans le monde, la philosophie de la subjectivité est au contraire ce qui nous permet de rendre compte d’une telle insertion, c’est-à-dire de donner un fondement ontologique au fait de l’être-en-situation. » (p. 264.) Finalement, on peut dire que « le corps se maintient près de soi dans son rapport au monde ou à soi-même » (p. 265.) Le corps objectif, s’il apparaît bien dans le monde, n’est pas pour autant un objet comme un autre. Il est mis en mouvement par les intentionnalités du corps subjectif, ce qui nous permet de voir que ce corps marche, ouvre la porte etc. « Le corps objectif a beau être présent dans la représentation, il ne peut être pour nous « en marche » qu’au prix d’un emprunt à une autre région de l’être. » (p. 266.) « Toutes les déterminations qui ont trait à sa situation se ramènent en fin de compte au premier groupe de caractères en vertu desquels ce corps objectif se situe en fait dans le monde, non pas comme un être-là inerte, mais comme un objet mouvant, secrètement habité par un sujet. » (p. 267.) Le corps organique n’est alors pas situé, au contraire, c’est lui qui situe tout ce qu’il y autour de lui : « Notre corps originaire est un centre absolu, et par suite, loin qu’il puisse être librement soumis à la catégorie générale de la situation, il est bien plutôt en situation, et cela dans un sens bien déterminé en vertu duquel il doit être décrit finalement comme le fondement ontologique de toute situation possible. » (p. 270.)
La relation du Soi au corps n’est pas celle d’un « avoir », elle est celle démontrée tout au long de l’œuvre. « À l’affirmation “ j’ai un corps “, il convient donc d’opposer cette affirmation plus originaire : “ je suis mon corps “. […] “ Je suis mon corps “, cela signifie très exactement : l’être originaire de mon corps est une expérience interne transcendantale et, par suite, la vie de ce corps est un mode de la vie absolue de l’ego. « J’ai un corps », cela signifie : un corps transcendant se manifeste aussi pour moi et se donne à moi comme soumis, par un rapport de dépendance, au corps absolu qui, comme l’a montré la théorie de la constitution du corps propre, fonde aussi bien ce corps objectif que le rapport de possession qui le lie à l’ego. » (p. 271.)
Michel Henry profite ensuite d’une critique d’Hegel pour marquer son opposition à la théorie traditionnelle de la subjectivité : « La subjectivité n’est pas cet esprit pur enfermé dans son propre néant et incapable de descendre dans la détermination de la vie, elle est cette vie même. » (p. 273-274.) En effet, pour Hegel, « l’action est précisément une aliénation de cette sorte. Ce moment où le pur esprit, pour devenir effectif, doit alors s’objectiver, devenir étranger à lui-même. (p. 277.) La subjectivité ne faisant pas partie de l’être transcendant, pour devenir réelle elle doit se rendre étrangère à elle-même, pour modifier le réel. Or la subjectivité ne peut être du domaine de la transcendance. « S’objectiver pour l’ego, c’est donc seulement se représenter à lui-même. Mais précisément acquérir de soi une telle représentation, ce n’est pas agir, ce serait plutôt vivre une vie contemplative. » (p. 278.)
Alors qu’est-ce que l’action ? Pour cela nous devons pousser l’élucidation ontologique de ce phénomène. « L’action reste intentionnelle, c’est-à-dire qu’elle se maintient près de soi dans une sphère d’immanence, sans “ sortir “ jamais d’elle-même pour aller en quelque sorte se manifester en personne dans le monde, car, encore une fois, elle n’est pas une vie qui se représente à elle-même, mais une vie qui agit. Et, à la fin du processus, cette action est demeurée dans le milieu qui lui est propre, sous la forme d’une dernière intentionnalité liée synthétiquement à toutes celles qui la précèdent et dont la totalité constitue le phénomène que nous appelons une action déterminée – l’ensemble du phénomène devant naturellement être rapporté à l’essence de la vie active et non à celle de la vie théorique, c’est-à-dire devant être compris à partir du rapport transcendantal du mouvement subjectif et du terme non représenté vers lequel l’action se transcende immédiatement dans ce mouvement. » (p. 279-280.) Par la suite, via L’analyse ontologique de la subjectivité, Michel Henry peut donner un fondement à l’éthique, déterminer l’intentionnalité du sujet comme se confondant avec l’action du sujet et non plus dissocier intention comme élément dit subjectif et l’action comme élément transcendant.
De manière générale, Henry pose donc la nécessité d’aller à l’encontre de la conception traditionnelle dualiste de l’esprit et du corps qui fait de ce dernier un élément étranger à la subjectivité et à la conscience. Seulement, que cette dualité perdure à notre époque n’est pas sans conséquence ni sans cause. Si le corps ne s’oppose pas à l’esprit, c’est donc que le Soi se nie soi-même au travers l’Oublie de sa propre condition de vivant. « Oublieux de son moi, l’ego se soucie du monde. » (Michel Henry, C’est moi la vérité, Seuil, Paris, 1996.p. 180.) La modernité comme négation du corps au travers du fait sportif, de la course à la valorisation de la valeur du capital ou de la sexualité réifiée est donc auto-négation générale de la subjectivité. On pourra retrouver un développement de la réflexion d’Henry sur certains de ces points dans la suite de son œuvre, notamment dans La Barbarie, ou dans son interprétation phénoménologique de Marx.
A. Aït Moussa
[1] Theodor W. Adorno, Dialectique négative, Paris, Payot, 1978, p. 45.
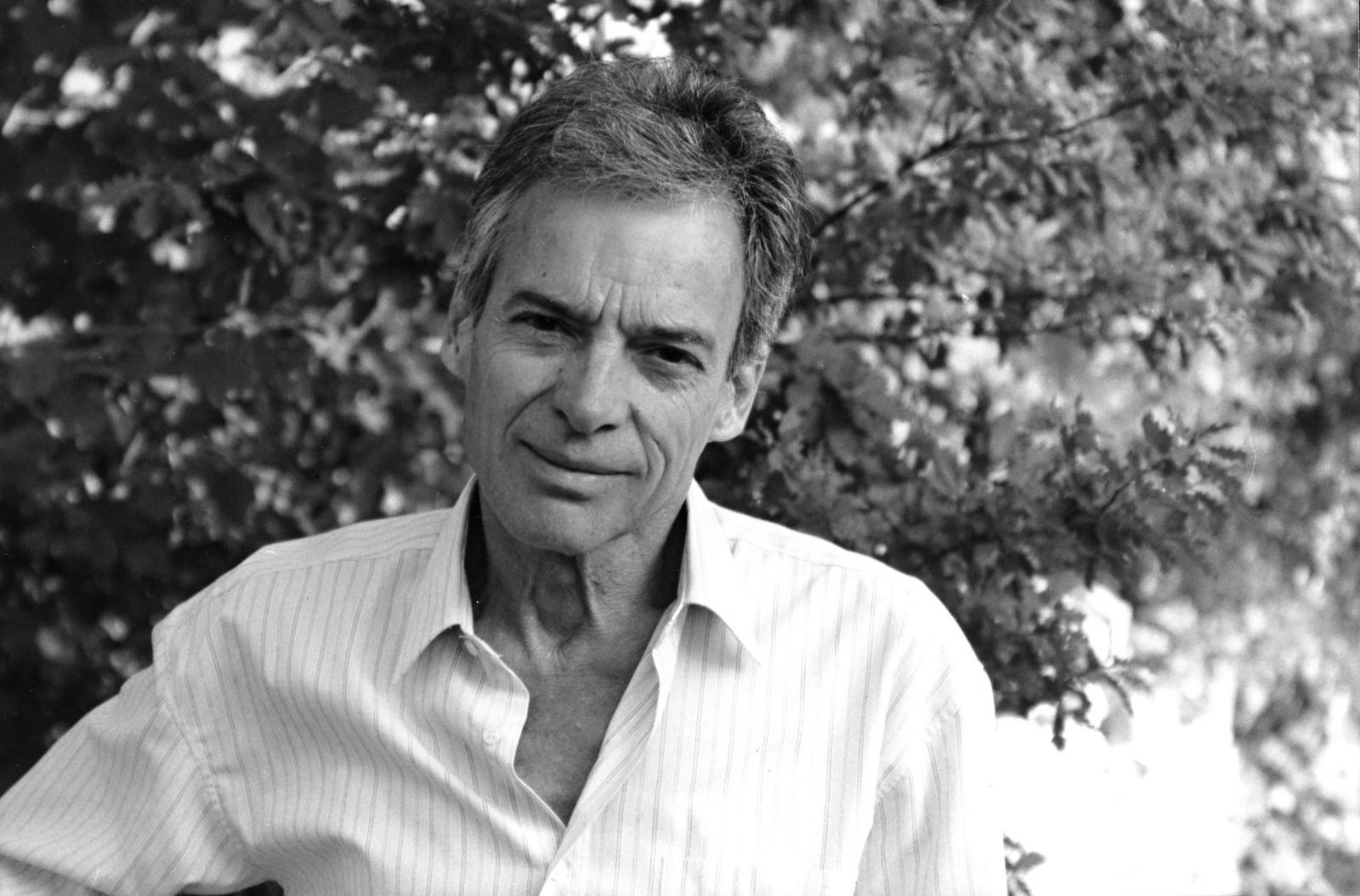

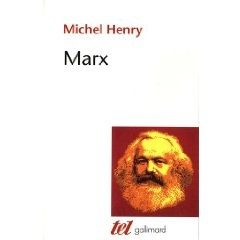


Analyse critique du populisme

Une analyse critique des idées d’Étienne Chouard
Vous aimerez aussi

Nouvelles Questions Féministes – La sexualité des femmes : le plaisir contraint
20 novembre 2016
Voline – La révolution russe
23 juillet 2017