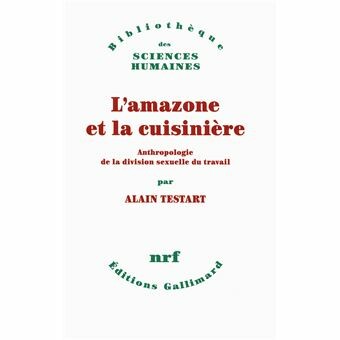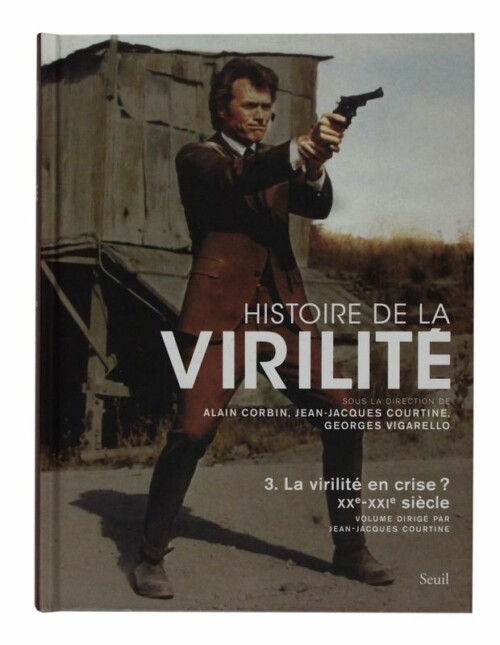
Histoire de la virilité – La virilité en crise ? Le XXème-XXIème siècle (1ère partie)
Jean-Jacques Courtine (dir.), Histoire de la virilité. La virilité en crise ? Le XXème-XXIème siècle, Paris, Seuil, 2011
Ce dernier tome d’Histoire de la virilité est davantage un objet « chaud » puisqu’il traite du patriarcat et du virilisme contemporains. Il renferme également davantage d’articles intéressants, d’où une certaine difficulté à en faire une note de lecture complète. Quoiqu’il en soit, ce dernier tome d’Histoire de la virilité nous permettra de réfléchir aux évolutions du patriarcat et du virilisme depuis un siècle.
Introduction. Impossible virilité
Le bilan des deux précédents tomes d’Histoire de la virilité se formule ainsi : « [Les] lecteurs […] auront vu se former et se transformer […] un socle anthropologique de représentations extrêmement anciennes mais toujours présentes, assignant une « valeur différentielle » aux sexes et assurant une hégémonie du pouvoir viril fondée sur un idéal de force physique, de fermeté morale et de puissance sexuelle. Ils auront constaté que cette domination masculine ne relève d’aucun état de nature, mais qu’elle est profondément inscrite dans celui de la culture, du langage et des images […]. [Pour autant] l’ensemble des rôles sociaux et des systèmes de représentation qui définissent le masculin comme le féminin ne peuvent se reproduire, identiques à eux-mêmes, que si l’hégémonie virile semble appartenir à l’ordre nature et inéluctable des choses » (pp. 7-8). Peut-être faudrait-il nuancer cette vision quasi-statique du patriarcat et du virilisme, et insister sur une forte évolution à partir du 16ème siècle [Federici], et surtout du 19ème siècle [Le triomphe de la virilité]. D’autre part, le virilisme n’est pas qu’une idéalisation du dominant masculin, mais également un instrument de soumission des mâles aux patriarches supérieurs, même s’il reste principalement l’idéologie de la domination masculine. Enfin, il faudrait plutôt parler d’une domination masculine comme structure concrète de domination sociale (donc construite, donc dépassable), plutôt qu’inscrit dans une « culture » tendanciellement essentialiste.
Quoiqu’il en soit, Jean-Jacques Courtine dans son Introduction formule (quoique de manière problématique) un paradoxe central du 20ème siècle, celui du spectre idéologique de la dévirilisation et de la « féminisation » (Soral), notamment du fait des luttes féministes, et d’un maintien concret du système patriarcal-viriliste, avec même des backlash terrifiants : « Dès la fin du 19ème siècle, des années 1870 à la Grande Guerre, le spectre de la dévirilisation vient hanter les sociétés européennes : dégénérescence des énergies mâles, déperdition de la force, multiplication des tares. La virilité est en danger, et la nation avec elle. Sa militarisation va connaître avec la guerre son apogée tragique : la dévastation des corps sape le mythe militaro-viril et inscrit la vulnérabilité masculine au cœur de la culture sensible. La Seconde Guerre mondiale, puis les dernières guerres coloniales finiront d’achever l’enthousiasme viril pour la prouesse guerrière […]. D’autant plus que la virilité se voit confrontée au cours du siècle à la contestation de son plus ancien privilège par l’éveil et les progrès de l’égalité entre les sexes, et les avancées du féminisme. L’obtention par les femmes de droits nouveaux à partir des années 1960 et 1970, le réajustement des rôles sexués dans la sphère publique et privée, la réprobation puis la condamnation [officielle] des formes de violence envers l’autre sexe, tout cela ne va pas sans attiser des angoisses masculines : on s’inquiète de la déperdition de l’autorité paternelle, on redoute les effets d’une « société sans pères » livrée à la toute-puissance de mères dominatrices. […] On ne saurait oublier que le 20ème siècle a été tout autant le théâtre de grands flamboiements virils » (pp. 9-10), ni même surtout (ajoutera-t-on) qu’on reste dans une société patriarcale, avec son cortège de violences (de rues, gynécologiques, conjugales, familiales, au travail…), d’inégalités, d’exploitation domestique, etc. Jean-Jacques Courtine pose en fin d’introduction cette question : « Les hommes d’aujourd’hui entendent-ils porter longtemps encore cette charge millénaire, ou bien vont-ils souhaiter sentir s’en alléger le poids, quitte à renoncer à ses avantages ? » (p. 11). Nous formulerions autrement cette question : allons-nous enfin auto-abolir notre propre domination masculine, allons-nous faire enfin cette nuit de l’abolition des privilèges masculins, allons-nous enfin nous libérer de cette « cage d’acier » (Weber) idéologique du virilisme nous assignant à être des dominants prédateurs – nous empêchant de développer des vraies relations humaines, entres autres – et en même temps des dominés obéissants servilement-virilement aux patriarches supérieurs (mafieux, gourous comme Soral, etc.) ?
Première partie. Origines, mutations, déconstructions de la domination masculine
Anthropologies de la virilité : la peur de l’impuissance
L’article de Claudine Haroche est extrêmement problématique, outre qu’il est assez pauvre en apports historiques (en-dehors d’une référence intéressante aux travaux de Klaus Theweleit au sujet du fascisme comme virilisme), puisqu’il s’inscrit dans une approche différencialiste, et particulièrement celle de Françoise Héritier, anthropologue – mais au moins nous permet-il de faire un point critique sur cette approche différencialiste. Cette dernière fait l’hypothèse d’une domination masculine remontant « à l’origine de notre espèce » (Héritier), instaurant « des formes variables mais continues d’inégalités profondes entre les hommes et les femmes », ceux-ci exerçant une « domination persistante, visible ou insidieuse, sur les femmes », et ce dès l’échange « primitif » des femmes. Le problème d’une telle approche, c’est qu’elle postule une différence radicale entre « femmes » et « hommes » antérieure au patriarcat, celui-ci ne venant que s’y surajouter, alors même qu’avec Christine Delphy, on dirait au contraire que c’est le patriarcat qui a divisé l’humanité en deux, un groupe dominant (« hommes ») et un groupe dominé (« femmes »), avec comme simple marqueur une identification sociale au sexe « mâle » ou au sexe « femelle », et ce de différentes manières (différencialisme social et continuiste jusqu’au 18ème siècle, différencialisme biologisant et discontinuiste à partir du 19ème siècle [Laqueur]). Symétriquement, il n’y a pas des « races » préexistantes au système raciste-colonial, mais au contraire celui-ci divisant l’humanité en deux, un groupe dominant et un groupe dominé (« indigènes »), avec comme simple marqueur un taux de mélanine plus ou moins différent et des traits physiques : l’exemple même en étant la création coloniale-raciste des « Tutsis » et des « Hutus » au Rwanda.
La suite de l’article est consacré à des considérations générales, pas inintéressantes, mais non-novatrices (« la virilité est l’élément central de la mémoire de la domination masculine », « même si elle a reculé dans bien des lieux, cette domination a perduré, et même progressé, précisément dans ses formes insidieuses » [pp. 16-17]), avant une évocation intéressante de « la virilité fusionnelle des fraternités », ces organisations non-mixtes de camaraderie viriliste nées aux lendemains de la Première Guerre mondiale : « Des fraternités [qui] révèlent des éléments essentiels du dispositif viril : celui […] de l’exclusion des femmes, celui encore du processus de formation d’une solidarité compacte entre hommes-frères, indissociable […] de traces du modèle patriarcal autoritaire » (p. 21).
L’ « atomisation » du social – qu’il ne faut pas voir que de manière négatif, puisqu’elle permet également aux individus d’échapper au carcan communautaire – consécutif aux déracinements des individus de leurs communautés agricoles (exode rural) ou urbaines (fin des corporations et des associations d’artisans), l’isolement des individus, a pour contrepartie « dialectique » une recherche masculine de fusion totalitaire (p. 22) dans des masses ou des fraternités virilistes, souvent guidées par un patriarche supérieur (un « Chef », un « Führer », un « Duce ») : c’est ce que disait Adorno lorsqu’il disait qu’il y a des individus qui « n’ont à leur disposition qu’un moi faible et ont par conséquent besoin, comme substitut, de l’identification à un grand collectif ». Les solidarités virilistes d’aujourd’hui sont également « une manière de faire bloc, de fournir dans des formes d’agrégation collective une réponse » (p. 23) à un isolement individuel aussi bien qu’à une menace d’abolition du statut de mâle dominant. Les travaux de Klaus Theweilt au sujet des corps-francs et leur virilisme permettrait, de plus, de faire une description psychique du « mâle soldat » (et aujourd’hui, du mâle viriliste-masculiniste) en termes de « moi carapace », de « moi fermé, dur, rigide » craignant une dissolution de lui-même s’il ne développe pas une personnalité autoritaire (p. 24). S’ensuit toute une analyse psychanalytique du virilisme fasciste, partiellement intéressante, partiellement spéculative, au sujet de la formation psychique des mâles (surtout petit-bourgeois) au sein du capitalisme industriel : « La personnalité […] du fils dans la famille bourgeoise patriarcale […] va sourdement induire, au travers d’une mythification de la mère, un certain type d’économie psychique, corporelle, sexuelle visant à capter les énergies dans le travail, le profit, la rentabilité […], déterminant, au-delà du seul rapport à la mère, le rapport […] aux femmes de manière plus générale. Le fasciste, en fait, n’aurait jamais achevé sa séparation d’avec sa mère et ne se serait jamais constitué un Moi au sens freudien du terme […] En devenant père et mari, tout en continuant à vénérer sa mère, le fils reproduira alors le modèle en dominant, en asservissant lui aussi sa femme » ( » (p. 25). Le problème est qu’une telle analyse demeure spéculative, elle psychologise intégralement des types politiques, même s’il y a sans doute une part de réalité – comme au sein des analyses de Reich dans La psychologie de masse du fascisme. S’ensuit une référence intéressante aux travaux d’Horkheimer au sujet de la famille bourgeoise autoritaire et de la personnalité autoritaire : « C’est la famille qui veille à la formation de la personnalité et du caractère autoritaire […] ; c’est au sein de la famille que la soumission à l’autorité, la « dépendance » ont été apprises ; c’est la famille enfin qui participe à la reproduction des mentalités qu’exigent les traditions de la société bourgeoise. Le père exerce « naturellement la puissance sur la famille, une puissance […] fondée sur « sa position économique et [sur] sa force physique entérinée juridiquement » » (p. 26).
L’auteure de l’article poursuit de manière problématique lorsqu’elle prétend qu’ « on peut réduire la domination masculine, on ne saurait pourtant l’éradiquer » (p. 29) : dans un raisonnement typiquement différencialiste, l’auteure fait de la domination masculine une structure anthropologique « naturelle » qu’on ne pourrait soi-disant abolir, alors même qu’il s’agit d’une structure socio-historique, donc dépassable. D’autre part, l’auteur, avec Héritier, met en garde contre une « « guerre » menée contre le genre masculin qui ne peut alors que se défendre » (cité, p. 29). Mais s’agit-il vraiment d’une guerre ? Il s’agit plutôt d’une lutte (pouvant impliquer des hommes, d’ailleurs) visant à une abolition de la domination masculine, des privilèges des « mâles », du patriarcat, et non une « guerre des sexes » sous forme de lutte mortelle : c’est là un fantasme masculiniste, précisément. C’est comme de confondre l’abolition des classes avec l’élimination physique des bourgeois (même si cette confusion a été historiquement effective, avec Staline), alors même qu’il ne s’agit d’éliminer un système de domination sociale. Enfin, l’auteure persiste dans son différencialisme : « Il n’est pas non plus sûr que l’enfermement dans des nouvelles normes d’indifférenciation des sexes constitue une voie souhaitable : écartant la différence, on pourrait ainsi vouloir combattre l’inégalité du modèle archaïque dominant, tandis qu’on favoriserait l’homogène, la conformité, le conformisme » (p. 30). On nage ici dans un autre fantasme, celui qu’une abolition du système patriarcat et de l’obligation des individus de se conformer de manière binaire à un genre « masculin » ou « féminin » conduirait à une « indifférenciation des sexes » : en réalité, cette double abolition conduirait à une possibilité ouverture pour chaque individu, qu’il soit biologiquement « mâle », « femelle » ou intersexe, de s’auto-déterminer comme il veut, sans tenir compte d’aucun modèle de « genre », (binaire « traditionnel » comme post-moderne), ni même que cet état de fait biologique (qu’il ne s’agit pas de nier) ne dicte de quelque manière que ce soit son existence propre.
La virilité face à la médecine
La médecine participe d’une définition de la virilité : elle dit ce qui est « biologiquement » viril et ce qui ne l’est pas, et d’autre part elle s’occupe de l’impuissance sexuelle (p. 31). La médecine va même participer de l’idéologie viriliste faisant des hommes des êtres « puissants » et des femmes des êtres « faibles » (jusqu’à elle-même abuser des femmes) du fait d’une mise en valeur de la « puissance génitale » du mâle et de sa testostérone (p. 33). Les hormones, au cœur du paradigme médical de l’entre-deux-guerres (1918-1939), brouillent cependant cette frontière, « par la présence d’hormones féminines dans le corps masculin et d’hormones masculines dans le corps féminin. De la testostérone [est] ainsi produite chez les femmes, et la diminution de la production d’œstrogènes à la ménopause laisserait le champ libre à l’hormone « mâle », expliquant la virilisation observée depuis longtemps à l’âge critique. Si les deux sexes produisent les deux genres d’hormones, la question du degré devient plus aiguë encore. Or on sait depuis la fin du 19ème siècle qu’il n’existe pas, d’un point de vue statistique, de rupture significative entre les taux masculins et féminins : les écarts de proportion entre les deux types d’hormones – si l’on doit encore utiliser cette distinction – sont plus importants d’un individu à l’autre du même sexe que d’un sexe à l’autre. La masculinité, et a fortiori la virilité s’en trouvent, de fait, brouillées » (pp. 35-36). Mais l’idéologie viriliste a une solution : un taux élevé de testostérone fait du mâle un « homme viril », tandis qu’un taux faible fait du mâle un efféminé, voire déterminerait des penchants homosexuels (p. 37) : « La testostérone, hormone mâle et « active », assume presque exclusivement le rôle déterminant ; c’est son déficit qui entraînerait chez l’homme une tendance homosexuelle, et son excès chez les femmes qui les pousserait au lesbianisme […] Seul serait viril le masculin suffisamment chargé en testostérone. […] La virilité résiderait donc dans une sorte d’hypermasculinité hormonale » (p. 37). La génétique, en plein essor dans l’après-guerre, rassure tout d’abord, avec une 23ème paire de chromosomes différente chez les « mâles » (XY) et chez les « femelles » (XX) : « C’est donc, en déduit-on, la présence du chromosome Y qui fait l’homme » (p. 38). Ainsi, « comme dans le cas des hormones, la science semble ainsi confirmer dans un premier temps l’irréductible différence entre les sexes – et de quelle façon ! –, celle-ci s’inscrivant comme un minuscule cachet au sein de chaque cellule du corps. Cette découverte est confortée par les théories sur les mécanismes fœtaux de la distinction sexuelle. […] Les gender studies n’ont pas manqué de souligner à quel point les scénarios ainsi élaborés reproduisaient, une fois de plus, les partages sociaux […] des rôles féminin et masculin : le chromosome Y est défini comme le chromosome actif et créatif, le chromosome X engendrant en quelque sorte passivement le sexe féminin, par défaut. Cette vision « naturelle » a probablement gelé ou du moins retardé les recherches sur la détermination du sexe féminin, puisque celui-ci semblait un non-événement » (p. 38-39). Mais « la fin du 20ème et le début du 21ème siècle voient pourtant se troubler ce régime d’évidence. Les combinaisons génétiques possibles se révèlent beaucoup plus étendues, et leurs versions complexes plus répandues que ce que l’on croyait au départ ; les individus de type XO, XXX, XXY, XYY ou XXYY abordent (2 % des naissances seraient de type « intersexué »), et les phénotypes ne coïncident pas nécessairement avec les génotypes : il existerait ainsi des individus XY à phénotype femelle et des individus XX à phénotype mâle » (p. 39). Il ne s’agit évidemment pas d’en faire une interprétation politique en faveur d’une abolition du système patriarcal de genre, puisque précisément celui-ci n’est pas une « superstructure » sociale fonctionnant à partir d’une « infrastructure biologique », mais une structure sociale s’expliquant de manière sociale (définition du « fait social » chez Durkheim, fondateur de la sociologie) ; et ce d’autant plus qu’il faut se méfier de l’utilisation politique des théories scientifiques, généralement conservatrice ou réactionnaires. Ainsi, la sociobiologie (héritière du darwinisme social) prétend expliquer des faits sociaux par des déterminismes génétiques : « La sociobiologie […] vise à expliquer les comportements humains, y compris sociaux, par un déterminisme « naturel » – notamment génétique. Dès lors, il est tentant de rechercher les causes de l’homosexualité dans un caryotype XX ou de rattacher des comportements agressifs à un gène recherché « naturellement » sur le chromosome Y » (p. 39), sans parler des individus XYY présentés comme particulièrement criminogènes.
La médecine du 19ème siècle avait, par ailleurs, fait de l’érection une contraction puissante, un afflux de sang allant de pair avec un tempérament sanguin : « L’homme fort « bande » ses muscles comme un ressort, l’homme viril « bande » tout simplement » (p. 42). Le coït est présenté comme une gymnastique, un exercice de maîtrise rationnelle et d’endurance sportive. « La force persuasive de ce modèle de « tension » explique peut-être le caractère tardif de l’élucidation des mécanismes de l’érection. C’est seulement dans les années 1980 que ces derniers sont expliqués selon un nouveau schéma neuro-sanguin inattendu, et moins conforme aux catégories de genre […] L’érection […] ne résulte pas [ainsi] d’une tension, […] mais au contraire d’un indispensable relâchement préalable des muscles lisses des alvéoles des corps caverneux […] ; à l’inverse, la flaccidité ordinaire procède d’une contraction de ces muscles, empêchant le sang d’affluer dans la verge » (p. 43).
La sexologie contribue également à un renouvellement des représentations. Mais d’abord, c’est une sexologie freudienne qui prédomine au début du 20ème siècle et durant une bonne partie de celui-ci. Certes, dans Trois essais sur la sexualité (1905), Freud « affirme l’existence d’une sexualité infantile et dissocie par là même clairement la sexualité de l’impératif reproducteur, le moteur de la sexualité étant désormais la libido, le désir ; la façon dont cette sexualité infantile est vécue conditionne la santé sexuelle de l’adulte. Il définit plusieurs stades à la maturation de la sexualité (orale, anale, génitale) et réhabilite la masturbation comme une étape du stade génital ; ce faisant, il introduit au passage une distinction lourde de conséquences […] entre l’orgasme clitoridien, masturbatoire, et l’orgasme vaginal, obtenu par la pénétration » (pp. 44-45). En effet, selon Freud, « l’orgasme clitoridien » serait immature, superficiel, et seul « l’orgasme vaginal » serait digne d’une « vraie femme » : il s’agit par-là de culpabiliser les femmes n’ayant pas d’ « orgasme vaginal » (soit une majorité de femmes n’ayant guère d’orgasme lors d’une pénétration vaginale ; d’ailleurs en réalité « l’orgasme vaginal » est un mythe), et de tenter de relier inextricablement (après les avoir dissociés) la sexualité et la reproduction, ou du tout moins la pénétration vaginale. Freud connaissant l’orgasme clitoridien, c’est donc en connaissance de cause qu’il dévalorise celui-ci, dans l’optique d’une sexualité coïtale, phallocentrée, reproductive, sans considération du plaisir « féminin » [La sexualité des femmes] : bref, d’une sexualité patriarcale. L’homosexualité est d’ailleurs également dévalorisée comme sexualité immature (p. 45).
« Freud est par ailleurs […] convaincu que chaque être humain est au départ bisexuel, physiquement et surtout psychiquement. La perception de la différence sexuelle repose toutefois sur une révélation déséquilibrée : c’est la présence du pénis qui définit la masculinité ; c’est son absence qui définit la féminité, celle-ci procédant par défaut, en creux. […] En avoir ou pas, telle est la question : douloureuse pour les filles, chez qui [selon Freud] ce complexe radical peut trouver une issue dans la maternité et le dévouement ; angoissante pour les garçons qui, certes, sont dotés de la puissance sexuelle mais hantés par la castration » (p. 45). L’androcentrisme de Freud se double ainsi d’un phallocentrisme affirmé.
Les théories freudiennes de soin de l’impuissance vont connaître un certain succès jusqu’aux années 1960 (pp. 46-47). La sexualité va néanmoins connaître une première évolution avec le rapport Kinsey (1948), consacré à la sexualité masculine, et qui montre « que des pratiques comme la masturbation sont banales et, de fait, inoffensives ou qu’une sexualité excessive n’entraîne pas d’impuissance » (pp. 47-48), et avec Human Sexual Responses de Masters (médecin) et Johnson (psychologue) qui font de l’orgasme « le point central de la nouvelle sexologie » (p. 48), au point que c’est désormais « sur son obtention, à la fois pour soi et pour l’autre – si possible simultanément -, que la sexologie se concentre, car « le choc extatique et orgasmique de la terminaison de l’acte d’amour apparaît de nos jours comme le conditionnement indispensable d’un équilibre moral et caractériel qui rend la vie clarifiée, heureuse, optimiste et facile » » (p. 48). Cependant, les homosexuel-le-s restent exclus de cette sexologie « hétéronormative », et cette approche reste socialement conservatrice (l’orgasme pour une poursuite « heureuse » du patriarcat) même si elle met fin à une idéologie sexuelle victorienne puritaine. Les rapports Hite sur la sexualité « féminine » (1971) et « masculine » (1981) approfondissent cette petite révolution [La sexualité des femmes]. Les apports de la sexologie sont récupérés dans une approche marchande-spectaculaire, avec une vente de best-sellers de conseils sexologiques, une multiplication des pages « sexualité » dans la presse patriarcale (qu’elle soit « féminine » ou « masculine »), des consultations thérapeutiques assez rémunératrices, etc. Mais elle pose également des problèmes en elle-même, car lorsqu’elle « diffuse auprès d’un vaste public des connaissances sur l’anatomie génitale, la physiologie du coït, les techniques de la jouissance », cela a une « puissance normative indéniable » (p. 50) : la sexualité génitale, coïtale, pénétrative reste l’horizon indépassable des relations sexuelles, et le « devoir d’orgasme » « fait peser une double contrainte : sur la femme, sommée de l’expérimenter sous peine d’être taxée de frigidité, et sur l’homme, sommé de le procurer à sa partenaire » (p. 50). Il y a effectivement du progrès par rapport à une sexualité victorienne exclusivement reproductrice, ou l’idéal du 19ème siècle d’un « coït bref et vigoureux » (p. 51). Mais cet impératif de performance orgasmique, c’est-à-dire en réalité de performance génitale (l’épanouissement sexuel s’étant éloigné dans une représentation pornographique, dirait Debord), a eu comme conséquence, du côté des hommes, d’avoir une importante pression à être un étalon puissant, endurant, techniquement doué (imitation des acteurs pornographiques, pas forcément gage d’un plaisir « féminin » supérieur), et du côté des femmes, une soumission aux codes pornographiques (nouvel étalon du plaisir « masculin » et soi-disant « féminin ») et un recours accru à la simulation bruyante. L’impératif de performance sexuel n’a pas abouti à un véritable épanouissement sur ce terrain-là, mais plutôt à une reproduction plus ou moins maladroite des normes issues de l’industrie pornographique.
L’industrie pornographique va également promouvoir des pénis surdimensionnés, exacerbant le « complexe du micropénis » (p. 52) chez de nombreux hommes, angoisse qu’est incapable de calmer la médecine et à laquelle elle ne répond qu’avec « des traitements hormonaux ou chirurgicaux ». L’industrie pornographique promeut également un allongement démesuré des relations sexuelles, non pas des dites « préliminaires » (allongement salutaire par rapport aux normes du 19ème siècle, lesquelles ne lui accordaient qu’une place assez exiguë) qu’elle passe très rapidement (au moins au regard du plaisir « féminin »), mais de l’acte génital lui-même (p. 52). La sexologie promeut une relation davantage épanouissante, avec des longues préliminaires, et orientée vers l’orgasme simultané, mais sans qu’il y ait de remise en cause du patriarcat sexuel (p. 52). Toutefois, « l’impératif de plaisir », « l’importance de procurer du plaisir à sa partenaire », est valorisé, même s’il y a toujours une distribution patriarcale des rôles (« mâle entreprenant »). L’insatisfaction sexuelle des femmes est publiquement dénoncée au cours des années 1970, le caractère massif de la simulation publiquement exposé. Les femmes réclament désormais un « droit à l’orgasme » et « refusent désormais de « subir » sans contrepartie » (p. 54). La « libération sexuelle » des années 1970 a en effet été davantage une idéologie spectaculaire qu’une réalité (même s’il y a eu un épanouissement sexuel supérieur aux décennies précédentes), surtout du côté des femmes qui l’ont parfois vécu comme une contrainte « à baiser » (tandis que certains hommes se sont plaints d’une fausse promesse particulièrement frustrante).
En dépit de Kinsey, Masters and Johnson, et surtout Hite, l’idée de l’existence d’un « orgasme vaginal » et sa supériorité vis-à-vis de « l’orgasme clitoridien » perdure : « Rien n’y fait, la distinction résiste et fascine : il n’est de véritable orgasme que vaginal, obtenu par un coït classique – la pénétration. Le battage médiatique autour du fameux point G, zone érogène vaginale supposée à fort potentiel orgasmique, au début des années 1980, réactualise d’ailleurs cette hiérarchie. On a beaucoup insisté [à raison] sur l’inquiétude et la frustration nées de la quête obsessionnelle des femmes du seul « véritable orgasme ». Mais il faudrait réfléchir au poids que pourrait faire peser cette quête sur la définition de la virilité : serait viril celui qui parviendrait à procurer à sa partenaire, par la pénétration, l’orgasme orthodoxe […]. Le serait moins celui qui ne provoquerait qu’un orgasme […] relevant en quelques sorte d’éternels préliminaires » (p. 55). Il n’est d’ailleurs guère innocent qu’on parle de « préliminaires » pour désigner tout ce qui n’est pas d’un ordre génital : c’est dévaloriser toute sexualité non-génitale, ravaler celle-ci au rang de préparatifs, et survaloriser la sexualité génitale, phallocentrée, coïtale, pénétrative – et, en dernière instance, reproductive, « hétéro-normative », patriarcale.
S’ensuit alors une partie consacrée aux techniques de restauration de la virilité. Techniques de « fortification », d’abord : pommades réfrigérantes du 19ème siècle, transfusions sanguines, hormones, anesthésiques, tonifiants chimiques ou biologiques, gymnastique, musculation, yoga, masturbation même… (pp. 56-59). Mais également techniques « prothétiques » : greffes de testicules d’animaux ou d’êtres humains (inefficaces), erectors et autres congestors (avec des effets secondaires désagréables semble-t-il), prothèses, ou allongement chirurgical du pénis (souvent résultat d’une norme oppressive) [pp. 60-67]. Enfin, le Viagra est devenu omniprésent depuis une quinzaine d’années, au prix d’une médicalisation de la sexualité (« En offrant une solution simple à un problème honteux et complexe, a-t-on abaissé les seuils de tolérance et créé une maladie ? « En l’absence de traitement, on n’a pas de maladie », reconnaît Irwin Goldstein, un des membres du groupe de Boston [p. 69]) et du retour d’un phallocentrisme réducteur (p. 70).
Virilités inquiètes, virilités violentes
Fabrice Virgili commence son article en faisant référence aux féminicides de Bertrand Cantat et du rugbyman Cécillon, en disant qu’aujourd’hui il y aurait consensus pour condamner ces violences masculines dirigées contre des femmes. Le problème est qu’une condamnation affichée n’équivaut pas à une lutte contre ces violences [NQF], loin de là. Quoiqu’il en soit, il s’agit dans cet article d’une étude des violences masculines durant l’époque où celles-ci étaient considérées comme « privées » et non comme politiques (grâce au mouvement féministe) : par exemple, « comment des relations sexuelles imposées dans le cadre du mariage ont-elles pu être perçues comme une agression quand beaucoup [d’hommes surtout] les considéraient comme une forme du devoir conjugal ? »
Malgré une diminution des violences quotidiennes de 1789 au début du 20ème siècle, « ce changement, aussi profond fût-il, ne signifiait nullement la disparition d’un usage masculin de la violence […] Un homme, pourtant meurtrier de sa femme, déclarait en 1962 : « Je ne l’ai pas frappée plus qu’à l’ordinaire ! » Pour cet homme, la question de la légitimité ne se posait pas et il paraissait simplement surpris des conséquences de son comportement « ordinaire » » (p. 73). Les archives ne font apparaître que ces cas extrêmes de violence conjugale, et elles tendent à une accréditation du « mythe de l’homme violent ressemblant à un monstre, un salaud, un fou – ce qui est en réalité l’exception […] En offrant des explications individualisantes, psychologiques sur l’homme violent, le mythe occulte pour la femme sa situation d’être dominée en l’empêchant d’accéder à un statut de sujet ou de se révolter » (Daniel Welzer-Lang, cité, p. 73). Pourtant, si « l’exagération » est révélatrice d’une tendance structurelle, comme l’affirment Adorno et son compère Horkheimer, alors c’est qu’il y a une tendance de fond. En effet, « l’essentiel des droits politiques, sociaux, familiaux demeurait l’apanage des hommes [au début du 20ème siècle]. Aussi revenait-il aux hommes de préserver ce déséquilibre, d’éviter que « leurs femmes » (mères, sœurs, épouses, filles) aient des comportements qui trouble l’ordre sexuel, donc l’ordre social [patriarcal]. C’était à chaque homme se s’assurer de la bonne conduite des femmes encore considérées, légalement comme intellectuellement, comme irresponsables. Ainsi, au même titre que l’éducation d’un enfant justifiait une correction, celle-ci s’imposait parfois pour « tenir » sa femme » (p. 74). Mais cela est dit de manière encore trop patriarcale : la violence sert en dernière instance au maintien de l’ordre patriarcal, puisqu’il s’agit de garder sa femme « avec un gant de fer », comme dit l’adage patriarcal. La guerre de 1914-1918, avec ses modes de La Garçonne, ébranle l’ordre symbolique patriarcal, d’où un renforcement de certaines législations (anti-avortement, notamment). Le mâle est posé comme un jaloux propriétaire de marchandises dont il devrait seul avoir l’usufruit, d’où une punition féroce de l’adultère féminin (p. 76). D’autre part, « l’usage de la force, les coups, la peur permettent au mari d’empêcher d’emblée ou d’interrompre la réciprocité de la dispute », notamment au sujet de l’alcoolisme. Cette violence sert également de rappel aux « ménagères » que si elles règnent sur leur logis, c’est uniquement comme intendante du patriarche. D’autre part, elle sert à un maintien des femmes uniquement dans l’espace domestique, lequel devient une prison, un lieu de réclusion, où il n’y a pas de droit de visite libre de la prisonnière : « L’isolement devient la garantie d’un pouvoir absolu, d’une sexualité exclusive comme dans un harem monogame » (p. 78). Le discours au sujet du « pauvre homme » ivre battant sa femme a notamment pour fonction d’exonérer celle-ci de sa responsabilité (p. 79). Après un long tableau des violences conjugales, qu’on trouve insuffisamment critique, on passe à une sous-partie intitulée « La rupture interdite ». « La séparation constitue la principale solution pour mettre un terme aux violences subies » (p. 86), mais cette séparation peut être interdite de facto, et cette interdiction peut mener au féminicide (et non au « crime passionnel », concept patriarcal) : « Médecins, juristes et criminologues s’accordent […] pour souligner le caractère très majoritairement masculin des meurtriers et féminins des victimes. En 1947, Daniel Lagache cite une statistique […] à partir de 122 condamnés pour jalousie homicide : 75 % des victimes sont des femmes, épouses, maîtresses ou concubines contre 15 % des hommes […]. En 2008, une étude du ministère de l’Intérieur recensait 156 femmes sur les 184 personnes décédées victimes de leur partenaire ou ex-partenaires. Tout au long du siècle, les crimes se ressemblent quand un homme veut empêcher le départ de sa femme. » (pp. 87-88). Cette violence témoigne du fait qu’un mâle se considère comme propriétaire sexuel de sa compagne, et qu’il peut en disposer comme bon lui semble. Si elle lui échappe, la violence va d’ « une gifle reçue d’un mari excédée et la décapitation et le découpage d’une homme dont les différents membres sont retrouvés aux abords ou dans le canal Saint-Martin en février 1944 » (p. 88) : « Ces gestes sont d’abord des coups, de poing ou de pied, mais aussi le lancement d’objets divers au visage, le contenu d’un verre, de la vaisselle, une bouteille, puis un fer à repasser ou l’escabeau […]. Dans d’autres cas, l’homme frappe sa compagne à l’aide d’un couteau […] Cela peut également être l’usage de ce que le criminologue Gustave Macé surnomme au début du siècle le « poignard liquide », le vitriol » (pp. 88-89). Le vitriolage des femmes en France n’a donc pas commencé au sein des « banlieues » peuplées « d’immigrés », mais avant.
Par ailleurs, « au milieu du 20ème siècle, la violence masculine sortit des domiciles […] pour s’exercer massivement, avec la participation d’une grande partie de la population française, à l’encontre de femmes à qui l’on reprochait d’avoir collaboré avec l’occupant allemand. Partout en France, près de vingt mille femmes furent tondues […]. On s’en prit donc, dans le cadre de l’épuration, de manière spécifique aux femmes […]. La France devait redevenir […] virile. Il s’agissait donc de dire aux Françaises, au moment même où elles votaient pour la première fois, que tout en accédant à la citoyenneté politique, leur corps demeurait sous contrôle masculin. » (p. 90).
S’il y a bien des « défenses et ripostes féminines », celles-ci restent individuelles ou du fait d’une solidarité de voisinage avant les années 60-70, date de renouveau du mouvement féministe. Celle-ci s’attaque à « la quasi-impunité du viol », et ses « condamnations […] rarissimes » (p. 92). « Le viol est un crime » : voilà un des principaux slogans du mouvement féministe suite au procès de Bobigny de 1972. Le viol n’est d’ailleurs plus défini comme quelque chose d’exceptionnel, mais comme « un acte de violence et d’autorité [commis] par des hommes normaux » (Benoîte Groult), comme « la manifestation sexuelle de la domination masculine » (p. 93). Le procès d’Aix de 1978 est l’occasion d’une attaque en règle du traitement judiciaire des affaires de viols : « correctionnalisation, huis clos prononcé à la demande des accusés, suspicion de consentement vis-à-vis des victimes » (il faut dire qu’une majorité des magistrats sont des hommes, non-féministes de surcroît). Corinne Briche écrit ainsi : « Toutes les agressions sexuelles supposent un type de rapport de domination homme/femme symptomatique […]. Consciemment ou inconsciemment, un certain nombre de valeurs masculines a, en fait, justifié le viol par la « naturelle virilité agressive » [qu’on retrouve chez Zemmour dans Le premier sexe ou chez Soral dans Sociologie du dragueur] de l’homme et la « passivité masochiste » de la femme » (p. 93). Le viol sera redéfini sous pression féministe en 1980 comme « tout acte de pénétration [contraint] de quelque nature que ce soit », mais c’est seulement en 1992 que fut supprimée « l’ancienne distinction entre coït licite et illicite », ouvrant la voie « à la poursuite du viol conjugal (arrêt du 11 juin 1992 » (p. 93). Mais en réalité, seule une infime minorité des viols est déclarée et fait l’objet d’une condamnation, encore aujourd’hui [NQF]. Le harcèlement sexuel (dont 100 % des femmes auraient fait l’expérience au sein des transports en commun) est davantage reconnu-pénalisé, mais il reste un phénomène massif. La « torture psychologique » est également reconnue, aux côtés des violences de nature physique, mais elle demeure un phénomène massif [La domination masculine]. Finalement, au moins une femme sur dix est victime de violences conjugales chaque année en France, plus d’une centaine est morte sous les coups de son conjoint, et au moins 75 000 victimes d’un viol (p. 96). Les viols collectifs ou « tournantes », en revanche, n’ont guère de nouveauté, ceux-ci venant remplacer ceux des « blousons noirs » des années 1960 (p. 97).
Par ailleurs, on constate un renouveau des imaginaires sadiques-masochistes érotisant la domination, promouvant « l’image d’une virilité brutale et dominatrice et celle d’une féminité dont l’épanouissement passerait par la sujétion au mâle » (p. 97) [A quoi rêvent les jeunes filles] Est-ce qu’on n’aurait pas même affaire « à une recrudescence de violence masculine, un « backlash brutal » » des masculinistes, en réaction aux coups de boutoir aux privilèges masculins ? C’est probable, et du coup il faut être d’autant plus vigilant à ces comportements au sein du milieu militant que ce backlash réactif est susceptible de s’emparer de tout homme soucieux avant tout de ses privilèges et de son identité de dominant.
La virilité au miroir des femmes
Faire « l’histoire de la critique féministe de la virilité » : voilà l’ambition de l’article de Christine Bard. « À partir des années 1960, les mythes de la féminité mais aussi de la virilité explosent. Le miroir renvoie alors aux hommes une image difficile à accepter de la – de leur – virilité : mortifère, belliciste, criminelle, mutilante… Pour les féministes, la virilité coïncide désormais avec un comportement sexiste ; elle exprime la domination masculine » (pp. 101-102). Les femmes avaient pourtant (et ont toujours [La domination masculine]) comme fonction du point de vue du patriarcat d’être des miroirs grossissants, des miroirs renvoyant une image agrandie du patriarche : les miroirs, comme l’explique Virginia Woolf, sont « indispensables à qui veut agir avec violence ou héroïsme. C’est pourquoi Napoléon et Mussolini insistent tous deux avant tant de force sur l’infériorité des femmes ; car si elles n’étaient pas inférieurs, elles cesseraient d’être des miroirs grossissants » (cité, p. 102). Leni Riefenstahl et son film Le Triomphe de la volonté (1934) est ainsi un miroir grossissant du Führer (p. 104), lequel défend un modèle viril : « L’Etat racial [völkisch] [doit être] l’incarnation arrogante de la force virile et des femmes [Weiber] capables de mettre au monde de vrais hommes » (cité, p. 105). Ainsi, « les nazis ont toujours besoin de femmes qui leur tendant le miroir. […] Weib (« femelle ») plutôt que Frau, c’est-à-dire reproductrices, gardiennes de la pureté du sang, mères de quatre garçons de préférence. « La récompense que le national-socialisme offre aux femmes, en échange de leur travail, est qu’il élève de nouveau des hommes […] » déclare Hitler en 1935 […]. Le parti national-socialiste se veut un männerbund, un ordre masculin, uni « par la camaraderie virile de la guerre, des corps francs et des brasseries ». En 1921, les femmes en sont exclues. L’encyclopédie des personnalités du Troisième Reich ne signale que des hommes. Le nazisme est, « par nature, un mouvement masculin » (Joseph Goebbels). » (p. 105). Ici, difficile de ne pas penser au discours d’Alain Soral au sujet des femmes et du virilisme… Quoiqu’il en soit, « le soutien féminin au nazisme est pour une part le résultat de la « nationalisation des femmes » durant la Première Guerre mondiale. […] En Allemagne se développement un « national-féminisme », accommodant avec le nouveau régime, pourtant violemment antiféministe puisqu’il demande aux femmes de « s’émanciper de l’émancipation », cette « invention juive ». En 1933, les électrices sont aussi nombreuses que les électeurs à voter pour le parti. » (p. 106). Le nationalisme s’empare des femmes, l’antisémitisme également (alors même qu’antisémitisme et antiféminisme vont souvent de pair), et même l’anti-féminisme : comment l’expliquer ? L’idéologie patriarcale traverse l’ensemble du corps social, jusqu’aux femmes, lesquelles sont de toute façon sommées de choisir entre leur rôle « traditionnel » d’épouse et de mère ou une fantasmatique « prostitution universelle » (en cas de révolution sociale). En tout cas, « les organisations féminines nazies compteront jusqu’à douze millions de membres, de 6 à 60 ans. […] Du point de vue des nazis, la mobilisation féminine est une réussite. La valorisation du travail traditionnellement invisible de la maternité et les tâches domestiques donnent une forme de reconnaissance dans une fonction sociale bien identifiée. La complémentarité des sphères – référence idéologie, par exemple pour Alfred Rosenberg qui voit l’homme comme l’architecte du macrocosme et la femme comme la préservatrice du microcosme – veut que la femme reste dans la famille et que l’homme déploie son activité partout ailleurs. Mais la femme n’échappe pas à l’État, puisqu’elle est la base dans le système nazi. Et des femmes participent aux entreprises criminelles nazies. Elles sont par exemple 10 % à travailler à la surveillance des camps. [D]es femmes appartiennent à la SS » (pp. 106-107). Les femmes peuvent donc s’associer à des régimes politiques ultra-patriarcaux et génocidaires, du fait de l’idéologie patriarcale qui leur offre l’alternative entre leur rôle « traditionnel » et une fantasmée « prostitution universelle » en cas de révolution sociale (condamnée d’avance au sein des Manuscrits de 1844 du jeune Marx).
« Le fascisme et le franquisme font aussi triompher la virilité avec un soutien important des femmes. […] En Espagne […] il faut souligner l’influence des prêtres dans la construction d’un discours viril national : Dieu a voulu punir les femmes du péché originel, c’est pourquoi il leur a infligé la douleur dans la maternité et la soumission à l’autorité masculine. Le clergé enseigne aux jeunes, en 1943, que « la femme étant formée d’une partie de l’homme, la suprématie du droit et la force de l’autorité reviennent à celui-ci. […]. La femme a été faite pour aimer, l’homme a été fait pour commander » […] Le meurtre de l’épouse infidèle est, dans l’Espagne franquiste, couvert par l’impunité. » (p. 107). Pire, « l’antiféministe s’appuie sur des idéologues [femmes] […] L’Italienne Gina Lombroso brille par son influence dans le monde catholique. Elle distingue deux types de femmes : l’épouse-mère-ménagère, « altérocentriste », et la féministe promise au malheur » (p. 108).
Simone de Beauvoir n’est, selon l’auteure, pas hostile à une certaine forme de virilité, celle consistant dans une recherche de maîtrise rationnelle du monde ; pour autant, elle défend un point de vue constructiviste, et critique Freud et son point de vue androcentrique-phallocentrique (p. 111). Les femmes peuvent devenir des sujets autonomes à l’instar des hommes, une fois qu’elles auront cessé d’être l’Autre du Sujet (masculin). Mais cela requiert une subversion du patriarcat comme système, et non une simple attitude « existentialiste » [Scholz].
Malgré une idéologie patriarcale inculquée aux femmes, au point que Sylvia Plath écrit dans Daddy qu’ « Every woman adores a Fascist », le virilisme est violemment rejeté à partir des années 1960-70, notamment son versant militaire : une majorité de féministes condamnent avant tout une socialisation brutale des hommes, au travers des jeux guerriers et du service militaire (p. 112). Certaines féministes continuent d’expliquer cependant l’agressivité des hommes de manière biologisante (trop de testostérone), alors même qu’il faudrait davantage prendre en compte sa construction sociale. Le patriarcat donne aux hommes un monopole de la violence « légitime », et ce monopole aboutit assez logiquement au viol, même « ordinaire », lequel est souvent commis par un proche et non un dangereux pervers d’origine étrangère. La « castration chimique » n’est pas une solution à une violence systémique.
Des féministes vont critiquer l’androcentrisme d’une majorité des promoteurs de la « libération sexuelle » : Kate Millett affirme qu’il faut que les femmes mènent leur propre « libération sexuelle » et non une libération phallocentrique au service des hommes (en mode « harem gauchiste »), tandis qu’Alice Schwarzer dans La Petite Différence et ses Grandes Conséquences préconise aux femmes de prendre en main de manière autonome leur sexualité au travers de groupe de self-help (p. 115), et remet en cause une hétéronormativité interdisant aux femmes de se défendre vis-à-vis du patriarcat en refusant de rentrer dans son jeu sexuel (« lesbianisme radical »). Luce Irigaray, psychanalyste, affirme elle « une jouissance […] non localisée, tout le corps devenant sexe », au contraire du phallocentrisme des hommes : mais on pourrait lui objecter qu’il s’agit-là d’une affirmation différencialiste-naturaliste, que cet érotisme polycentrique ne provient pas d’une « nature féminine » mais d’une certaine socialisation sexuelle.
Des groupes d’hommes se forment au cours des années 60-70 sur ces problématiques, « mais ils ne vont pas durer », sans doute parce qu’il y un reflux de la révolution féministe et qu’ils ne sont pas incités à une remise en cause radicale des privilèges masculins. En réaction, Valerie Solanas dans SCUM Manifesto vire à une certaine androphobie, mais de manière ironique, en inversant l’idéologie patriarcale : « Ce petit traité parodique du sexisme considère la virilité comme une « déficience organique » : le gène Y (mâle) n’est qu’un gène X (femelle) incomplet. L’homme ? « Une femme manquée », « une mécanique », « un godemiché ambulant ». De nature passive, il cherche à masquer son vrai désir : être une femme » (p. 117). Androphobie, peut-être si elle est au premier degré, mais cette inversion permet de faire comprendre aux hommes ce qu’est l’idéologie patriarcale du point de vue des dominées, à l’instar de Martin, sexe faible aujourd’hui.
La pornographie est également l’objet d’un vif débat. Si elle est d’abord perçu comme une libération de l’ordre moral, elle vire vite à un « culte religieux du phallus » (Luce Irigaray), et devient un support privilégié des « rêves mégalosexistes » (Benoîte Groult) : une mise-en-spectacle du néo-patriarcat sexuel (après la « libération sexuelle » phallocentrée). La pornographie mainstream est clairement patriarcale, phallocentrée, réifiante, machinique, souvent violente, etc., mais faut-il l’interdire, comme pensent Andrea Dworkin (Pornographe. Men Possessing Women) et Catharine MacKinnon, ou plutôt promouvoir une « pornographie féministe » (Gayle Rubin, Judith Butler) ? C’est ce débat qu’on appelle « Sex Wars » aux États-Unis, et dont nous discuterons dans une prochaine émission.
« Montréal, 6 décembre 1989, Marc Lépine entre dans une classe de Polytechnique, sépare les hommes des femmes, et tire sur les étudiantes en éructant : « Vous êtes des féministes » ; « Vous n’avez pas d’affaire ici » (ce haut lieu du savoir masculin n’est pas pour vous). Quatorze étudiants sont tuées. […] On trouvera sur son cadavre une liste de personnalités féministes à abattre. Aucun doute n’est permis : le crime a un caractère sexiste avéré. Il est même explicitement antiféministe, ce qui est plus rare. Dans les médias, c’est pourtant la thèse de la folie individuelle qui l’emporte. Quand l’antiféministe est pris en compte, c’est pour signaler le désarroi des hommes qui voient le monde ancien s’écrouler avec la « révolution féministe », ou pour accuser les féministes de récupérer à leur profit la tragédie.
Les féministes québécoises entreprennent alors un travail réflexif sur la masculinité. Un collectif masculin contre le sexisme est créé. Le diagnostic peut être partagé, même si le Québec a pour particularité d’avoir connu des changements très accélérés dans les années 1960-1970, réglant des comptes avec une écrasante tradition catholique, et développant un mouvement féministe vigoureux. » (p. 119). On visionnera La domination masculine à ce sujet.
Toutefois, « le geste de Marc Lépine doit être contextualisé. Au tournant des années 1990, les mouvements dits masculinistes se développent. […] L’argumentaire tient du miroir inversé : les hommes sont victimes de violences conjugales, battus, à la recherche d’une fierté identitaire. […] Le masculinisme est aussi un « musculinisme » qui voue un culte aux superhéros, « supergéniteurs », « superpuissants » […]. Les masculinistes rejettent bien sûr toute effémination chez l’homme. Ils traitent de « pisse-assis » les milieux antisexistes et rejettent les études sur le genre. Ils rebaptisent les féministes « féminazies » ou « féminisexistes », et les rendent responsables des fausses accusations de viol ou de pédophilie, […] ainsi que de l’augmentation du taux de suicide masculin » (pp. 119-120). Le masculinisme est-il une réaction légitime ? C’est une tentative stratégique de renversement des victimes et des bourreaux : s’il y a effectivement quelques violences faites par des femmes sur des hommes [NQF], l’inverse est largement supérieur. Les dominants, au lieu de remettre en cause leur domination, se font passer pour des victimes d’une fantasmatique « domination féminine » : fruit généralement d’une défense psychologique de son statut de mâle dominant, ce masculinisme est un sexisme exacerbé, un antiféminisme et un conservatisme réactionnaire, et constitue une version du « white power » suprématiste-raciste transposée au terrain des rapports patriarcaux. S’il ne s’agit évidemment pas de promouvoir une inversion des dominants (hommes) et des dominé-e-s (femmes), il s’agit néanmoins de promouvoir une égalité réelle, une abolition du patriarcat, et donc une remise en cause des privilèges masculins, même si cela peut avoir un coût psychologique – d’un autre côté, pensons au coût psychologique d’être une femme dans une société patriarcale…
« Le masculinisme émerge au moment où la féministe américaine Susan Faludi diagnostique dans Backlash (1991) une revanche, après les victoires féministes des années 1970 […]. C’est un tournant politique dans plusieurs pays où arrivent au pouvoir des forces très conservatrices. La situation sociale, difficile, crée une insécurité économique grandissante […] [et] les femmes, soi-disant triomphantes, servent alors de bouc émissaire, comme dans les années 1930 » (pp. 120-121). Le masculinisme d’un Jean-Marie Le Pen ou d’un actuel député européen FN va jusqu’à promouvoir un retour au foyer des femmes comme solution au chômage et à la crise, de manière symétrique au renvoi des « immigrés » chez eux.
La critique de « l’hétérosexisme » et de la « pensée straight » (Monique Wittig) implique également une crise du « sujet femme » comme collectif unitaire du mouvement féministe, dénoncé comme « standpoint mystificateur qui unifie arbitrairement l’infinie diversité des perceptions, généralement au profit d’un point de vue particulier supposé refléter la position des femmes blanches, hétérosexuelles, diplômées des classes moyennes, valides et plus ou moins puritaines, idéologiquement timorées, ré-essentialisant le genre, remplaçant simplement le mot « sexe », devenue politiquement incorrect » (p. 122). Le débat n’est toujours pas fini, et s’il faut être critique vis-à-vis du « vieux féminisme », il ne faut pas casser l’unité (nécessairement critique, partiellement contradictoire, etc.) des dominées du patriarcat.
L’article enchaîne au sujet des femmes « viriles », ayant adopté depuis des siècles « un genre masculin, allant parfois jusqu’à prendre l’identité masculine, ce qui leur permet de se marier, d’obtenir du travail, des gains plus importants, de voyager au loin, de combattre dans l’armée avec un bel uniforme… […] Transfuges de classe en quelque sorte, elles s’élèvent dans la société en se faisant hommes. Elles sont sans doute mieux comprises que les hommes qui font le trajet inverse […] Certaines femmes habillées en hommes atteignent un haut degré de respectabilité, de préférence post mortem. C’est le cas de Jeanne d’Arc, […] preuve durable de la possible dissociation de la masculinité et de la virilité » (p. 123). Certes, mais ces trajectoires demeurent exceptionnelles, et si elles constituent des brèches dans l’ordre patriarcal, elles demeurent l’exception qui confirme la règle, au point que Jeanne d’Arc soit devenu un symbole de l’extrême-droite ultra-patriarcale en France. De plus, cette « virilisation » idéologique-professionnelle des femmes se fait souvent en contexte de guerre, donc exceptionnel, même si elle a permis des avancées notables et qu’elle a donné naissance à cette célèbre iconographie du « We can do it ». À un niveau davantage individuel, la « virilité » de certaines femmes est d’abord psychiatrisée (parfois pathologisée) et pensée comme une inversion (« du désir, qui se tourne vers les femmes, […] physique, avec la présence de caractères sexuels secondaires masculins, et […] psychologique, remarquable dans le tempérament actif »). Ces théories peuvent rendre visible l’invisible, le lesbianisme notamment dans Le Puits de solitude, même si son auteure, ayant adopté un genre masculin, admire Mussolini. Ainsi et de manière paradoxale, au 20ème siècle, « le respect des codes de genre est de rigueur dans les lieux de rencontre dédiés [aux lesbiennes]. Au Québec, dans les années 1950-1960, il est d’ailleurs très mal vu qu’une lesbienne ne soit ni butch ni « fem » » (p. 126). L’emprise du genre est ainsi reconduite même au sein des milieux lesbiens, avec l’alternative entre des lesbiennes virilisées (« butch » et leur attitude de camionneuse) et des lesbiennes féminisées (« fem »), sans dépassement du genre finalement – et une multiplication des gens n’y remédiera pas, puisqu’il s’agit toujours de se conformer à des modèles. S’en suit une description du mouvement queer, son intérêt (faire une critique du binarisme contraint de genre, refuser d’être « féminin » ou « viril », subvertir l’équation « mâle/femelle biologique » = « masculin/féminin », refuser qu’un changement de genre nécessite une chirurgie de réassignation sexuelle, naissance de nouveaux genres comme « butch »…) et ses limites (au lieu d’une lutte tournée vers l’abolition du système patriarcal de genre [Delphy], une démarche individualisante de redéfinition de soi en adoptant un nouveau modèle de genre – au lieu d’aller au-delà de tout modèle de genre –, un retour du biologique et de la misogynie avec une fascination pour la prise de testostérone et le virilisme…) [pp. 127-130]. Malgré une moindre « féminisation » des femmes depuis une quarantaine d’années (et même depuis « La Garçonne » des années 1920), celle-ci reste mal perçue : « cheveux courts […] qui font mauvais genre » (p. 132), retour du corset et des bas, jugement négatif des femmes « masculines » (il faut « rester femme »), lesbiennes voulant rester « féminines » parce qu’elles « pensent que cela améliore l’image des lesbiennes » (p. 133), multiplication des actes homophobes, lesbophobes, transphobes… « Le succès d’essais tels que Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus » (p. 133) relativise l’influence du féminisme, hélas.

Masculinités et virilités dans le monde anglophone
L’article de Christopher E. Forth commence par un rappel du fait que « l’étude critique des hommes et des masculinités se divise en deux grandes perspectives théoriques. […] Leur différence peut se décrire sous la forme d’une tension entre des « critiques matérialistes et poststructuralistes […] ». Les tenants du point de vue « matérialiste » dégagent des fondements sociaux et institutionnels plus ou moins stables sur lesquels repose la production des normes masculines, alors que ceux qui adoptent une position « poststructuraliste » s’attachent à déceler les ambigüités, les instabilités et les contradictions dans la formulation de telles normes » (p. 136). Ici, nous nous inscrivons essentiellement dans une théorie matérialiste, mais critique du matérialisme classique, et en reprenant quelques apports des études poststructuralistes (lesquelles ont néanmoins, à nos yeux, un paradigme complètement défaillant d’un point de vue analytique, puisqu’il fait fi des structures de domination concrètes pour ne s’intéresser qu’aux discours normatifs et aux écarts individuels vis-à-vis de ceux-ci). Quoiqu’il en soit, « les premières critiques de la domination masculine furent issues des théories résolument matérialistes du « patriarcat » […]. Le patriarcat [était] conçu comme l’expression transhistorique d’une contrainte fondamentalement mâle opérant à travers un ensemble de structures économiques, politiques et sociales » (p. 137). Le problème d’une telle approche, c’est que si l’on doit effectivement rappeler que le patriarcat n’est pas une création moderne succédant à des siècles heureux [Testart], il n’en prend pas moins des formes différentes au travers de l’histoire, si bien qu’il vaut mieux l’affubler d’un adjectif l’historicisant (« patriarcat romain », « patriarcat féodal », « patriarcat capitaliste », etc.). Le patriarcat est bien, quoiqu’il en soit, un système de domination concret, attribuant à une partie de l’humanité (« hommes ») un pouvoir d’exploitation (matériel, sexuel, etc.) d’une autre partie de l’humanité (« femmes »), au travers d’un asservissement domestique (variable historiquement). Ou plutôt, il est un système d’exploitation et de subordination d’une partie de l’humanité par une autre partie de l’humanité (Delphy), y compris au sein du capitalisme qui est consubstantiellement patriarcal (au point qu’il est impossible d’étudier l’un sans l’autre, et réciproquement).
Les féministes post-structuralistes trouvèrent que cette théorisation était réductrice, incapable de prendre en compte l’écart entre un modèle théorique structurel et une réalité davantage nuancée. Il est vrai qu’il n’est guère souhaitable de réduire « les hommes et la « masculinité » […] au simple fait de la domination masculine » (p. 137), il faut rappeler qu’il y a des brèches, des marges de manœuvre, des subversions, des (auto) critiques masculines, mais d’un autre côté il faut impérativement considérer qu’une structure de domination patriarcale existe. Le poststructuralisme vient nuancer l’approche matérialiste structurale, elle ne saurait s’y substituer raisonnablement, à moins de dissoudre l’objet même de la critique antipatriarcale. L’approche en termes de « genre » apporte néanmoins quelques éléments intéressants à une critique du patriarcat, et d’abord, l’idée que celui-ci était également nocif aux dominants masculins : « Le psychologue Joseph H. Peck argumentait ainsi que l’idéal du rôle sexué masculin était parfaitement illusoire, et exerçait une pression considérable » (p. 138). Sans tomber dans une victimisation des dominants, il faut rappeler qu’effectivement cette assignation au genre dominant n’est pas qu’un avantage (dans l’absolu). Toutefois, « mêmes les hommes pro-féministes qui se défendent d’exercer une masculinité hégémonique en restent « complices », car ils jouissent des avantages symboliques et matériels qu’elle procure, par le simple fait d’être des hommes dans un monde qui dévalue les femmes, ce que Connell nomme le « dividende patriarcal » » (p. 139). La déclaration d’être pro-féministe est en effet insuffisante, si l’on continue de jouir des avantages du système patriarcal ; déjà, renoncer à ses privilèges masculins au sein de l’espace domestique comme militant est un pas supplémentaire, même s’il faudra abolir le patriarcat comme système global pour en finir vraiment avec lui.
« Massivement employée dans les sciences humaines, l’idée de masculinité hégémonie permit une importante avancée dans l’analyse critique de la masculinité. À la différence de la notion de « patriarcat », elle offrait une perception plus nuancée de la gamme des manières concurrentes et hiérarchiquement ordonnées d’être un homme » (p. 139). Mais cela était une analyse encore trop structurelle pour nombre de chercheurs postmodernes sous l’influence de la French Theory (Foucault, Derrida, Lacan), qui succombèrent au « tournant linguistique ». Certes, il y eut des apports importants, l’idée notamment d’une construction discursive du « sexe » lui-même [Butler, Laqueur] et non seulement du « genre », mais ces « travaux, dépourvus de toute théorie concrète du social », font « comme si « le discours était le seul objet de l’analyse sociale » [Connell] » (p. 141). Le discours peut certes être une force matérielle, dans une relecture de Marx au-delà du dualisme infrastructure-superstructure et du dualisme économie-idéologie, mais une large part des rapports sociaux d’exploitation, d’oppression et de domination a son origine dans des processus concrets non-explicités.
L’article souligne également qu’on s’est souvent intéressé de manière privilégiée aux femmes lorsqu’il s’agissait de genre, comme s’il n’y avait pas de construction sociale de la masculinité et de la virilité. Une explication peut être que si de nombreuses chercheuses étaient engagées au sein du féminisme, peu de chercheurs étaient désireux de montrer leur propre construction sociale de dominants – avec l’exception notamment de Be a Man ! Males in Modern Society (1979) de Peter N. Stearns. L’article rappelle également que ce concept de genre a fait l’objet d’un certain soupçon au sein du féminisme matérialiste-marxiste, parce qu’il pourrait dissoudre l’oppression concrète des femmes au profit d’une lecture culturaliste. Christine Delphy prouve pourtant au contraire qu’on peut utiliser ce concept (plus commode que celui de « sexe social », lequel reste assez essentialiste) et rester dans une analyse structurelle du patriarcat : le « genre » devient alors un sous-produit d’une coupure hiérarchique de l’humanité en deux parties, le « sexe » n’étant alors qu’un marqueur de reconnaissance de cette division hiérarchique « genrée » de l’humanité [Delphy][1]. Plutôt que de « déconstruire » idéellement des discours considérés comme l’oppression elle-même, il vaudrait mieux « déconstruire » réellement des structures concrètes de domination sociale.
Ainsi, « cette prolifération d’études historiques de la masculinité a ses détracteurs. Des critiques féministes expriment de façon insistante leur insatisfaction face à une telle explosion d’intérêt pour le genre : beaucoup d’entre elles y voient une destruction du socle sur lequel se dresse le féminisme politique. Selon leur point de vue, l’étude des masculinités menace d’émousser le tranchant politique du féminisme en « sous-estimant le pouvoir des hommes sur les femmes ». C’est pourquoi John Tosh a appelé de nouveau les historiens à adopter la notion de masculinité hégémonique, et affirmé que « l’absence virtuelle du « patriarcat » dans le vocabulaire actuel des chercheurs indique un éloignement préoccupant des inégalités entre hommes et femmes, profondément enracinées et tenaces, qui étaient bien présentes dans les recherches des années 1970 et 1980 » » (pp. 148-149). Certes, il ne faudrait surtout pas retomber dans un essentialisme binaire, mais il faut cesser de considérer « les genres » comme des simples « constructions linguistiques » en décalage avec une réalité complexe, mais plutôt comme des structures de domination concrètes, socio-historiquement construites, et qu’il s’agit d’abolir plutôt que de chercher individuelle à en jouer.
« En dépit de leurs différences, les points de vue matérialiste et poststructuralistes s’accordent à considérer que les masculinités doivent être traitées comme des constructions fondamentalement relationnelles » (p. 149) : il n’y a pas d’essence « masculine » ou « féminine », mais il s’agit de deux pôles dialectiquement liés (définis selon des oppositions binaires : force/faiblesse, violence/douceur, égoïsme/altruisme, etc.) d’une construction socio-historique liée à un système de domination sociale, le patriarcat. Dès lors, « la tentative d’atteindre une masculinité « pure » dépend d’une « renonciation perpétuelle à la « féminité » » [Lynne Segal] », c’est-à-dire aux qualités assignées socio-historiquement comme « féminines » : « « la capacité à être sensible à soi comme aux autres, à la tendresse et à l’empathie […] » (cité, p. 150). La construction sociale de la masculinité implique ainsi une (auto)mutilation, mutilation de qualités humaines comme l’empathie : « La production de la masculinité suppose ainsi un combat sur deux fronts afin de contenir, de marginaliser ou exclure le « féminin » à l’intérieur comme à l’extérieur » (p. 150). Ce dualisme, cette opposition binaire construite socio-historiquement, est également celui de « l’esprit » (assigné au « masculin », devant être un froid calculateur) et du « corps » (assigné au « féminin », devant être une douce ignorante), de la « culture », du « public » et de la « politique » d’une part (assignés au « masculin », catégorie dominante exempté du labeur domestique) et de la « nature », du « privé » et de l’incapacité politique de l’autre (assignés au « féminin », catégorie dominée, mineure politiquement, exploitée domestique).
L’article parle ensuite de Fantasmâlgories de Klaus Theweleit, exploration de la littérature pré-nazie des corps-francs des années 1920, où « le féminin » est un repoussoir absolu qu’il s’agit de détruire en soi-même (pp. 151-152), de même qu’il s’agit de traquer « l’effémination homosexuelle » – alors même que jusqu’alors, il suffisait d’avoir un rôle actif au sein des relations homosexuelles pour être préservé de cette accusation. L’Orient colonisé a lui-même été caractérisé comme « efféminé » [Saïd], notamment dans l’opposition entre « l’Anglais viril » et le « Bengali efféminé » (p. 154), à des fins de justification idéologie de l’impérialisme colonial. George L. Mosse, enfin, a montré comment l’idéologie viriliste « réclamait parallèlement l’identification d’un « contretype » » (p. 155) : juifs, homosexuels, etc. D’où, en réaction, un certain virilisme des colons israéliens et de l’armée israélienne.
Enfin, l’article parle des fréquents retours de l’angoisse d’une « effémination », d’une perte de masculinité et de virilité, qu’on retrouverait aux alentours des années 1780, 1850, 1890 (réaction nationaliste-viriliste assimilant la République à une « putain », à une « gueuse ») et des années 1930 (réaction fasciste face aux « libérales » années 20). Inquiétude concernant une transformation « libérale » de la « masculinité hégémonique », mais également à notre avis au sujet d’un possible affaiblissement de cette « masculinité hégémonique » : d’où l’actuel backlash masculiniste, viriliste, antiféministe aux États-Unis, au Québec et en France.
Conclusion provisoire
Malgré une diversité de problématiques abordées, cette première partie d’Histoire de la virilité. La virilité en crise ? Le XXème-XXIème siècle est intéressante, notamment « La virilité face à la médecine », « Virilités inquiètes, virilités violentes » et « La virilité au miroir des femmes ». Au sein des autres parties, « La fabrique de la virilité (deuxième partie) et « Exemples, modèles, antimodèles » (troisième partie), on recommandera vivement « On ne naît pas viril, on le devient », « Armées et guerres : une brèche au cœur du modèle viril ? », « Virilités sportives », « Virilités criminelles », « Virilité fasciste », « Virilité ouvrière », « Mutations homosexuelles » et « Virilités coloniales et post-coloniales ». Les deux parties feront l’objet de deux notes de lecture ultérieures. Elles nous permettront de conclure que s’il y a eu des brèches dans la domination patriarcale grâce aux luttes féministes et aux transformations sociales, celle-ci demeure, et qu’il serait précipité de parler de crise du patriarcat et du virilisme.
A. Paris
[1] « Le genre précède le sexe ; dans cette hypothèse, le sexe est simplement un marqueur de la division sociale ; il sert à reconnaître et identifier les dominants des dominés » (Christine Delphy, L’économie politique du patriarcat. 2. Penser le genre, Paris, Syllepse, 2013).
Vous aimerez aussi
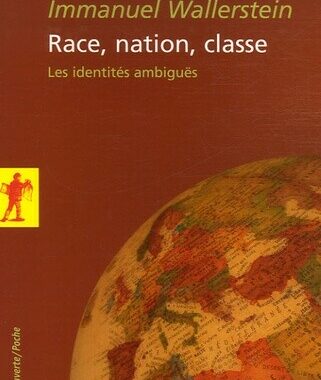
Étienne Balibar et Immanuel Wallerstein – Race, nation, classe
6 février 2017
Otto Rühle – La révolution n’est pas une affaire de parti
12 juillet 2017