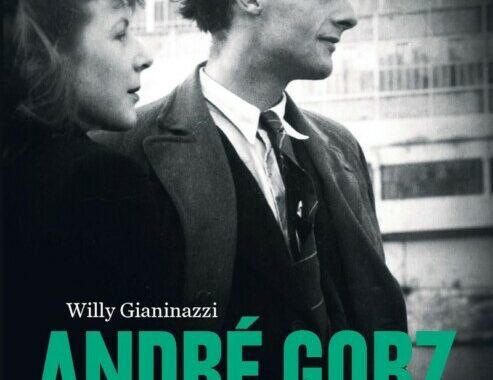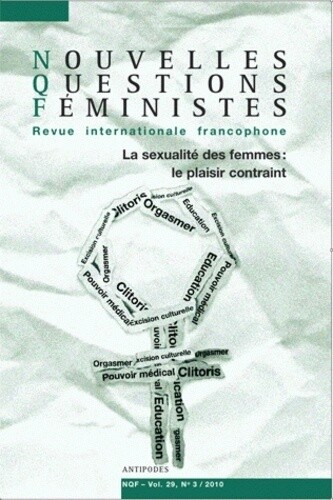
Nouvelles Questions Féministes – La sexualité des femmes : le plaisir contraint
Nouvelles Questions Féministes, La sexualité des femmes : le plaisir contraint, Vol. 29, n°3, 2010
Ce numéro de Nouvelles questions féministes, revue universitaire fondée entre autres par Simone de Beauvoir et Christine Delphy en 1981, questionne la construction sociale du plaisir féminin, partant du texte fondateur de Anne Koedt, Le mythe de l’orgasme vaginal, datant de 1968 et ainsi s’intéresse aux processus sociaux inhibant les aspirations et revendications sexuelles des femmes dans l’hétérosexualité.
La revue s’inscrit dans un courant féministe anti-essentialiste et radical et réfute donc les arguments biologiques et naturalistes comme explication de la subordination des femmes aux hommes. On pense donc « Femme » et « Homme » comme catégories sociales produites par des rapports de pouvoir issus d’un système genré et patriarcal, où la domination des femmes se fonde sur des pratiques matérielles, par exemple le travail domestique (Delphy)
Les auteures de l’éditorial rappellent l’importance des mouvements féministes comme levier de l’émancipation sexuelle des femmes, notamment sur le plan de la maitrise de la fécondité (Mouvement pour la planification familiale), de la lutte contre les violences sexuelles et de la correctionnalisation du viol (SOS Femme et Alternatives, Collectif féministe contre le viol), de la dénonciation du harcèlement sexuel des femmes dans l’espace public et au travail (publication en 1979 de Sexual Harassment of working women : A case of Sex Discrimination de Catharine McKinnon) ainsi que du « préjugé hétérosexuel inévitable » [Rich 1985] (émergence d’une parole de femmes homosexuelles au sein du mouvement de libération des femmes ; publication de La contrainte à l’hétérosexualité de Adrienne Rich).
Cependant, les avancées évoquées ci-dessus n’ont pas permis de rupture du lien établi entre un rapport sexuel « vrai ou accompli et l’objectif reproductif, ni entre sexualité et hétérosexualité » (p .6), on parle donc d’une « sexualité domestiquée » (Tabet) par la norme et la fécondité, au travers d’une propagande sexuelle selon laquelle la pénétration vaginale serait la pratique la plus épanouissante pour la femme et pour l’homme. (p. 7).
Malgré la légitimation de l’étude de la sexualité, celle-ci se limite aux dimensions biologiques et reproductives se cantonnant aux divers troubles et dysfonctions sexuels. L’apparition du VIH dans les années 1980 place l’étude de la sexualité dans les champs de la santé publique, et y affère des enjeux politiques et sociaux. En revanche les études d’analyse des rapports sociaux de sexe restent très peu développées. Les auteures de l’éditorial constatent l’absence d’études scientifiques portant sur le plaisir sexuel, « paru comme objet d’étude secondaire dans une perspective sanitaire » et donne l’hypothèse de la « prégnance d’une norme masculino-pénétrative » (p.8). Il n’est pas sans rappeler le fait que l’anatomie complète du clitoris date de 1998, soit la même année que la commercialisation du Viagra. La médecine sexuelle répondait donc déjà aux dysfonctions érectiles chez l’homme alors que l’organe du plaisir féminin restait inconnu. Il faudra attendre les années 2000 pour que la médecine s’y intéresse de plus prés[1].
De plus, les auteures rappellent l’insuffisance de l’aspect du « biologiquement fiable » en matière de plaisir sexuel, en insistant sur le caractère social de la sexualité, qui « nécessite comme toute pratique sociale, un apprentissage » (p.8), où les circonstances du plaisir souhaitable sont définies par les sociétés, et donc défavorables aux femmes, là où cette construction sociale de la sexualité des femmes « nie leurs expériences et leurs attentes » (p.8). La réflexion sexuelle féminine est ensuite mise en avant par les auteures comme émancipation par la parution de The Hite Report de Shere Hite en 1977, résultats d’un questionnaire sur la masturbation et le plaisir féminin. On y révélait les difficultés de certaines femmes à avoir du plaisir par la pénétration vaginale, mais également que la majorité des femmes stimulaient leurs clitoris pour se procurer du plaisir. The Hite Report place également les femmes dans une sexualité active dans le sens où « orgasmer » s’oppose à « avoir un orgasme » (p.9). Très vite en 1981, c’est l’apparition du point de Gräfenberg, très vite récupéré afin de postuler une certaine « jouissance vaginale » comme Graal de la sexualité, et donc de replacer l’homme comme seul donneur d’orgasme pour la femme.
Le mythe de l’orgasme vaginal
Cette idée renvoie à l’argument d’Anne Koedt dans Le mythe de l’orgasme vaginal, qui, revendiquant le clitoris comme étant le seul organe de la jouissance féminine, dénonce l’androcentrisme de la « sexualité conventionnelle », les femmes étant « définies sexuellement en fonction de ce qui fait jouir les hommes ; leurs physiologie propre n’a pas été proprement analysée. Au lieu de ça, on a collé le mythe de la femme émancipée avec son orgasme vaginal – un orgasme qui en fait n’existe pas. ». L’auteure encourage un renouveau sexuel en vue d’une satisfaction mutuelle et afin de « modifier cet aspect particulier de notre exploitation sexuelle courante ».
Anne Koedt dénonce cette jouissance normative comme injonction formulée par les hommes et soumettant les femmes.
Elle dénonce, tout d’abord, le mépris de Freud envers les femmes, la disqualification de l’orgasme clitoridien, l’édification à travers la médecine[2] et divers travaux[3] d’une « loi de la nature de la sexualité féminine » fondamentalement paternaliste et misogyne, fondée sur « sa propre conception de la femme comme appendice et inférieure de l’homme, et du rôle social et psychologique qui en découle ».
Elle dénonce également l’évidence spécifique, d’abord sociale et médicale, concernant le clitoris et le plaisir, connu des femmes par la masturbation et des hommes durant les préliminaires. Également le fait qu’à la parution du texte en 1968, les connaissances anatomiques acquises par la recherche n’ont pas « pour des raisons sociales été popularisées ». Elle dénonce en outre une certaine pression envers les femmes à guérir d’une maladie qui n’existe pas, pouvant « amener une femme au dernier degré de la haine de soi et de l’insécurité. Car son analyste lui raconte que le seul et unique rôle qui lui revient dans la société mâle – rôle de femme – elle n’est même pas capable de le remplir. » (p. 19)
Elle dénonce de même l’entretien de ce mythe par les hommes, et le fait de « définir strictement les femmes en fonction de leurs propres avantages » (p. 20), c’est-à-dire la pénétration, tandis que la prise en compte du clitoris[4] rendrait l’homme sexuellement facultatif.
Elle dénonce, enfin, le contrôle de la sexualité des femmes, prenant pour exemple l’excision au Moyen Orient, assurant « que les débordements sexuels seront amoindris » (p. 21) et maintenant la femme comme propriété de l’homme sous le poids de la tradition.
Réparation du clitoris et reconstruction de la sexualité chez les femmes excisées : la place du plaisir
L’article de Michela Villani et Armelle Andro, analysant le « parcours de réparation » des femmes excisées vivant en France (50 000, et 140 millions de manière mondiale), suit ce questionnement autour de la notion de « normalité » de l’appareil génital et de la sexualité. L’article révèle, par les divers témoignages, le désir de retrouver une anatomie « comme celle des autres », où la chirurgie réparatrice apparait comme une affirmation des droits sexuels, d’aptitude au plaisir : « au-delà de la seule opération physique, le processus de réparation entraîne de fait une verbalisation de l’expérience de l’excision. C’est à la fois la formulation politique en termes d’accès aux droits et la reconnaissance d’un handicap – qui peut être formulé sous divers noms et d’autres termes. Demander la « réparation » chirurgicale sert à ces femmes excisées à la fois à reconnaitre leur mutilation et exiger un droit au plaisir » (p. 41). Les différents témoignages de ces femmes excisées interrogent également « ce que l’on peut appeler une « excision culturelle », qui se manifeste dans les discours, les images, et plus généralement, les représentations de la sexualité féminine. » (p.42). Ce terme d’ « excision culturelle » (peut-être un peu excessif en ce qu’il minimise par contrecoup le degré supérieur de violence de l’excision physique), renvoie tout d’abord à ce « manque d’intérêt » de l’université à la recherche sur le plaisir féminin qui ne relèverait pas du soin, mais également de ce phénomène social de « normalisation » de l’appareil génital des femmes. Cette dimension nous rappelle les divers témoignages du documentaire Vulva 3.0 de Claudia Richarz et Ulrike Zimmermann. De la labioplastie aux vulves retouchées des photographies érotiques – encore une fois, lèvres gommées et vulves lisses – en passant par l’injection de collagène dans la structure interne du clitoris, ces phénomènes révèlent les injonctions d’une esthétique lisse et aseptisée des sexes féminins, d’une pression sociale envers les femmes qui « se doivent » de jouir de la pénétration et de se conformer aux attentes sexuelles masculines.
Sexualité féminine et consultation gynécologique : la part évincée du plaisir
En prenant appui sur une recherche qualitative consacrée à la médicalisation contemporaine du corps féminin dans le cadre de la consultation gynécologique, l’article de Laurence Guyard questionne la nature de la relation gynécologue-patiente, et ainsi le fait de « repérer les mécanismes par lesquels les femmes sont amenées à adhérer à la médicalisation de leurs corps » (p.45). L’article révèle – sans surprise – que la sexualité n’est que très rarement abordée lors d’entretiens gynécologiques, qu’il s’agisse d’un-e docteur-e femme ou homme. Le cadre de la consultation médicale nécessitant une forme de « neutralisation » de l’échange, « le corps ne fait jamais l’objet du discours lorsqu’il occupe toute la scène au moment de l’examen gynécologique et les modalités discursives et langagières répondent à une exigence de la décence morale pour évoquer la sexualité. Les parties du corps directement accessibles et engagées dans la sexualité, telles que sexe, vulve ou clitoris ne sont jamais nommées. Si le terme vagin est utilisé par les gynécologues, les femmes n’y font jamais référence. En revanche, les organes génitaux uniquement accessibles par l’acte médical ne posent pas problème à l’énonciation. Utérus, col de l’utérus, ovaires ou trompes sont évoqués sans détour par les médecins comme par les femmes ». (p. 47)
L’auteure rapporte également l’indisposition de certains gynécologues à dialoguer autour de la sexualité, par manque de temps[5] mais également à cause de leur relation existentielle et personnelle – parfois douloureuse – à la sexualité[6]. Cette indisposition étant partagée par certaines femmes interrogées, ne considérant par la consultation gynécologique comme lieu légitime pour parler sexualité. L’auteure dégage deux stratégies adoptées pour « écarter le risque de glissement du registre médical au registre sexuel » (p. 46) : placer la sexualité sous silence, et « convoquer l’autre masculin » (p. 49). L’article montre de plus que la représentation de la sexualité féminine généralisée lors de ces consultations « contribue à la reproduction des inégalités de genre en matière de sexualité. La sexualité prônée reste en effet profondément hétéro-normée, reproductive et conjugale, marquée par le primat du désir et du plaisir masculin » (« éducation » normée des gynécologues envers des jeunes patientes[7], appréhension de la sexualité féminine « à travers les enjeux de séduction » (p. 52), recours au THS [traitement hormonal substitutif] pour les douleurs/gênes/sècheresses lors de la pénétration, choix des méthodes contraceptives, influence des postulats freudiens, injonction à la maternité et à la conjugalité).
« En définissant un tel cadre normatif, les gynécologues, en entrepreneurs de la morale, exercent un contrôle sur la sexualité féminine, excluant de cette consultation des femmes aux pratiques sexuelles différentes ou confortant certaines d’entre elles dans l’idée de s’en tenir éloignées. Nous pensons notamment aux femmes lesbiennes qui, pour avoir été confrontées à des situations de lesbophobie ou par croyance dans le fait de ne pas en avoir besoin, échappent au suivi gynécologique et à la prévention[8] » (p. 56).
On recommandera également dans ce numéro l’entretien d’Emmanuelle Piet, médecin de protection materno-infantile, militante du Mouvement Français pour le planning familial et présidente du « Collectif Féministe contre le viol », soucieuse de la formation et des enjeux d’une médecine féministe.
L’Éducation nationale française : de l’égalité à la « libération sexuelle »
Par une analyse comparative de documents pédagogiques destinés à l’éducation sexuelle mis en œuvre par le Ministère de l’éducation nationale (l’un datant de 2000, l’autre de 2008), Annie Ferrand met en évidence la régression politique des guides éducatifs s’ajustant à une théorie naturaliste, mêlant biologie et psychanalyse.
Le document de 2000 adopte un point de vue sociologique et « féministe » sur la sexualité. Issus de la convention interministérielle pour « la promotion de l’égalité des chances entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes, dans le système éducatif » du 25 février 2000, il aborde les inégalités globales et sexuelles comme outil de réflexion pour une politique d’égalité. Le document propose sous forme de scénarios de la vie quotidienne, « une analyse féministe de diverses situations inégalitaires[9] » (p. 59) et recommande de lutter contre celles-ci. Le document fait également la différence entre mixité et égalité, en exposant les différents rôles sociaux présents, le sexisme implicite (voire institué) et ainsi les différentes formes de violences qui en découlent.
Le document de 2008 soutient a contrario, des thèses naturalistes et différentialistes. Il ne se situe pas dans une approche critique, et entend lutter contre les inégalités sociales par des connaissances « objectives » et « scientifiques ». Son caractère naturaliste ne permet pas d’approche politique lorsqu’il est question d’inégalités : « Il voit dans l’ordre social, l’expression de lois immuables qui protègerait du chaos (psychique, social ou anthropologique). La hiérarchie aurait une valeur positive car elle organise le social »[10] (p. 62). Ce programme relevant d’une politique d’égalité entre les sexes est dorénavant dans la politique de santé publique (sexualité comme « risques », égalité par l’acceptation des « différences » sexuelles biologiques). Le document n’évoque ni les inégalités, ni les violences sexuelles et/ou sexistes, ou alors au travers de ce que nous pourrions nommer comme champ lexical du flou[11], réduisant ces violences dans « l’exceptionnel » et non dans le « quotidien ». Le document a pour objectif d’ouvrir un débat entre filles et garçons pour révéler « les différences d’opinion et de représentations », tout en taisant les expressions courantes et violentes dans la sexualité qui, pour l’auteure, portent un enjeu politique : « Le pacte tacite selon lequel chacun-e parlerait à égalité de choses biologiques dénie le pouvoir des garçons et leurs possibles agressions verbales. » (p. 64) Les auteur-e-s du document prétendent qu’un « devoir psychique » découle d’une loi biologique (code vestimentaire féminin comme démonstration de force masculine seraient des « enjeux de séduction classiques, façon d’apprivoiser cette nouvelle place »), également d’une « spécificité anatomophysiologique qui facilitent une sexualité plus génitale pour les garçons » (« plus technique » alors que les femmes demanderait une relation, laquelle serait « amoureuse » »), mais aussi d’une loi symbolique et psychanalytique, conduisant à un « déterminisme endogène » où la pulsion déterminerait les faits sociaux.
« La position freudienne du guide est contraire à toute égalité. Mais parce qu’elle prétend dire la vérité « profonde » de la sexualité, elle apparait progressiste dans le contexte social actuel. En effet le guide reconduit une conception de l’égalité issue de ladite « libération sexuelle » […] L’idée que les femmes comme les hommes pâtiraient d’une même censure nie les inégalités entre eux, mensonge que la psychanalyse a transformé en théorie » (p. 71)
« Loin d’enseigner aux filles comment refuser cette sexualité patriarcale, il en construit l’explication psychologique. En invoquant la Loi symbolique et les lois de l’inconscient, il fait du consentement à ce sexisme un devoir. […] Réduire la lutte pour l’égalité et pour notre liberté à une politique sexuelle, puis dire la sexualité naturellement hiérarchique et sadique est un projet politique. » (p. 72)
Cette analyse comparative permet de mettre en évidence la régression des enjeux politiques de l’égalité des sexes dans les guides éducatifs à la sexualité entre 2000 et 2008. Dans une approche déterministe-naturaliste, notre devoir serait de respecter une certaine loi de la nature, mêlant biologie et psychanalyse, reconduisant ainsi une hiérarchie profonde et dite « naturelle » entre les sexes et les sexualités, où la seule ouverture vers une égalité est une prétendue équité via LA différence entre les femmes et les hommes. Dénoncé par l’auteure, ce guide représente la justification de l’idéologie patriarcale, soutenue par une caution scientifique sexiste, où la sexualité définit « ce que sont les femmes et à quoi elles servent » (p. 72).
Quand la menace d’exclusion professionnelle renforce le genre
On recommandera également dans ce numéro « Quand la menace d’exclusion professionnelle renforce le genre : représentations et identités de genre auprès de jeunes sans emploi » de Lavinia Gianettoni et Pierre Simon-Vermot. Il s’agit d’une enquête par questionnaire analysant des processus par lesquels le système de genre se trouve légitimé dans le contexte d’exclusion professionnelle. Les résultats démontrent l’adhésion des garçons aux stéréotypes de sexe, et que le sentiment de proximité aux normes masculines contribue à l’estime de soi, contrairement aux filles. Cette enquête démontre « l’interdépendance entre les rapports de domination qui structurent notre société, et rappelle la nécessité de prendre en compte l’ensemble de ceux-ci dans la lutte contre le sexisme » (p.122).
Conclusion
La sexualité féminine fait encore l’objet de nombreuses violences physiques, psychologiques, politiques et culturelles. Elle constitue un moyen de contrôle et de maintien de la domination des hommes sur les femmes, par les normes sociales, la médecine ou l’éducation, mais également d’émancipation par la réappropriation de son corps et de son plaisir.
Les luttes pour l’égalité sexuelle, qu’il s’agisse de maintenir et défendre les droits obtenus, ou d’en obtenir davantage, sont nécessaires dans une optique réaliste et quotidienne. Mais ces droits restent encore ambivalents dans la mesure où ils sont accordés par un pouvoir républicain et biomédical, qui assigne structurellement et de façon patriarcale les individus à des « genres » et à des « sexualités » réductrices. Une visée féministe devrait pourvoir articuler ces exigences réalistes à une visée plus radicale sur le long terme, qui consisterait à conquérir une société future où cette ambivalence aurait été abolie, où les formes de reconnaissance juridique ne s’accapareraient plus la question des droits de façon patriarcale.
Laura G.
[1] En 2005, première résonance magnétique du clitoris. En 2008, coupe échographique en 3 dimensions du clitoris. En 2009, première échographie du clitoris pendant le coït.
[2] « Lorsque, son époux étant un partenaire convenable, une femme ne parvient pas à l’orgasme dans le coït, et préfère la stimulation clitoridienne à toute forme d’activité sexuelle, elle peut être considérée comme frigide, et relève des soins d’un psychiatre » (Franck S. Capio, disciple contemporain de Freud, en 1953)
[3] Marie Bonaparte, De la sexualité de la femme, 1951.
[4] « Le clitoris étant à peu près identique au pénis, il se trouve, dans des sociétés diverses, beaucoup d’hommes qui essayent de l’ignorer et de privilégier le vagin […] En vérité, il est clair pour moi que les hommes craignent le clitoris comme un menace pour leurs masculinité » (p. 21)
[5] « Si elles ne parlent pas de sexualité, je ne leur en parle surtout pas parce que sinon elles en parlent longuement et pendant des heures et là c’est l’horreur » Témoignage de Dr J. (p. 48)
[6] Dans son ouvrage, le Dr Rouméas reconnaît être « passée à côté de pans entiers de l’histoire des femmes ». A ce titre elle évoque des excisions qu’elle n’a jamais remarquées, le viol subi par une de ses patientes qu’elle n’a pas pu entendre. » (p. 48)
[7] « Les gynécologues insistent beaucoup sur l’importance non seulement de se sentir respectée et en confiance avec le partenaire sexuel, mais aussi de nourrir des sentiments à son encontre » (p. 51)
[8] Genon et al. , « Pour une promotion de la santé lesbienne : état des lieux des recherches enjeux et propositions », Genre, sexualité et société, n°1.
[9] « La division sociosexuée du travail pendant les cours, l’influence des représentations stéréotypées des professeur-e-s sur les compétences respectives des filles et des garçons, ou encore le poids sur l’orientation d’un double standard de jugement portés sur les résultats scolaires des unes et des autres » (p. 59)
[10] « L’inconscient n’est ni égalitaire, ni démocratique et il reste sourd à toute éducation » (André, 1997, p. 42)
[11] « Refus de discrimination de toutes sortes » ; « la domination d’un sexe par l’autre » ; « exploitation sexuelle » ; « une personne cherche à imposer à une autre sa façon de vivre sa sexualité, transformant ainsi son ou sa partenaire en objet »
Vous aimerez aussi
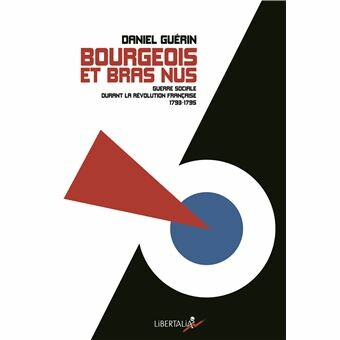
Daniel Guérin – Bourgeois et bras nus. Guerre sociale durant la Révolution française 1793-1795
16 septembre 2016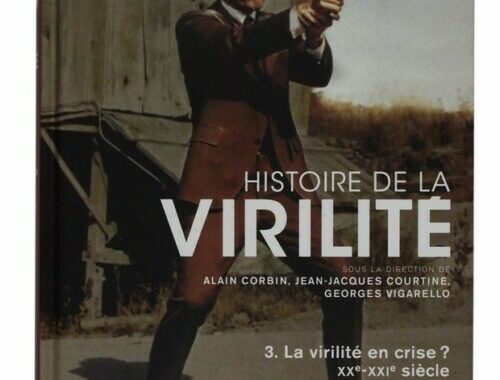
Histoire de la virilité – La virilité en crise ? Le XXème-XXIème siècle (1ère partie)
8 décembre 2016