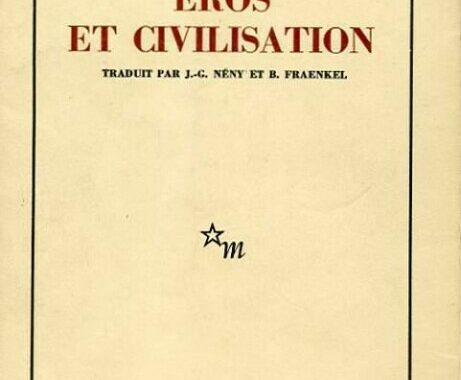Le pari de l’autonomie. Récits de luttes dans l’Espagne des années 70
Collectif, Le pari de l’autonomie. Récits de lutte dans l’Espagne des années 70, Éditions du soufflet, 2018
Les années 70 furent des années de réveil social, animées par un grand bouillonnement de révolte et de vie. Le livre Le pari de l’autonomie (d’abord publié en espagnol sous le titre Por la memoria anticapitalista. Reflexiones sobre la autonomía), récemment sorti en français aux éditions du Soufflet, raconte l’histoire tourmentée des luttes sociales dans l’Espagne des années 70, un des nombreux endroits où ce séisme révolutionnaire mondial pris un caractère plus diffus, plus étalé dans le temps mais néanmoins profond et intense.
C’est donc dans le cadre de troubles mondiaux, d’une part, et de la fin du régime de Franco en 1975 et le passage vers la « transition démocratique », libéralisation de façade du régime, d’autre part, que ce conflit s’ancre.
Les luttes sociales d’alors, lassées de l’encadrement engourdissant des structures syndicales et politiques officielles, prennent un tournant dit autonome, c’est à dire pratiquant l’auto-organisation.
La forme de la lutte change, se faisant plus directe, violente et sans concession, combattant les multiples structures du Capital et au passage réinventant la vie même.
Ce livre, constitué de récits et de réflexions, se propose de contribuer à l’entretien d’une mémoire historique de ce mouvement qui à n’en pas douter contient de riches ressources pour alimenter les combats du présent et du futur.
Dans une société où l’histoire des luttes est toujours plus effacée au profit du monologue consensuel qui ne nous dit autre chose que « le capitalisme a toujours existé et il n’y a jamais eu d’alternative », il faut considérer la mémoire de l’histoire de la révolution comme une lutte en soi, dont ce livre est résolument une munition de choix.
« Indépendance dans la prise de décision »
La politique de relance de l’industrie entamée dans les années 60 par le pouvoir franquiste entraîna une concentration de la population ouvrière dans les usines et les villes. Ces ouvriers (avec une présence importante de femmes et de jeunes), vivant dans les mêmes quartiers et travaillant dans les mêmes usines, se retrouvèrent unis par ces conditions communes, faisant émerger une conscience de classe forte, qui deviendra puissance motrice de luttes capables de faire trembler la bourgeoisie et l’Etat.
En effet, de la moitié des années 60 jusqu’au début des années 80, de très nombreuses grèves – impliquant des millions de travailleurs – déclenchées par des conditions de vie insatisfaisantes secouent l’Espagne.
Ces grèves sont marquées par une détermination forte et surtout par leur rejet du syndicat officiel de l’État (le « syndicat vertical ») ainsi que leur méfiance envers tout parti (Parti Communiste Espagnol) ou organisation politique (« avant-gardes » d’extrême-gauche ou même libertaires).
Les ouvrier.e.s préfèrent s’auto-organiser par la pratique massive des assemblées, et l’élection de leurs propres délégués, un ensemble de pratiques qui caractérise le mouvement dit de l’autonomie ouvrière.
Le Dictionnaire du militant ouvrier définit cette notion ainsi : « Autonomie : indépendance dans la prise de décision. L’autonomie du mouvement ouvrier par rapport aux partis politiques, au gouvernement ou à toute autre classe dirigeante est indispensable afin de garantir une lutte ouvrière forte et d’éviter qu’elle puisse être freinée par un contrôle trop rigide. ».
Il s’agit donc d’un saut qualitatif radicalisant le mouvement, et reprenant la pratique anarchiste traditionnelle de l’action directe, sans intermédiaire.
Le mouvement ne s’arrête pas aux usines et s’étend aussi dans la rue, lors des nombreuses manifestations où ont lieu des affrontements très violents avec la police, celle-ci tuant de nombreuses personnes.
Sur un plan plus large, cette conscience de classe ouvrière semble se traduire par une grande solidarité en actes, que ce soit sur les lieux de travail ou dans les quartiers (on note des mouvements assembléistes de quartiers), ou en réaction à la répression.
Ces luttes, si elles ont clairement fait vaciller le pouvoir et entravé le bon fonctionnement de l’économie, ne sont toutefois pas allé plus loin en sortant durablement du cadre englobant du travail, en tant que logique productive qui détermine la place d’ « ouvrier » dans la société.
La préface à l’édition espagnole, intitulée Au sujet des crises sociales, dépeint un attachement moral toujours bien enraciné à la valeur travail, et à la forme-sujet [i] du travailleur :
« L’éthique du travail, cette invention bourgeoise calviniste servant à discipliner le prolétariat, implique que travailler est la condition normale des êtres humains. La condition de l’ouvrier est pour ainsi dire sa condition naturelle. En accord avec ce concept, le travail, en plus d’être la condition absolue de la survie, est un réceptacle de valeurs : la dignité, la place de la société, l’épanouissement. Ainsi, du point de vue des « gens qui bossent », la société sans classe serait une sorte d’usine universelle. »
En effet, au-delà des manifs, des grèves, on ne voit pas ou peu dans les récits du livre, de tentatives de créer une nouvelle vie sur le long terme, dans une visée non-marchande, par exemple en détournant certains moyens de production de manière créative ou en détruisant consciemment les usines les plus nuisibles. Les assemblées, grèves, manifs etc., semblent n’être vues dans l’ensemble que comme de simples moyens dont la fin serait encore et toujours, la production marchande. Production certes réactualisée avec peut-être un meilleur sens de la répartition, mais production tout de même. L’Autonomie, dans ce sens, ne serait que partielle, temporaire, simple moyen, la fin, la production de marchandises, restant foncièrement hétéronome [ii] : soumission à l’argent et aux lois du marché.
« Détruire les prisons »
Parmi les nombreux secteurs de la société espagnole menaçant d’exploser, les prisons dans les années 70 sont au premier rang.
Dans ces lieux qui se veulent servir d’exemple pour normaliser tous les incontrôlés, la situation à l’époque est très dure, les conditions y sont abrutissantes et le niveau de conscience politique assez bas. On distingue les détenus en deux groupes : les « politiques », et les « droits-communs » (ou « prisonniers sociaux »), d’origine principalement ouvrière et largement majoritaires.
Malgré les grandes difficultés de départ, des groupes de droits-communs décident de s’organiser pour mettre fin à leur misère quotidienne.
« Nous avons commencé à des niveaux très rudimentaires, en rédigeant des tracts minuscules, écrits en tout petit, et nous profitions des transferts pour les diffuser. Nous les cachions dans les doublures des pantalons, sous les couronnes des dents, dans les endroits les plus invraisemblables, afin que l’agitation s’étende aux autres prisons de l’Etat. »
Petit à petit, la contestation grandit, une coordination nationale, la COPEL (Coordination des prisonniers en lutte) se crée, jusqu’à atteindre une ampleur incroyable en 1977 quand des soulèvements ont lieu simultanément dans près de 40 prisons du pays.
Les insurgés tiennent des « communes » où, le contrôle de la prison repris, ils s’organisent en assemblées, prennent des décisions collectives et vivent ensemble au quotidien.
La séparation entre « prisonniers sociaux » et « prisonniers politiques » est contestée, et dans le sillon du vote de la « transition démocratique » sur l’amnistie des prisonniers politiques [iii], ils réclament la grâce générale pour tous sans exception, se considérant eux aussi comme des victimes du franquisme.
Dans l’approfondissement du rejet de la séparation entre « politique » et « social », la COPEL essaye de mettre en place au sein des prisonniers sociaux une nouvelle éthique, plus consciente et révolutionnaire, voulant tuer le « prisonnier sans conscience, le caïd, qui était l’archétype du prisonnier viril, avec une mentalité mafieuse basée sur la loi du plus fort ».
Des groupes s’organisent pour creuser des tunnels, permettant aux prisonniers les plus en danger de s’évader, et les mutins s’attellent physiquement à leur objectif le plus radical : la destruction des prisons.
Après cette année 1977, les luttes continuent mais la répression frappe dur. Les détenus, de concert avec les autres composantes du mouvement social abandonnent peu à peu, pris par la fatigue, les récupérations politiciennes ou l’héroïne diffusée massivement.
Si le mouvement n’a pas abouti comme désiré à la destruction générale des prisons et que celles-ci deviennent aujourd’hui de plus en plus cauchemardesques, le mouvement des prisonniers en lutte dans l’Espagne des années 70 nous laisse néanmoins avec cette impression réconfortante que même quand tout semble perdu d’avance, dans les situations de contrôle apparemment absolu, il reste encore possible de mener des luttes d’offensive.
« Nous avons réussi à briser l’abrutissement et la folie auxquels on nous condamnait, […] nous avons démontré que nous étions capables de briser cette sentence, de vivre ensemble et de tout partager. »
« Ce sont les délinquants qui vont tout faire péter »
Parallèlement à cette agitation se développent nombre de petit groupes présentés ou se revendiquant comme des « groupes autonomes ». Ne dépendant d’aucun parti et refusant toute hiérarchie, ils se regroupent et s’organisent de leur propre initiative. Souvent émanant du mouvement ouvrier et dans une volonté de radicalisation de celui-ci, ils mènent des actions d’offensive contre les structures du pouvoir capitaliste, le champ d’action ne se limitant plus à l’usine ou au quartier mais s’étendant à la métropole capitaliste et aux milles et unes ramifications du pouvoir total de l’Économie.
Des actions offensives attaquant le capital, telles que des blocages des flux, des sabotages économiques ou encore des créations de groupes d’autodéfense armés combattant la police, sont menées. De nombreuses « expropriations », souvent sous la forme de braquages de banques, servent à financer les actions, ainsi qu’une presse révolutionnaire et des bibliothèques, et permettent à ces autonomes de vivre sans travailler. Car c’est aussi dans la vie quotidienne que se situe leur terrain de lutte, à travers le refus du travail salarié et la création d’une nouvelle vie en dehors de celui-ci. « Nous croyons que c’est dans nos propres relations que se trouve la négation du vieux monde », écrit un groupe autonome. [iv]
Avec cette démarche émerge une critique du militantisme comme pratique aliénée :
« Nous n’étions pas d’accord avec le fait de vivre pour le parti comme le faisaient les militants des organisations […]. Nous pensions que nous n’avions qu’une vie, et que nous devions faire la révolution pour nous-mêmes. Nous pensions que nous devions être les plus conséquents possible, mais que nous devions également vivre dans la joie. Nous essayons donc de vivre en révolutionnaires, en cassant les différences entre les dirigeants et les dirigés, et en vivant dans notre quotidien cette même révolution à laquelle nous aspirions. » [v]
Cette conception de la révolution casse le schéma léniniste classique de la société du travail et de ses divisions, qui voit une majorité révoltée mais trop inconsciente et individualiste, que seule une classe de spécialistes « pragmatiques » conscients de l’intérêt général peut diriger. La lutte au contraire doit devenir à la fois réalisation collective et individuelle (ou de l’individu dans le collectif). [vi]
Le refus de créer une organisation permanente, formelle, autour d’une idéologie abstraite, tient aussi de cette volonté de détruire le militantisme gauchiste et son inefficacité (ou sa nuisance) pour mener des actions réellement pertinentes pour le mouvement social. « Nous croyions en l’organisation des tâches, en l’organisation de ce que nous avions à faire et rien de plus » [vii] : « nos actions naissent des circonstances et de l’actualité » [viii]
Cette forme d’organisation permet donc une grande diversité d’actions, dans un cadre plus large que celui restreint surtout à l’usine (c’est à dire à la sphère de production des marchandises) du mouvement ouvrier. Des possibilités de combat s’ouvrent au sein des différentes sphères qui ont toute leur importance dans le fonctionnement global du capitalisme telles que sa sphère de circulation des marchandises (magasins, banques, moyens de transport, etc.) et sa sphère de reproduction des marchandises-forces de travail (vie quotidienne).
Malgré cette radicalité dans les pratiques, il semble qu’un certain attachement à une « classe ouvrière » vue comme unique sujet révolutionnaire persiste chez certains groupes (du moins parmi ceux cités dans le bouquin).
Cet ouvriérisme issu d’une longue tradition idéologique de marxisme traditionnel pousse certains à se considérer seulement comme des « groupes d’appui » [ix], subordonnés à la volonté du peuple travailleur, comme le montre par exemple ces paroles d’un « Commando Autonome Anticapitaliste » basque au sujet du « peuple des travailleurs » :
« Le peuple doit être le seul acteur direct et le seul dirigeant du processus révolutionnaire, notre fonction est de renforcer son rôle et de compléter l’action directe du peuple en armes en tirant profit des avantages qu’offre une structure clandestine, tout en nous soumettant aux directives générales élaborées par le peuple » [x]
On peut relativement comprendre cette posture dans le cadre des années 70 où existait encore une « classe ouvrière » forte et fer de lance des luttes les plus combative. Néanmoins, penser cette classe comme portant en elle-même un potentiel de dépassement du capitalisme a toujours été erroné, celle-ci se constituant d’abord à travers son appartenance au travail, catégorie fondamentale du capitalisme.
Dans ce sens, une émancipation réelle des individus composant cette classe se jouerait plus dans le refus de l’identification positive au travail, donc de l’appartenance à une classe séparée, par l’association avec d’autres secteurs de la société en lutte.
Les « groupes autonomes », dans la mesure où ils sortent de la seule lutte dans la sphère de production, se coupent du mouvement ouvrier, ne serait-ce qu’en quittant leurs lieux de travail. L’autonomie pourrait donc se penser comme mouvement indépendant, méritant une attention en soi, ceci bien sûr non dans une optique de sectionnement ou d’isolement des luttes, mais plutôt d’autonomie des luttes, se fédérant et fusionnant à l’envi selon leurs particularités propres, dans toute leur diversité.
On peut penser par exemple au mouvement de l’autonomie désirante en Italie, qui à la même époque a développé de manière plus profonde et à une échelle plus large la révolution de la vie quotidienne, et qui se pensait comme un mouvement indépendant du mouvement ouvrier.
Conclusion
À la lecture de ce livre, on est impressionné par l’énergie, la détermination et le caractère offensif de ces « années de braises ».
Stratégiquement on retient la pratique massive de méthodes de lutte radicales, refusant la représentation politique ou le militantisme classique aliénant, à travers la pratique de grèves auto-organisées, d’assemblées de lutte, et de groupes autonomes d’action et d’expérimentation.
Le domaine de la lutte s’élargit aussi en s’attaquant aux multiples facettes du capitalisme.
Aujourd’hui, avec le déclin du mouvement ouvrier, ces formes de luttes plus variées nous intéressent particulièrement. On peut voir actuellement dans le mouvement des Gilets Jaunes une nouvelle forme de lutte autonome : refusant tout direction politicienne et s’auto-organisant, il s’est formé en dehors des lieux de travail, fruit de travailleurs souvent isolés qui se sont retrouvés sur les ronds-points, en manifestation, etc.
Mais on retrouve aussi l’Autonomie dans des mouvements aussi variés que ceux des ZAD, des squats, des mouvements féministes, LGBT, etc.
Ces mouvements, comme hier, sont souvent traversés par des contradictions et notamment par un certain attachement à des revendications d’intégration au système marchand (une meilleure répartition de l’argent ou du travail chez les GJ par exemple) qui maintiennent une séparation entre moyen et fin. En effet il s’agit encore souvent seulement d’une simple autonomie de la lutte et encore peu d’une autonomie « de la vie », où l’autonomie n’est plus perçue seulement comme un moyen de lutte (un outil) mais comme l’affirmation positive sur le long terme d’une vie dont les normes ont été consciemment choisies, en dehors du travail et de l’argent.
On retrouve pourtant de possibles germes de cette « autonomie du vivant » dans toutes les luttes qui ont des aspects autonomes : dans l’auto-organisation, dans la mise en commun, dans la camaraderie révolutionnaire, dans la réappropriation de l’espace urbain, dans la destruction pure et simple de l’économie, etc. Ce sont ces germes encore souvent inconscients de leur potentialité qu’il faut développer, en les poussant toujours plus loin.
On peut voir dans la prolifération de luttes toujours plus variées, un potentiel d’entraide et d’enrichissement mutuel important, qu’il s’agit de saisir afin de développer notre autonomie.
Anonyme
[i] La forme-sujet dans le vocabulaire marxien est le « masque de caractère » (Marx) que porte un certain groupe social en fonction de sa place dans la synthèse sociale capitaliste : le masque du « travailleur », de l’ « homme », de la « femme », etc.
[ii] Autonomie, du grec autos, soi-même et de nomos, loi – se faire soi-même sa loi. Hétéronomie, du grec hétéros, autre et de nomos, loi – avoir ses lois dictées de l’extérieur.
[iii] Après la mort de Franco, le régime de la « transition démocratique » vers une « monarchie constitutionnelle » décide, pour se donner une image plus libérale, de libérer tous les « prisonniers politiques » du franquisme.
[iv] « Nosotros creemos que es en nuestras propias relatciones donde se encuentra la negaciòn del viejo mundo » – « El Porque de los grupos autónomos », Groupe autonome enfermé à la prison de La Modelo, août 1978, paru dans Communicados de la prisión de Segovia y otros llamientos a la guerra social, Muturreko burutazioak, 2000.
[v] 6Témoignage d’un ancien membre du MIL (Mouvement Ibérique de Libération), qui effectua, de 1967 à 1974 de nombreuses actions directes ainsi qu’une production théorique intéressante. (« En plein dans le MIL »).
[vi] « Le point culminant d’un groupe autonome est l’autonomie de chacun de ses membres » (« el punto culminante de un grup autónomon es la autonomía de cada uno de sus miembros ») – « Communicado a la opinión publica », Groupe autonome de Barcelone, mars 1978, paru dans Communicados de la prisión de Segovia, op. cit.
[vii] « En plein dans le MIL » dans Le pari de l’autonomie.
[viii] « Communicado a la opinión publica », op. cit.
[ix] « Sur l’agitation armée », MIL, 1972.
[x] « Introduction à une histoire du mouvement autonome assembléiste au Pays Basque » dans Le pari de l’autonomie.

Révolution, contre-révolution et guerre en Syrie
Vous aimerez aussi
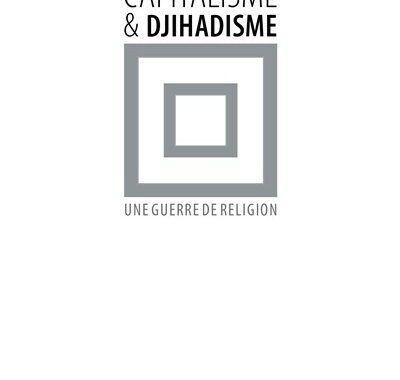
Michel Surya – Capitalisme et djihadisme. Une guerre de religion
6 septembre 2017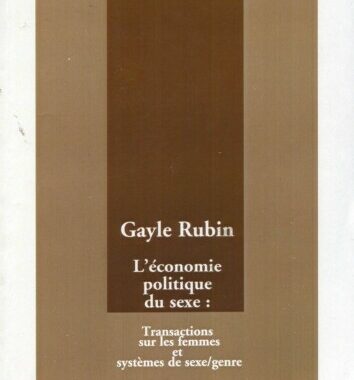
Gayle Rubin – L’économie politique du sexe
9 juillet 2017