
Giuseppe Rensi – Contre le travail
Giuseppe Rensi, Contre le travail, Paris, Allia, 2017
Les éditions Allia rééditent l’ouvrage de Giuseppe Rensi, Il lavoro, « Contre le travail », traduit de l’italien par Marie-José Tramuta. Publié en 1923, la même année qu’Histoire et conscience de classe (Lukács), cet essai propose une critique originale et radicale du travail, dont la dimension « morale » s’affirme à chaque page. Rensi, penseur subversif s’étant opposé à la droite néo-hégélienne de son temps, proposa une philosophie sceptique et post-leopardienne. Il fut condamné par contumace à 11 ans de prison, tandis qu’il dirigeait la revue Lotta di Classe, et fut évincé plus tard, en 1927, de sa chaire de philosophie morale à l’université de Gênes. En 1903, exilé en Suisse, il fut le premier député socialiste élu dans le Tessin. Il fut au sommet des avant-gardes artistiques de son époque, et reste un précurseur des situationnistes, avec ce plaidoyer contre le travail.
Les antilogies du travail
De façon cohérente, Rensi évoque d’abord la dualité du terme de « justice » qui s’impose lorsqu’on évoque la question du travail. La dite « justice » bourgeoise, qui s’impose généalogiquement par la force (expropriations), renvoie à l’injustice de la dépossession et du dénuement : l’individu au travail est dépossédé de son outil de travail, et du produit de son travail. L’extorsion d’une plus-value, condition du profit bourgeois, ajoute à cela une injustice plus explicite, institutionnalisée cyniquement. Le pseudo-contrat de travail qui relie un employeur à son employé entérine « juridiquement » une situation qui est de fait injuste, imposée par la force. Le « travailleur libre », qui ne « dispose » que de sa force de travail, ne travaille pas en fait de façon « libre », ni donc de façon « juste », mais il est contraint de se vendre, ne serait-ce que pour survivre.
Rensi n’évoque pas ces dimensions économiques dans le détail, mais sa diatribe morale contient en germe tout le scandale capitaliste relatif à la réification des individus devant travailler, réification que décrira Lukács précisément la même année. Il oppose une pseudo-justice, idéologiquement affirmée, mais imposée par la force, à une justice véridique, qui consiste à revendiquer l’émancipation à l’égard du travail. L’appareil policier et militaire dont dispose la bourgeoisie, par laquelle elle fait respecter le « droit » à la propriété privée, repose sur une violence expropriatrice et dépossédante de principe, et son monopole de la force n’est « légitime » que dans l’inversion idéologique. Qui voudrait renverser cette pseudo-justice le ferait au nom d’une justice plus impérieuse, soit celle qui reconnaît la dignité de toute personne humaine, et son droit à s’appartenir elle-même, à avoir une réelle emprise sur son activité propre.
En un certain sens, Rensi évoque ici une dissociation à l’œuvre : ce qui se dit « juste » au sein du capitalisme morbide est l’injuste en soi, socialement et pratiquement parlant. La thèse de Rensi est claire et simple : au plus cette pseudo-justice idéologique, au fil du processus économique, accompagne une réalité cyniquement et explicitement injuste, au plus elle sera combattue fermement, car un sentiment de légitimité plus fort pourra se développer dans les luttes contre « l’ordre » admis.
A la même époque, un philosophe allemand, Walter Benjamin, pourra donner une résonnance originale, « adamique », à ces intuitions de Rensi à propos de la dissociation qui vient se nicher au cœur même de la désignation des faits par les mots, dans un monde réellement inversé, où le vrai est un moment du faux :
« La dénomination adamique est si loin d’être un jeu ou un arbitraire que c’est elle, précisément, qui définit comme tel l’état paradisiaque, où il n’était pas besoin de se battre avec la valeur de communication des mots. De même qu’elles se donnent sans intention dans la dénomination, les idées doivent aussi se renouveler dans la contemplation philosophique. Dans ce renouvellement, c’est la perception originelle des mots qui se rétablit.
Et c’est ainsi que dans le cours de son histoire, qui a si souvent été un objet de railleries, la philosophie apparaît avec raison comme une lutte dont l’enjeu est la présentation d’un petit nombre de mots, toujours les mêmes – autrement dit d’idées. Il y a donc lieu de faire des réserves, à l’intérieur du domaine philosophique, sur l’introduction de terminologies nouvelles, dans la mesure où elle ne se limite pas strictement au domaine conceptuel mais vise les objets suprêmes de la contemplation. Il manque à ce genre de terminologies […] l’objectivité que l’histoire a conférée aux principales expressions caractéristiques de la contemplation philosophique. »
Walter Benjamin, préface épistémo-critique de l’Origine du drame baroque allemand.

Le travail est-il moral ou immoral ?
Le travail est à la fois considéré comme la condition morale de toute élévation spirituelle, et en même temps, puisqu’il n’est pas cette élévation contemplative, dans le temps de son déroulement, mais l’exclut, il est considéré comme un fardeau, un épuisement injustifiable, un scandale.
Il faut travailler pour s’élever à la dignité morale, nous disent les idéologues du travail, mais en même temps tout travail empêche l’exercice de cette dignité. Rensi évoque ici un système de récompenses qui fait penser au christianisme. Il ne précise pas ce fait, mais c’est bien l’éthique protestante, qui fait du travail une vertu, qui est mise en cause ici. Comme religion qui accompagne les premiers pas du capitalisme (anglicanisme), le protestantisme tente de justifier, déjà avec Luther, l’injustifiable : l’exploitation en tant que telle. Et ce, précisément, en faisant du travail une valeur morale en soi. C’est aussi plus globalement le mythe du « péché originel » qu’on peut questionner : le travail est une condamnation subie après la chute. Comme « rachat », il peut être considéré comme « moral ». Mais comme empreinte de la faute, il rappelle l’immoralité foncière de l’humain.
Plus globalement, c’est la dualité de la vie active et de la vie contemplative que Rensi envisage : seule la contemplation permet d’envisager sereinement le devoir moral, mais pour « mériter » l’accès à cette contemplation, encore faut-il avoir agi dans la sphère du travail. La souffrance de l’individu au travail le rend digne de la moralité, et finalement digne du bonheur que devrait garantir cette moralité, pour reprendre une idée du grand protestant Emmanuel Kant.
Seulement, selon Rensi, le cynisme du système bourgeois réside dans le fait que ceux qui travaillent accèdent à cette dignité morale sans jamais pouvoir accéder à la vie contemplative, si bien que leur travail est de part en part traversé par l’injustice. Ce sont les gestionnaires bourgeois qui ont « inventé » cette moralité du travail pour mieux soumettre les travailleurs, pour mieux leur faire aimer leur servitude. La « fierté », la « dignité » du travailleur, sont des sentiments pathologiquement extorqués aux travailleurs qui ne montrent qu’une seule chose : la radicale efficacité de l’idéologie bourgeoise du travail.
La dévalorisation morale du travail crée la survalorisation économique
Le raisonnement de Rensi ici est assez simple : si le travail est considéré comme une vertu, les travailleurs n’ont pas à être exigeants en ce qui concerne la rétribution monétaire, puisqu’ils devraient déjà être « bien heureux » d’être ainsi rétribué « moralement ». Mais s’il est davantage conçu comme fardeau, comme peine, comme scandale injustifiable, les travailleurs tendent à durcir leurs revendications, et la rétribution du travail doit suivre en conséquence.
Au plus la rationalisation du travail s’accroît, au plus le travailleur est disloqué subjectivement, et au plus il devient clair que le travail est une peine injustifiable. L’idéologie du travail comme « vertu » perd tout son crédit. Rensi écrit dans les années 1920 : le taylorisme se développe, et il devient toujours plus évident que le travailleur n’est qu’un appendice de la machine, laquelle cristallise des théories scientifiques qui le dépossèdent de son activité. Toujours plus, de ce fait, il apparaît que le travail est une déshumanisation, un fardeau, et en rien une « élévation morale ». De ce fait, si l’on suit la logique de Rensi, les travailleurs exigeront la revalorisation économique de leur labeur, car les dissociations idéologiques bourgeoises ne sont plus tenables. On trouve avec Rensi, de ce fait, une interprétation originale, morale, précisément, du « cercle vertueux » du fordisme.
Le juste fondement de la haine du travail
Rensi reprend ici un argument que l’on retrouvera sous la plume d’Arendt, dans La crise de la culture, et dans Condition de l’homme moderne. Le travail soumet les individus aux cycles biologiques de la survie : il assigne l’individu humain au point de vue animal de la reproduction de l’espèce. De ce fait, il le prive de ce qui le spécifie en tant qu’humain, de sa liberté et de sa spiritualité propres. Si les humains ne font que s’insérer dans une circularité répétitive de la production et de la consommation, en ne faisant que travailler, ils sont privés de la linéarité historique proprement humaine. Ils sont rejetés hors humanité et hors histoire.
Les propos de Rensi, ici, ont quelque chose d’anthropocentrique : Rensi est un penseur de son temps. Sa distinction entre la vie contemplative et le travail évoque d’antiques distinctions aristocratiques (grecques) dont il faudrait s’émanciper aujourd’hui. La société qu’il promeut, en un certain sens, serait la démocratie athénienne, moins l’esclavage. Mais ces préconisations anachroniques ne s’adaptent pas aux exigences modernes, et il faudrait peut-être critiquer cette distinction encore très « humaniste » entre la vie active et la vie contemplative (distinction que Marx lui-même, comme penseur utopiste, pouvait soutenir, ici ou là). Néanmoins, cette idée que la sphère du travail est une sphère de la survie qui abolit toute possibilité de vie libre et émancipée reste porteuse, et n’a pas perdu de son actualité.
Travail et jeu
Le jeu, tout comme l’activité artistique, scientifique ou philosophique, sont des fins en soi, qui se suffisent à elles-mêmes, selon Rensi, contrairement au travail, qui n’est qu’un moyen en vue de la survie.
La distinction entre création libre et production mécanique est ici faite implicitement : la première émancipe, et fait surgir le nouveau comme nouveau, l’irréversible, là où la seconde soumet à la nécessité implacable du « cours des choses », cyclique et répétitif. Parce qu’il n’est pas fin en soi épanouissante, mais moyen contraint, le travail est vécu comme une astreinte pure, et il doit donc être aboli. Rensi n’envisage pas ici le fait que, dans une société marchande, les activités qu’il qualifie de « fins en soi » deviennent toujours plus des moyens productifs non seulement en vue de la survie, mais aussi et surtout en vue de la valorisation de la valeur économique. Ils perdent tout désintéressement. L’art, le sport, par exemple, ne finissent par valoir que dans leur relation à l’argent qu’ils brassent.
En outre, Rensi n’aperçoit pas assez que la science et la philosophie, par exemple, comme idéologies, n’ont rien de désintéressées, mais consolident rétroactivement une situation matérielle et sociale dans laquelle le travail intellectuel, comme organe de la gestion du tout social, a intérêt à maintenir les rapports de production en place. La première section de l’Idéologie allemande indique des pistes intéressantes, à ce sujet. Mais il reste pertinent de montrer que certains individus, qui font de la philosophie ou de la science toute la journée, et sont rétribués pour cela, ne subissent pas la contrainte que d’autres travailleurs « manuels » subissent au quotidien, et conçoivent de ce fait différemment la critique radicale du travail (c’est-à-dire, peut-être : « de l’extérieur »).
Le « travail » intellectuel mérite-t-il rétribution ?
A priori, le travail intellectuel est à lui-même sa propre rétribution : il est épanouissement. Là où le travail manuel, qui écrase toujours plus les individus, exige impérieusement une rétribution à la mesure de la contrainte subie. Cela étant, il se trouve que le travail intellectuel, qui définit une « culture » légitime, implique une position sociale privilégiée, là où le travail manuel est faiblement rémunéré. Les prolétaires perdent sur les deux tableaux : on leur refuse toute « élévation spirituelle », et en outre ils connaissent le dénuement. Rensi, en socialiste cohérent, préconise la réappropriation par les prolétaires de l’activité spirituelle, et des biens produits.

Le caractère de « fin en soi » de l’homme condamne le travail
Le bourgeois achète des instruments de travail, des matières premières, et de la « force de travail », pour produire des marchandises qu’il revendra plus cher que ce qu’elles ont coûté à produire. Il fait du profit, car précisément la force de travail rapporte plus que ce qu’elle coûte : le salarié est rétribué de telle sorte qu’il pourra survivre (reproduire sa force de travail), mais il doit travailler en plus un certain nombre d’heures gratuitement.
Dans ce procès, le travailleur est triplement réifié : il ne possède pas son outil de travail, mais doit se soumettre à l’organisation technique de cet outil ; il ne possède pas le produit final ; il est exploité et disloqué subjectivement dans la production.
Il n’est plus un être humain dont la dignité consiste à se définir comme fin en soi, mais il n’est plus que moyen entre les mains du capitalisme, « ressource », « chose » exploitable, au même titre que les matières premières et instruments de travail. De ce fait, c’est l’impératif moral kantien qui est violé constamment par la société du travail ; cet impératif dit qu’il ne faut pas traiter l’autre personne simplement comme moyen, mais d’abord comme fin. Pour suivre les traces de Lukàcs (1923), on dira ici que la société bourgeoise est une société inconsciente d’elle-même, qui provoque inconsciemment sa propre dissolution : elle affirme par exemple des pures formes morales (comme les formes kantiennes) qu’elle ne fait que contredire dans la réalité des faits. Moralement parlant, de ce fait, elle désire inconsciemment son auto-abolition, et ce sont les luttes prolétaires, avec Lukács, qui viendront réaliser consciemment ce souhait bourgeois inconscient.
On trouve ici un avantage tactique certain : même du point de vue de la « légitimité morale » bourgeoise, la société bourgeoise est immorale, si bien que les individus réifiés qui viendront s’opposer à elle pourront retourner ses valeurs morales contre elle-même.
Rensi écrit ici en stratège habile. Seulement, la société bourgeoise est aussi explicitement cynique, et elle le revendique toujours plus clairement : ce sont bien les individus exploités qui doivent respecter la morale bourgeoise (respecter le bourgeois comme fin en soi), mais les bourgeois quant à eux, qui « gèrent » cette morale, sont exemptés du devoir de la servir. Le christianisme politique fait d’ailleurs exactement la même chose : c’est ainsi que Marx l’entendait, lorsqu’il disait que « la religion est l’opium du peuple ».
Travail et contemplation
La perspective ici est presque esthétique : la vie est une chose trop brève et trop miraculeuse pour être gâchée par le labeur astreignant. L’humain, jeté dans un monde aussi mystérieux et plein, est fait pour la contemplation. Le travail brise cette vocation, ce pourquoi il est insupportable.
Cet argument esthétique, voire existentiel, est important à rappeler : que chaque être humain puisse s’élever à la dignité et à la profondeur de la poésie n’est pas une exigence si extravagante, si l’on songe à quel point le simple fait de vivre est lui-même extravagant.
On songe ici encore à Arendt (Crise de la culture, chapitre sur la liberté) : toute vie, et toute vie humaine, est un événement infiniment improbable, qui vient briser la circularité des processus naturels. Un univers physique étant donné, il était infiniment improbable qu’une vie consciente se manifeste en lui. En ce sens, Arendt évoque un surgissement « miraculeux » non surnaturel, un principe d’émergence, qu’il faut protéger. Le fait de la natalité, mais aussi le fait politique, enveloppent un tel principe, et le protègent indéfiniment. Mais pour Arendt, la réduction de l’humain à l’animal laborans le ramène à des cycles répétitifs, prévisibles, et obstruent l’accès plein à ce miracle. Avec Arendt, donc, on politiserait davantage les intuitions esthétiques et existentielles de Rensi. Celles-ci hélas, peut-être, sont encore trop transhistoriques, cela étant, et ne ciblent peut-être pas assez la radicale spécificité du travail au sens moderne.
Le travail nécessaire et impossible
Pour Rensi, la finalité de l’humain est la contemplation spirituelle. C’est ainsi qu’il devient lui-même une fin en soi, d’ailleurs, et qu’il est donc respecté moralement.
Mais pour accéder à la contemplation spirituelle, encore faut-il travailler. Le travail est donc nécessaire, dans le même temps où il rend impossible ce pour quoi il est nécessaire. L’inspiration ici encore est très kantienne : il s’agit de s’élever à l’estime raisonnable de soi pour être une personne humaine en tant que telle, mais cette estime suppose le travail, qui la brise. Ici encore, on retourne les valeurs morales de la bourgeoisie contre elle-même : la bourgeoisie comme bourgeoisie ne peut sortir de ses propres antinomies, et ce n’est que par l’abolition de la société bourgeoise que de telles antinomies disparaissent. On songera ici aux propos lukácsiens relatifs aux antinomies de la pensée bourgeoise, évoqués plus haut, et développés la même année. On pourrait dire que Rensi propose ici le correspondant moral de Lukács.

Remarques finales
Cet essai de Rensi a l’originalité de poser une critique du travail d’un point de vue moral et spirituel. Mais on peut lui reprocher d’avoir une conception encore trop transhistorique du travail.
Si l’on suit les analyses du chapitre 1 du Capital, le travail n’est pas « l’essence de l’homme », ou encore une condition humaine « archaïque », contrairement à ce que tend à affirmer Rensi, en pensant par exemple conjointement le travail salarié moderne et l’esclavage antique, mais un tel travail « tout court », un tel travail « sans phrase », est bien une spécificité radicalement moderne.
En effet, la modernité capitaliste fait surgir un principe nouveau : l’accumulation des marchandises. Une marchandise est un bien qui possède une valeur d’usage et une valeur d’échange. La valeur d’échange est la forme empirique de la valeur. Le travail dans un tel contexte se dédouble en travail concret et en travail abstrait. Le travail concret, spécifique et différencié, est ce qui produit la pluralité des valeurs d’usage marchandes. Le travail abstrait, non spécifique, indifférencié, est un temps de travail moyen, qui devient la substance de la valeur des marchandises, rendant possible la détermination de leurs valeurs d’échange. Le capitaliste, en accumulant des marchandises, a pour seule finalité l’accumulation de valeur, soit l’accumulation de travail abstrait.
Or, on ne peut parler de « travail tout court » que dans une société dans laquelle on a fait du travail abstrait le principe de toute synthèse sociale : soit dans la société moderne. Dans une société précapitaliste, jamais l’idée de rassembler deux activités aussi différentes que, par exemple, le fait de produire une bombe et le fait d’écrire un poème, pour les subsumer sous un seul concept opératoire, le travail « en soi », n’aurait pu germer dans les esprits, car les synthèses sociales n’étaient pas « économiques » au sens fonctionnel (elles étaient patriarcales et théocratiques, essentiellement). Ainsi, on pouvait parler d’activités productives différenciées, ou de labeurs multiples, mais pas de « travail » en tant que tel.
Ainsi, une critique radicale du travail n’est pas la critique de l’activité humaine en vue de la survie, mais bien une critique qui cible essentiellement la modernité capitaliste. Le fait de s’en prendre à quelque travail transhistorique, concept flou à tendance « naturaliste », ne permet pas de cibler la spécificité de l’aliénation moderne, ni donc la possibilité de son dépassement. En rétroprojetant les catégories modernes sur des réalités pré-modernes, on tend à naturaliser ces catégories, et à rendre plus difficilement envisageable leur abolition.
La critique de l’économie politique est d’abord une dénaturalisation des catégories économiques modernes, chose que Rensi n’aperçoit pas assez, selon nous, en évoquant un concept de travail qui se veut trop englobant. C’est précisément la perspective morale ou spirituelle, « universellement humaine », qui recèle cet écueil.
Néanmoins, les inconvénients de cette démarche sont aussi à la mesure de ses avantages certains : en définissant des finalités morales, Rensi désigne une préhistoire humaine globalement insupportable, en particulier lorsque le capitalisme est en décomposition, préhistoire qu’il faut bien dépasser, également pour des raisons créatives et éthiques déterminées.
En conjuguant les analyses marxiennes contre le travail (Grundrisse, 1ère section du Capital) et la perspective morale de Rensi, via un principe d’ajustement et d’enrichissement mutuels, on parvient très certainement à une position d’une radicalité et d’une originalité intéressantes.
Benoît Bohy-Bunel
Vous aimerez aussi
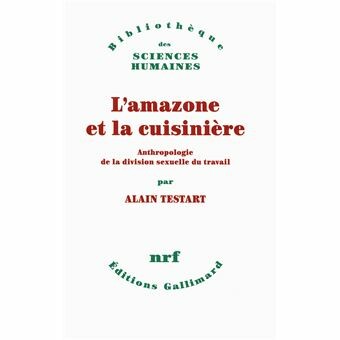
Alain Testart – L’amazone et la cuisinière. Anthropologie de la division sexuelle du travail
26 septembre 2016
Histoire de la virilité – L’invention de la virilité. De l’Antiquité aux Lumières
5 novembre 2016
