
George Caffentzis. En lettres de feu et de sang – Travail, machines et crise du capitalisme.
Publié en 2025 chez Entremonde (excepté pour le Canada, où il s’agit des Editions de la rue Dorion), cet ouvrage rassemble plusieurs essais de George Caffentzis écrits entre 1980 et 2010, présentés dans trois grandes parties : « le travail et son refus », « les machines », « l’argent, la guerre et la crise ». A propos de George Caffentzis, on trouvera des éléments de bibliographie de cet « acteur majeur » du marxisme autonome sur le très sympathique site compagnon de l’Asymétrie. On ne peut que se réjouir de cette publication en français qui permet, enfin, de découvrir et « lire en profondeur » Caffentzis.
Résumer cet ouvrage foisonnant étant hors de notre portée, nous nous contenterons ici d’identifier quelques points clés qui ont attiré notre attention, complétés par des citations directes de l’ouvrage.
Un premier aspect plaisant de ce livre réside dans l’étude du développement des sciences (mécanique, thermodynamique, informatique), indispensables à la mise au travail des travailleurs et travailleuses à différentes époques.
« Newton et ses compagnons planificateurs du « siècle de génie » ont dû créer un temps de travail non terrestre qui serait le même, l’hiver comme l’été, la nuit comme le jour, sur la terre comme au ciel. Sans cette transformation du temps, le prolongement de la journée de travail aurait été impossible à imaginer, encore moins à imposer « avec le feu et le sang ». En revanche les « révolutions » (…) par la classe ouvrière durant la première moitié du XIXe siècle ont marqué la fin d’une période où l’on pouvait créer des profits en étirant la journée de travail jusqu’à sa limite (…) Le problème n’était plus de savoir comment enfermer les travailleurs et les travailleuses le plus longtemps possible, mais comment transformer leur énergie et leur chaleur révolutionnaire en travail. Il n’est pas étonnant que la thermodynamique (…) soit devenue science après 1848 » (p. 29-30)
Ces sciences sont non seulement considérées à travers le prisme marxien, mais Caffentzis discute également (au moins dans le cas de la thermodynamique) de leur contemporanéité et de leurs relations avec les écrits de Marx. De même en ce qui concerne le lien entre les différentes théories des machines (Ure, Babbage) au XIXème siècle et la théorie des machines de Marx (dont le fameux Fragment sur les machines). A travers différents essais, Caffentzis apporte une attention particulière à l’évolution des machines depuis l’époque de Marx, identifiant une « lacune » importante mais non « fatale » à sa théorie. En effet, l’apparition de la machine de Turing (comme modèle de l’ordinateur) remet en cause, ou à tout le moins impose une actualisation, de cette théorie. L’application de la théorie de Turing pour décomposer le procès de travail en fournit une analyse nouvelle au service du capital.
« ce que cette nouvelle analyse considérait comme critique n’était pas la forme spatio-temporelle du procès de travail, mais sa structure informatique à tous les niveaux de production. Par conséquent, non seulement les parties manuelles du travail sont analysées et rendues comparables entre elles, mais les aspects intellectuels du travail pourraient également être rendus comparables à celles-ci » (p 264-265)
En d’autres termes, la machine de Turing permet de s’attaquer à ce qui apparaissait jusqu’alors comme travail qualifié, ou travail intellectuel (deux notions largement discutées par Caffentzis), en réduisant les opérations de la pensée à une succession de travaux simples (calculs, opérations ; l’ensemble formant un algorithme) comparables entre eux.
« Tout comme la thermodynamique nous donne la mesure pour comparer toutes sortes de dépenses énergétiques humaines, une analyse de la machine de Turing nous permet de percevoir la base quantitative des compétences. » (p. 254)
« Bien que les machines simples et les moteur thermiques soient des modèles évidents pour le travail manuel, le fonctionnement de la machine de Turing apparaît comme un modèle pour la pensée en tant que travail intellectuel » (p. 261)
Pour Caffentzis, une conséquence importante est qu’il n’y pas d’exceptionnalité du travail intellectuel. Autrement dit,
« Si tout activité régie par des règles est informatisable, alors tout travail répétable et standardisé (qu’il soit intellectuel ou physique) produisant des marchandises est mécanisable » (p. 276)
Nous avons d’ailleurs discuté de certaines des évolutions (appauvrissements, dégradations) du travail intellectuel dans le cas spécifique de l’ingénierie, en particulier sur l’activité de conception, dans l’une de nos émissions. Ces considérations de Caffentzis s’inscrivent dans une série de débats avec les défenseurs d’une théorie marxiste (post-opéraïste) du capital cognitif ou du travail immatériel (Negri, Hardt, Vercellone). Ces théories identifient de nouvelles contradictions au sein du capitalisme contemporain, notamment au sein des travailleurs créatifs et du savoir, qui échapperaient à l’emprise du capital, ouvrant ainsi de nouveaux horizons révolutionnaires. En défendant la non exceptionnalité du travail intellectuel, soumis à la menace de la machine de Turing, Caffentzis ébauche un avenir bien plus sombre que rieur pour ces travailleurs cognitifs.
« Il faut s’attendre (…) à une contre-attaque venant de plusieurs côtés (a) l’internationalisation des sources de « connaissances vivantes », (b) la substitution des machines (connaissances mortes) aux « connaissances vivantes » des travailleurs et travailleuses, (c) la création de nouvelles techniques de centralisation des travailleurs et travailleuses cognitifs, (d) le développement de nouveaux systèmes de mesure du travail cognitif, (e) le développement de nouvelles méthodes de paiement. Il ne faut pas trop d’imagination pour voir ce scénario se jouer dans la crise actuelle » (p. 187-188)
Ce passage quasi-prophétique résonne particulièrement aujourd’hui, du fait du développement de l’intelligence artificielle (générative ou d’un autre type). Peut-être ne s’agit-il pas ici d’un automate de Turing, mais d’une nouvelle machine (un automate statistique ?), qui nécessiterait d’étendre encore la théorie des machines proposée par Caffentzis. On ne peut en tout cas que constater avec lui, par exemple en observant les réactions des artistes (graphistes, musiciennes, écrivaine…) et scientifiques face à l’IA générative, que se rejoue la farce tragique des travailleurs et travailleuses qualifiées.
« C’est le chant de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs qualifiés tout au long de l’histoire du capitalisme « Ils ne peuvent pas me prendre mon travail ; ma contribution est incommensurable ; j’en sais trop ! » » (p. 188)
Malheureusement, si l’on en croit les apôtres de l’IA sur ses résultats bluffants, il nous faudra en déduire que si jusqu’à alors certain.e.s travailleureuses ont échappé aux machines simples, thermiques et de Turing, leur travail n’étant ni simple dépense énergétique, ni répétable, ni standardisé, leur activité créative n’en comporterait pas moins une dimension répétable et donc mécanisable, au moins dans le sens statistique et probabiliste du terme. Ce qui, pour le capital, pourrait être amplement suffisant pour capturer le savoir collectif (de « nouvelles enclosures »), produire des marchandises culturelles et scientifiques, ou tout simplement automatiser ce qui peut l’être, y compris dans les services et dans les sphères de la circulation et de la reproduction.
Un autre aspect de la théorie de Caffentzis sur les machines consiste à réaffirmer, avec Marx, que les machines (simples, thermiques mais aussi de Turing), ne créent pas de valeur. Cette affirmation s’inscrit à la fois face à celleux qui imaginent la fin du travail grâce à l’automatisation capitaliste, mais aussi face aux partisan.e.s de la théorie marxiste du capitalisme cognitif qui, sans doute, se contentent d’observer certaines tendances visibles dans les grands centres occidentaux d’accumulation capitaliste. Pour Caffentzis, l’expansion continue de machines ne peut que s’accompagner simultanément d’une expansion du travail le plus misérable. Ceci, en raison des tentatives du capital de contrer la baisse tendancielle du taux de profit due à l’introduction de machines.
« Ces causes qui contrecarrent la loi [de la baisse tendancielle du taux de profit] sont soit l’augmentation de la masse de plus-value (augmentation de l’intensité et de la durée de la journée de travail), soit la diminution de la masse du capital variable (réduction du salaire au-dessous de sa valeur, expansion du commerce extérieur), soit la réduction du capital constant (…) ou soit une combinaison de ces possibilités disjonctives » (p. 115)
C’est en combinant ces causes contraires, en particulier la pressurisation des travailleureuses par divers moyens, avec l’épineuse question de l’égalisation des taux de profits à travers différents secteurs de production capitaliste que Caffentzis démontre que «l’ordinateur a besoin de l’atelier de misère, et l’existence du cyborg s’appuie sur celle de l’esclave » (p. 126). Sous le capitalisme, l’automatisation ne peut pas être la source de la prospérité collective.
« La transformation des valeurs en prix résout le paradoxe du « zéro travail » en soulignant que le capitaliste « zéro travail », qui n’investit que dans le capital constant (machines, bâtiments et matières premières) et rien dans le capital variable (main d’œuvre) , reçoit un taux de profit moyen du à la transformation de la valeur des sphères de production qui fonctionnent avec beaucoup de capital variable (…) l’existence même de sphères de production ayant une composition organique (…) élevée (…) nécessite l’existence d’une masse de force de travail beaucoup plus importante exploitée dans les sphères de production ayant une composition organisation organique extrêmement faible » (p. 239)
Dans le premier essai qui ouvre le livre (La crise du rapport travail/énergie et l’apocalypse), Caffentzis attribue d’ailleurs à l’énergie et à la fixation de ses prix un rôle clé, à la fois pour la mise au travail et pour la répartition des profits entre différentes branches. Il se pourrait par ailleurs que ces tentatives de rétablir le taux de profit soient désormais insuffisantes, en raison d’une ponction toujours plus importante de plus-value par des services improductifs. Nous renvoyons ici à l’analyse de Jason Smith (Les capitalistes rêvent-ils de moutons électriques, Editions Grevis).
Mais alors, si tout travail humain (manuel ou intellectuel) est remplaçable par une machine mais que les machines ne créent pas de valeur, quelle est la particularité du travail humain qui permet effectivement la création de valeur ? Pour Caffentzis, il s’agit de la capacité unique à refuser la mise au travail. Ce thème parcourt l’ensemble de l’ouvrage.
« Si le travail doit créer de la valeur, mais que les machines (simples, thermiques ou de Turing) n’en créent pas, alors les capacités de création de valeur du travail doivent résider dans sa capacité négative, c’est-à-dire dans sa capacité à refuser d’être du travail » (p. 256)
« Cette analyse de création de la valeur nous permet de percevoir que la lutte des classes est à la base du mode de production capitaliste dans le domaine du travail « intellectuel » tout comme on le retrouve dans le domaine de la production physique. Elle est fondamentale, non parce qu’elle est un signe de la qualité particulière du travail intellectuel, mais parce qu’elle est simplement du travail. Bien que complexe, cette capacité de la force de travail à refuser son actualisation en travail n’est pas un aspect mystérieux de l’humanité, c’est un présupposé de l’existence la société contractuelle initiale » (p. 258)
Soulignons enfin, et c’est appréciable, que chez Caffentzis, la notion de travail créateur de valeur incorpore les théories féministes de M. Dalla Costa, S. Federici ou L. Fortunati, « la valeur est créée non seulement par le travail nécessaire à la production des marchandises, mais aussi par le travail nécessaire à la production et la reproduction de la force de travail » (p. 427). Le travail misérable, et son refus, incorporent donc de large pans du travail salarié rémunéré, mais également le travail informel et le travail reproductif non rémunéré. Le refus du travail prend ainsi des formes multiples, comme ici en 1980 :
« – le refus des « ententes de productivité » sur les chaînes de montage ;
– la désintégration de la famille et de l’appareil reproductif nécessaire à l’entrée des travailleurs et travailleuses dans le procès de production ;
– le refus d’accepter le triage d’entropie du capital, par exemple dans le système d’éducation et par l’intensification de la « criminalité » ;
– le refus d’absorber passivement l’expulsion de merde du capital dans le processus biosocial de reproduction, par exemple dans la lutte contre les prisons et celle contre les décharges radioactives .
Toutes ces formes de refus ont directement provoqué la crise des profits et le rétablissement de la rentabilité qui a suivi, « la crise énergétique ». » (p. 104)
Pour finir, mentionnons que l’ouvrage contient aussi des considérations intéressants sur les théories marxistes de la guerre (on s’autorisera ici une référence à la récente contribution à ce sujet chez Réalité) ou sur les liens entre lutte des classes, dette et crédit ; ce qui, là aussi, semble particulièrement d’actualité.
Tom
On trouvera quelques articles de George Caffentzis sur Libcom ainsi qu’une traduction (également présente dans le livre) sur le site de la revue ouvrage.
Vous aimerez aussi
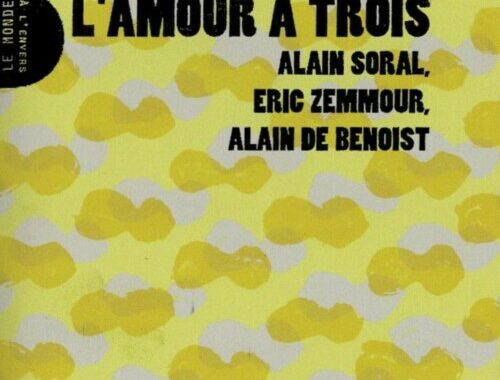
Nicolas Bonanni – L’amour à trois. Alain Soral, Eric Zemmour, Alain de Benoist
19 février 2017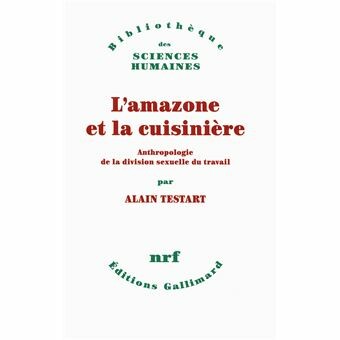
Alain Testart – L’amazone et la cuisinière. Anthropologie de la division sexuelle du travail
26 septembre 2016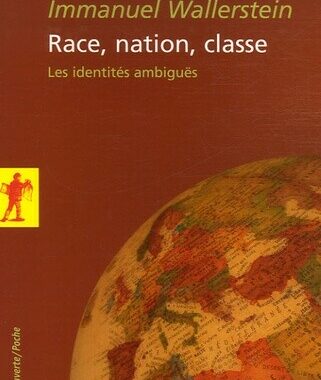


Un commentaire
Ping :